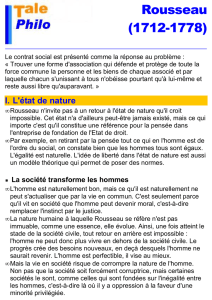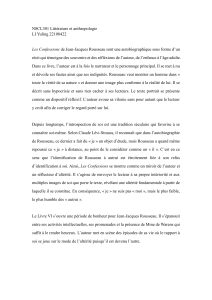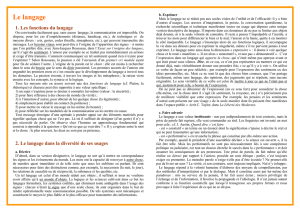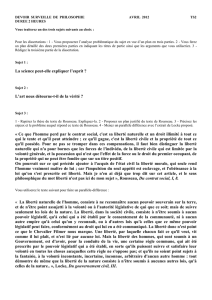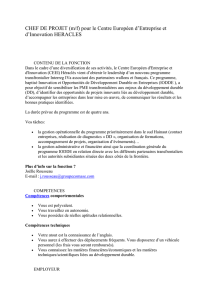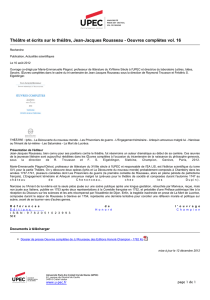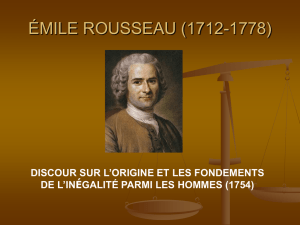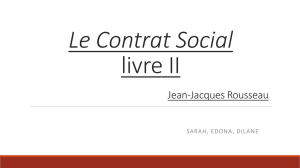1
REPUBLIQUE DU BENIN
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, TECHNIQUE
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
COLLEGE CATHOLIQUE NOTRE DAME DE LOURDES DE
PORTO-NOVO(ATTAKE)
EXPOSE SUR:
Discipline: Philosophie Classe:1ère C
Prénom et Nom de l’apprenante
Sharon OGOUDJOBI
Sous la supervision de:
Mr Cyriaque Adébayo ADJAHO
Année Académique: 2024-2025
LES CHAPITRES 5 à 8 DU LIVRE 1
DE L’ŒUVRE Du contrat social de
JEAN JACQUES ROUSSEAU

2
PLAN
INTRODUCTION
Présentation, résumé et explication des chapitres 5 à 8
du livre 1 de l’œuvre Du contrat social de Jean Jacques
ROUSSEAU
CONCLUSION

3
INTRODUCTION
L’œuvre Du Contrat Social de Jean-Jacques Rousseau, publié en
1762, est une œuvre fondamentale de la philosophie politique qui
questionne les fondements de la légitimité du pouvoir et de l'organisation
de la société. À travers cet ouvrage, Rousseau cherche à définir les bases
d'une société où la liberté et l'égalité des individus sont préservées, en
proposant un modèle de contrat social qui transforme les rapports
sociaux et politiques. Dans les chapitres 5 à 8 du Livre 1, il aborde les
principes essentiels de ce contrat et explique comment il permet de
fonder une société juste, en mettant en place une nouvelle forme de lien
social : celui de la volonté générale. À partir de ces chapitres, Rousseau
amorce la réflexion sur le passage de l'état de nature à la société civile, en
insistant sur la nécessité d’un contrat qui garantit la liberté et l'égalité.
Ainsi, la question centrale de cette analyse est la suivante : Comment
Rousseau définit-il les fondements du contrat social dans ces chapitres,
en particulier à travers ses réflexions sur la souveraineté et la loi ? Nous
verrons dans un premier temps que Rousseau consacre la souveraineté à
l’expression de la volonté générale (chapitre 5), avant de démontrer dans
un second temps que les lois issues de cette volonté générale sont
l’instrument fondamental de la liberté collective (chapitre 6). Puis, nous
soulignerons la nature indivisible et inaliénable de la souveraineté
(chapitre 7) et enfin nous explorerons les limites de cette souveraineté
qui doivent protéger les droits individuels (chapitre 8).

4
Présentation, résumé et explication des chapitres 5
à 8 du livre 1 de l’œuvre Du contrat social de Jean
Jacques ROUSSEAU
Chapitre 5: « Qu’il faut toujours remonter à une première
convention. » p.50 à 51
« Il y aura toujours une différence entre soumettre une multitude,
et régir une société. » Dans le contexte
Du Contrat Social, Rousseau
souligne, à travers ce passage qu’il existe une différence essentielle entre
l’obéissance imposée (par des tyrans, des despotes ou des conquérants)
et la gestion collective d'une communauté organisée selon des principes
de liberté et d'égalité. Le véritable gouvernement, pour Rousseau, doit
être basé sur le consentement volontaire des citoyens et leur participation
active à la création de la loi. Rousseau oppose ainsi la volonté générale
(une volonté collective partagée par tous les citoyens, qui doit guider les
lois et la politique) à la volonté de tous (la simple addition des volontés
individuelles, qui peut mener à des intérêts égoïstes ou contradictoires).
Il souligne que gouverner une société légitime n’est pas une simple affaire
de contrôle ou de soumission, mais de création d’un ordre juste et
égalitaire qui émane des citoyens eux-mêmes.
Dans le même temps, Rousseau insiste sur le fait qu'il faut remonter
à une première convention pour justifier l'établissement d'une société
civile et d’un pouvoir légitime, il fait référence à un acte fondateur qui
permet de passer de l’état de nature, où l'individu est libre mais exposé à
la violence et à l'incertitude, à une société où l’individu est soumis à un
ordre politique commun. Cette convention antérieure est celle qui
instaure le contrat social en créant les bases d'une société civilisée. Elle
permet d’établir les règles de vie commune, de réguler les relations
humaines et de garantir la liberté et l'égalité des individus au sein de la
société. En d'autres termes, cette convention est le fondement de
l’autorité légitime et de l’organisation politique. Ainsi, à travers ce
chapitre Rousseau nous fait comprendre qu'il est nécessaire de remonter
à une première convention pour comprendre l'origine de la société civile
et de l'autorité politique. Et cette convention, fondée sur un contrat
social, préserve la société à travers la volonté générale, garantissant ainsi
l'égalité et la justice sociale.

5
Chapitre 6: « Du pacte social »p.51 à 54
Dans ce chapitre, Rousseau explore les fondements du pacte social,
ce contrat originel par lequel les individus, en se réunissant en société,
abandonnent certaines libertés naturelles pour en gagner d'autres plus
grandes, au service du bien commun. Ce pacte est à la base de la création
de la société civile, permettant la formation d'une volonté générale qui,
par son autorité, assure l'égalité et la liberté des citoyens. Le pacte social
comme origine légitime de l'autorité politique, est un contrat imaginaire
mais nécessaire à l'organisation d'une société juste. Selon Rousseau, pour
qu'un individu fasse partie de la société, il doit se soumettre à un contrat
où il accepte de renoncer à certaines libertés au profit du bien commun.
Le "pacte social" n’est pas un simple accord de convenance, mais l'acte
fondateur d'un ordre politique légitime. A travers le passage « Chacun de
nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la direction
de la volonté générale; et nous recevons en échange chaque membre
comme une partie indivisible du tout. » Rousseau souligne l’essence du
pacte social qui est le fait que chaque citoyen se soumette à la volonté
générale, ce qui signifie qu'il accepte les lois édictées collectivement.
Ainsi, il renonce à sa liberté naturelle pour obtenir une liberté civile, qui
est celle de vivre sous des lois auxquelles il a donné son consentement.
Chapitre 7: « Du Souverain » p.54 à 56
A travers ce chapitre, l’auteur poursuit l’exploration de la théorie
politique qu’il développe tout au long de son ouvrage en s’intéressant
spécifiquement à la notion de souveraineté. Ce chapitre approfondit le
concept de souveraineté populaire, que Rousseau lie de manière
indissociable à la volonté générale, et précise comment cette
souveraineté s’exerce au sein de la société civile. Le souverain, pour
Rousseau, n'est pas un individu, mais la collectivité des citoyens agissant
ensemble pour le bien commun. Il élabore une théorie de la
souveraineté radicalement démocratique en insistant sur le fait que la
souveraineté appartient toujours au peuple, exprimée par la volonté
générale, et que cette souveraineté est indivisible et inaliénable. Le
 6
6
 7
7
1
/
7
100%