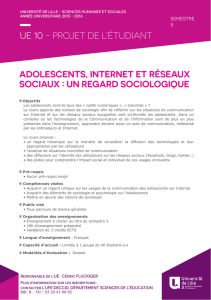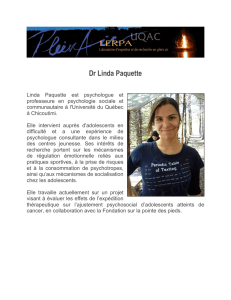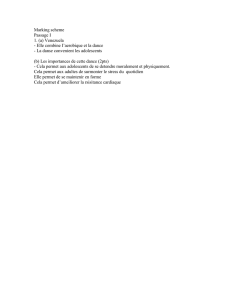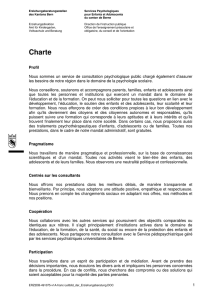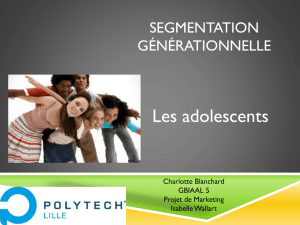que faire avec les adolescents ? 327
21. Que faire avec les adolescents ?
C’est la question que se posent de nombreux bibliothécaires de lecture publique qui
ont affaire à des adolescents : « Comment les gérer ? » En posant la question de cette
manière, ils en attendent une réponse qui, telle une recette, puisse leur apporter sécu-
rité et apaisement. Mais, à mon sens, la question posée de cette manière n’apporte pas
de réponses satisfaisantes ni efficaces. Et comme souvent, pour avoir de bonnes
réponses, il faut savoir poser de bonnes questions, je suggère plutôt la question
formulée ainsi : « Comment se comporter avec les adolescents ? » Ici, comme dans
d’autres circonstances, il ne s’agit pas de « faire », pour être efficace, mais « d’être ».
On pourrait penser a priori qu’ils y viennent pour assouvir des besoins d’ordre
documentaire, mais ce besoin est loin d’être le premier cité et perceptible dans leur
comportement. En voici quelques-uns, plus conformes à la réalité du quotidien vécu
par le personnel en service public.
Quand les adolescents apprécient de venir à la bibliothèque…
Voici quelques besoins, listés par des bibliothécaires en contact avec eux, et en lien
avec les besoins de la pyramide de Maslow :
Satisfaire des besoins physiologiques
• Être au chaud quand il pleut.
• Grignoter.
Satisfaire des besoins de sécurité
• Être au calme.
• Sortir de chez eux.
• Sortir de la pression parentale et familiale.
• Retrouver leurs racines, des références.
Satisfaire des besoins d’appartenance
• Se retrouver entre eux.
• Le plaisir : trouver une complicité.
• Pour rire.

328 regards sur les publics
• Trouver du réconfort, du lien, draguer.
• Trouver un contact.
• Suivre les copains.
Satisfaire des besoins de reconnaissance
• Qu’on leur porte de l’intérêt.
• Venir avec un petit frère ou une petite sœur pour avoir un rôle d’initiateur.
• Qu’on les accepte tels qu’ils sont, sans jugement de valeur négatif.
1. Une adolescente (ill. originale d’Héloïse de Miribel).
Satisfaire des besoins de sens
• Emmagasiner du savoir.
• Trouver un lieu où il y a des choses insolites.
• Aller dans un lieu de rencontre transgénérationnel.
• Aborder la différence.
• Retrouver les histoires d’enfance.
• Reprendre contact avec leur propre imaginaire.
Les questions que ces besoins peuvent poser aux bibliothécaires…
« Dans quelle proportion cette liste de besoins, élaborée par des professionnels,
correspond-elle réellement à leurs besoins réels ? »
« Quel type de besoins est privilégié à cet âge-là ? »
« En quoi ces besoins sont-ils en lien avec les missions de la bibliothèque ? »
« Ces besoins trouvent-ils leur satisfaction en bibliothèque ? »
« Cette satisfaction est-elle légitime en bibliothèque ? »
« En quoi la bibliothèque y répond-elle ? Les encourage-t-elle ? Ou non ? »
Toutes ces questions montrent à quel point les adolescents viennent confronter, par
leur manière toute personnelle de détourner et de s’approprier les lieux à leur usage,
les règles et la cohérence de la bibliothèque, et à quel point ils la renvoient à la cohé-
rence interne de son rôle et de ses missions.

que faire avec les adolescents ? 329
Quand les adolescents n’aiment pas venir à la bibliothèque…
Pour cibler le problème dans son ensemble, il est intéressant aussi de se demander
pourquoi les adolescents ne viennent pas en bibliothèque.
Un lieu perçu comme inadapté à leurs besoins
• Le lieu est perçu comme trop rigide (pas le droit d’y manger, par exemple).
• Peur d’être perdu, noyé.
• La bibliothèque, c’est ringard.
• Besoin d’espace.
• La bibliothèque est un autre monde.
• La bibliothèque souffre d’un manque d’ouverture et de vie.
Une attitude d’opposition à une institution
• Par esprit de contestation par rapport à une institution.
• Refus de rentrer dans le moule.
Un personnel perçu comme rigide
• Le bibliothécaire a la grosse tête.
• Il y a une différence de culture entre le bibliothécaire et eux.
• Le bibliothécaire est psychorigide.
• Le bibliothécaire est parano et Big Brother : il surveille tout et veut tout voir et
contrôler.
Ces objections, nées de la confrontation entre adolescents et bibliothécaires, sont-
elles pertinentes et justes ? Comment les bibliothécaires réagissent-ils à ces critiques ?
Sont-ils prêts à les accepter et à changer des choses dans leur comportement pour
mieux répondre à ce qui est attendu d’eux ?
Les adolescents aiment la bibliothèque pour des raisons qui leur sont personnelles
et ne l’aiment pas pour des raisons exogènes, propres à la culture du lieu.
Pourquoi se font-ils rejeter ?
En réalité, ils ne sont pas agressifs d’emblée. C’est leur attitude considérée comme
« je m’en foutiste » qui dérange. Ils se contentent d’être entre eux et d’ignorer le
monde autour d’eux. Or leur mode de vie en groupe, qui génère du bruit le plus
souvent, heurte le cadre de référence des « bons lecteurs » ou qui se jugent comme
tels, et excite la désapprobation, le mécontentement, la rancœur, l’agressivité ou la
peur non formulée de leur entourage.
À la bibliothèque de l’Alcazar1, « ces manières collectives de travailler font inter-
venir les pratiques spatiales et langagières qui caractérisent les groupes de pairs.
1. Elsa Zotian, « Modes d’usage et d’appropriation : l’exemple des enfants de Belsunce à la bibliothèque
de l’Alcazar », Bulletin des bibliothèques de France, t. 51, n° 6, 2006, pp. 68-74.

330 regards sur les publics
Ainsi, un exercice effectué collectivement engendrera très souvent un haussement de
ton et un ensemble de micro-déplacements d’un membre à l’autre du groupe, binôme
d’éléments qui, en bibliothèque, est considéré comme de l’agitation, et fait donc
parfois l’objet de sanctions (séparation des membres du groupe, intervention des
agents de sécurité, obligation d’aller se calmer dehors…) ».
2. « Maintenant, vous sortez ! » (ill. originale de Jean-Baptiste Courtin).
Et les bibliothécaires, qui se sentent, à un moment donné, obligés d’intervenir,
entrent dans leur bulle et, de ce fait, peuvent être considérés par eux comme les
premiers agressifs, surtout s’ils interviennent à partir de consignes ou de règles qu’ils
méprisent ou dont ils ne reconnaissent pas le bien-fondé.
Par leur comportement, en marge des règles implicites du bon comportement en
bibliothèque, les adolescents poussent les bibliothécaires à réagir avec plus ou moins
de doigté et à aller jusqu’à l’épreuve de force pour les obliger à s’adapter aux règles
ou à se retirer ; ce qui leur permet de garder le beau rôle : « On les a chassés alors
qu’ils n’avaient rien fait ! » Cette mini-aventure leur permet aussi de conforter leur
croyance selon laquelle les adultes, « fonctionnaires » de surcroît, sont vraiment des
« taches ».
Ils détournent et s’approprient l’espace
Comme ils arrivent en groupe, ils adoptent le comportement avantageux du nombre
par rapport à l’individu. Ce sont des conquérants. Ils s’installent en masse, de préfé-
rence dans les endroits les plus agréables ou ceux qui permettent l’interprétation la
plus libre de l’occupation des espaces : là où l’on peut s’entasser à plusieurs sur les
tables, s’empiler sur les chaises, s’agglutiner autour d’un écran…
Le taux de tolérance des membres du personnel est à ce sujet variable : certains
considèrent comme inacceptable de s’asseoir sur les tables, par exemple, et pour
d’autres, cela n’a pas d’importance.

que faire avec les adolescents ? 331
3. Skating sur la rampe (ill. originale d’Héloïse de Miribel).
Ils ignorent le monde autour d’eux
Le groupe agit comme un aimant. Ils sont dans leur bulle et ne voient littéralement
pas le monde et les autres autour d’eux. Ils ne demandent rien d’autre que d’être laissés
à eux-mêmes, mais leur invasion dérange le plus souvent les lecteurs isolés, paisibles
mais impuissants, qui étaient là « avant ». Ils ne méprisent pas d’emblée les autres
autour, ils ne les voient simplement pas. Ils les ignorent car ils n’ont pas d’importance.
Ils transgressent les règles
Leur mode de vie implique la gestion simultanée des objets cultes : la cigarette, le
portable, le soda, les cookies, le lecteur à oreillettes… Or certains d’entre eux génèrent
du bruit et de ce fait sont souvent interdits en bibliothèque. Mais ces interdictions sont
ressenties comme inacceptables car trop en contradiction avec leur mode de vie quoti-
dien. C’est comme si on demandait aux mères de famille de venir à la bibliothèque
sans leur sac à main.
Quels sont les facteurs qui aggravent la situation ?
Cette situation de « provocation passive » est une situation instable. Elle peut tout
aussi bien se diluer dans un modus vivendi accepté de part et d’autre que dégénérer en
conflit ouvert avec violences verbales et violence physique avec passage à l’acte.
Se tromper de leader du groupe
Rien de plus humiliant, pour un chef, que d’être ignoré en tant que tel. Imaginez
que dans la famille Dalton, Lucky Luke s’adresse à Averell comme au chef de la
famille, parce qu’il est le plus grand… Que ressentirait Jo ? Comment réagirait-il ?
Violemment sans aucun doute.
Comment repérer dans un groupe d’adolescents qui en est le chef, afin de pouvoir
s’adresser à lui en tant que tel ? Ce n’est pas obligatoirement le plus grand, le plus
fort, ou celui qui parle le plus. C’est celui que les autres regardent et sur lequel ils
calquent leur conduite. Il peut être silencieux et en retrait.
S’adresser au chef, d’égal à égal, avec respect, est le premier pas de la résolution
d’un conflit.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%