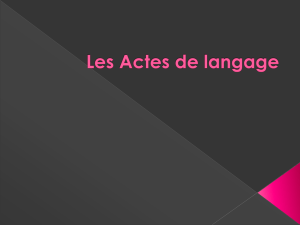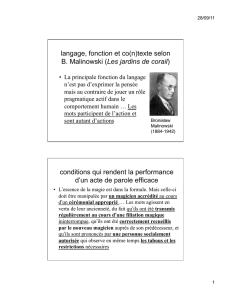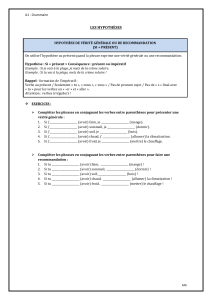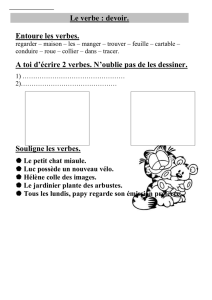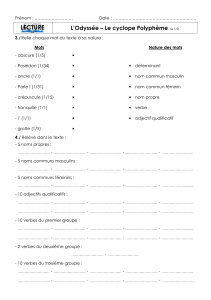Cours.02 Les actes de langage
Analyse du discours (Université Hassiba Ben Bouali de Chlef)
Scan to open on Studocu
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Cours.02 Les actes de langage
Analyse du discours (Université Hassiba Ben Bouali de Chlef)
Scan to open on Studocu
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Zonghi ([email protected])
lOMoARcPSD|43627801

1
Université Hassiba Benbouali - Chlef-
Département de français
Module : Sémantique et pragmatique du discours Enseignante : Ilhem Benadla
Niveau : 2ème année Master SDL Année universitaire :2020-2021
Les actes de langage
Un acte de langage (ou acte de parole) est un moyen mis en œuvre par un locuteur pour agir sur son
environnement par ses mots : il cherche à informer, inciter, demander, convaincre, promettre, etc. son ou ses
interlocuteurs par ce moyen.
Cette théorie, liée à la philosophie du langage ordinaire, a été développée par John L. Austin dans Quand dire
c'est faire (1962), puis par John Searle. Elle insiste sur le fait qu'outre le contenu sémantique d'une assertion (sa
signification logique, indépendante du contexte réel), un individu peut s’adresser à un autre dans l'idée de faire
quelque chose, à savoir de transformer les représentations de choses et de buts d'autrui, plutôt que de simplement
dire quelque chose : on parle alors d'un énoncé performatif, par contraste avec un énoncé constatif.
Performatifs VS Constatifs
La thèse d’Austin s’appuie sur une distinction parmi les énoncés affirmatifs entre ceux qui décrivent le monde
(constatifs) et ceux qui accomplissent une action (performatifs) :
(1) Le soleil brille.
(2) a. Je te promets que je t’emmènerai au cinéma demain.
b. Je baptise ce navire "Queen Elizabeth".
c. Je déclare la guerre au Zanzibar.
d. Je m'excuse d’être en retard.
f. Je te nomme sénateur.
g. Je te condamne à dix années de travaux.
i. Je te donne ma parole d'honneur.
Les constatifs peuvent recevoir une valeur de vérité. Les performatifs, par contre, ne peuvent pas recevoir de
valeur de vérité. Toutefois, ils peuvent être heureux ou malheureux, l’acte peut réussir ou échouer et, de même
que les valeurs de vérité attribuées aux énoncés constatifs dépendent des conditions de vérité qui leur sont
attachées, la félicité d’un énoncé performatif dépend de ses conditions de félicité.
Les conditions de félicité dépendent de l’existence de procédures conventionnelles (parfois institutionnelles :
mariage, baptême, etc.) et de leur application correcte et complète, des états mentaux appropriés ou inappropriés
Downloaded by Zonghi ([email protected])
lOMoARcPSD|43627801

2
du locuteur, du fait que la conduite ultérieure du locuteur et de l’interlocuteur soit conforme aux prescriptions
liées à l’acte de langage accompli.
Les performatifs sont constitués autour de verbes usuels qui ne "décrivent", ne "rapportent", ne constatent
absolument rien, ne sont pas "vraies ou fausses"…
Enonciation d'une phrase = exécution d'une action ou acte de dire quelque chose.
Un énoncé performatif :
-décrit une certaine action performative.
-son énonciation revient à accomplir cette action.
Exemple : Lorsque le juge d’un tribunal déclare La séance est ouverte, il accomplit un véritable acte de parole,
qui consiste à ouvrir la séance (la séance n’est réputée ouverte qu’à la suite de cette formule),
Pour nous rendre compte de l'importance de ces conditions, examinons un cas dans lequel elles ne sont pas
satisfaites. Supposons par exemple, qu'un citoyen britannique, ou français, ou roumain dise un jour à sa femme:
Avec ces paroles, je divorce d'avec toi. (1)
Certainement ce citoyen n'obtiendra pas le divorce dans ces conditions, parce qu'il n'existe pas une procédure de
ce type, conformément à laquelle en prononçant (1) on peut obtenir le divorce.
En revanche, dans la culture musulmane une telle procédure existe : en prononçant une phrase comme (1) trois
fois de suite, un mari musulman réalise, ipso facto [= par le fait même], un divorce.
À côté de ces actes de parole qui, pour s’accomplir, nécessitent un contexte social approprié, ils existent toute
une série d’actes, dits « ordinaires », que le langage accomplit sans exiger des conditions aussi spécifiques,
-Je t’ordonne de te taire
- Quelle heure est-il ?
J’accomplis, par le fait même de dire, des actes réels (ordre, question), qui prétendent influer sur mon
interlocuteur en l’amenant à faire ou à dire quelque chose.
Quelles sont les conditions pour le succès d’un acte de langage ?
Les conditions générales pour le succès d’un acte de langage sont liées aux conditions générales de
communication :
-le locuteur doit s’adresser à quelqu’un.
-son interlocuteur doit avoir compris ce qui lui a été dit dans l’énoncé correspondant à l’acte de langage.
Downloaded by Zonghi ([email protected])
lOMoARcPSD|43627801

3
Les performatifs explicites : sont des phrases qui désignent explicitement l’acte qu’elles servent à accomplir.
Exemples :
Je vous déclare unis par les liens du mariage.
Au nom de la loi, je vous arrête.
Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité.
Je vous présente mes condoléances.
Je te promets d’arrêter de fumer.
Je te conseille de venir ce soir.
Je m’excuse
Les performatifs implicites (primaires) : sont des phrases qui font référence à une convention, mais ne
désignent pas explicitement l’acte qu’elles servent à accomplir. Les performatifs implicites accomplissent les
mêmes actes que les performatifs explicites et sont paraphrasables par ceux-ci.
Exemples :
Je vais arrêter de fumer. > Je te promets d’arrêter de fumer.
Accepte. > Je te conseille d’accepter.
Je suis désolé. > Je m’excuse.
Sortez d’ici > Je vous ordonne de sortir d’ici.
-Je te promets d’arrêter de fumer (performatif explicite).
-Je vais arrêter de fumer (performatif implicite).
Limites de la distinction performatif/constatif
1- Je te promets que je t’emmènerai au cinéma demain.
2- Je t’emmènerai au cinéma demain.
La distinction performatif/constatif, basée comme elle l’est sur la distinction entre condition de félicité et
conditions de vérité, n’a pas résisté à l’examen sévère auquel Austin l’a soumis. Il a notamment remarqué qu’à
côté de performatifs explicites comme (1), il y a des performatifs implicites comme (2), qui peut aussi
correspondre à une promesse, mais où le verbe « promettre » n’est pas explicitement employé.
De plus, les constatifs correspondent à des actes de langage implicites, des actes d’assertion sont donc soumis à
des conditions de félicité, comme le sont les performatifs. Enfin, ils peuvent être comparés à leur correspondant
Downloaded by Zonghi ([email protected])
lOMoARcPSD|43627801

4
performatif explicite, comme (3), ce qui ruine définitivement la distinction performatif/constatif :
3- J’affirme que le chat est sur le paillasson.
L’opposition entre conditions de félicité et conditions de vérité n’est donc pas complète (elles peuvent se
combiner sur le même énoncé), et par contrecoup, l’opposition entre performatifs et constatifs n’est pas aussi
tranchée qu’il y a paraissait à un premier examen. Austin abandonne l'opposition énoncés constatifs et énoncés
performatifs et bâtit une nouvelle classification des actes de langage en 3 catégories :
- L'acte locutoire (= que dit-il ?) : production d'une suite de sons ayant un sens dans une langue.
Exemple : qui a gagné le tour de France cette année ?
[Acte locutionnaire = construire et prononcer la phrase interrogative]
- L'acte iIIocutoire (que fait-il ?) : acte que l’on accomplit en disant quelque chose : faire une promesse,
donner un ordre, proférer une assertion, formuler une protestation, poser une question…
- L'acte perlocutoire (pour quoi faire ?) : acte que l’on accomplit par le fait de dire quelque chose :
obliger l’interlocuteur à avouer son ignorance en matière du cyclisme, amener l’interlocuteur à allumer la
télévision, changer de sujet de conversation…etc.
Cet acte sort du cadre linguistique. L'énoncé provoque des effets (perturbations, changements) dans la situation
de communication.
-Austin conclut que toute phrase énoncée sérieusement correspond au moins à l’exécution d’un acte locutionnaire
et à celle d’un acte locutionnaire, et parfois à celle d’un acte perlocutionnaire.
Exemples :
Ne te gare pas devant l’entrée des voisins.
acte locutionnaire+ acte illocutionnaire (=ordre négatif, i. e, interdiction).
On est lundi
acte locutionnaire+ acte illocutionnaire (=assertion) + acte perlocutionnaire (=persuasion).
Taxinomie des valeurs illocutionnaires (Austin)
Austin propose une typologie des valeurs illocutionnaires, celle-ci se compose de cinq catégories établies par le
classement des verbes au moyen desquels s’expriment les actes illocutionnaires.
Les verbes verdictifs expriment un verdict, une appréciation, et correspondent souvent aux actes
juridiques : acquitter, condamner, diagnostiquer, estimer, évaluer, prononcer, supputer…
Downloaded by Zonghi ([email protected])
lOMoARcPSD|43627801
 6
6
 7
7
1
/
7
100%