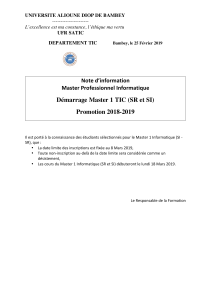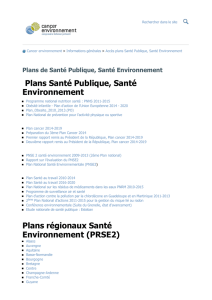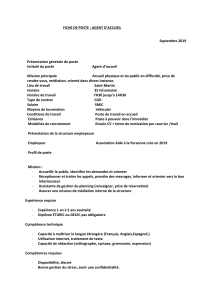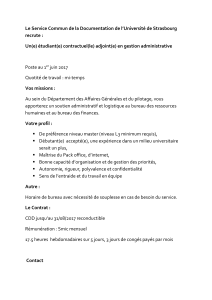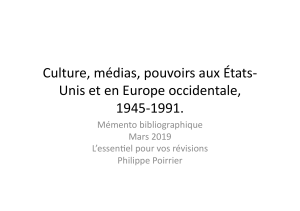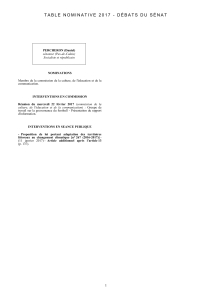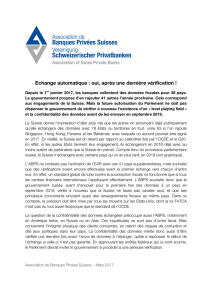Telechargé par
farajiasmaa07
Cartographie des risques et sécurité des patients en pédiatrie
publicité

Abonnez-vous à DeepL Pro pour traduire des fichiers plus volumineux. Visitez www.DeepL.com/pro pour en savoir plus. Annales de pédiatrie 97 (2022) 229---236 www.analesdepediatria.org ORIGINAL Impact de la cartographie des risques en tant que stratégie de suivi et d'amélioration de la sécurité des patients dans les services d'urgence6 Andrea Mora-Capína,∗ , Carmen Ignacio-Cerroa, Alicia Díaz-Redondob, Paula VázquezLópeza et Rafael Maran˜ón-Pardillo a a Sección de Urgencias Pediátricas, Hospital materno-infantil Gregorio Maran˜ón. Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Maran˜ón, Madrid, Espagne. b Département de médecine préventive et de gestion de la qualité. Hôpital materno-infantile Gregorio Maran˜ón, Madrid, Espagne. Reçu le 13 décembre 2021 ; Accepté le 1er mars 2022 Disponible en ligne le 13 mai 2022 MOTS CLÉS Sécurité des patients ; Gestion des risques ; médecine d'urgence pédiatrique ; Amélioration de la qualité Résumé Objectif : Concevoir une carte des risques (CR) comme outil d'identification et de gestion des risques aux urgences pédiatriques et analyser l'impact des actions d'amélioration développées sur la base des risques identifiés, sur le niveau de risque pour la sécurité des patients (SP). Méthodologie : Un groupe de travail pluridisciplinaire a revu l'ensemble du processus de soins en appliquant l'outil d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE). Phases du projet : 1a ) RM 2017 et planification des actions d'amélioration. 2a ) Développement et mise en œuvre des actions d'amélioration. 3a ) RM 2019. 4a ) Analyse : évolution du RM et impact des actions d'amélioration. Résultats : 106 modes de défaillance (MF) ont été identifiés dans le RM 2017 (54,7 % à risque élevé ou très élevé). Des critères de priorisation ont été appliqués pour sélectionner les actions d'amélioration à planifier. 19 actions d'amélioration ont été planifiées, avec des responsables et des échéances, permettant de traiter 46 FM prioritaires. 100 % d'entre elles ont été mises en œuvre. Dans la RM 2019, 110 MF ont été identifiés (48,2 % à haut risque) et une réduction globale du niveau de risque de 20 % a été visée. En analysant les 46 MF prioritaires qui avaient été traités par les 19 actions d'amélioration planifiées, il a été constaté que 60% étaient passés d'un niveau de risque élevé à un niveau de risque moyen et que le niveau de risque avait été réduit à la fois globalement (-27,8%) et ventilé par processus. 6 Le travail a été présenté lors des réunions scientifiques suivantes : XXXVII Congreso de la Sociedad Espan˜ola de Calidad Asistencial. San Sebastián. Octobre 2019. VIII Jornada AMCA, Asociación Madrilen˜a de Calidad Asistencial. Madrid. Décembre 2019. Premier prix de la meilleure communication. XXV SEUP MEETING, Société espagnole des urgences pédiatriques. Virtuel. Mars 2021. ∗ Auteur correspondant. E-mail : [email protected] (A. Mora-Capín). https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2022.03.001 1695-4033/© 2022 Asociacio'n Espan˜ola de Pediatr'ıa. Publié par Elsevier Espan˜a, S.L.U. Ceci est un article en libre accès sous licence CC BYNC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). A. Mora-Capín, C. Ignacio-Cerro, A. Díaz-Redondo et al. Conclusion : l'AMDE est un outil utile pour identifier les risques, analyser l'impact des stratégies d'amélioration et contrôler le niveau de risque d'un service clinique complexe. Les actions d'amélioration développées ont permis de réduire le niveau de risque de nos processus, améliorant ainsi le SP. © 2022 Asociacio'n Espan˜ola de Pediatr'ıa. Publié par Elsevier Espan˜a, S.L.U. Ceci est un article en libre accès sous licence CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by- ncnd/4.0/). MOTS CLÉS Sécurité des patients ; gestion des risques ; Médecine d'urgence pédiatrique ; Amélioration de la qualité Impact de la cartographie des risques en tant que stratégie de suivi et d'amélioration de la sécurité des patients dans les soins d'urgence pédiatriques Résumé Objectif : Concevoir une carte des risques comme outil d'identification et de gestion des risques dans le service des urgences pédiatriques et évaluer l'impact des actions d'amélioration développées sur la base des risques identifiés en termes de niveau de risque pour la sécurité des patients. Méthodologie : Un groupe de travail pluridisciplinaire a revu l'ensemble du processus de soins en appliquant l'outil d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE). Phases du projet : 1) RM 2017 et planification des actions d'amélioration ; 2) Développement et mise en œuvre des actions d'amélioration ; 3) RM 2019 ; 4) Analyse : évolution du RM et impact des actions d'amélioration. Résultats : Au total, 106 modes de défaillance (MF) ont été identifiés dans le RM 2017 (54,7 % à risque élevé ou très élevé). Nous avons appliqué des critères de priorisation pour sélectionner les actions d'amélioration à planifier. Dix-neuf actions d'amélioration ont été planifiées, avec des responsables et des échéances assignés, pour traiter 46 MF prioritaires. Cent pour cent d'entre elles ont été mises en œuvre. Dans le MR 2019, nous avons identifié 110 MF (48,2 % à haut risque) et constaté une réduction globale du niveau de risque de 20 %. En analysant les 46 MF prioritaires qui avaient été traités par les 19 mesures d'amélioration prévues, nous avons constaté que 60 % étaient passés d'un niveau de risque élevé à un niveau de risque moyen et que le niveau de risque avait diminué, à la fois globalement (---27,8 %) et par processus. Conclusion : l'AMDE est un outil utile pour identifier les risques, analyser l'impact des stratégies d'amélioration et contrôler le niveau de risque d'un service de soins cliniques complexe. Les actions d'amélioration développées ont permis de réduire le niveau de risque dans les processus de notre unité, améliorant ainsi la sécurité des patients. © 2022 Asociacio'n Espan˜ola de Pediatr'ıa. Publié par Elsevier Espan˜a, S.L.U. Il s'agit d'un article en libre accès sous licence CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/ 4.0/). Introduction La sécurité des patients (SP) (Matériel supplémentaire : annexe 1. Glossaire des abréviations) devrait être une priorité pour les organisations de soins de santé qui recherchent l'excellence dans les soins qu'elles prodiguent à leurs patients. On considère aujourd'hui qu'il est de leur devoir d'établir des stratégies visant à garantir la sécurité des patients par la mise en œuvre de plans de gestion des risques et de pratiques sûres visant à prévenir les événements indésirables (EI)1 . L'étude EVADUR2 (Estudio de Eventos Adversos ligados a la Asistencia en los Servicios de Urgencias de Hospitales Espan˜oles), parrainée par la Sociedad Espan˜ola de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), a révélé la situation de la PS dans les services d'urgence des hôpitaux (HED) à l'échelle nationale. Selon ses résultats, 12 % des patients vus aux urgences ont souffert d'au moins un EI, dont 70 % étaient potentiellement évitables. Les caractéristiques particulières des HED (variété et complexité des processus de soins, prise en charge simultanée d'un nombre illimité de patients présentant des pathologies de nature et de complexité différentes, peut 230 Annales de pédiatrie 97 (2022) 229---236 Le fait qu'ils aient des maladies antérieures et qu'ils soient généralement inconnus des professionnels qui s'occupent d'eux, la pression du temps et le manque d'informations cliniques pour la prise de décision, les conditions de travail et les aspects organisationnels) en font l'un des domaines de soins présentant le risque le plus élevé de SP1,3--5 . D'autre part, les patients pédiatriques présentent certaines particularités qui les rendent plus vulnérables aux EI, comme la variabilité des signes vitaux en fonction de l'âge, les caractéristiques anatomiques, physiologiques et développementales spécifiques de chaque groupe d'âge ou le calcul d e s doses de médicaments en fonction du poids corporel5 . Depuis 2014, notre unité des urgences pédiatriques (PU) travaille avec un système intégré de gestion de la qualité et de gestion des risques pour les PS, certifié selon les normes UNE-EN-ISO-9001:2015 et UNE-179003. Notre système de gestion des risques repose sur deux stratégies complémentaires : la gestion réactive des incidents signalés volontairement, par le biais d'une analyse centrée sur le système et axée sur le développement de barrières qui empêchent leur récurrence ; et la gestion proactive, qui analyse les risques potentiels ou avérés et les préjudices subis par le patient pendant le déroulement de l'incident. 231 A. Mora-Capín, C. Ignacio-Cerro, A. Díaz-Redondo et al. leur processus de soins1,6,7 , en identifiant les points critiques pour la PS dans le but d'anticiper et de mettre en œuvre des pratiques sûres qui minimisent la probabilité qu'un EI se produise. La carte des risques (CR) est un outil proactif qui permet, au moyen d'informations descriptives et d'indicateurs appropriés, d'effectuer une analyse périodique des risques d'un système et de vérifier l'efficacité des interventions programmées une fois qu'elles ont été mises en œuvre1 . Les responsables de la sécurité de l'unité avaient une expérience préalable de l'élaboration des MR et avaient utilisé l'outil d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) à petite échelle pour vérifier l'efficacité des interventions programmées une fois qu'elles avaient été mises en œuvre.8 Les responsables de la sécurité de l'unité avaient une expérience préalable dans l'élaboration des MR et avaient utilisé l'outil AMDE pour revoir certains sous-processus avec l'implication multidisciplinaire de professionnels d'autres services ("Prescription électronique" avec le service de pharmacie et "Tests microbiologiques urgents" avec le service de microbiologie). Les objectifs de ce projet étaient d'identifier et de gérer les risques d'une unité de soins intensifs d'un hôpital de soins tertiaires par le biais du développement d'un RM, ainsi que de vérifier l'impact des actions d'amélioration développées dans le SP. processus de l'unité a été examinée en appliquant la méthodologie décrite (AMDE) et en enregistrant toutes les informations dans un modèle Excel (matrice des risques ; matériel supplémentaire : annexe 3). Les sources d'information suivantes ont été utilisées pour identifier les MF : • Brainstorming, analyse et consensus des participants Méthodologie La méthodologie de l'AMDE appliquée à la carte des processus de l'UP (appendice supplémentaire BMatériel : annexe 2) a été utilisée pour concevoir le MR. Tous les processus opérationnels ont été examinés en posant trois questions : • Qu'est-ce qui peut mal tourner ? Modes de défaillance (MF) ou risques pour le plan de sécurité. • Quels effets un tel échec peut-il avoir sur le patient ? Les effets. • Pourquoi une telle défaillance peut-elle se produire ? Causes (facteurs contributifs) Classement national de la sécurité des patients Agence )9. Ensuite, chacun des MF identifiés a été évalué en notant sa fréquence (F), sa gravité (G) et sa détectabilité (D) sur une échelle de 1 à 5 (tableau 1). Sur la base de ces scores, l'indice de hiérarchisation des risques (RPI = FxGxD) a été calculé, un score qui nous permet d'estimer théoriquement le niveau de risque associé à chaque MF (tableau 2), afin de hiérarchiser la prise en charge de ceux qui ont le plus grand impact sur la PS. Phases du projet phase. Carte des risques 2017 Formation d'un groupe de travail (GT) multidisciplinaire (médecins et personnel soignant) composé de référents sécurité, de responsables qualité et de consultants de l'unité fonctionnelle de gestion des risques. Préparation du rapport de gestion 2017. La carte des 1ère 230 Annales de pédiatrie 97 229---236 de(2022) risque). • Examen des incidents déclarés par l'intermédiaire de la plateforme de communication télématique pour les incidents de sécurité et les erreurs de médication de la Communauté de Madrid. Madrid (CISEMadrid) ou lors de réunions d'information sur la sécurité10. • Expérience préalable ("e-prescribing" MRs et "Tests microbiologiques urgents". • Évaluation de l'expérience des patients (plaintes, enquêtes sur la qualité perçue et groupes de discussion11). Les notes F, G et D ont été attribuées par consensus entre tous les membres du groupe de travail. Enfin, l'IPR de chaque MF a été calculé et les MF ont été stratifiés en fonction du niveau de risque (tableau 2). Cette classification en quatre niveaux de risque selon l'IPR est tirée du document interne "Proactive Risk Management Procedure" (code GP-HGM-01), développé par l'unité fonctionnelle de gestion des risques de l'institution. Planification d'actions d'amélioration (AI) pour les MF considérés comme prioritaires en raison de leur niveau de risque (très élevé ou élevé). Des critères de priorisation ont été établis pour la mise en œuvre des AI : niveau de risque à traiter (IPR), impact potentiel de chaque AI sur la réduction globale des risques (certaines AI permettent de traiter plusieurs MF simultanément), cohérence avec les lignes stratégiques de l'organisation et faisabilité (ressources disponibles). Phase 2. Élaboration et mise en œuvre de l'AM Pour chacune des AM prévues, des responsabilités et des délais de mise en œuvre ont été attribués, avec un suivi périodique de chacune d'entre elles, comme le prévoit le système de gestion de la qualité et de gestion des risques de l'unité. phase. Carte des risques 2019 Développement du RM 2019. Le même groupe de travail qui avait rédigé le RM 2017 s'est réuni en 2019 pour mettre à jour le RM en appliquant la même méthodologie et en considérant que la mise en œuvre de nouvelles applications informatiques (outil de triage pédiatrique [TRIPED-GM], dossier de santé électronique [HCIS] et prescription électronique [FARHOS]) avait entraîné des changements dans certains processus opérationnels, ce qui pourrait conditionner de nouveaux RM. 3ème Phase 4. Analyse de l'évolution du MR Comparaison des MF identifiés en 2017/2019 : répartition par processus, stratification des risques, niveau de risque global et ventilation par processus. Vérification de la mise en œuvre des AM planifiées (à partir de RM 2017). Analyse de l'impact de l'EM mise en œuvre sur le niveau de risque pour le PS. Présentation des résultats Les variables catégorielles ont été présentées sous forme de fréquences absolues et de pourcentages. Dans chaque RM (2017 et 2019), le nombre de MF identifiés globalement et ventilés par processus a été décrit, ainsi que la stratification des risques (nombre absolu et proportion de MF classés pour chaque niveau 233 A. Mora-Capín, C. Ignacio-Cerro, A. Díaz-Redondo et al. Tableau 1 Critères de notation de la gravité (G), de la fréquence (F) et de la détectabilité (D). Tiré d'un document interne : "Procédure de gestion proactive des risques" (code GP-HGM-01) Gravité : quelle est la probabilité que le mode de défaillance ait un impact sur le patient et lui cause un préjudice grave ? Très graveMode de défaillance très critique affectant la sécurité du produit ou du système 5 Les dommages causés par un accident de la route ou par un accident de la circulation peuvent avoir des effets irréparables sur les résultats de l'organisation et sur les performances du système. Catastrophique (décès) ou dommages graves aux soins de santé de nature permanente (perte d'un membre, blessure physique ou organique pertinente de nature permanente). Mode de défaillance grave qui peut être très critique pour la sécurité du produit ou de l'appareil du processus, avec des effets qui compromettent gravement les résultats de l'organisation et la performance du système. Dommages graves aux soins de santé de nature non permanente (nécessité de soins intensifs, nécessité d'une intervention chirurgicale). Modéré Mode de défaillance d'une importance relative pour la sécurité du produit ou du système avec des effets susceptibles de compromettre les résultats de l'organisation et la performance du système. Dommages modérés aux soins de santé (nécessité d'un traitement supplémentaire, nécessité d'une procédure non chirurgicale supplémentaire, prolongation significative de la durée du séjour). Mode de défaillance faible ayant un impact sur la sécurité du produit ou 2 Les dommages causés au processus de soins de santé, qui n'affectent pas de manière significative les résultats de l'organisation ou les performances du système. Légère atteinte aux soins de santé, mais pouvant nécessiter des mesures de surveillance et d'observation. Très faible Mode de défaillance mineur, qui ne devrait pas entraîner de dommages à l'environnement. un impact réel sur les résultats de l'organisation et la performance du système. Aucun préjudice pour les soins de santé 4 3 1 Fréquence : quelle est la probabilité que le mode de défaillance se produise ? Très élevé Haut Modéré Faible Très faible Échec presque inévitable. Fréquence hebdomadaire (routine, une ou plusieurs fois par semaine) les semaines) Échec très probable. Fréquence mensuelle (une fois par mois tout le temps) 4 mois) Échec probable. Fréquence trimestrielle ou semestrielle (plusieurs fois par an) 3 Défaillance occasionnelle. Fréquence par an (au cours des 3 dernières années) 2 Défaillance isolée. Fréquence : quelques fois dans l'expérience de l'organisation 1 5 Détectabilité : quelle est la probabilité que nous puissions détecter le défaut avant qu'il n'atteigne le patient ? Nul Occasionnel Les médias détecter. Modéré Haut La défaillance ne peut pas être détectée avant que l'effet ne se produise et est 5 atteindra presque certainement le patient Le défaut est d'une nature telle qu'il est difficile de le détecter à l'aide de l'appareil de mesure. 4 les procédures établies avant de produire l'effet L'échec est détectable, éventuellement dans les derniers stades du processus, mais il n'est pas possible de le 3 échappe parfois aux contrôles et entraîne un effet indésirable. Il n'est pas toujours détecté avant que l'effet ne se produise. La défaillance, bien qu'évidente et facilement détectable, pourrait à l'occasion 2 Les contrôles ne sont pas toujours effectués de manière à échapper aux premiers contrôles, bien qu'ils soient presque toujours détectés au cours des dernières étapes du processus, avant que l'effet ne se produise. La faille est évidente. Il est très peu probable qu'elle ne soit pas détectée par l'organisme de contrôle. 1 les contrôles existants en place et arrêtés avant que l'événement indésirable ne se produise chez le patient à chacun des MF identifiés. Pour évaluer l'impact des AM, nous avons spécifiquement analysé les MF qui avaient été risque). Le niveau de risque global et du processus a été estimé par la somme et la médiane des notes IPR attribuées 232 Annales de traités pédiatrie 97 (2022) 229---236 par le biais d'AM planifiées et mises en œuvre, en comparant le profil de stratification des risques et en calculant la réduction relative du niveau de risque (somme des scores IPR de chaque MF, globalement et par processus). 233 A. Mora-Capín, C. Ignacio-Cerro, A. Díaz-Redondo et al. Tableau 2 Stratification du niveau de risque : IPR = F x G x D IPR : indice de priorité des risques ; F : fréquence ; G : gravité ; D : détectabilité : Détectabilité. 2017 Enregistrer-Classifier Assistance Urgence vitale Assister aux priorités 2 à 5 Observer Tests complémentaires Traitement Gérer la décharge GLOBAL 2019 10 10 25 31 106 110 + 11,1% + 8,3% -11,1% + 8,0% -3,1% + 13,3% + 3,8% Tableau 4 Stratification des risques. Comparaison des N◦ des modes de défaillance classés dans chaque niveau de risque dans les cartes des risques 2017 et 2019. Niveau de risque 2017 2019 Développe ments Très élevé Haut Moyen Sous TOTAL 1 0 48 0 106 55 -100% -7,1% + 14,6% + 200% + 3,8% 110 2017 2019 243 92 476 344 756 881 537 3.329 262 115 428 251 735 858 513 3.142 2017 + 7,8% + 25,0% -10,1% -27,0% -2,8% -2,6% -4,5% -5,6% 45 42 30 30 30 d'amélioration ont été appliqués. Résultats Le tableau 3 présente le nombre total de MF et leur répartition par processus, ainsi que le niveau de risque global et sa répartition par processus pour les MR de 2017 et de 2019. En 2017, 106 MR ont été identifiés, dont 54,7 % (58) ont été classés comme présentant un niveau de risque élevé (57) ou très élevé (1) (tableau 4). La gestion de ce volume de risques étant impossible, les critères de priorisation décrits dans la méthodologie de planification des stratégies 234 2019 + 20,0% + 125,0% -23,8% -11,1% -10,0% -20% -20% RPI : Indice de priorité des risques. Annales de pédiatrie 97 (2022) 229---236 Enfin, 19 AM ont été planifiées (tableau 5), ce qui a permis de traiter 46 MF prioritaires en raison de leur niveau de risque. En 2019, 110 MF ont été identifiés dont 48,2 % (53) ont été stratifiés comme étant à haut risque (tableau 4). En analysant l'évolution de nos MR, nous avons constaté que le nombre total de MF avait augmenté de 3,8 % en 2019 (110 MF contre 106 en 2017). Cependant, comme le montre le tableau de stratification des risques (tableau 4), cette augmentation s'est faite au détriment des MF classés en risque moyen et faible, le pourcentage de MF classés en risque élevé ou très élevé ayant diminué de 6,5 % (de 54,7 % en 2017 à 48,2 % en 2019). Globalement, le niveau de risque, estimé par la médiane des scores IPR, a diminué de 20 % dans la RM 2019. L'analyse processus par processus montre une réduction du niveau de risque dans tous les processus, à l'exception des processus "Enregistrer-classifier" et "Assister en cas d'urgence vitale" (tableau 3). Toutes les AM planifiées sur la base des risques identifiés en 2017 ont été mises en œuvre. Afin d'évaluer l'impact des 19 AMM élaborées, les 46 risques prioritaires (MF) auxquels les stratégies étaient censées répondre ont fait l'objet d'une analyse spécifique. Soixante pour cent des 235 A. Mora-Capín, C. Ignacio-Cerro, A. Díaz-Redondo et al. Tableau 5 Actions d'amélioration prévues dans la carte des risques 2017 ACTIONS D'AMÉLIORATION 1. Plan d'urgence sur papier (gestion des incidents informatiques) 2. Protocole d'identification univoque du patient avec système d'identification des allergies/intolérances (alimentaires et médicamenteuses) au moyen d'un autocollant (rouge/blanc) sur le bracelet d'identification du patient. 3. Développement, mise en œuvre et validation d'une nouvelle échelle de triage pédiatrique brevetée (TRIPED-GM). 4. Programme de simulation multidisciplinaire pour le travail d'équipe dans la prise en charge des enfants atteints de pathologies urgentes. 5. Répartition des rôles dans les soins aux patients en situation critique (au début de chaque équipe) 6. Récupération de la figure du "OU manager" (supervision et gestion du flux de patients dans l'OU). 7. Mise en place de la prescription électronique FARHOS (avec accès direct depuis le dossier médical électronique) dans l'UO et formation du personnel médical et infirmier (en collaboration avec le service de pharmacie). 8. Protocoles de prescription électronique avec calcul automatique de la dose et limitation de la dose maximale 9. Gilets pour minimiser les interruptions pendant la prescription/préparation des médicaments 10. Formation au protocole "right 5" pour l'administration des médicaments 11. Procédure pour les commandes verbales de médicaments dans les situations d'urgence (circuit fermé avec double vérification du médicament, de la dose et de la voie d'administration). 12. Outil SBAR pour le transfert d'informations cliniques sur les patients en attente lors des changements d'équipe 13. Ateliers sur l'humanisation et la communication efficace dans le domaine des soins de santé 14. Procédure d'extraction des échantillons biologiques (impression des autocollants et confirmation des échantillons requis avant la procédure d'extraction) 15. Registre de traçabilité des échantillons microbiologiques urgents 16. Procédure de "transfert sécurisé 17. Encadrement renforcé des médecins résidents (plan d'accueil et directeur adjoint de l'UO). 18. Ateliers sur la ponction lombaire pour les médecins résidents nouvellement recrutés 19. Application de l'outil AMDE au sous-processus "gestion de l'admission dans le service d'hospitalisation" avec une approche multidisciplinaire et la participation de la section d'hospitalisation pédiatrique et des services d'admission et de nettoyage. AMDE : Analyse des modes de défaillance et de leurs effets ; OU : Unité d'observation ; SBAR : acronyme pour "situation", "contexte", "évaluation", "recommandation". Tableau 6 Impact des actions d'amélioration développées sur les risques traités : comparaison du niveau de risque (somme des IPR) global et ventilé par processus, en considérant spécifiquement les 46 risques traités. Processus Nombre de MF Niveau de risque 2017 Enregistrer-Classifier Assistance en cas d'urgence vitale Assister aux priorités 2 à 5 Observer Tests complémentaires Traitement Gérer l'inscription GLOBAL 1 8 46 275 318 528 331 1.884 (somme des DPI) 2019 Réduire le niveau de risque 45 -16,7% -25,0% 182 189 231 438 216 1.361 -39,3% -31,3% -27,4% -17,0% -37,4% -27,8% RPI : Risk Prioritisation Index (indice de priorité des risques) ; FM : failure modes (modes de défaillance). de ces MF sont passés d'un niveau de risque "élevé" en 2017 à un niveau de risque "moyen" en 2019. Le tableau 6 montre l'impact des actions d'amélioration sur les 46 MF qui ont été traités, avec une réduction du niveau de risque à la fois au niveau global (-27,8 %) et dans l'analyse ventilée par processus. Discussion De nombreuses publications confirment l'utilité de l'AMDE en tant qu'instrument permettant d'évaluer systématiquement des processus complexes, d'identifier les zones à risque et d'évaluer les risques. 236 Annales de pédiatrie 97 (2022) 229---236 fournir une base pour la conception d'interventions qui minimisent la probabilité de survenue d'EI, contribuant ainsi à l'amélioration de la PS aux urgences1,4,12 . Certaines expériences de conception de RM dans le cadre des urgences pédiatriques ont été publiées5,7 . Cependant, comme le souligne Orrego12 , l'enthousiasme initial pour le développement de méthodologies d'analyse ne doit pas en faire le cœur de la stratégie de sécurité d'une organisation, sans garder à l'esprit que l'accent doit être mis sur les propositions d'amélioration et la refonte des processus afin d'améliorer leur sécurité. Plusieurs travaux13-16 237 A. Mora-Capín, C. Ignacio-Cerro, A. Díaz-Redondo et al. soulignent la pertinence de l'examen des scores IPR pour tester l'efficacité des actions correctives planifiées sur la base d'une AMDE13---16 . Toutefois, au niveau national, nous n'avons identifié qu'une seule étude utilisant l'AMDE pour analyser l'impact d'un ensemble de mesures d'amélioration destinées à réduire les erreurs de prescription dans un hôpital à haute résolution17 . Il s'agit donc de la première étude à appliquer l'outil AMDE en tant qu'instrument de suivi de l'évolution du niveau de risque global dans un service clinique complexe. Dans le cadre de la certification de la gestion des risques du SP (UNE-179003), la préparation et la révision périodique des RM est une stratégie proactive qui complète la gestion réactive, basée sur l'analyse des incidents signalés dans l'unité. En effet, il existe un parallélisme entre la distribution par processus des RM identifiés dans la RM (1◦ Traitement, 2◦ Tests complémentaires) et le profil des incidents signalés dans l'unité (distribution des incidents).14 (distribution La répartition des notifications par processus au cours de la période 1 de l'étude : 1◦ Traitement 35,8%, 2◦ Tests complémentaires 32,1%). Cette répartition des MF est similaire à celle décrite dans l'étude de l Les erreurs médicamenteuses conçues dans d'autres unités de soins au niveau national5,7 et est également cohérente avec la littérature, les "erreurs de médication" étant l'incident/l'EI le plus fréquent en milieu pédiatrique18,19 . La mise à jour régulière de notre RM en appliquant l'outil AMDE nous a permis de connaître l'impact des AM planifiées et de suivre l'évolution du niveau de risque de l'unité globalement et dans chacun de nos processus opérationnels. La RM 2019 a montré une augmentation du nombre total de risques par rapport à 2017, probablement liée à la refonte de certains processus en raison de la mise en œuvre de nouvelles applications informatiques (triage, dossiers médicaux électroniques et prescription électronique) qui ont donné lieu à de nouvelles MA, ainsi qu'à la formation à la méthodologie des membres du GT, qui sont de plus en plus sensibles à la détection des risques, principalement ceux de niveau moyen et faible, ce qui permet une revue de plus en plus approfondie des processus. Malgré l'augmentation du nombre total de MF, il a été constaté que le niveau de risque de l'UP a considérablement diminué en 2019, comme le montre le profil de stratification des risques (réduction de 6,5 % des MF classés comme présentant un risque élevé ou très élevé), ainsi que le niveau de risque estimé par les scores médians de l'IPR, qui a diminué de 20 % dans le RM 2019. Cette réduction globale du risque est probablement due au fait que l'adoption de mesures correctives ciblant les risques très élevés entraîne indirectement une réduction d'autres risques moins importants1 . Dans l'analyse processus par processus, le niveau de risque n'a augmenté que dans les processus "Enregistrer-classifier" et "Assister en cas d'urgence vitale". Dans le cas de "Register-classify", une MF non envisagée dans le RM 2017 est incluse (retard dans l'enregistrement administratif ; IPR 48). Dans le cas de "Assister l'urgence vitale", l'un des MF inclus dans le RM 2017 (Manque de formation à la stabilisation des patients critiques ; IPR 60) est décomposé en deux MF dans le RM 2019, compte tenu de l'implication de différents facteurs contributifs (Manque de connaissance/formation aux algorithmes de stabilisation des patients critiques ; IPR 60 et Problèmes de coordination/manque de formation au travail d'équipe ; IPR 45, ce dernier MF étant celui qui avait été inclus dans le RM 2019), compte tenu de l'implication de différents facteurs contributifs (Manque de connaissance/formation aux algorithmes de stabilisation des patients critiques ; IPR 60 et Problèmes de coordination/manque de formation au travail d'équipe ; IPR 45, ce dernier MF étant celui qui avait été inclus dans le RM 2019). 238 Annales de pédiatrie 97 229---236 de(2022) travail et de l'organisation à tenir des réunions ont été traitées par les AM planifiées). Le nombre total de MF régulières et productives (dans notre cas, chaque RM dans ce processus est maintenu car un MF disparaît dans impliquait la participation des membres du groupe de RM2019 par rapport à RM2017 ("erreur dans l'identification travail et de l'organisation).20 (dans notre cas, chaque TR des échantillons", car il est considéré comme une information impliquait cinq jours de travail pour chaque membre du en double avec le processus "tests complémentaires"). Ces GT). Enfin, s'agissant d'un projet monocentrique, les différences sont considérées comme justifiant risques identifiés dans le RM sont les suivants l'augmentation du niveau de risque dans ces processus. La plupart des AM planifiées sur la base des risques identifiés dans le RM 2017 peuvent être regroupées e n cinq blocs : utilisation sûre des médicaments, sécurité dans la réalisation des examens complémentaires, stabilisation des patients critiques, communicationtransfert d'informations cliniques et supervision des médecins résidents. En outre, d'autres pratiques sûres de nature transver- sale ont été développées, qui affectent tous les processus, comme le protocole d'identification sans équivoque des patients, le protocole de "transfert sûr" et le plan d'urgence sur papier pour faire face aux incidents informatiques. Nous pensons que la clé de la réussite de la mise en œuvre de toutes les AM planifiées réside dans les critères de priorisation, en sélectionnant les stratégies considérées comme faisables, alignées sur les lignes stratégiques de l'organisation et ayant le plus grand impact potentiel sur le niveau de risque, ainsi que dans l'attribution des responsabilités et des échéances intermédiaires de suivi. L'analyse des manuels de procédures qui ont été traités par ces AI a montré une réduction du niveau de risque global et du niveau de risque lié au processus. La diminution du niveau de risque a été obtenue grâce à deux types de stratégies : certaines visaient à réduire la probabilité qu'un MF donné se produise (la simulation du t r a v a i l e n é q u i p e multidisciplinaire, qui améliore les compétences des professionnels à travailler de manière coordonnée pendant la stabilisation d'un patient critique, ou les protocoles de prescription électronique avec calcul automatique de la dose et limitation de la dose maximale, qui réduisent le risque d'erreurs de prescription), qui réduisent le risque d'erreurs de prescription) et d'autres qui, considérant que l'"erreur" est inhérente à notre pratique clinique, visent à améliorer notre capacité à la détecter avant qu'elle n'atteigne le patient (le circuit fermé des commandes verbales de médicaments dans l a boîte vitale ou la figure du gestionnaire d'observation pour améliorer l'efficacité de l'administration des médicaments). la supervision des médecins résidents). Les points forts de ce travail résident dans l'utilisation de l'outil AMDE, non seulement avec une approche diagnostique (MR 2017) mais aussi comme un instrument de suivi qui, dans un esprit d'amélioration continue, nous permet de surveiller le niveau de risque d'un service clinique complexe, contribuant ainsi à l'amélioration du SP. Nous pensons qu'il peut être utile pour d'autres HED en fournissant des suggestions de stratégies d'amélioration, ainsi qu'un modèle de gestion des risques qui peut être exporté à d'autres services, en les adaptant aux particularités de chacun d'entre eux. L'une des limites est que l'AMDE est un exercice théorique soumis à un certain degré de subjectivité individuelle qui peut conditionner l'analyse des causes et l'évaluation du niveau de risque16 . D'autre part, l'élaboration de la RM implique un coût considérable en temps et en ressources, et son succès dépend dans une large mesure de l'engagement des membres du groupe 239 A. Mora-Capín, C. Ignacio-Cerro, A. Díaz-Redondo et al. L'étude est basée sur l'environnement et les circonstances spécifiques du service dans lequel elle est réalisée. Il serait intéressant de réaliser des études similaires dans d'autres HED disposant d'un système consolidé de gestion des risques afin de comparer les résultats. Conclusions L'élaboration d'un MR permet de détecter les points critiques pour la PS au cours du processus de soins. L'AMDE est un outil utile pour identifier les risques de PS dans les unités de soins, analyser l'impact des stratégies d'amélioration développées sur la base des risques identifiés et contrôler le niveau de risque d'un service clinique complexe. Le développement d'actions d'amélioration a eu un impact significatif sur la réduction du niveau de risque de nos processus, contribuant ainsi à l'amélioration de la PS. Annexe. Matériel supplémentaire Des informations complémentaires à cet article sont disponibles dans sa version électronique à l'adresse suivante : https://doi.org/ 10.1016/j.anpedi.2022.03.001 Bibliographie 1. Tomás Vecina S, Bueno Domínguez MJ, Chanovas Borrás M, Roqueta Egea F, SEMES Risk Map Working Group. Conception et validation d'une carte des risques pour améliorer la sécurité des patients dans les s e r v i c e s d ' urgence des hôpitaux. Trauma Fund MAPFRE. 2014;25:46---53. 2. Tomás S, Chanovas M, Roquetas F, Alcaraz J, Toranzo T, EVADUR-SEMES Working Group. EVADUR : événements indésirables liés aux soins dans les services d'urgence des hôpitaux espagnols. Emergencias. 2010;22:415---28. 3. Bleetman A, Sanusi S, Dale T, Brace S. Human factors and error prevention in emergency medicine. Emerg Med J. 2012;24:225---33. 4. Tejedor Fernández M, Montero-Pérez FJ, Min˜arro del Moral R, Gracia García F, Roig García JJ, García Moyano AM. Disen˜o e implantación de un plan de seguridad del paciente en un servicio de urgencias del hospital : cómo hacerlo ? Emergencias. 2013;25:218---27. 5. Mojica E, Izarzuagaza E, González M, Astobiza E, Benito J, Mintegi S. Elaboration d'une carte des risques dans un service d'urgence pédiatrique d'un hôpital universitaire. Emerg Med J. 2016;33:681---9. 6. Garcia MM. Risk maps. Concept et méthodologie pour son élaboration. Rev San Hig Pub. 1994;68:443---53. 7. Arias Constantí V, Rife Escudero E, Trenchs Sainz de la Maza V, Blanco González JM, Luaces Cubells C. Design of a risk map in a p a e d i a t r i c emergency department (Conception d'une carte des risques dans un service d'urgences p é d i a t r i q u e s ) . An Pediatr. 2021;S1695-4033:00134-X, http://dx.doi. org/10.1016/j.anpedi.2021.02.006. 8. Institut pour l'amélioration des soins de santé. Analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE). Institute for Healthcare Improvement. 2004 [consulté le 8 novembre 2021]. Disponible à l'adresse : http://www.ihi. org/resources/Pages/Tools/FailureModesandEffectsAnalysisTool. aspx. 9. Analyse des causes profondes. Schéma de classification des facteurs contributifs. Agence nationale pour la sécurité des patients (NPSA). National Health Service (NHS) Royaume-Uni. [consulté le 8 août 2017]. Disponible à l'adresse : https://www. seguridaddelpaciente.es/resources/documentos/tutorial gestion de riesgos/amfe clasificacion factores contribuyentes. pdf. 10. Castro-Rodríguez C, Solís-García G, Mora-Capín A, Díaz-Redondo A, Jové-Blanco A, Lorente-Romero J, et al. Briefings : A Tool to Improve Safety Culture in a Pediatric Emergency Room. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2020;46:617---22. 11. Simón-Gozalboa A, Llorente Parrado C, Díaz Redondo A, Ignacio Cerro C, Vázquez López P, Mora Capín A. Perceived quality in a hyperfrequent child population : a q u a l i t a t i v e approach. J Healthc Qual Res. 2020;35:19--26. 12. Orrego Villagran C. Analyse de la sécurité clinique et des outils d'évaluation proactive. Monographies Emergencias. 2007;3:18--21. 13. Moya Suárez AB, Mora Banderas A, Fuentes Gómez V, Sepúlveda Sánchez JM, Canca Sánchez JC. Analyse modale des défaillances et des effets dans les transferts intra-hospitaliers. J Healthc Qual Res. 2019;34:66---77. 14. Mora Capín A, Rivas García A, Maran˜ón Pardillo R, Ignacio Cerro C, Díaz Redondo A, Vázquez López P. Impact d'une stratégie d'amélioration de la qualité des soins et de la gestion des risques dans un service d'urgences pédiatriques. J Healthc Qual Res. 2019;34:78---85. 15. Arenas Jiménez JD, Ferre G, Álvarez-Ude F. Strategies to increase patient safety in haemodialysis : Application of the Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) system. Nefrología. 2017;37:608---21. 16. Prado-Mel E, Mejías Trueba M, Reyes González I, Gallego Espina MA, Martín Márquez MT, Alfaro Lara EF. Application d'une analyse des modes de défaillance et de leurs effets pour améliorer la sécurité dans l'utilisation des systèmes automatisés de distribution de médicaments. J Healthc Qual Res. 2021;36:81---90. 17. Paredes-Atenciano JA, Roldán Avin˜a JP, González García M, Blanco-Sánchez JC, Pinto-Melero MA, Pérez-Ramírez C, et al. Modal analysis of failures and effects in computerized pharmacy prescriptions. Rev Calid Asist. 2015;30:182---94. 18. Vilà de Muga M, Serrano Llop A, Rifé Escudero E, Jabalera Contreras M, Luaces Cubells C. Impact of a standardised model for incident reporting and analysis on the improvement of a paediatric emergency department (Impact d'un modèle standardisé de déclaration et d'analyse des incidents sur l'amélioration d'un service d'urgence pédiatrique). An Pediatr (Barc). 2015;83:248---56. 19. Ross M, Wallace J, Paton JY. Medication errors in a paediatric teaching hospital in the UK : Five years operational experience (Erreurs de médication dans un hôpital universitaire pédiatrique au Royaume-Uni : cinq ans d'expérience opérationnelle). Arch Dis Child. 2000;83:492---7. 20. Ashley L, Armitage G, Neary M, Hollingsworth G. Guide pratique de l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets dans les soins de santé : tirer le meilleur parti de l'équipe et de ses réunions. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2010;36:351---8. 240