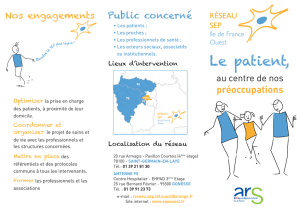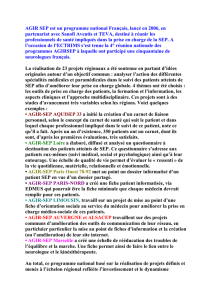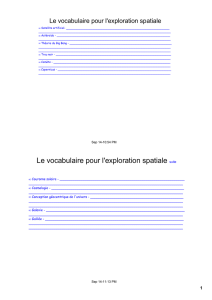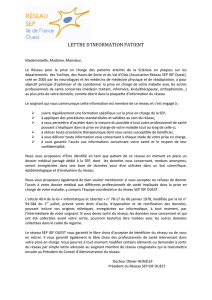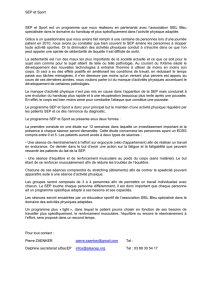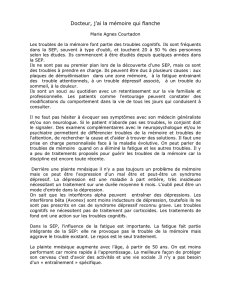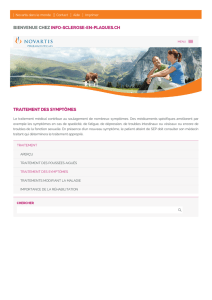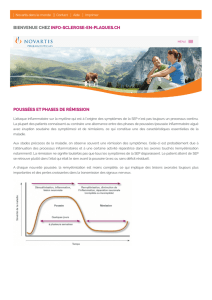Contribution à l'amélioration du sentiment de compétence par la pratique d'évaluation positive
Telechargé par
romyrabenandro

1
Année universitaire : 2023/2024
Semestre 3
Parcours : PIF ECLA
Ecole inclusive et adaptation des pratiques pédagogiques aux besoins particuliers des
enfants et adolescents
Année d’études : Master 2
Intitulé du travail : Contribution à l’amélioration du Sentiment d’Efficacité
Personnelle des élèves d’élémentaire par l’évaluation positive.
Romy Barbara RAKOTO
Numéro étudiant : 52112890
Date de remise : 06 mars 2024
Responsables de formation : Mesdames Céline Ryckebusch et Emmanuelle Vincent
Suivie par Madame Caroline Desombre

2
« La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information. »
Albert Einstein
L’écrit qui suit est le fruit des changements que j’ai subis à l’issue de ma formation. Il est également
inspiré de mon vécu personnel (remise en cause de pratiques professionnelles, les aléas de la vie
migrante que je mène, ma pathologie). J’ai longtemps été bloquée avant de décider d’écrire. Je n’ai
rien écrit à la première session. Non pas parce que la formation ne m’a rien apporté. Je dirai même
le contraire. J’en ai trop eu que je ne sais plus quoi en faire. Je ne suis pas arrivée tout simplement.
Je ne me sentais pas capable. Je me suis rendu compte que j’ai perdu la motivation, le sens de ce
que je fais. Des questionnements ont surgi en moi sur ce que je vis, où tout ceci va me mener. Je
suis en train d’expérimenter certaines des difficultés et troubles des élèves (fatigue chronique,
dyspraxie, dysphasie). J’évolue même dans un type de handicap particulier avec ma maladie
neurodégénérative. Je suis dans la peau de ces apprenants, sujets de la politique d’inclusion sociale
et scolaire. De la difficulté scolaire légère puis persistante au déficit intellectuel et ou moteur, voire
des situations de handicap, en passant par l’éventail de tous les troubles. Comment répondre à
chaque besoin particulier ? La formation et mon vécu m’ont transformée. Et la route continue.
Romy Barbara RAKOTO

3
TABLES DES MATIERES
Introduction
I. Cadre théorique ................................................................................................................... 7
1. Le Sentiment d’Efficacité Personnelle (SEP) ................................................................. 7
a. Définition .................................................................................................................... 8
b. Caractéristiques du SEP (subjective, relative, évolutive) ........................................... 9
c. Les sources du SEP ................................................................................................... 10
2. Des concepts proches .................................................................................................... 11
a. L’estime de soi .......................................................................................................... 11
i. Définition ............................................................................................................... 11
ii. Types et construction de l’estime de soi ................................................................ 12
b. La motivation scolaire ............................................................................................... 13
i. La motivation extrinsèque ..................................................................................... 14
ii. La motivation intrinsèque ...................................................................................... 15
iii. Construction et entretien de la motivation ............................................................. 15
3. L’évaluation scolaire ..................................................................................................... 16
a. Les types d’évaluation ............................................................................................... 17
i. L’évaluation diagnostique ..................................................................................... 17
ii. L’évaluation formative .......................................................................................... 17
iii. L’évaluation sommative ........................................................................................ 18
b. L’évaluation positive au cœur des apprentissages .................................................... 19
iv. Dimension psychologique et pédagogique de l’évaluation ............................... 19
v. Mise en œuvre et forme de l’évaluation positive .................................................. 20
II. Méthodologie .................................................................................................................... 21
1. Le questionnaire pour mesurer le SEP des élèves (Echelle conçue par Julien MASSON
et Fabien FENOUILLET) .................................................................................................... 21
III. Analyse des résultats ..................................................................................................... 22
IV. Discussions ................................................................................................................... 22
Bibliographie
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Les sortants du système éducatif ............................................................................. 25
Figure 2 : Le triangle pédagogique de Jean Houssaye ............................................................. 25

4
Introduction
L’éducation nationale affiche qu’en 2021, 7% des élèves quittent l’école avec 5% sans le brevet
(figure 1). Par ailleurs, 44 % des jeunes en France avouent avoir rencontré des difficultés
scolaires et 12,9 % des jeunes de 15 à 29 ans sont sans emploi ni formation ou simplement
déscolarisés selon le Sondage opinion way pour les apprentis d’Auteuil dans « Décrochage,
l’échec scolaire en hausse depuis le début de la crise » paru le 15 octobre 2021. Lutter contre
le décrochage scolaire est un défi de l’éducation nationale, voire une préoccupation nationale.
Quels sont les profils des « décrocheurs » ? Quelles peuvent en être les causes ? Relève-t-il
d’un problème structurel, institutionnel, social, ou pédagogique ? Avant de répondre à ces
interrogations, voyons de plus près le sens de décrochage scolaire. Cette expression demande
une réflexion plus poussée, une remise en question. En effet, « L’usage du terme décrocheur
n’est pas neutre » (Bernard 2014). Il insinue un jugement négatif, plus rabaissant
qu’encourageant. « Faible qualification, problèmes d’insertion professionnelle ». Dans ces
qualificatifs, la personne décrocheuse a fait preuve de lâcheté par rapport aux efforts demandés
auparavant à l’école et cela se poursuit dans son parcours professionnel. Pourtant, « Le
décrochage scolaire résulte d’une élaboration dans des espaces sociaux s’appuyant sur des
principes de légitimité. On pourrait considérer d’ailleurs la problématique du décrochage
scolaire comme une forme de reconnaissance sociale de la généralisation de la norme
d’achèvement de la scolarité que représente aujourd’hui le diplôme. » Par conséquent, il
prononce un verdict infligeant aux « décrocheurs » plusieurs fois la même peine : la perte de
l’estime dans la société et la non-conformité aux normes mises à part les difficultés
quotidiennes qu’ils rencontrent. Sont-ils vraiment les seuls responsables de cette situation ?
pour ne pas dire, est-ce un choix de leur part ? Ne faudrait-il pas tout d’abord se demander
« Quels ont été les acteurs de la diffusion de la problématique du décrochage scolaire ? Ensuite,
comment les différents acteurs en charge des jeunes sortant précocement du système éducatif
ont-ils (ou non) intégré cette désignation ? » (Bernard 2014)
Dans un article du Vue d’ensemble (Dardier, Laïb et Robert-Bobée 2013), ces élèves avaient
des difficultés scolaires dès le primaire ou étaient dans l’enseignement spécialisé et sont
transférés au collège. Ils (se) sont orientés aussitôt dans des parcours professionnalisants et la
plupart a beaucoup de mal à réussir. Ces auteurs affirment que « le niveau scolaire et les
origines sociales jouent un rôle mais pas seulement ». Concernant les origines sociales, ils
confirment la théorie de la reproduction sociale (Bourdieu et Passeron, 1964) et démontrent
l’existence des inégalités sociales dans le système éducatif et que le niveau scolaire des enfants,

5
leur réussite ou leur échec est une reproduction du vécu de leurs parents. Quant aux difficultés
scolaires, il faut tenir compte des facteurs contextuel et ou psychologique comme la motivation
selon la théorie de l’autodétermination (Deci et Ryan, 2002) et la biologie de l’attachement
(Cyrulnik, 2007). En d’autres termes, les difficultés de ces apprenants peuvent relever de
dimensions diverses telles que le social avec la précarité, la fatigue, les problèmes familiaux,
la discrimination voire l’exclusion ou le médical avec l’apparition et la fluctuation de plusieurs
maladies chroniques, pandémiques, incurables, dégénératives, neurologiques ou
psychologiques avec les traumas appelés aussi psychopathologies (Freud, 2010). Une politique
plus inclusive, multidimensionnelle rendant les acteurs, tout secteur compris, responsables de
ce phénomène serait donc plus efficiente. En France, la question de l’inclusion scolaire s’est
d’abord focalisée sur les élèves en situation de handicap pour s’étendre sur d’autres profils
d’élèves tels que enfants issus de familles migrants, primo-arrivants et allophones ainsi que les
élèves issus de familles itinérantes (Ventoso et Fumey, 2019). Les besoins éducatifs particuliers
rassemblent alors un ensemble de situations très diversifiées. La démarche inclusive doit ainsi
apporter des réponses aux pathologies chroniques, à la maîtrise insuffisante de certaines
connaissances ou compétences due à certains troubles cognitifs : « Une école est inclusive au
plan éducatif lorsque l’école tient compte des attitudes et du bien-être de chaque apprenant
dans l’apprentissage » (Brunbrouck, 2018). Elle soulève également un questionnement sur les
élèves qui ont du mal à apprendre et ont besoin de réponses adaptées à leur situation
désavantageuse face aux inégalités sociale, économique, culturelle. L’inclusion scolaire est
« un processus visant à tenir compte de la diversité des élèves et à y répondre par une
participation croissante à l’apprentissage. » (Ventoso et Fumey, 2019).
Ceci dit, les sources de difficulté scolaire peuvent relever de plusieurs dimensions. Dans ce
sens, cette étude se focalise sur un aspect psychologique de cette difficulté. Elle veut contribuer
à la prévention de ce phénomène de décrochage scolaire en s’intéressant au ressenti des élèves
ayant des difficultés quant à leur relation avec l’institution scolaire, avec l’enseignant, avec le
savoir mais surtout avec eux-mêmes en situation d’apprentissage. Elle va traiter ce qui pourrait
les bloquer en situation d’apprentissages par rapport à leur sentiment, émotion et réflexion. A
quoi faut-il penser face à un élève qui refuse ponctuellement ou systématiquement d’exécuter
la consigne ? Quel doit être le réflexe de l’enseignant ? Dans notre parcours scolaire ou
professionnel, n’avons-nous pas encore fait face à ce type de blocage ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%