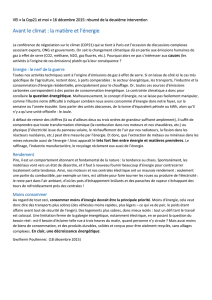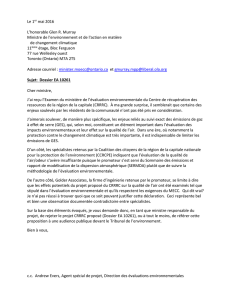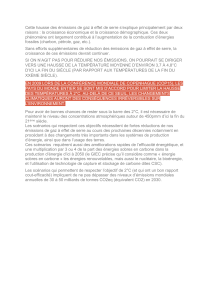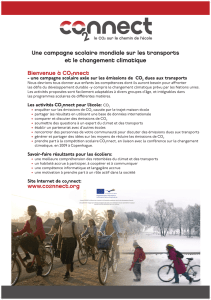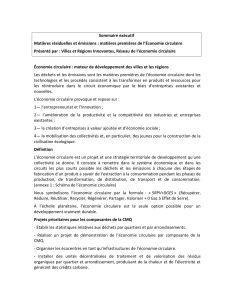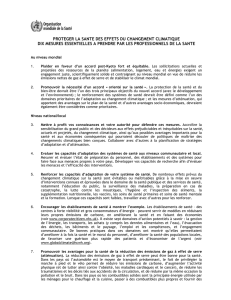Chiffres clés du climat : France, Europe, Monde - Édition 2022
Telechargé par
fatima.elaroussi

Chiffres clés du climat
France, Europe et Monde
ÉDITION 2022
L A B
T A
D A

2 – Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde
Publication disponible en HTML sur
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
Document édité par:
Le service des données
et études statistiques (SDES)
L’arrondi de la somme n’est pas toujours
égal à la somme des arrondis.
Chiffres clés du climat
France, Europe et Monde
sommaire
5 - Données clés
9 - Qu’est-ce que le changement climatique?
Cette première partie résume les principaux éléments scientifiques disponibles
sur les causes et les conséquences possibles du changement climatique.
25 - Quelles sont les quantités de gaz à effet de serre émises
danslemonde?
L’accent est ici mis sur les données les plus significatives concernant les émissions
mondiales de GES, notamment la répartition par pays et grande région du monde.
39 - Quelles sont les quantités de gaz à effet de serre émises
enEurope et en France?
Un panorama complet est proposé pour les statistiques d’émissions de GES en
Europe et en France. Ces données sont complétées par des estimations de
l’empreinte carbone des Français.
45 - Comment les émissions de GES se répartissent-elles
parsecteur en Europe et en France?
Cette partie comprend le détail de l’évolution depuis 1990 des émissions de GES
pour les grands secteurs suivants: énergie, transports, industrie,
résidentiel-tertiaire, agriculture et affectation des terres et gestion des déchets.
57 - Quelles politiques climatiques dans le monde, en Europe
etenFrance?
Les différentes politiques de lutte contre le changement climatique mises
enœuvre aux niveaux international, européen et français sont présentées dans
leurs grandes lignes.
81 - Annexes

Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde – 3
CC
AF
MB
Manuel Baude
SDES
manuel.baude@
developpement-durable.gouv.fr
Clara Calipel
I4CE-Institute for
Climate Economics
clara.calipel@i4ce.org
Alexis Foussard
SDES
alexis.foussard@
developpement-durable.gouv.fr
AC
Aurore Colin
I4CE-Institute for
Climate Economics
JD
Jérôme Duvernoy
Onerc
jerome.duvernoy@
developpement-durable.gouv.fr
contributeurs

4 – Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde
Données clés
avant-propos
C
ette édition des Chiffres clés du climat paraît
àl’occasion de la 26eConférence des parties
surles changements climatiques(COP),
quisedéroule du 1erau12novembre2021
àGlasgow sous présidence britannique,
enpartenariat avec l’Italie.
Cette publication offre un panorama des principales données liées
àl’enjeu climatique: la réalité du changement climatique et ses
impacts, les émissions de gaz à effet de serre à l’échelon mondial,
européen et national ainsi que la répartition sectorielle de
cesémissions et leurs évolutions, et un point sur les principales
politiques climatiques menées pour répondre à ces enjeux.
Lorsqu’elles sont disponibles, des statistiques provisoires
d’émissions pour2020 sont présentées. Au-delà du caractère
exceptionnel de cette année, marquée par la crise sanitaire,
lesdonnées sont fournies sur longue période afin d’en apprécier
lestendances.
Plusieurs jeux de données, présentés sous forme de graphiques
dans ce document, sont également téléchargeables sur le site
internet du SDES.
— Béatrice Sédillot
CHEFFE DU SERVICE DES DONNÉES ET ÉTUDES STATISTIQUES (SDES)

Données clés
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
1
/
92
100%