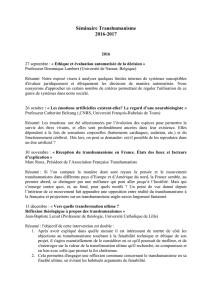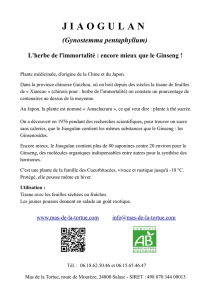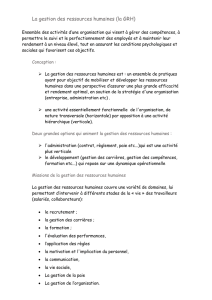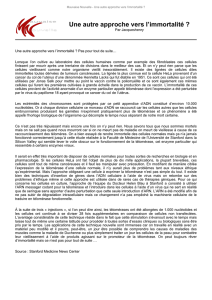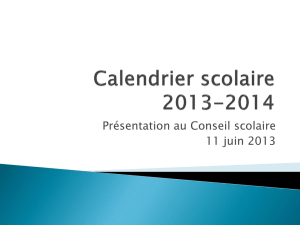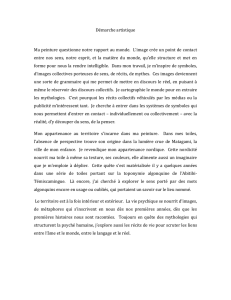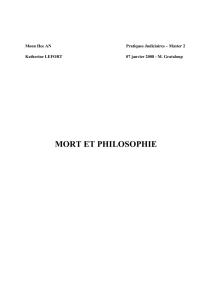Mvet-Ekang: Transhumanisme Africain & Amélioration Humaine
Telechargé par
Julien Kemloh

LE « PERFECTIONNEMENT HUMAIN » UN PRINCIPE DU MVET-EKANG : AUX SOURCES D’UN
TRANSHUMANISME AFRICAIN.
INTRODUCTION
Les cultures orales, écrites et artistiques qui parsèment les traditions anthropologiques et
philosophiques africaines mettent généralement en valeur un certain nombre de représentations, d’idées,
de croyances et de récits qui permet de définir l’homme africain dans son cosmos, sa société et son
identité personnelle. Le Mvet est l’une de ses riches traditions que l’on retrouve dans l’architecture de
l’anthropologie culturelle de certain pays d’Afrique Centrale. En ce sens, il s’illustre comme l’un des plus
vieux récits faisant du thème de l’immortalité humaine un principe dynamique avec pour référence un
mode opératoire inouïe et spectaculaire : l’incorporation métallique. Or, cette approche nous semble de
plus en plus contemporaine et rappelle certaines thèses du mouvement transhumaniste, notamment la
thématique de l’hybridation homme-machine grâce aux prothèses mécatroniques et autres implants
électroniques, le but étant un « perfectionnement de l’être humain » avec pour corollaire l’absence de la
vulnérabilité, le repoussement de la durée de vie et l’extension de la mort. Pourrait-on se demander alors
si ce projet transhumaniste autant qu’il émerge théoriquement dans la culture occidentale n’est-il pas
universel ? En d’autres termes, qu’est-ce qui légitimerait dans l’épopée du Mvet, un héritage culturel de
l’idée d’une quête de l’immortalité dont l’homme africain pourrait se targuer d’en justifier sinon la
nécessité du moins la désirabilité ? Mieux, peut-on établir un lien entre le Mvet et le Transhumanisme ?
Ces deux termes barbares que rien ne rapproche a priori, mais qui pourtant, nous semblent
théoriquement abordables, l’article suivant tentera d’établir un rapprochement à partir d’un angle de
perception ontologique et axiologique mettant en relief l’hypothèse de perfectibilité humaine telle qu’elle
ressort dans l’étude du corps comme espace symbolique dans le Mvet-Ekang et l’hypothèse
bioprogressiste d’une amortalité humaine via une cyborgisation des composants ou du tout humain.
Il s’agira d’examiner un aspect du récit épique du Mvet-Ekang tel qu’il est constitutif d’une
réorganisation de la structure organique du corps humain. Suivant une approche comparatiste, il sera
question d’évaluer de part et d’autre du Mvet et du transhumanisme, la perspective d’une représentation
symbolique et philosophique du perfectionnement humaine. Pour le faire, on mettra en exergue deux
contextes théoriques. Le premier permettra de situer le contexte d’émergence du transhumanisme et le
second présentera un corpus à partir duquel nous conjecturons l’idée d’un transhumanisme africain.
L’enjeu de cet article étant de conforter l’hypothèse d’une universalité du projet transhumaniste.

I – LE MVET : DEFINITION, ORIGINE, TYPOLOGIE et AXIOLOGIE
I-1- DEFINITION
Une définition du Mvet
1
pourrait être restrictive et peu ordinaire, issue d’une épopée qui se fait
raconter par ceux qu’on convient d’appeler les Initiés, le Mvet a néanmoins une tradition littéraire à partir
de laquelle plusieurs acceptions permettent d’en préciser le contenu.
Objet de fabrication artisanale constitué d’une corde, d’une branche de palmier raphia, d’une tige
de bois rigide (archet), plus ou moins rectiligne ou courbe, d’une, deux ou trois demi calebasses
résonnantes aux diamètres non réguliers, cet objet est avant tout un instrument de musique folklorique
qui accompagne le récit du conteur du Mvet et qui permet de dégager une approche esthétique du Mvet.
Pourtant, au-delà de son apparence, cette harpe cithare traditionnelle et le récit qu’il accompagne,
véhiculent un savoir ancien, initiatique, historique et toujours vivant : « je tiens que le mvett est un texte
déroutant, une parole du terrible, qui prétend parler des choses lointaines, imaginaires tandis qu'il est
question de connaissances cachées, secrètes, de nouvelles connaissances ou de nouveaux savoirs »
2
, écrit
G. Biyogo. Le Mvet est donc non seulement un instrument de musique traditionnelle, il est une littérature
orale
3
et écrite
4
, une ontologie
5
, une philosophie pratique
6
, un rite d’initiation, une science
7
, un système
politique
8
.
I-2- ORIGINE
Les diseurs du Mvet s’accordent sur le fait qu’il est un savoir initiatique qui est un héritage culturel
du peuple des Fang Anciens, répartit aujourd’hui entre les tribus Fang-Béti-Bulu et que l’on retrouve
principalement au Cameroun, au Gabon et en Guinée équatoriale. On peut néanmoins dégager une
origine imaginaire et historique du Mvet.
Il précèderait l’Egypte pharaonique, en tant que source orale, le Mvet serait une Parole puissante,
tel le Verbe biblique ou le Logos grec qui aurait émergé d’un être incréé, Eyo
9
et qui serait inspirée à une
créature intelligente (le Diseur) pour faire savoir le principe moteur qui anime de Mvet : l’existence de
deux peuples opposés celui des Engong ; peuple des Immortels, habitant au Sud et associés au Fer et celui
des Oku ; peuple des Mortels, habitant au Nord et constitué des plusieurs tribus. Le premier peuple aurait
1
Nous utilisons la transcription Mvet en français au lieu de Mvett.
2
Extrait de la préface du livre de Laurent Minko Bengone, Comprendre autrement le Mvett, Paris, L’Harmattan,
2008,
3
Le tout premier conteur à qui fut révélé le Mvet est Oyono Ada Ngône.
4
Le premier à l’avoir consigné par l’écrit fut Zwé Nguéma.
5
Lire notamment Mvet 1,2,3 de Tsira Ndong Ndoutoume.
6
Steeve Ella, Altérité et Transcendance dans le Mvett – Essai de philosophie pratique, Paris, L’Harmattan, 2014, 196
p.
7
La mvettologie, voir G. Biyogo, « De la Mvettologie », Conférence donnée à l’UOB, 30 janv. 1993, Libreville, lire
aussi Encyclopédie du Mvet 1,2,3.
8
D. Assoumou Ndoutoume, Du Mvett: l'Orage : processus de démocratisation conté par un diseur de Mvett, Paris,
L’Harmattan, 1993, 221 p.
9
Selon l’ontologie de Zwé Nguéma, ‘‘Eyo’’ est le Dieu unique et incréé par qui tout existe et vers quoi tout tend.
Le Mvet est un monothéisme.

acquis l’immortalité par la maitrise d’un cheminement secret qui y conduit
10
, tandis que le second peuple,
demeuré mortel, tente en vain, via des subterfuges mais aussi par des rivalités guerrières, de s’approprier
le secret de la longévité mais surtout de la toute-puissance des hommes du peuple d’Engong.
Historiquement, le Mvet est une succession infinie et indéfinie de récits dont le tout premier est celui
d’Oyono Ada Ngône, chaque récit s’imbriquant toujours dans le principe moteur qui dynamise le Mvet :
le dualisme mortel/immortel.
I-3- TYPOLOGIE
S’il existe une typologie du Mvet aussi bien dans sa structure matérielle
11
, son appartenance
géographique que dans la singularité de ses récits, c’est le Mvet Ekang, encore appelé « la geste des
Immortels d’Engong »
12
qui renferme le plus d’intrigues et qui décrit surtout la technique d’hybridation et
de transformation à partir du Fer, faisant des hommes d’Engong des guerriers possédant une structure
corporelle immortelle.
I-4- AXIOLOGIE
Le récit du Mvet Ekang, comme le dit Angèle Christine Ondo, repose aussi sur une axiologie qui
délimite un certain nombre de principes parmi lesquels le principe du « perfectionnement humain ».
Steeve Ella le définit comme la vie intérieure ou la recherche de l’immortalité dans son sens absolu, c’est-
à-dire une pratique qui consiste à « se hisser, s’élever », cela correspondrait au sens que Platon donnait à
la dialectique. L’homme du Mvet est d’une matière qu’il faut travailler à l’aide du Fer, du Feu et du
Marteau pour lui donner une forme évoluée qui serait celle d’un perfectionnement à la fois intérieur et
extérieur. Dans le dualisme des peuples d’Engong et d’Oku, le Mvet Ekang aborde une philosophie
pratique qui est celle de l’altérité et de la transcendance
13
; l’immortalité n’est pas tabou ni
fantasmagorique, elle n’est pas proscrite mais intensément recherchée (c’est d’ailleurs cela qui fait le
dynamisme du Mvet), elle n’est non plus source d’ennui existentielle, de même que les récits ne donnent
pas à penser que les hommes d’Engong sont frappés par une sénilité qui entrave leur bonheur d’avoir
accédé à l’immortalité dans un monde où d’autres hommes (notamment les Oku) sont encore mortels.
L’immortalité est plutôt une réalité dans le peuple d’Engong et procède d’une méthodologie de
transmutation ‘‘mystique’’ du métal dans le corps par le biais du feu. Ce n’est donc pas l’immortalité de
l’âme qui est envisagée ici, mais bien celle du corps (d’où la récurrence de la métaphore guerrière dans le
Mvet). A. C. Ondo explique cela en examinant l’espace corporel intérieur dans le Mvet au travers de quatre
poèmes épiques
14
. La constante dans ces poèmes est effectivement la valeur que ses héros accordent au
10
Le corpus épique que nous allons mettre en exergue explique brièvement mais clairement le processus qui à
terme, confère l’immortalité aux hommes du peuple d’Engong.
11
Selon Daniel Assoumou Ndoutoume, l’instrument a connu quatre phases de son évolution historique et
esthétique qui marquent aussi les quatre Âges du Mvett : Nna Otse, Ekang Nna, Oyone Ada et la forme actuelle.
Read more at http://www.ayong.fr/pages/news/articles/page-3.html#ykVdXk9VKIMWJhQB.99
12
A. C. ONDO, « L’espace corporel intérieur dans le mvet », Journal des africanistes [En ligne], 79-2 | 2009, mis en
ligne le 01 avril 2013, consulté le 29 juin 2018. URL :http://journals.openedition.org/africanistes/2991.
13
Lire à cet effet, Steeve Ella, Altérité et Transcendance dans le Mvett – Essai de philosophie pratique, Paris,
L’Harmattan, 2014, 196p.
14
Celui de Zwé Nguéma, et la trilogie des Mvet I, II, III de Tsira Ndong Ndoutoume.

perfectionnement humain, l’idée qu’ils donnent de leur nature, de leur nature humaine, mais aussi la
nécessité qu’il y a pour eux de s’affranchir de leur condition mortelle.
II- LE MVET ET LA QUESTION DE LA NATURE HUMAINE
Après avoir expliqué ce que c’est que le Mvet et comment il met en exergue la question de
l’immortalité humaine, il nous faut maintenant examiner comment ses récits épiques laissent à penser la
nature de l’homme. Pour le faire, nous allons nous appuyer sur l’article de A. C. Ondo intitulé « l’espace
corporel intérieur dans le Mvet », qui analyse quatre poèmes épiques : un de Zwé Nguéma et trois de
Tsira.
D’après A. C. Ondo, qui cite Aubame
15
, le Mvet reposerait sur une vision du monde qui induirait
plusieurs principes axiologiques et qui donnerait un sens à l’existence des hommes du peuple Ekang
16
.
Confrontés aux méandres des vicissitudes de leur condition mortelle, les hommes du pays d’Oku, via leur
héros, tentent dans leur périple guerrier avec les hommes immortels du pays d’Engong, de repousser leurs
limites. Cela passe alors par une simplification méthodique de la nature humaine qui s’apparente à un
réductionnisme matérialiste : « Le premier grand principe appelé « perfectionnement humain »
akóməngà postule qu’à sa naissance l’homme est comparable à du minerai brut qui, pour prendre forme,
doit être fondu et travaillé. »
17
Cette idée d’une nature minérale de l’homme est déjà présente dans
l’ontogénèse humaine à partir de l’angle évolutionniste, elle va être reprise et entérinée au cours du
XVIIIème siècle par les thèses matérialistes de Marx, Engels puis Feuerbach. Ce principe laisse alors croire
que l’homme n’est pas un tout constitué mais seulement un élément constituant : « C’est de l’habileté
des magiciens-forgerons, écrit A. C. Ondo, que l’être humain recevra sa forme finale. »
18
Ces magiciens-
forgerons sont une classe élevée dans le système du Mvet qui ont acquis par initiation, les techniques
permettant de transformer l’espace corporel intérieur humain grâce à l’alliage métallique. « C’est
pourquoi, poursuit A. C. Ondo, des images appartenant au champ sémantique de la métaphore
métallurgique parsèment les poèmes épiques. […] Á la naissance, le futur homme puissant, à l’exemple
d’Oveng Ndoumou, est vidé de ses organes de chair contenus dans l’espace physiologique. Un nouvel
espace est créé à l’occasion de l’initiation avec l’implantation d’organes métalliques. Cette opération est
seulement le début d’un long processus qui, bien mené, le conduira à l’immortalité. »
19
Cette technologie
inconnue mais pourtant effective dans le Mvet, est celle qui aurait mené les hommes du pays d’Engong à
l’immortalité. Si le récit ne donne pas plus d’informations sur la nature de cet homme nouveau après
l’implantation d’organes métalliques, l’auteur ne nous laisse non plus perplexe, car comme indiqué plus
haut, parmi le peuple des immortels, il y a ceux qu’on nomma les Fers, irréductibles et invincibles. Par
contre, tout porte à croire que ces « organes métalliques » sont bien issus de l’habile fabrication de ceux
qu’on a catégorisés comme magiciens-forgerons. De même, une technique de reproduction des organes
biologiques et corporels, par transmutation métallique, nous renseigne sur la maîtrise à la fois des
15
J.-M AUBAME, Les Béti du Gabon et d’ailleurs, sites, parcours et structures, Paris, L’Harmattan, 2002, T. 1, 274 p.
16
C’est un nom générique et historique qui renvoi à un peuple tribal dénommé Fang-Béti-Bulu et que l’on retrouve
principalement au Cameroun, au Gabon et en Guinée Equatoriale.
17
A. C. ONDO, « L’espace corporel intérieur dans le mvet », Journal des africanistes [En ligne], 79-2 | 2009, mis en
ligne le 01 avril 2013, consulté le 27 juin 2018. URL : http://journals.openedition.org/africanistes/2991
18
Ibid.
19
Ibid.

composants humains et leurs espaces respectifs, aussi bien que les propriétés du métal utilisé, leur
résistance, leur alliage et leur adhésion à la structure humaine. Ceci nous amène à conjecturer qu’il n’y a
pas également dans le Mvet une conception strictement essentialiste de la nature humaine, celle-ci
s’apparente plutôt à un projet (dans le sens où J.P. Sartre l’entendait) qui, différemment de la philosophie
évolutionniste, aurait un but assigné : le perfectionnement humain qui précède à son tour l’immortalité
c’est-à-dire la longévité mais aussi l’invulnérabilité.
III – DISCUSSION SUR LE SENS DE L’IMMORTALITE DANS LE MVET
Le Mvet, en tant qu’élément culturel, peut-il être légitimement intégré la rhétorique des sources
probables des idéaux transhumanistes ? Sous quel prisme peut-on évaluer la pertinence épistémologique
du concept du Mvet en tant que fondement dans la culture africaine d’une représentation symbolique de
la quête d’immortalité via le perfectionnement humain ? Peut-on croiser théoriquement les éléments de
la culture occidentale, (en l’occurrence la science-fiction
20
et les récits utopiques et/ou dystopiques
21
qui
fondent plus ou moins la légitimité culturelle et intellectuelle du transhumanisme) avec cet élément de la
culture africaine (le Mvet) ?
Comme on l’a vu plus haut, le thème central du Mvet c’est l’élévation de soi, le dépassement de
sa forme humaine finie pour accéder à une forme humaine finale. Steeve Ella propose d’ailleurs une
définition qui résume cette hypothèse, d’après lui, le Mvet c’est la connaissance de la vérité, celle qui part
de l’homme, le mortel, à l’Homme, l’Immortel
22
. Si tous les récits épiques semblent se fonder sur ce
paradigme, l’originalité par rapport à la philosophie transhumaniste de l’immortalité est que cette
vocation ontologique est la fin intrinsèque mais aussi la finalité de toute la dialectique existentielle de
l’homme du pays d’Oku. En d’autres termes, là où la philosophie transhumaniste de l’immortalité prétend
que la nature humaine n’est pas achevée, le Mvet reprend la même thèse, mais l’enrichie en y enjoignant
la nécessité d’une pro-action, celle de la fondre et de la travailler. Plus encore, le Mvet assigne une
téléonomie claire à la nature de l’homme, transformer le corps des guerriers ou héros Oku, au sens d’un
perfectionnement qui, contrairement à la philosophie transhumaniste de l’immortalité, n’est pas
indéfinie.
Le but de ce perfectionnement n’engage pas seulement la thématique de la longévité, de
l’invulnérabilité et l’indestructibilité, il fixe le cap de l’accomplissement humain, qui dans les récits du
Mvet, est uniquement l’immortalité. Or, cette approche téléonomique qui procède d’une logique du
perfectionnement humain via une transformation par alliage métallurgique, n’est qu’une modalité de
l’accession à l’immortalité dans la philosophie transhumaniste dominante. Elle se rapporte au principe de
cyborgisation qui est manifeste dans la science-fiction et les récits dystopiques mais qui de plus en plus,
20
Le premier film cinématographique reprenant les thèmes transhumanistes sur la robotique ou l’alliage
humain/métal (177 films), date de 1921, il s’agit de L’homme mécanique, une production de A. Deed. Et l’un des
tous premiers à ressortir les thèmes sur les manipulations génétiques ( 145 films) est bien l’adaptation
cinématographique Frankenstein, (1931) de James Whale.
21
Il s’agit entre autre de la Nouvelle Atlantide rédigé en 1624 par Francis Bacon et paru à titre posthume en 1627.
Le Meilleur des mondes (1932) de Aldous Huxley.
22
S. ELLA, «Le Mvett et le Renouvellement des épistémès », Ayong, [en ligne], 24/11/2014, consulté le 28 juin
2018, http://www.ayong.fr/pages/news/articles/page-3.html.
 6
6
1
/
6
100%