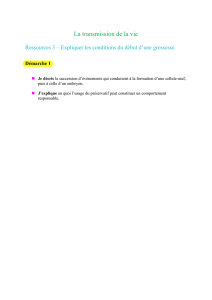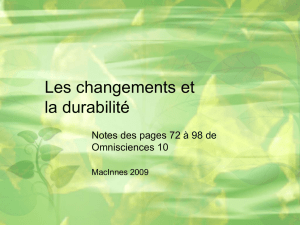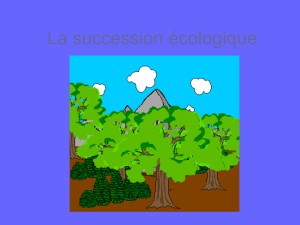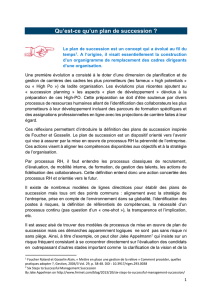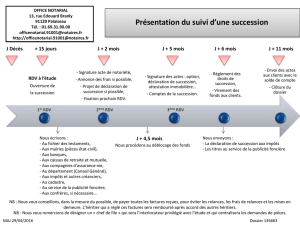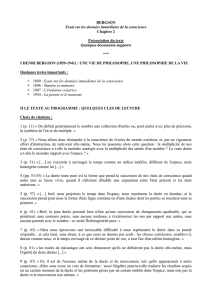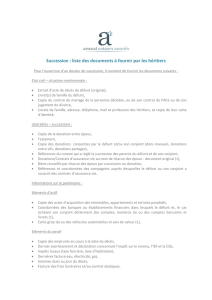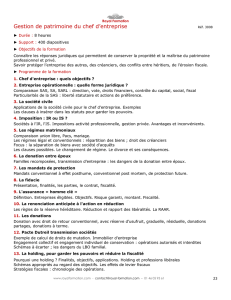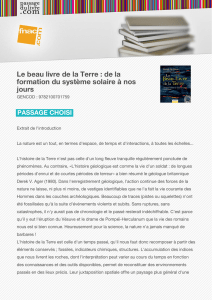Bureau de dépôt 1998 7 SEPTEMBRE 1998 1 1160 Bruxelles 16 Cent cinquantième année Recueil mensuel (ne paraît pas en juillet et août) • • :150: • ANS • ••••••• [ fondé en 1848 ] \\\\\1 Il1 ~1 \ ~\ 11\1 Ill~~~\ Il~\ ~\ Il \Il 11\1 1 B34 E RecGenEnr No 24.837 - 24.847 KLUWER ÉDITIONS JURIDIQUES BELGIQUE 11 1 Recueil Général de l'Enregistrement et du Notariat Comité de rédaction A. CULOT (rédacteur en chef). M. COII'EL, J. 0EBLANDRE, P. DEHAN, D. JUNGERS-POIRL G. RASSON Collaborateurs H. AMORY, notaire A. BENOÎT-MOURY. professeur ordinaire à la Faculté de Droit de l'U.Lg. J. DELANGRE, conservateur honoraire des Hypothèques P. DELNOY. professeur ordinaire à la Faculté de Droit de 1'U.Lg. Ph. DE PAGE, maître d'enseignement à l"U.LB. G. HALLET, conservateur honoraire des Hypothèques Y.-H. LELEU. chargé de cours à la Faculté de Droit de l'U.Lg. P. V AN DEN EYNDE. notaire P. V AN MELKEBEKE. licencié en notariat - collaborateur notarial J. VERSTAPPEN, conseiller juridique et fiscal à la Fédération Royale des Notaires de Belgique Édité par KLUWER ÉDITIONS JURIDIQUES BELGIQUE (Kluwcr Éditions Juridiques Belgique et E. Story-Scientia) l~diteur responsable C. WEYN Kouterveld 2 - 1831 Diegem Administration des abonnements : Tél. : 0800-168 68 (appel gratuit) Fax: (02)723 21 21 e-mail : [email protected] -- Prix (TVA, frais d'envoi et d'administration inclus) pour 199S ( 10 numéros + dossier) : 4.390 FB 615 FB numéro séparé : classeur : 750 FB Abonnement par année civile. Souscription prolongée automatiquement saur résiliation. Changement d'adresse: en cas de changement de nom ou d'adresse, veuillez nous retourner !"étiquette de l'enveloppe corrigée. Aucun C.\trait de cctk· publication ne peut étrc reproduit. introduit dan~ un ..-y.-.tèmt de n.?cup~ration ou transféré électroniquc-mènL mé-caniqut'tncnt. au moyen de photocopies ou sous touk autre forme. ;-.an~ autorisation préalable écrite dè l'éditL·ur. L~..·s auteur;-. cèdent ù la S.,\. \\'.K. B. !L'urs droit:-. intcllectueb sur le;-. textes publiés dans k Recueil Generoi de 1'1:-nregislroHnll tl du A'owrioT. Toute rèproduction est dès lors interdite sans l'accord écrit de la S.A. \V.K.B. \"cuille; contacter l'éditeur pour I'nploiwtion ét·enrucl!e d'une lin! nec. ISSN 077S-8002 - N° 24.837- 389 -W24.837- LE DON MANUEL EN DROIT FISCAL (DROITS D'ENREGISTREMENT ET DROITS DE SUCCESSION) TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION CHAPITRE I: Le don manuel en droit civil Section 1 : Conditions de validité A. Généralités B. Objet du don manuel C. Tradition D. L'animus donandi E. Acceptation du vivant du donateur Section 2: Pactes adjoints et réserve d'usufruit Section 3 : Preuve A. Preuve de l'existence du don manuel B. Preuve des pactes adjoints C. Preuve de la date D. Établissement d'un écrit probatoire CHAPITRE II : Principes appliqués en droit fiscal au don manuel Section 1 : Droits d'enregistrement Section 2 : Droits de succession Section 3 : Attitude de 1'Administration envers le don manuel A. La mesure anti-abus de droit B. La rectification de la qualification erronée C. La preuve de la simulation CHAPITRE III : Étude critique des différentes techniques imaginées par la pratique pour réaliser un don manuel et s'en réserver la preuve Section 1 : Don manuel simple A. Acte authentique B. Enregistrement de la déclaration unilatérale du donateur C. Mention unilatérale dans un acte présenté à l'enregistrement D. Acte notarié ou public étranger E. Technique bancaire F. Constatation par le notaire de la tradition G. Procès-verbal notarié de 1'assemblée générale de la société dont les titres ont été donnés H. Mention dans la déclaration de succession Section 2 : Don manuel avec pacte adjoint CONCLUSION Rec. gén. enr. not. 7 390 - N° 24.837- * * * Introduction Le don manuel est une institution qui ignore tout prescrit légal. Quotidiennement utilisé, c'est le type même de pratique pour laquelle les juristes ont dû se plier à la réalité, faute de pouvoir la modeler à coup de lois. A ses avantages civils s'ajoute un intérêt fiscal. Essentiellement informel, le don manuel échappe aux conditions de forme solennelles des donations. En outre, la possession qu'il transmet permet le plus souvent au donataire de ne pas avoir à sc soucier de s'en réserver une preuve. Enfin, il n'est la plupart du temps pas taxé car il ne doit pas obligatoirement être enregistré. Alors que 1'imposition des donations ct des successions est de plus en plus ressentie comme une double, voire une triple taxation unique et à un taux trop élevé, ce dernier avantage explique sans doute le regain d'intérêt que suscite le don manuel dans la doctrine juridique. On ne compte plus les études et les colloques où il est examiné. Certes, des questions nouvelles se posent parce que l'on voudrait appliquer cette technique si simple aux catégories les plus diverses de biens et en utilisant des modes nouveaux, « dématérialisés », de transmission. Mais ce qui occupe surtout les praticiens et les auteurs, c'est d'imaginer les techniques les plus sécurisantes possibles pour se prémunir contre une Administration fiscale souvent considérée comme rapace et facilement accusatrice. Or, l'Administration ne« désapprouve» pas le don manuel, même s'il est souvent utilisé pour éviter le paiement des droits de succession. Elle ne peut y voir aucune simulation puisque l'intention est bien de transmettre ses biens à titre gratuit. Elle ne dispose donc de guère de moyens d'action contre les parties, à supposer même qu'elle découvre le don, ce qui n'est pas si fréquent. S'il est important de pouvoir déterminer sa date pour échapper aux droits de succession, elle permet d'en établir la réalité par tous moyens de droit. Les techniques complexes et les précautions parfois presque surréalistes inventées par la pratique paraissent donc quelque peu excessives. Elles sont par ailleurs caractéristiques d'une certaine « mentalité belge ». Il paraissait donc intéressant d'établir un relevé de ces différentes techniques et d'examiner l'attitude de l'Administration à leur égard. Un rappel des principes civils sera très utile pour aborder la suite de 1'étude. Le second chapitre présentera de manière générale les principes fiscaux applicables au don manuel ainsi que les moyens dont dispose en théorie l'Administration pour s'opposer à certaines pratiques. Le troisième chapitre traitera enfin des diverses techniques imaginées pour réaliser un don manuel et pour s'en réserver la preuve. E. Story-Scientia - 391 N° 24.837- On n'abordera par contre pas les litiges qui pourraient survenir entre les héritiers et le bénéficiaire du don manuel, ni entre celui-ci et 1'Administration des contributions directes. CHAPITRE I : LE DON MANUEL EN DROIT CIVIL L'étude se concentrant plutôt sur les aspects fiscaux du don manuel, on se contentera, pour les aspects civils, de quelques rappels et on renverra pour le surplus à des exposés plus approfondis (1 ). Section 1 : Conditions de validité A. Généralités Le don manuel peut être défini comme« la donation d'un bien meuble corporel, ou d'un meuble incorporel pour lequel le droit s'incorpore au titre, faite sans forme, de la main à la main » (2). Appartenant donc à la catégorie des donations et plus généralement à celle des libéralités, le don manuel devra respecter les conditions de validité de ces deux types d'actes juridiques. La libéralité, outre les conditions propres à tout contrat (relatives au consentement, à la capacité, à l'objet et à la cause), parfois renforcées, requiert un élément matériel (appauvrissement du disposant, enrichissement du bénéficiaire et absence de contrepartie) et un élément intentionnel (l'intention libérale). La donation, contrat entre vifs, doit opérer un dépouillement immédiat et être irrévocable. Elle exige égale1. A. RODENBACH, <<De gifte van hand tot hand », Rechtsk. T., 1927, p. 227; G. LAMMERTYN, << Het bewijs der gift van hand tot hand >>, Rechtsk. T., 1930, 193 ; G. PACILLY, Le don manuel, Paris, Dalloz, 1936; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2c éd., VIII, vol. 1, n° 494 et 516 à 546bis ; C. DE WULF, << De schenking van hand tot hand », Exequatur van vriendschap. Liber discipulorum et amicorum Egied Spanoghe, Gent, 1980; A. DE BOUNGNE, <<De schenking van hand tot hand », T. not., 1982, p. 161 ; L. RAU CENT et 1. STAQUET, <<Examen de jurisprudence ( 1980 à 1987). Les libéralités et les successions>>, R.C.J.B., 1989, p. 687 à 691 ; R. DILLEMANS, M. PUELINCKX-COENE, W. PINTENS et N. TORFS, << Overzicht van rechtspraak. Schenkingen en Testamenten » (1970-1984), T.P.R., 1985, p. 559 à 562 ; B. CAPELLE, << Preuve dans le procès civil relatif à un meuble corporel et don manuel », R.G.D.C., 1 et 4/1991 ; M. MUNO, << Le don manuel », Journ. dr. fisc., 5-6/1993 ; J. FACQ, << Over dubbelzinnige en onwaarschijnlijke handgiften », T. Not., 1993, p. 139-162 ; M. COENE, << Overzicht van rechtspraak. Giften (1985-1992) », T.P.R., 1994, p. 1615; E. DE WILDE o'ESTMAEL, Les donations: aspects civil et fiscal, Bruxelles, Créadif, 1996; E. DE WILDE D'ESTMAEL, << Les donations » in Rép. not., VIII, 1. VII, Bruxelles, Larcier, 1995 ; F. DELPORTE, Le don manuel, Diegem, Ced. Samson, 1996; J. BYTTEBIER, <<De handgift », T. not., 1998, p. 67. 2. M. MUNO, o.c., p. 134 qui se réfère à H. DE PAGE, o.c., n° 516. Rec. gén. enr. not. 7 392 - w 24.837- ment une acceptation expresse du donataire. Ses conditions de forme- acte notarié notamment- ne s'appliquent par contre pas au don manuel, acte non solennel par essence. Outre ces différents éléments, le don manuel doit respecter des conditions qui lui sont propres et qui tiennent à son objet et à la tradition de celui-ci. On examinera également pour le seul don manuel les conditions de l' animus donandi et de 1'acceptation du donataire du vivant du donateur. B. Objet du don manuel Le don manuel, qui se réalise par tradition réelle, ne peut avoir pour objet que des biens meubles corporels ou des meubles incorporels relativement auxquels le droit s'incorpore au titre. Les meubles corporels sont visés à l'article 528 du Code civil; les meubles incorporels relativement auxquels le droit s'incorpore au titre sont notamment les billets de banque, les titres de société au porteur, les bons de caisse au porteur ( 1), les chèques au porteur. (2) Les biens qui ne sont pas susceptibles de tradition de la main à la main ne pourront par contre pas faire l'objet d'un don manuel: ainsi les immeubles et les meubles incorporels pour lesquels le droit ne s'incorpore pas au titre, tels que les créances nominatives, les titres nominatifs (3) ou à ordre, les chèques nominatifs (4), endossés ou barrés (5), les livrets d'épargne (6), les porte- 1. Bruxelles, 28 juin 1967, J.T., 1968, p. !54; Civ. Bruxelles, 17 novembre 1987, Rev. not. b., 1989, p. 287. 2. L'objet exact du don manuel d'un chèque est controversé: voy. H. Du FAUX, <<Le chèque au porteur objet de don manuel>>, Rev. not. b., 1985, p. 482; D. CLAEYS, Le don manuel et l'Administration de l'Enregistrement, Mémoire de stage, Ministère des Finances, Centre départemental de formation ; P. DELNOY, <<Chronique de jurisprudence. Les libéralités (1981-1987) >>, J.T., 1989, p. 325 ; L. RAUCENT et 1. STAQUET, o.c., p. 688 ; E. DE WILDE D'ESTMAEL, <<Les donations>>, o.c., p. 163-164. 3. Bruxelles, Il février 1964, Rev. prat. not. b., 1966, p. 333 ; ces titres pourront cependant faire l'objet de donations indirectes ou déguisées qui ne sont pas non plus soumises aux règles de forme des donations; voyez à ce sujet l'étude de Th. LHOMME, << Donations d'actions nominatives et de parts de sociétés >>, Rec. gén. enr. not., 1994, n° 24.341 ; contra, Ch. DE WULF, o.c., p. 50. 4. Ce point a été souvent discuté en doctrine : voyez L. RAUCENT et 1. STAQUET, o.c., p. 689; H. Du FAUX, o.c., n° 7-8; D. CLAEYS, o.c., p. 19 à 28; F. DELPORTE, o.c., p. 1617; M. COENE, << Giften >>, o.c., p. 1710; voyez aussi Bruxelles, 19 septembre 1994, Rev. trim. dr. fam., 1996, p. 595, note P. DE PAGE. 5. Car<< l'endossement d'un chèque ne vaut pas tradition [et car] le chèque barré s'identifie à un virement (sauf qu'il est acceptable comme paiement)>>: cf. P. STIENON, <<Problèmes civils et fiscaux relatifs aux dons manuels>>, Rev. gén. fisc., 1987, p. 43. 6. Liège, 5 mars 1976, J.T., 1976, p. 355; Liège, 4 décembre 1988, Rec. gén. enr. not., 1990, n° 23.866; Gand, 18 juin 1991, T.G.R., 1991, 117. Cependant, un versement E. Story-Scientia - W 24.837- 393 feuilles d'assurances (1 ), les universalités de biens. De même, le virement de compte à compte d'argent sous forme de monnaie scripturale est considéré en Belgique, contrairement à la jurisprudence française, comme n'opérant pas un don manuel (2). D'autre part, certains auteurs admettent que le don manuel ait pour objet un droit réel autre que la propriété : la nue-propriété ou 1'usufruit sur un meuble corporel ou sur un meuble incorporel pour lequel le droit s'incorpore au titre (3), mais a priori, cette possibilité semble heurter 1'exigence de la tradition matérielle (cf. infra). C. Tradition Le don manuel est un contrat réel, qui s'exécute par la remise du bien qui en est l'objet. La tradition est donc un élément majeur de ce contrat. Elle consiste en principe en un transfert physique, de la main à la main. Les manières de remettre une chose ont cependant évolué de nos jours, notamment grâce à 1'apparition de nouveaux moyens de paiement ( 4). La jurisprudence n'est donc plus aussi formaliste dans l'exigence d'une tradition matérielle. Ainsi, le versement sur un compte bancaire peut servir de tradition ; on considère dans ce cas que le banquier est le mandataire des parties (5). Par contre, le virement, on l'a vu, ne peut être constitutif de don manuel. La remise d'un chèque au porteur constitue une tradition régulière, mais laquestion se pose de savoir si l'objet du don manuel est une somme d'argent ou seulement« le droit pour le porteur d'exiger du tiré, en sa qualité de détenteur de la provision, la remise de celle-ci à concurrence du montant du chèque dans les limites de la provision» (6). La doctrine penche plutôt en faveur de cette seconde solution (7). L'objet du don est en effet, à notre avis, la sur un livret d'épargne peut constituer un don manuel: Mons, 16 juin 1982, Rec. gén. enr. not., 1983, n° 22.974, note A.C. 1. Liège, 25 janvier 1984, F.J.F., 84/188. 2. Voyez une synthèse de la discussion et de nombreuses références in M. MUND, o.c., p. 136-137; M. COENE, << Giften >>, o.c., 1711; E. DE WILDE D'ESTMAEL, <<Les donations>>, o.c., p. 165-167. 3. H. DE PAGE, o.c., n° 535; E. DE WILDE D'ESTMAEL, <<Les donations>>, o.c., p. 159; BAUDRY-LACANTINERIE et COLIN, t. 1, 3• éd., n° 1177. 4. E. DE WILDE D'ESTMAEL, <<Les donations», o.c., p. 159. 5. Ch. DE WULF, o.c., p. 42 ; Gand, 10 janvier 1975, T. not., 1997, p. 311 ; Bruxelles, 12 décembre 1962, J. T., 1963, p. 320 ; Mons, 16 juin 1982, Rec. gén. enr. not., 1983, n° 22.974. 6. H. Du FAUX,<< Le chèque au porteur objet de don manuel>>, Rev. not. b., 1985, p. 486. 7. Ph. STIÉNON, <<Problèmes civils et fiscaux relatifs aux dons manuels», Rev. gén. fisc., 2/1987, p. 43; P. DELNOY, o.c., p. 325. Rec. gén. enr. not. 7 394 -W24.837- créance envers le tiré, en tant qu'elle s'est incorporée dans le chèque. Par contre, la remise de cartes bancaires ou de cartes de crédit ne peut opérer un don manuel du compte auquel elles donnent accès, celui-ci étant nominatif. Le donataire pourrait cependant se prétendre donataire d'une somme d'argent retirée sur ce compte s'il en a reçu mandat et s'il prouve l'interversion de titre ( 1). De nombreux cas sont ainsi traités par la jurisprudence, dont le relevé serait fastidieux (2). Cette jurisprudence est cohérente dans 1'ensemble, mais on a critiqué le maintien même de 1'exigence d'un aspect matériel à la tradition (3). L'évolution des moyens de paiement devrait conduire à admettre une dématérialisation de la tradition, à 1'instar de la jurisprudence française qui admet le don manuel par virement. On 1'a aperçu dans les exemples qui précèdent, la tradition peut avoir lieu par mandataire. Ce mandat doit être exprès (4). Elle peut aussi s'effectuer longa manu, par la mise à la disposition du donataire de 1'objet : remise des clés d'une voiture, d'un coffre, si en même temps, le donateur ne peut plus en disposer (5). L'interversion de titre (traditio brevi manu) peut également dispenser de remise matérielle, à condition que le donataire prouve qu'il possède désormais à titre de propriétaire le bien qu'il possédait à titre de dépositaire, mandataire, emprunteur... Dans ces différents cas, la mesure de la régularité de la tradition sera la vérification du dessaisissement immédiat, effectif et irrévocable du donateur au profit du donataire (6). Si le donateur s'est réservé la possibilité de reprendre les biens ou simplement d'y avoir accès (7), ou si le don manuel est affecté d'une condition suspensive ou d'un terme, il ne sera pas valable (8). 1. E. DE WILDE D'ESTMAEL, <<Les donations>>, o.c., p. 165; Ph. STIÉNON, o.c., p. 43. 2. Pour d'autres exemples, voyez F. DELPORTE, Le don manuel, Diegem, ced. Samson, 1996, p. 21 à 26. 3. P. STIENON, o.c., p. 45 ; M. V ANQUICKENBORNE et R. DEKKERS, <<Examen de jurisprudence (1965 à 1972). Les successions et les libéralités>>, R.C.J.B., 1975, p. Ill, n° 31 ; voyez aussi civ. Anvers, 30 juin 1988, Rec. gén. enr. not., n° 23.865, obs. A.C. 4. F. DELPORTE, o.c., p. 20-21. 5. Liège, 3 décembre 1986, Re v. not. b., 1988, p. 150; Ci v. Huy, 12 février 1987, R.G.D.C., 1987, p. 78; Liège, 3 octobre 1989 et Il septembre 1990, Rev. not. b., 1991, pp. 347 et 350, note L. RAUCENT. 6. M. MUND, o.c., p. 138 et les références citées à la note 26. 7. Sauf s'il s'est réservé l'usufruit. 8. F. DELPORTE, Le don manuel, Diegem, ced. Samson, 1996, p. 20 ; E. DE WILDE D'ESTMAEL, «Les donations>>, o.c., p. 157 et 162 et références de jurisprudence citées; M. MUND, o.c., p. 138 et 140. E. Story-Scientia - N° 24.837- 395 Enfin, la tradition doit avoir lieu avant le décès du donateur ou du donataire, ce qui peut poser des problèmes pour les dons par l'intermédiaire d'un mandataire ( 1). D. L' animus donandi L'intention de gratifier le donataire, 1'animus donandi, est également un élément majeur du don manuel, comme de toute donation. En effet, la tradition ne suffit pas car elle pourrait avoir lieu à un autre titre. E. Acceptation du vivant du donateur Le don manuel doit être accepté par le donataire : il s'agit là d'une des conditions de validité des donations. Cette acceptation ne doit cependant pas revêtir les formes solennelles requises pour les donations directes. Elle peut même être tacite (2). La donation est un contrat entre vifs et de même que, on l'a vu, la tradition doit intervenir du vivant du donateur, 1'acceptation doit également avoir lieu à un moment où le concours de volontés est encore possible. Ces règles trouvent leur acuité lorsque le contrat a lieu entre absents : si le donateur décède avant que le donataire n'ait pu formuler son acceptation auprès du mandataire ou avant que celui-ci n'ait porté 1'acceptation à la connaissance du donateur, le contrat n'est pas formé. Il reste au stade de la simple offre, qui n'a aucun effet juridique s'agissant d'une donation (article 932 du Code civil) (3). Section 2 : Pactes adjoints et réserve d'usufruit Les pactes adjoints sont toutes les clauses accessoires au contrat de don manuel. Ils ne sont licites que s'ils sont compatibles avec les caractéristiques essentielles de ce contrat, c'est-à-dire le dépouillement immédiat et irrévocable du donateur, la transmission de la main à la main et le caractère d'opération entre vifs (4). Ces clauses accessoires feront, comme le don lui-même, 1. Voyez les références de jurisprudence citées parE. DE WILDE o'ESTMAEL, «Les donations>>, o.c., p. 161. 2. M. MUNO, o.c., p. 142; F. DELPORTE, o.c., p. 34; ces deux auteurs estiment néanmoins, contre DE PAGE, o.c., n° 529, que la simple prise de possession du bien qui est l'objet du don manuel n'emporte pas nécessairement acceptation. 3.Cass.,2juillet 1914,Pas.,l915/6,1,37;Bruxelles,ll mars 1969,Pas.,II, 134; Ci v. Bruxelles, 14 avril 1987, R. W., 1988/9, 1240. 4. Ainsi, un terme suspensif ou extinctif, de même qu'une condition suspensive (possibles pour une donation par acte authentique) sont inconcevables pour un don manuel puisqu'ils empêchent une dépossession immédiat ou irrévocable du donateur. Par contre, la condition résolutoire sera licite si ellen 'a pas pour effet de rendre le don manuel révocable. Voyez M. MUNO, o.c., p. 143 et F. DELPORTE, o.c., p. 36-37. Rec. gén. enr. not. 7 396 - w 24.837- l'objet d'un accord qui sera souvent verbal mais qu'on peut vivement conseiller de consigner par écrit. Ces pactes peuvent prévoir une charge (1) imposée au donataire (verser un revenu au donateur ou donner telle destination aux biens donnés, par exemple), un retour conventionnel, une dispense de rapport, une stipulation pour autrui ... (2) Ils peuvent également stipuler une réserve d'usufruit au profit du donateur. Ce procédé est fréquemment utilisé par les donateurs qui souhaitent transmettre une partie de leur patrimoine avant leur décès, pour éviter à leurs héritiers les droits de successions, mais qui désirent conserver la jouissance des biens donnés ou tout au moins les revenus produits par ceux-ci jusqu 'à leur mort. Cette réserve d'usufruit n'est possible, s'agissant d'un don manuel, que si elle n'est pas en contradiction avec les obligations de tradition réelle et de dépossession du donateur (3). On imagine mal, notamment, que le donateur se réserve l'usufruit de meubles corporels sans les garder à sa disposition, avec comme conséquence qu'il manquerait à l'obligation de tradition matérielle et à l'obligation de se dépouiller immédiatement non seulement de la propriété du bien, mais aussi de la possession de ce bien ( 4). Nous avons vu que plusieurs auteurs admettaient que le don manuel puisse porter sur la nuepropriété ou même l'usufruit d'un bien, notamment pour la raison que le droit de propriété est lui-même un droit incorporel qui peut être transmis matériellement (5). Or, le droit de propriété est un droit réel tout à fait particulier, qui s'incorpore dans le bien corporel qu'il a pour objet etc 'est pour cette raison gu 'il peut être transmis par tradition réelle. Par contre, la nue-propriété ou l'usufruit sont des droits réels « dématérialisés », distincts de leur objet et on ne voit vraiment pas comment ils pourraient être physiquement transmis. Il nous semble donc qu'il faut condamner l'utilisation abusive de l'expression « don manuel avec réserve d'usufruit », car le don manuel d'une nue-propriété est matériellement impossible (6). 1. À condition que cette charge ne soit pas assez lourde pour constituer une réelle contrepartie de la prestation accomplie par le donateur, car cela dénaturerait le caractère de libéralité de 1'opération. 2. Voyez les exemples cités parE. DE WILDE o'ESTMAEL, <<Dons manuels: techniques de preuve (bancaires et autres), pacte adjoint, réserve d'usufruit>>, Journée d'étude Skyroom du 28 janvier 1997; également, H. DE PAGE, o.c., n° 530 à 537. 3. M. MUNO, o.c., p.l43; E. DE WILDE D'ESTMAEL, «Les donations», o.c., p. 174. 4. Notons que cette obligation ne vaut que pour le don manuel et non pour les donations authentiques. 5. BAUDRY-LACANTINERIE et COLIN, t. 1, 3• éd., n° 1177. 6. Dans le même sens, voyez S. NUDELHOLE, « Les donations réalisées en Belgique autrement que par acte notarié», Journée d'étude Skyroom du 31 mars 1998, p. 5-6; «Droits d'enregistrement et de succession: en quoi l'introduction d'un facteur interna- E. Story-Scientia - N° 24.837- 397 On a prétendu qu'un tel don serait possible pour les titres au porteurs, en séparant les coupons du manteau, ce dernier représentant la nue-propriété des titres. Or, les coupons ne permettent pas à leur possesseur d'exercer tous les droits qu'un usufruitier pourrait exercer. Ils lui permettent seulement, jusqu 'à leur épuisement, de percevoir les dividendes. Pour pallier à cette impossibilité, on peut constituer un droit d'usufruit au profit du donataire après avoir réalisé la tradition réelle de la pleine propriété - tradition dont il conviendra de se réserver la preuve, particulièrement à 1'égard de 1'Administration fiscale-, ou tenter d'atteindre le même résultat par le biais d'autres pactes adjoints. La « réserve d'usufruit » pourrait être remplacée par un prêt ou un dépôt des meubles donnés chez le donateur mais on verra que, d'une part, le donataire perd alors la protection possessoire, très utile s'il doit prouver son titre de propriété sur les biens et que, d'autre part, l'Administration fiscale pourrait requalifier l'opération en une transmission pour cause de mort en démontrant que la volonté du donateur était de garder les biens jusqu'à son décès (1 ). Par contre, si ces meubles corporels produisent des revenus (parce qu'ils sont loués, par exemple), on pourrait prévoir une charge pour le donataire de payer ces revenus au donateur jusqu'à sa mort. Cette opération constitue plutôt une donation avec charge qu'une réserve d'usufruit car si le donateur, qui s'est dépossédé du bien, doit s'adresser au donataire pour obtenir l'exécution de son droit d'usufruit, où est le droit réel? (2) De même, 1'argent se prête difficilement à un don avec « réserve d 'usufruit », à moins de la remplacer par une charge de paiement viager des intérêts produits par la somme donnée (3). Par contre, les titres au porteur sont fréquemment donnés sous cette forme. En effet, les administrateurs de société qui songent à transmettre leurs titres avant leur décès souhaitent souvent garder un certain contrôle ou un pouvoir de gestion sur la société. Nous étudierons dans le troisième chapitre les différentes méthodes imaginées par la pratique pour exaucer ce souhait, ainsi que les problèmes d'ordre fiscal auxquels elles peuvent se heurter. Une autre motivation de la réserve d'usufruit sur les titres de société ou d'autres valeurs mobilières peut également être le désir de continuer à jouir de leurs revenus. C'est à nouveau à une donation avec charge que 1'opération s'apparentera. tional peut-elle modifier les données du problème ? >>,Journée d'étude Skyroom du 2 oc- tobre /997, p. 7. 1. E. DE WILDE D'ESTMAEL, «Dons manuels: techniques de preuves (bancaires et autres), pacte adjoint, réserve d'usufruit.>>, o.c., p. 14. 2. H. DE PAGE, o.c., n° 535. 3. E. DE WILDE D'ESTMAEL, ibidem;« Les donations>>, o.c., p. 177. Rec. gén. enr. not. 7 398 - w 24.837- Section 3 : Preuve Le problème de la preuve est au cœur de la plupart des litiges concernant le don manuel car, la plupart du temps, les parties n'auront pas songé à se constituer une preuve écrite. La raison principale de cette négligence est bien entendu l'absence de tout formalisme qui caractérise le don manuel; pour les donations ordinaires, 1'exigence d'un acte notarié comme élément essentiel du contrat résout la question de la preuve. D'autre part, les dons manuels ont souvent lieu entre des personnes proches qui n'ont pas pour usage de consigner les contrats entre elles par écrit. Enfin, sur le plan fiscal, l'établissement d'un écrit laisse craindre à certains un assujettissement obligatoire aux droits d'enregistrement. Cette difficile question ayant fait 1'objet de nombreux commentaires (1) et même d'études complètes (2), on se contentera d'un rapide survol pour se concentrer, dans le troisième chapitre, sur la preuve à 1'égard du fisc. En effet, c'est essentiellement pour se constituer une preuve vis-à-vis de 1'Administration et plus particulièrement une preuve de la date du don manuel que les différents procédés étudiés ci-après ont été imaginés par la pratique. A. Preuve de l'existence du don manuel Le don manuel, comme tout contrat, se prouve en principe au moyen d'un écrit (article 1341 du Code civil). Aux donataires négligents, l'article 2279 du Code civil vient heureusement apporter sa protection : le bénéficiaire du don manuel est devenu le possesseur de la chose et, à ce titre, la propriété dans son chef est présumée. Il ne devra donc pas prouver le don manuel si on lui ré- 1. M. MUNO, o.c., p. 144 à 151 ; F. DELPORTE, o.c., p. 44 à 47 ; E. DE WILDE o'EsTMAEL, <<Les donations>>, o.c., p. 169 à 174; Ch. DE WULF, <<De schenking van hand tot hand >>, Exequatur van vriendschap. Liber discipulorum et amicorum Egied Spanoghe, Gent, 1980, p. 58 à 66; P. DELNOY, «Chronique de jurisprudence- Les libéralités >> (1981-1987), J.T., 1989, p. 325-326; Ph. STIENON, «Problèmes civils et fiscaux relatifs aux dons manuels>>, R.G.F., 1987, p. 43-44; C. REMON, «La preuve des créances et des donations entre époux séparés de biens >>, Ann. dr. Louvain, 1981, p. 123 ; J.-L. RENCHON, «La preuve des relations patrimoniales entre époux>>, in La preuve, colloque U.C.L., 1987. 2. B. CAPELLE, «Preuve dans le procès civil relatif à un meuble corporel et don manuel >>, R.G.D.C., 1991, p. 19 et 303 ; « La preuve du don manuel >>, in Les arrangements de famille, Bruxelles, Story-Scientia, 1990, p. 147 à 155 ; J. FACQ, « Over dubbelzinnige en onwaarschijnlijke handgiften », Tijds. not., 1993, p. 139 ; G. LAMMERTYN, « Het bewijs der gift van hand tot hand », Rechtsk. T., 1930, 193. E. Story-Scientia - w 24.837- 399 clame le bien donné, mais se contentera d'opposer sa possession (1 ). Ce sera le cas si le donateur ou ses héritiers agissent en revendication du bien (2). Cependant, pour bénéficier de la protection de l'article 2279, la possession doit être utile, c'est-à-dire exempte des vices suivants: clandestinité, équivoque, violence et discontinuité. Cette absence de vices est elle-même présumée par 1'article 2229 du Code civil. Si toutefois le demandeur ou ses héritiers parviennent à renverser cette présomption ou s'ils prouvent que le possesseur possède pour un autre, à titre précaire (3), la possession ne pourra plus faire titre et le donataire devra prouver le don manuel selon les règles des articles 1341 et suivants du Code civil (4). En pratique, il arrive souvent que le demandeur puisse démontrer que la possession est équivoque ou précaire lorsque les deux parties au litige habitent sous le même toit ou ont souvent entre elles des relations de prêt ou de mandat. La jurisprudence, désireuse d'accorder au prétendu donateur une certaine protection - dans le même esprit que le législateur-, admet de manière assez souple la démonstration de ces vices (5). Le donateur ou ses héritiers peuvent aussi, au contraire, s'appuyer sur le don manuel pour réclamer la chose - dans le contexte d'une demande en révocation, en annulation, en application des règles de la réduction ou du 1. Bruxelles, 21 novembre 1985, Rec. gén. enr. not., 1987, p. 108 ; J. T., 1986, p. 395 ; Civ. Bruges, 12 novembre 1987, T. Not., 1988, p. 166; R.W., 1988-89, p. 547; Mons, 5 mai 1987, J.L.M.B., 1987, p. 1026; Civ. Namur, 19 avril 1990, Rec. gén. enr. not., 1990, n° 23.868 et obs. ; civ. Liège, 23 octobre 1989, Rec. gén. enr. not., no 23.867 ; Bruxelles, 24 janvier 1991, Rec. gén. enr. not., n° 24.204; Gand, 3 décembre 1993, T. not., 1994, p. 137; Rev. not. b., 1995, p. 261; Gand, 14 juin 1994, R.W., 199511996, 542 ; Mons, 13 février 1996, Rev. not. b., 1996, p. 350. 2. S'ils agissent en restitution du bien sur la base d'un contrat de prêt, de dépôt ou de mandat qu'ils sont parvenus à prouver, le prétendu donataire ne pourra se contenter d'opposer sa possession, devenue précaire, mais devra prouver l'interversion de titre intervenue par don manuel. Voyez ci v. Huy, 12 février 1987, Re v. not. b., 1991, p. 344; Liège, Il septembre 1990, Rev. not. b., 1991, p. 350, note RAU CENT ; ci v. Bruges, 18 novembre 1994, T. not., 1996, p. 467. 3. S'ils ont intenté une action en restitution basée par exemple sur un contrat de prêt ou de dépôt. 4. Voyez les références de jurisprudence citées par P. DELNOY, o.c., p. 326. 5. Civ. Malines, JC' décembre 1981, R. W., 1981-82, col. 2900, note M. P. -C. ; Rec. gén. enr. not., 1983, p. 35 et obs. ; Civ. Namur, 28 février 1984, R.R.D., 1984, p. 191 ; Civ. Bruges, 12 novembre 1987, T. Not., 1988, p. 166; R.W., 1988-89, p. 547; Civ. Bruxelles, 4 janvier 1991, Rev. trim. dr. fa m., 1991, p. 106; Liège, 10 février 1992, Rev. trim. dr.fam., 1993, p. 531; Rev. not. b., 1993, p. 110; Gand, 17 juin 1982, T.G.R., 1985, p. 10; Civ. Anvers, 16 mai 1989, T. Not., 1993, p. 166; Civ. Bruges, 18 mars 1985, T.B.R., 1985, p. 73 ; Civ. Namur, 19 avril 1990, Rec. gén. enr. not., 1990, n° 23.868 ; Civ. Bruxelles, 17 novembre 1987, Rev. not. b., 1989, p. 287; Liège, 15 octobre 1991, Rev. trim. dr. fam., 1993, p. 530; Civ. Liège, 9 décembre 1992, Rev. trim. dr. fam., 1993, p. 557; Liège, 3 octobre 1989, Rev. not. b., 1991, 347, note RAUCENT. Rec. gén. enr. not. 7 400 - N° 24.837- rapport- ou l'exécution des charges stipulées dans le contrat. Ils devront alors prouver ce don conformément au droit commun. S'il s'agit du donateur ou de ses héritiers exerçant un droit qu'ils tiennent de leur auteur, la preuve devra être écrite (1). Si les héritiers exercent un droit propre- réduction, rapport - ou si des créanciers agissent, par exemple par la voie de 1'action paulienne, ils pourront prouver le don manuel par toutes voies de droit (2). Il existe des circonstances où les parties à 1'acte peuvent également prouver par témoignage ou présomption: si la valeur du bien donné n'excède pas 15 000 francs, si la partie qui doit apporter la preuve dispose d'un commencement de preuve par écrit (article 1347 du Code civil) (3), ou si elle peut invoquer une impossibilité morale de se réserver une preuve écrite (article 1348 du Code civil) ( 4). Cette impossibilité morale ne sera pas nécessairement admise dès qu'il y a un lien de parenté ou d'affection entre les parties, ce qui est la plupart du temps le cas lorsqu 'il y a donation (5). En ce qui concerne les éléments dont il faut rapporter la preuve, il convient de rappeler ici que la tradition en elle-même est un fait matériel qui peut être prouvé par toutes voies de droit (6), mais que la preuve de la seule tradition n'emporte pas la preuve du don manuel; en effet, elle peut être justifiée par d'autres contrats, tels qu'un prêt, un dépôt ou même une vente. Il faudra donc également se réserver la preuve de l'animus donandi car c'est souvent son absence qu'invoqueront les héritiers du donateur, ou le donateur luimême. Cette preuve de 1'intention de donner dans le chef du donateur peut s'avérer particulièrement difficile (7). 1. P. DELNOY, o.c., p. 326 et références de jurisprudence citées. 2. Bruxelles, 27 mars 1986, J.T., 1987, p. 381; Mons, 10 janvier 1984, Rev. not. b., 1984, p. 284; Rev. rég. dr., 1984, p. 271; Rec. gén. enr. not., 1989, n° 23.725, p. 237; B. CAPELLE, o.c., p. 49 et notes. 3. Civ. Bruxelles, 3 février 1995, J.T., 1995, p. 343; Rec. gén. enr. not., n° 24.581. 4. Ci v. Dinant, 4 mai 1932, Pas., 1932, III, p. 31 ; Cass., 2 février 1961, Pas., 1961, 1, p. 587; Liège, 28 juin 1967, Jur. Liège, 1967, p. 169; Civ. Turnhout, Il janvier 1966, Turn. Rechts., p. 530; Bruxelles, 16 décembre 1968, Pas., 1969, II, p. 61 etRec. gén. enr. not. b., 1970, n° 21.373, p. 260, note ; Gand, 17 juin 1982, T.G.R., 1985, p. 1O. 5. Liège, 29 juin 1992, J.L.M.B., 1993, p. 391 ; Rev. trim. dr. fa m., 1993, p. 531 ; Rev. not. b., 1993, p. Il 0 ; Liège, 9 décembre 1954, Pas., 1955, II, p. 135 ; Liège, 16 mars 1954, Pas., 1956, II, p. 83. Contra, voyez L. GENET,<< La dispense morale de constituer la preuve écrite des donations », Jur. Liège, 1980, p. 299, qui plaide pour que dans les cas de relations sociales privilégiées, la dispense de preuve littérale devienne le principe et l'écrit, 1'exception. 6. Des documents bancaires pourraient notamment suffire : cf. infra, chapitre 3. 7. Selon F. DELPORTE, o.c., p. 28 et exemples jurisprudentiels cités, l' animus donandi est un fait juridique qui peut être prouvé par toutes voies de droit. Il nous semble au contraire que, même s'il n'est qu'un élément d'un autre acte juridique, 1'ani mus donandi est lui-même un acte juridique, puisqu'il s'agit bien de la manifestation d'une volonté en vue de produire un effet de droit (par opposition au fait juridique qui est << celui qui émane E. Story-Scientia - N° 24.837- 401 B. Preuve des pactes adjoints Les pactes adjoints doivent également être prouvés par écrit, sauf les exceptions citées dans le paragraphe précédent ( 1). C. Preuve de la date Plusieurs hypothèses sont envisageables. S'il existe un écrit constatant le don manuel et mentionnant sa date, celleci sera prouvée à suffisance. Si cependant, une des parties soutient que cette date est fausse, elle devra prouver contre l'écrit à l'aide d'un autre écrit, à moins qu'elle ne puisse démontrer une fraude, auquel cas elle pourra prouver la date exacte par toutes voies de droit (article 1353 du Code civil). Si l'écrit ne mentionne pas de date, la question de savoir si la preuve de celle-ci est une preuve outre l'acte (qui doit nécessairement être administrée au moyen d'un écrit) ou seulement la démonstration d'une des circonstances de la convention est controversée (2). Enfin, s'il n'existe pas d'écrit, on pourra prouver la date par toutes voies de droit s'il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité morale de se procurer un écrit, ou dans tous les cas -et notamment celui de l'aveu de l'adversaire qui admet l'existence du don manuel mais conteste sa date- si l'on considère que la date n'est qu'une circonstance de l'acte (3). À l'égard des tiers, dans ces différentes circonstances, la date doit être certaine au sens de l'article 1328 du Code civil pour être probante, sauf lorsque la convention n'est que verbale car en principe l'article 1328 ne s'appli- de l'homme mais sans vouloir y attacher un effet juridique ou qui est indépendant de toute volonté humaine, et auquel la loi attache des conséquences juridiques >> ; voy. N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991, p. 120). On pourrait prétendre que tous les éléments constitutifs d'un contrat sont des faits juridiques qui, pris séparément, peuvent être prouvés par toutes voies de droit, mais se contenterat-on de la preuve de ces éléments pour démontrer l'acte juridique qu'ils constituent et qui, lui, doit être prouvé par écrit? Nous ne le pensons évidemment pas et par ailleurs, dans les exemples jurisprudentiels cités par F. DELPORTE, il semble qu'un commencement de preuve par écrit ait chaque fois été apporté avant que le juge ne permette la preuve par présomptions de l'animus donandi. l. Il existerait cependant une exception supplémentaire pour le pacte de préciput: voyez B. CAPELLE, <<Preuve dans le procès civil relatif à un meuble corporel et don manuel>>, R.G.D.C., 1991, p. 305. 2. Pour une synthèse des différentes opinions, voyez B. CAPELLE, o.c., p. 308 qui conclut en faveur de la seconde solution au motif que la date n'est pas une clause de l'acte mais un simple fait qui pourrait être prouvé par toutes voies de droit. 3. B. CAPELLE, o.c., p. 308. Rec. gén. enr. not. 7 402 - N° 24.837- que qu'à 1'opposabilité des actes sous seing privé (1 ). La question de savoir si 1'héritier réservataire est lui aussi protégé par cette disposition n'est pas résolue (2). D. Etablissement d'un écrit probatoire On l'aura constaté, l'écrit reste la reine des preuves en matière de don manuel également. On ne peut que trop conseiller de le prévoir, à condition de s'entourer de certaines précautions. En effet, le don manuel ne peut perdre son caractère de contrat réel par 1'établissement de 1'écrit sous seing privé sous peine de tomber sous le coup de 1'article 931 du Code civil qui impose la forme notariée à 1'acte portant donation. Si on peut considérer que 1'acte sous seing privé est 1'acte de donation lui-même, le don sera nul pour défaut de forme. Il est donc essentiel que 1'acte sous seing privé ne contienne pas 1'obligation de donner mais constate simplement un don manuel déjà réalisé par la remise matérielle du bien (3). On apercevra immédiatement, dans le second chapitre, que 1'établissement d'un tel écrit peut n'avoir aucune conséquence au plan fiscal. Si cependant on veut donner date certaine au sens de 1'article 1328 du Code civil à l'écrit probatoire, l'établissement d'un acte authentique et donc 1'enregistrement de celui-ci seront obligatoires, ainsi que la perception du droit de donation. L'objet du troisième chapitre est précisément une étude d'autres moyens imaginés par la pratique pour prouver la date de l'acte à 1'égard du fisc, celui-ci n'exigeant pas une date certaine au sens strict. 1. Voyez N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991, p. 278 et références citées, qui explique que l'article 1328 <<ne limite pas l'opposabilité des conventions elles-mêmes mais uniquement celle de l'écrit qui la constate. L'on peut considérer que la date des conventions verbales est appréciée souverainement par le juge du fond>>. 2. Voyez B. CAPELLE, <<Preuve dans le procès civil relatif à un meuble corporel et don manuel», R.G.D.C., 1991, p. 310 à 313. 3. B. CAPELLE, idem, p. 315; <<La preuve du don manuel>>, in Les arrangements de famille, Bruxelles, Story-Scientia, 1990, p. 153 et 155; E. DE WILDE D'ESTMAEL, <<Les donations>>, o.c., p. 172 ; <<Dons manuels : techniques de preuve (bancaires et autres)pacte adjoint, réserve d'usufruit>>, o.c., p. Il ; C. DE WULF, <<De schenking van hand tot hand »,Exequatur van vriendschap. Liber discipulorum et amicorum Egied Spanoghe, Gent, 1980, p. 59 et références citées. E. Story-Scientia - w 403 24.837- CHAPITRE II: PRINCIPES APPLIQUES EN DROIT FISCAL AU DON MANUEL Nous nous limiterons à 1'étude des droits indirects - enregistrement et succession. L'examen de 1'attitude de 1'Administration des impôts directs face au don manuel, principalement lorsqu 'il est invoqué pour justifier une insuffisance indiciaire lors d'une taxation sur base de signes et indices d'aisance (article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992), est également intéressant et a fait 1'objet de nombreux commentaires (1) auxquels nous renvoyons. Section 1 : Droits d'enregistrement Les donations de biens meubles sont soumises à un droit d'enregistrement proportionnel mais uniquement si elles sont constatées dans un écrit obligatoirement enregistrable (acte notarié notamment) ou dans un écrit présenté volontairement à 1'enregistrement (articles 19 et 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe). Les donations directes qui doivent à peine de nullité intervenir par acte notarié seront donc obligatoirement enregistrables. Par contre, le don manuel, même constaté dans un écrit sous seing privé probatoire (2), ne sera pas taxé, à moins qu'il ne soit présenté volontairement à l'enregistrement. L'intérêt d'enregistrer un acte prouvant le don manuel est de lui procurer date certaine, opposable aux tiers (article 1328 du Code civil). L'enregistrement sera possible même si l'acte ne satisfait pas aux prescriptions de forme du Code civil (3), notamment si l'écrit sous seing privé, au lieu de constater un don manuel réalisé, contient lui-même 1'obligation de donner ou si le don manuel mentionné a lieu avec terme extinctif ou est accompagné d'autres pactes adjoints incompatibles avec la nature du don manuel. L'Administration n'est en effet pas juge de la validité des actes (4). 1. Voyez notamment F. DELPORTE, Le don manuel, Diegem, ced. Samson, 1996, pp. 52-54; M. MUNO,<< Le don manuel», Journ. dr. fisc., 1993, p. 161-162. 2. A. CuvELIER, <<Droits d'enregistrement applicables aux donations entre vifs», Rép. not., t. III, p. 42, n° 43; Ph. DE PAGE,<< Les donations et le cas particulier des dons manuels de titres>>, Journée d'étude VANHAM & VANHAM du 18 novembre 1997 -Le planning successoral d'une entreprise familiale, p. 1. 3. Civ. Arlon, 22 novembre 1847, Rec. gén. enr. not., n° 76; Cass., 15 février 1854, Rec. gén. enr. not., no 2.223; Cass., 18 mai 1866, Rec. gén. enr. not., n° 6.087, cités par A. CUVELIER, o.c., p. 42, n° 43; H. DE PAGE, o.c., t. VIII, vol. 1, p. 86-88; F. DELPORTE, o.c., p. 56; F. WERDEFROY, Registratierechten, Kluwer, 1991, p. 1124. 4. Civ. Arlon, 22 novembre 1847, Rec. gén. enr. not., n° 76, cité par A. CUVELIER, o.c., p. 42; par contre, si l'un des éléments constitutifs essentiels de la donation fait défaut, la perception du droit ne sera pas possible: cf. H. DE PAGE, o.c., p. 88. Rec. gén. enr. not. 7 404 - N° 24.837- D'autre part, il se peut que le don manuel soit constaté ou simplement mentionné dans un acte notarié obligatoirement enregistrable. Dans ces différents cas, le droit proportionnel ne sera dû que si l'acte présenté à l'enregistrement forme titre du don manuel, c'est-à-dires 'il constitue «la preuve littérale de la convention au sens de l'article 1315 du Code civil» (1). Ce sera notamment le cas si l'écrit porte la signature de toutes les parties à la convention. Une reconnaissance unilatérale ou une mention incidente du don pourraient cependant également faire titre. On examinera dans le troisième chapitre sous quelles conditions certains actes présentés à l'enregistrement ne seront pas soumis au droit proportionnel mais au droit fixe général pour la raison qu'ils ne forment pas titre du don manuel. Section 2 : Droits de succession Si le don manuel n'est, sauf présentation volontaire, jamais soumis à l'enregistrement, il peut par contre donner lieu au paiement de droits de succession en vertu de l'article 7 du Code des droits de succession qui présume juris et de jure que les biens dont le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès font partie de sa succession (2). À ce titre, ces biens donnés seront soumis au droit proportionnel de succession, sauf si le droit d'enregistrement a déjà été perçu sur la donation. Ce sont les héritiers ou les légataires universels qui, pour leur part et portion, acquitteront ce droit, sauf s'il est établi que la libéralité a été faite à telle personne déterminée, auquel cas celle-ci est réputée légataire de la chose donnée (article 7, alinéa 2). Les dons manuels sont particulièrement visés par cette disposition comme il ressort de l'exposé des motifs de la loi du 11 octobre 1919 (3). Les cadeaux et présents d'usage sont toutefois exclus du champ d'application de l'article7(4). 1. M. DONNAY,<< Droits d'enregistrement», Rép. not., tome XV, livre X, n° 77. 2. Voyez, sur les difficultés d'application de cet article, notamment en cas d'aliénation ou de perte du bien par le donataire, B. PEETERS, <<Article 7 du Code des droits de succession : quelques questions quant à son application pratique », Mens. not. fisc., 199111, p. 12. 3. Cités par M. DONNAY, <<Droits de succession et de mutation par décès>>, (mis à jour par A. CULOT), Rép. not., t. XV, 1. Xl, Bruxelles, Larcier, 1996, p. 370. 4. Déc. adm., 8 janvier 1955, Rec. gén. enr. not., 1955, n° 19.490; pour les dots moniales, les obligations alimentaires, les obligations naturelles, les donations rémunératoires, les donations avec charges, voyez M. DONNAY,« Droits de succession et de mutation par décès >> (mis à jour par A. CULOT), Rép. not., t. XV, 1. XI, Bruxelles, Larcier, 1996, p. 379 à 384. E. Story-Scientia - w 24.837- 405 C'est 1'Administration qui doit prouver l'existence d'une donation non soumise au droit d'enregistrement dans les trois ans précédant Je décès. Elle peut prouver cet acte par toutes voies de droit (article 105 du Code des droits de succession). Elle dispose en outre de la présomption contenue dans l'article 108 du Code, aux termes duquel les actes de propriété passés par le défunt, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant son décès, sur des biens meubles (1 ), établissent à suffisance que ces biens se retrouvent dans sa succession. Si elle ne peut prouver que ces actes de propriété ont eu lieu dans les trois ans, la présomption sera simple et devra en pratique être confortée par d'autres faits pour emporter la conviction du juge (article 105 du Code des droits de succession). Les « actes de propriété » au sens de J'article 108 sont les écrits, émanés du défunt lui-même, de ses auteurs ou de tiers agissant au profit du défunt (2), qui révèlent de façon certaine la propriété du de cujus sur les biens concernés (3). On peut citer à titre d'exemple les actes d'achat (actes authentiques ou sous seing privé mais également unilatéraux tels que les factures, bordereaux d'achat de valeurs etc.), les actes de donation en faveur du de cujus, les reconnaissances de dette envers Je de cujus, les inventaires par exemple annexés aux contrats de mariage, les déclarations de succession signées par le de cujus (4), les actes de société dont on peut déduire la propriété par le de cujus d'actions ou d'obligations et notamment la liste des présences à 1'assemblée générale, les polices d'assurance contre Je vol ou 1'incendie, les écritures bancaires, les retraits de fonds, les actes de vente pour prouver la propriété de la somme constituant le prix, etc. (5) (6). Les actes qui laissent seulement présumer l'existence de certains biens ne suffisent pas à faire jouer la présomption de J'article 108 ; ainsi, 1'encaisse1. Ceux auxquels s'applique 1'article 2279 du Code civil. 2. M. DONNAY, o.c., p. 983-985. 3. Liège, 15 janvier 1932, Rec. gén. enr. not., n° 17.160, cité par M. DONNAY, o.c., p. 982 ; A. CULOT, << Les réactions de l'Administration face aux simulation en vue d'un planning successoral- Analyse de cas pratiques »,Journée d'étude Skyroom du 28 janvier 1997, p. 16. 4. Sais. Charleroi, 17 avril 1989, Rec. gén. enr. not., n° 23.749. 5. M. DONNAY,<< Droits de succession et de mutation par décès», (mis à jour par A. CULOT), Rép. not., t. XV, 1. XI, Bruxelles, Larcier, 1996, p. 981 et 998 à 1000, et références de jurisprudence citées. 6. On rappellera que la présomption créée par cet article est très fréquemment utilisée et que l'Administration dispose de larges moyens d'investigation pour découvrir les actes de propriété nécessaires : enquêtes bancaires (article 100 du Code des droits de succession), obligation pesant sur les sociétés, les banques, les agents de change, les agents d'affaires et les officiers publics et ministériels de l'informer spontanément des transferts, mutations, conversions, paiements ou restitutions relatifs aux titres sommes ou valeurs dont ces personnes ont à connaître (articles 96 à 99 du Code des droits de succession), etc. Rec. gén. enr. not. 7 406 - N° 24.837- ment de dividendes d'actions ou de coupons d'obligations par le de cujus ne prouve pas qu'il est propriétaire de ces valeurs (1 ). Ces actes pourront toutefois servir de présomption simple au sens de 1'article 105. L'article 108 permet donc au fisc d'éviter la preuve de la libéralité requise par 1'article 7. II lui suffit d'établir que le de cujus était propriétaire de biens mobiliers dans les trois ans précédant le décès pour pouvoir ajouter leur valeur à la base imposable pour les droits de succession. Les héritiers et légataires peuvent renverser la présomption de 1'article 108 de plusieurs façons. Ils peuvent tout d'abord prouver que les biens n'ont jamais appartenu au de cujus et attaquer la preuve par 1'Administration d'un acte de propriété en démontrant par exemple que 1'acte de propriété passé par le défunt en son nom 1'était pour le compte d'un tiers, en vertu d'un contrat de commission. Ils peuvent également démontrer que les biens ne faisaient plus partie du patrimoine du défunt au moment du décès, soit parce qu'ils se trouvent dans la succession sous une autre forme, sous laquelle ils ont été déclarés (2), soit parce qu'ils sont sortis de ce patrimoine- prêtés, volés, perdus, dépensés, ou encore donnés. La preuve à apporter par les ayant droit du de cujus est celle d'un fait matériel : le changement de possession ; ils peuvent dès lors utiliser tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris (3) ; de simples allégations ne suffisent bien entendu pas ( 4), mais ils ne doivent pas démontrer que le changement de possession intervenu a pour cause une donation (5) ou un autre acte juridique. C'est alors à 1'Administra1. M. DONNAY, o.c., p. 982. 2. A. CULOT, o.c., p. 17. 3. M. DONNAY, o.c., p. 1002; M. MUNO, o.c., p. 158, note 96; voyez aussi Bruxelles, 27 juin 1991, Rec. gén. enr. not., n° 34.216, où les héritiers parviennent à prouver par des faits précis et concordants que le produit litigieux de la vente d'un immeuble a été transmis à une tierce personne mais se gardent d'invoquer une donation. L'Administration, n'ayant pu démontrer la réalité de celle-ci, ne peut percevoir les droits. 4. Civ. Liège, 29 septembre 1994, Rec. gén. enr. not., n° 24.479 ; Civ. Arlon, Il janvier 1994, Rec. gén. enr. not., n° 24.361 ; Mons, 9 avril 1993, Rec. gén. enr. not., n° 24.326 ; 1'opposition sur titres effectuée par les héritiers est notamment insuffisante pour prouver que les biens n'ont pas été retrouvés dans la succession: décision du 30 janvier 1996, Rec. gén. enr. not, n° 24.623. 5. Lorsque 1'Administration démontre un acte de propriété dans les trois ans du décès, prouver que les biens ont été donnés n'est guère utile car après avoir renversé la présomption de l'article 108, on retombe- de Charybde en Scylla- dans le champ d'application de la présomption, irréfragable, de l'article 7. Les héritiers pourraient cependant avoir intérêt à rapporter cette preuve pour que le droit soit perçu dans le chef du donataire- présumé légataire-, si c'est un tiers. Des déclarations de complaisance d'un tiers attestant avoir reçu les biens par don manuel, en vue de réduire le taux marginal du droit, pourraient toutefois être rejetées comme ne constituant pas la preuve contraire prévue à l'article 108. Voyez M. DONNAY, << Droits de succession et de mutation par décès », (mis à jour par A. CULOT), Rép. not., t. XV, 1. XI, Bruxelles, Larcier, 1996, p. 377 et références citées. E. Story-Scientia - W 24.837- 407 tian de prouver que ces biens ont été donnés dans le laps de trois ans pour pouvoir percevoir les droits de succession. Si elle ne parvient pas à prouver que le changement de propriété démontré par les héritiers est dû à une donation, elle ne pourra pas percevoir les droits, ni sur base de l'article 108, ni sur base de l'article 7 (1). Si 1'Administration n'est pas parvenue à démontrer que 1'acte de propriété allégué avait eu lieu dans les trois ans précédant le décès du de cujus (2), les héritiers ne seront obligés d'apporter la preuve du don manuel intervenu avant ces trois ans que si 1'Administration avance d'autres faits précis et concordants tendant à démontrer que le défunt était toujours propriétaire des biens au moment du décès (3). C'est ici qu'outre la preuve du don manuel intervient la difficile preuve de la date de celui-ci, qui, on le voit, devient un élément fondamental. On insistera toutefois sur le fait que ce n'est que dans cette hypothèse précise ( 4) où le fisc n'a pu établir de véritable acte de propriété dans les trois ans que le contribuable aura intérêt à prouver le don manuel et sa date. Si le fisc a pu démontrer un acte de propriété sur les biens dans les trois ans du décès, il ne servira à rien de prouver un don manuel postérieur puisque le droit de succession sera dû en tout état de cause ; la seule chose à faire est alors de tenter d'établir que l'acte allégué n'est pas un acte à titre de propriétaire, mais par exemple à titre d'usufruitier, ou de gestionnaire, ou de mandant, et que le transfert de propriété par donation a eu lieu avant les trois ans. Restera alors à démontrer qu'il y a bien eu tradition et dépossession et donc don manuel valable ... Le fisc est un tiers par rapport au contrat de donation et 1'article 1328 du Code civil, imposant que la date soit certaine pour être opposable aux tiers, lui est applicable. Cependant, contrairement à 1'article 18 du Code des droits d'enregistrement, ni l'article 7, ni l'article 108 du Code des droits de succession ne reprennent cette exigence. D'autre part, comme en matière de droits d'enregistrement (5), l'Administration admet que la preuve de la sincérité de la date des actes soit rapportée par des éléments extrinsèques à ceux-ci (6). La tâche du contribuable est donc quelque peu simplifiée, même si on peut toujours conseiller de se réserver une preuve préconstituée. On reviendra sur les moyens de se réserver cette preuve dans le prochain chapitre. 1. Voyez M. MUNO, o.c., et référence citée. 2. Ou si 1'acte intervenu dans le délai de trois ans peut s'analyser autrement que comme un acte de propriété. 3. Par exemple 1'encaissement par le donateur des coupons de titres donnés avec réserve d'usufruit. 4. Outre 1'hypothèse de l'article 9 du Code des droits de succession, que nous étudierons plus loin. 5. Circulaire du 26 mars 1956, Rec. gén. enr. not., n° 19.682, citée par M. MUNO, o.c., p. 159. 6. M. DONNAY, o.c., p. 386, n° 279-3 et 1203. Rec. gén. enr. not. 7 408 - w 24.837- Section 3 : Attitude de l'Administration envers le don manuel L'utilisation de la technique du don manuel pour transmettre des biens a souvent pour but d'éluder les droits d'enregistrement ou de succession. Dès lors, les protagonistes se méfient souvent de possibles interventions du fisc pour~~ requalifier» leur opération. Or, le fisc n'a que peu de moyens d'action contre le don manuel. Il n'en a d'ailleurs souvent pas connaissance. Bien plus, il ne songe généralement pas à le critiquer car, si 1'intention fiscale est souvent présente, elle s'accompagne toujours d'une véritable intention de faire une donation. Il y a rarement simulation lorsqu'on fait un don manuel. Il y a parfois «montage» lorsque le don manuel fait partie d'une opération plus complexe mais, là aussi, au souci de payer des impôts moins élevés s'ajoutent des préoccupations patrimoniales légitimes. Un reproche que le fisc pourrait cependant quelquefois adresser à l'auteur d'un don manuel est d'accomplir entre vifs une transmission que ce dernier préférerait en réalité voir s'effectuer pour cause de mort- et de ne pas assumer les conséquences de ce choix. Certaines soi-disant traditions ou certains pactes adjoints sont à cet égard quelque peu suspects ... Mais, même contre ces dons manuels irréguliers, 1'Administration ne peut pas toujours agir. On étudiera rapidement dans cette section les moyens d'action généraux de 1'Administration, pour constater qu'ils ne sont pas d'une grande utilité face à un don manuel ( 1). A. La mesure anti-abus de droit Dans le but de mettre fin à l'application de la jurisprudence de l'arrêt Brepols (2) qui légitimait la recherche de la voie la moins imposée, la loi du 30 mars 1994 introduisit l'article 18, § 2 dans le Code des droits d'enregistrement et 1'article 106, alinéa 2 dans le Code des droits de succession, permettant de s'opposer à la qualification donnée à un acte ou à un ensemble d'actes lorsque cette qualification a pour seul but d'éviter le paiement de droits. Dans un premier temps, l'Administration avait décidé d'appliquer également ces dispositions à des opérations accomplies dans le cadre de la gestion privée d'un patrimoine (3). Elles pouvaient dès lors être utilisées pour dis1. On suppose bien entendu dans cette section que tout problème relatif à la preuve du don manuel a été résolu. 2. Cass., 6 juin 1961, Pas., 1961, I, 1082. 3. Circulaire administrative du 18 décembre 1995, Rec. gén. enr. not., 1996, p. 46, point 6. Cette circulaire n'indiquait cependant pas quels motifs légitimes privés le contribuable pouvait invoquer pour justifier la qualification adoptée (alors que les articles de loi ne citent que << des besoins légitimes de caractère financier ou économique » ). Cet oubli a donné lieu à des critiques: Ph. DE PAGE,<< Succession et donations. Questions de E. Story-Scientia - W 24.837- 409 qualifier non pas un don manuel isolé (qui semble peu susceptible d'une autre qualification), mais un ensemble d'opérations comprenant un ou plusieurs dons manuels, à condition que cet ensemble soit susceptible d'une autre qualification et que 1'évitement de 1'impôt ait été le but déterminant conduisant à la qualification choisie. Par exemple, la création d'une société par des parents qui y apportent un immeuble puis en transmettent les titres à leurs enfants par des dons manuels vise à éviter les droits de donation de l'immeuble. Elle peut cependant être également justifiée par le souci de maintenir l'unité de biens non partageables (château de famille ... ) (1). De même, le don manuel de fonds permettant au donataire d'acheter un immeuble ou des titres nominatifs au donateur permet également d'éviter les droits de donation (2). Il pourrait néanmoins s'expliquer par la volonté par exemple de transmettre 1'entreprise familiale à 1'héritier le plus apte et de permettre à celui -ci un rapport des seules sommes correspondant à la valeur de 1'entreprise au jour de la donation (article 868 du Code civil) afin de la protéger contre les éventuelles contestations des autres héritiers (3). Ainsi, la plupart des opérations de gestion du patrimoine privé sont inspirées de considérations légitimes, à côté d'éventuels motifs fiscaux. Dès lors, 1'Administration, ayant aperçu les nombreuses difficultés auxquelles elle pouvait se heurter ( 4), décida finalement de ne plus appliquer la mesure an tiabus de droit à ces opérations (5). fiscalité et moyens de preuve >>, Rev. not. b., 1996, p. 559 ; Ph. DE PAGE,<< Les donations et arrangements de famille et le droit fiscal >>, Rev. gén. fisc., 1996, p. 301 ; S. V AN CROMBRUGGE, « Anti-Misbruikmaatregel nu ook in registratie- en successierecht: een maat voor niets? >>, Fiscoloog, n° 460, 24 février 1994, cité par A. CULOT, <<Les réactions de 1'Administration face aux simulations en vue d'un planning successoral >>,Journée d'étude Skyroom du 28 janvier 1997, p. 3. 1. Ph. DE PAGE,<< Les donations et arrangements de famille et le droit fiscal>>, o.c., pp. 306-307. 2. Ceci n'est intéressant que si l'immeuble a une valeur très importante ou si les donataires sont des parents éloignés ou des étrangers par rapport aux donateurs. Une telle opération pourrait d'autre part faire suspecter le déguisement d'une donation d'immeuble si le don des fonds a lieu après la vente (ou s'il y a remise du prix immédiate au lieu de don manuel des fonds) ; dans ce cas, on le verra, 1'Administration choisira la taxation la plus favorable : voyez Ph. DE PAGE, << Successions et donations. Questions de fiscalité et moyens de preuve >>, o.c., pp. 560 et 562. 3. Ph. DE PAGE,<< Les donations et arrangements de famille et le droit fiscal>>, o.c., pp. 306-307. 4. Pour un relevé, voyez A. CULOT, << Les réactions de 1'Administration face aux simulations en vue d'un planning successoral>>, Journée d'étude Skyroom du 28 janvier 1997, p. 3. 5. Circulaire n° Il du 20 novembre 1996, citée par A. CULOT, o.c., p. 3; voy. aussi A. CULOT, << Mesures anti-abus de droit, requalification et simulation >>, Rec. gén. enr. not., n° 24.681, n° 1, p. 94. Rec. gén. enr. not. 7 410 - N° 24.837- Cette mesure n'est donc pas utilisée par l'Administration, s'agissant d'un don manuel. B. La rectification de la qualification erronée L'Administration doit rechercher la véritable nature de l'acte présenté à l'enregistrement et ne pas s'en tenir à la qualification proposée par les parties. Dès lors, si celles-ci ont de bonne foi mal qualifié 1'acte, le receveur des droits d'enregistrement pourra redresser la qualification erronée, à condition que tous les éléments de la nouvelle qualification soient inclus dans l'acte soumis à l'enregistrement et qu'aucune recherche extérieure à l'acte ne soit nécessaire (1 ). Cette requalification n'entraîne aucune sanction. Le don manuel n'étant généralement pas présenté à 1'enregistrement, on ne s'étendra pas sur cette mesure. C. La preuve de la simulation Lorsque les parties ont donné volontairement à 1'acte présenté à 1'enregistrement une qualification qui ne révèle pas la véritable convention intervenue entre elles, il y a simulation et 1'Administration peut rechercher les éléments extrinsèques établissant la convention secrète réellement intervenue. Elle est en effet un tiers à 1'acte et pourra se prévaloir ou non de la contre-lettre pour percevoir les droits les plus élevés. Chacune des parties est tenue en sus au paiement d'une amende égale aux droits éludés (articles 203 et 204 du Code des droits d'enregistrement). Dans 1'hypothèse où le don manuel est « avoué » (on n'a guère intérêt à le dissimuler sous un autre acte), il semble que la simulation est exclue car on voit mal ce qu'il pourrait cacher. Cependant, certains dons, notamment avec pacte adjoint pourraient poser problème. En effet, parfois, les parents donateurs auraient préféré transmettre leur patrimoine mobilier à leur mort mais le font entre vifs pour éviter à leurs enfants les droits de succession. Ils ne veulent cependant pas assumer toutes les conséquences de leur choix et désirent garder un contrôle sur les biens donnés, particulièrement s'il s'agit de titres d'une société familiale. Certains sont maladroits et ne respectent pas les conditions de validité du don manuel, et plus particulièrement celle de la tradition qui doit entraîner une dépossession immédiate. Par exemple, le placement de l'argent ou des titres donnés sur un compte ou dans un coffre (2) auquel le donateur a accès 1. A. CULOT, o.c., p. 9. 2. Dans ce cas, 1'article 1 JO du Code des droits de succession, qui présume que les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques déposés dans un coffre-fort au nom du défunt même seulement conjointement lui appartiennent pour une part virile, pourra également s'appliquer. E. Story-Scientia - N° 24.837- 411 et dont il peut retirer ces biens rend la donation nulle (1 ). Si le fisc peut prouver l'existence d'actes de propriété sur ces biens dans les trois ans avant le décès (article 108 du Code des droits de succession), l'allégation d'un don manuel n'empêchera pas la réintégration de ces biens dans la succession. D'autres ne se réservent que l'usufruit des biens donnés. S'il s'agit de biens pour lesquels la dissociation entre l'usufruit et la nue-propriété est possible en respectant les conditions du don manuel, l'Administration ne pourra en principe rien trouver à y redire si les parties peuvent prouver qu'il y a bien eu tradition. L'article 9 du Code des droits de succession, que nous étudierons plus avant dans le troisième chapitre, vient cependant précisément présumer que, sous certaines conditions, il y a simulation du don et déguisement d'un legs. Le législateur est parti de l'idée qu'une donation avec réserve d'usufruit avait pour l'essentielles mêmes effets qu'un legs-« à savoir le transfert de la pleine propriété au décès de l'aliénateur seulement et la conservation par ce dernier, sa vie durant, de la propriété « économique » du bien, c'est-à-dire des fruits et revenus par lui produits»- bien que, sur le plan fiscal, elle n'engendre pas la débition de droits de succession « parce que le nu-propriétaire devient plein propriétaire, non par succession, mais par suite de l'extinction de l'usufruit» (2). Cette présomption de déguisement peut être renversée en démontrant qu'une donation ou un autre transfert de propriété avait eu lieu avant l'exécution de la convention de réserve d'usufruit, comme on le verra plus en détail dans le troisième chapitre, mais on aperçoit d'ores et déjà que la prudence est de mise et que cette sorte de simulation assez insidieuse n'est pas invisible pour l'Administration. Un arrêt récent (3) est néanmoins venu affaiblir la position de l' Administration face à de prétendus don manuels « avec réserve d'usufruit ». Sans nécessairement invoquer l'article 9, elle considérait généralement que le don manuel, invoqué par exemple à l'encontre d'un faisceau de présomptions de propriété dans le chef du de cujus au décès, était nul pour défaut de tradition afin de réintégrer les biens dans la masse successorale. Or, dans son arrêt, la Cour d'appel de Liège déclare que l'Administration ne peut se prévaloir de la nullité d'une donation que les héritiers du donateur ont confirmée après le décès de celui-ci, notamment en renonçant à invoquer ses vices. En effet, selon l'article 1340 du Code civil, après le décès du donateur, la nullité devient relative et seuls les héritiers peuvent l'invoquer. La confirmation de la donation a pour effet de valider celle-ci à la date où elle a été réalisée ( 4). 1. Voyez supra, chapitre 1, section 1. 2. Liège, 9 mai 1995, Rec. gén. enr. not., n° 24.516. 3. Ibidem. 4. Voyez en ce sens, S. NUDELHOLE, « Le régime de la nullité des donations pour vice de forme>>, note sous Liège, 13 octobre 1997,J.L.M.B., 1998, p. 257 qui ajoute:<< C'est cette règle qui fait perdre une grande partie de son intérêt pratique à la question de savoir Rec. gén. enr. not. 7 412 - N° 24.837- D'autre part, l'Administration ne peut arguer de l'article 1338 in fine qui dispose que la confirmation d'un acte nul ne peut porter préjudice aux droits des tiers car elle n'est pas un tiers au sens de cet article (1 ). En 1'espèce, cette position de la Cour permit aux contribuables d'invoquer une donation nulle en la forme (il s'agissait d'une donation de parts de la société en commandite simple « Nagelmackers fils et compagnie, banquiers » dans le plus total mépris de 1'article 931 du Code civil) pour déroger à 1'application de 1' article 9 du Code des droits de succession. Les héritiers purent donc invoquer cette donation nulle pour prouver qu'un transfert de propriété avait bien eu lieu avant l'exécution de la convention de réserve d'usufruit. On peut se demander si cette jurisprudence n'est pas également applicable lorsqu 'un don manuel est allégué, dont la date est prouvée ou non contestée, mais qui ne respecte pas d'autres conditions de validité. Dans la mesure où 1'article 1340 du Code civil s'applique, il semble qu'on puisse répondre par 1' affirmative. Or, cette disposition permet aux héritiers du donateur de confirmer la donation nulle soit pour vice de forme, soit pour « toute autre exception ». Selon DE PAGE (2), il faut entendre par là « toutes les règles propres aux donations qui sont des règles de forme lato sensu en quelque sorte et qui sont assez nombreuses étant donné que la loi a multiplié les obstacles sur la route des donations » (3 ). Par contre, 1'expression ne pourrait être étendue aux nullités de fond qui restent des nullités absolues et ne deviennent pas relatives après le décès du donateur (4). si les actions nominatives de sociétés anonymes et les parts de S.P. R.L. peuvent faire l'objet d'une donation indirecte valable, par simple inscription dans le registre.[ ... ] pour la raison qui vient d'être rappelée, cette technique permet d'éviter les droits de succession, nonobstant la controverse qui subsiste quant à la validité en la forme des donations de parts nominatives réalisées de cette manière >>. 1. La Cour se base ici sur un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1994 (dans 1'affaire du Château de La Hulpe) dans lequel on peut lire que <<dans cette disposition, le terme << tiers >> désigne les personnes qui ont acquis, sur la chose faisant 1'objet du contrat, un droit propre et direct leur permettant d'agir en nullité>>. Dans l'affaire qui occupait la Cour d'appel de Liège, le fisc n'avait à aucun moment acquis de droit propre et direct sur la chose auquel la confirmation de la donation aurait pu nuire : en effet, avant le décès du donateur, il n'avait aucun intérêt à demander la nullité de la donation, et après le décès, il n'avait plus le droit de la demander puisqu'elle était devenue relative. 2. O.c., t. VIII, n° 480 et 487. 3. Il cite les nullités qui sanctionnent les clauses contraires à 1'irrévocabilité des donations et à l'interdiction des donations mutuelles entre époux. 4. Par exemple la nullité pour cause illicite ou la nullité d'une donation à une personne morale de droit public acceptée sans autorisation du gouvernement ; voyez à ce sujet S. NUDELHOLE, << Les donations réalisées en Belgique autrement que par acte notarié>>, Journée d'étude Skyroom du 31 mars 1998, p. 17 qui contrairement à DE PAGE (cf. note précédente) estime que l'irrévocabilité de la donation doit être sanctionnée par une nullité absolue, non susceptible de confirmation. E. Story-Scientia - W 24.837- 413 Sauf dans le cas de réelles nullités de fond, 1'Administration n'a dès lors plus intérêt à invoquer la nullité d'un don manuel- allégué pour échapper à 1'application de 1'article 9 ou simplement pour contrer la preuve d'un acte de propriété au-delà des trois ans avant le décès invoqué à titre de présomption simple (1 ). Elle pourrait par contre tenter de se prévaloir de 1'inexistence de 1'acte qui, elle, ne pourrait être confirmée - si un de ses éléments constitutifs essentiels venait à manquer. Reste à déterminer quels sont ces éléments dont le défaut rendrait l'acte inexistant. S'agissant des conditions d'existence du don manuel - tradition réelle, dépossession immédiate corrélative et objet susceptible de tradition, selon nous - on peut se demander si leur absence entraîne bien une totale inexistence de 1' acte et si on ne se trouverait pas en présence d'une donation, certes nulle en la forme, mais qui peut être confirmée par les héritiers. À suivre ce raisonnement, il ne servirait à rien d'invoquer le défaut des éléments constitutifs du don manuel et l'Administration devrait donc plutôt se concentrer sur les conditions essentielles des donations, pour pouvoir invoquer que la libéralité elle-même est inexistante. Ces conditions sont peutêtre plus difficiles à déterminer (2). En ce qui concerne 1'élément qui pourrait manquer dans les cas examinés ci-dessus, à savoir le dépouillement, il est certain que s'il doit s'agir du dépouillement de la possession elle-même pour la validité du don manuel, le dépouillement de la propriété peut être à terme ou même sous condition suspensive sans affecter la validité de la donation authentique (3). La question de savoir si 1'irrévocabilité, quant à elle, est un élément constitutif essentiel ou si c'est une simple «condition de forme lato sensu » dont le non-respect est susceptible de confirmation est moins claire. En attendant un verdict ju1. Une décision du 1er juillet 1957 (Rec. gén. enr. not., n° 20.157) fait d'ailleurs application de cette constatation dans le cas d'une donation de parts d'une s. p. r.l. en violation de l'article 931 du Code civil: «l'État[ ... ], en droit d'invoquer la nullité pour vice de forme [... ] s'abstient toutefois de le faire lorsque les circonstances de l'affaire font apparaître que la donation sera confirmée ou ratifiée ou exécutée volontairement et sans fraude par les héritiers ou ayants cause du donateur >>. 2. H. DE PAGE (o.c., n° 374) cite l'acte d'aliénation, l'acte réalisé à titre gratuit, l'acte réalisé anima donandi, l'acte entre vifs, l'acte bilatéral, le contrat solennel et l'acte irrévocable. Or, on a vu qu'il considère que certaines de ces conditions (au moins la solennité et l'irrévocabilité) sont des conditions de forme lata sensu, propres aux donations et dont le non-respect peut être couvert par une confirmation. À un autre endroit (n° 47), il cite seulement l'acceptation, l'acte à titre gratuit, le dépouillement actuel, le dépouillement irrévocable. 3. H. DE PAGE compare d'ailleurs à la donation pour cause de mort (mortis causa), non valable parce que révocable, des donations à terme de décès ou stipulées caduques en cas de prédécès du donataire qui, elles, restent irrévocables et donc régulières. Rec. gén. enr. not. 7 414 - N° 24.837- risprudentiel, on peut cependant douter que, même après l'arrêt de Liège, 1'Administration accepte de ne pas réintégrer dans la masse successorale des biens sur lesquels le donateur s'est par exemple réservé un droit de gestion qui lui permet de les aliéner pour les remplacer par d'autres, etc. (1). Peut-on déduire de ce qui précède que, dans le cas par exemple d'un soidisant don manuel de meubles corporels avec réserve d'usufruit ou dans le cas cité ci-dessus du placement des titres donnés sur un compte ou dans un coffre auquel le donateur a accès, l'Administration n'aura aucun moyen de réintégrer les biens dans la succession parce qu'on lui objecterait que si le don manuel est inexistant, la donation, elle, existe bien, quoiqu'elle soit nulle en la forme, et a été confirmée ? C'est aller un peu loin. On en arrive presque à encourager la fraude aux droits d'enregistrement pour toutes les donations si on est sûr qu'au moment du décès, les héritiers seront d'accord pour confirmer 1'acte (2). Si cependant les parties ont cru de bonne foi réaliser un don manuel valable et donc légalement non enregistrable, si donc 1' Administration ne peut pas prouver de fraude ni de contre-lettre (d'intention réelle différente de celle qui apparaît dans l'acte) (3), il nous semble que le raisonnement pourrait s'appliquer. Ainsi donc, du moins lorsque la date du transfert de propriété a été prouvée et qu'elle se situe plus de trois ans avant le décès du donateur, l'Administration ne dispose plus guère de moyens de percevoir les droits de succession, même si elle suspecte le don manuel d'irrégularité (et, bien entendu, sauf fraude à la loi). Ce n'est pas à dire qu'il ne faut pas rester prudent et tâcher de réaliser une opération qui respecte toutes les conditions de validité du don manuel. Les parties doivent également être de bonne foi et assumer les conséquences de leur acte ( 4), afin de couper court aux investigations de 1'Administration qui, 1. Cf. infra le cas du mandat de gestion adjoint au don d'un portefeuille de titres. 2. Il convient peut-être de rappeler ici que nous n'avons pas voulu étudier l'incidence des litiges civils entre les héritiers et les donataires. Ils trouveraient ici une acuité toute particulière puisque si les héritiers, au lieu de confirmer le don manuel, contestent sa validité, les biens donnés seront nécessairement réintégrés à la masse successorale. 3. Et il faudrait que cette intention existe au moment de la donation et non seulement au moment de la confirmation de 1'acte : dans 1'arrêt de Liège, lorsque l'Administration soutient que la confirmation des donations litigieuses lui est inopposable parce qu'elle ne poursuit qu'un seul but, éluder l'impôt, la Cour répond que<< s'il est incontestable que par les articles 5 à 1 1 du Code des droits de succession, le législateur a voulu empêcher la fraude à l'impôt successoral, il est également certain qu'il ne faut pas appliquer ces textes en dehors de leurs prévisions : les dispositions légales de ce type sont de stricte interprétation. >> 4. A. CULOT, «Les réactions de l'Administration face aux simulations en vue d'un planning successoral», Journée d'étude Skyroom du 28 janvier 1997, p. 22. E. Story-Scientia 415 -W24.837- tiers par rapport à l'acte, jouit toujours d'un pouvoir d'appréciation et d'analyse de celui-ci et peut se prévaloir de la contre-lettre qu'elle aura pu prouver. Les développements qui suivent dans le prochain chapitre (spécialement quand il sera question de réserve d'usufruit) seront donc toujours animés de l'intention d'accomplir un don manuel valable. CHAPITRE III : ÉTUDE CRITIQUE DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES IMAGINÉES PAR LA PRATIQUE POUR RÉALISER UN DON MANUEL ET S'EN RÉSERVER LA PREUVE Section 1 : Don manuel simple A. Acte authentique Le meilleur moyen de se réserver une preuve du don et de lui conférer date certaine est évidemment de le constater dans un acte authentique qui sera obligatoirement enregistrable (article 19, 1° du Code des droits d 'enregistrement). Le droit proportionnel sera alors exigé (1 ), ce qui est l 'inconvénient majeur de cette technique qu'on n'examinera donc pas plus avant. B. Enregistrement de la déclaration unilatérale du donateur Le droit proportionnel de donation ne sera exigible lors de l'enregistrement que si l'acte présenté fait titre de la donation. Le« titre» dont il s'agit est l'écrit probatoire, c'est-à-dire l'acte qui suffit à constituer la preuve littérale de la convention (2). Cet acte doit donc contenir la preuve du consentement du donateur et du donataire et porter la signature des parties (3). Une simple reconnaissance unilatérale du don, ne portant la signature que du donateur ou du donataire, ne devrait donc pas entraîner la débition du droit proportionnel mais celle du droit fixe général. 1. Notons que Je droit proportionnel sera dû également si J'acte présenté à l'enregistrement est un simple acte sous seing privé signé par les deux parties, que J'acte soit un écrit probatoire ou même qu'il soit l'écrit portant donation, en violation de l'article 931 du Code civil, car l'Administration n'est pas juge de la validité des actes. Quant à cet acte nul en la forme, reste la question de savoir s'il pourra être invoqué, alors même qu'il a été enregistré, pour prouver que les biens donnés ne se retrouvent pas dans la succession du donateur; la Cour d'appel de Liège a répondu à cette question par l'affirmative, si les héritiers ont confirmé J'acte nul (9 mai 1995, Rec. gén. enr. not.). 2. M. MUNO, << Le don manuel >>, Journ. dr. fisc., 1993, p. 152. 3. P. STIENON, << Problèmes civils et fiscaux relatifs aux dons manuels>>, Rev. gén. fisc., 2/1987, p. 44; A. CUVELIER, <<Droits d'enregistrement applicables aux donations entre vifs>>, Rép. not., tome III, livre XI, p. 43; M. MUNO, o.c., p. 153. Rec. gén. enr. not. 7 416 - N° 24.837- L'Administration considère cependant que la déclaration unilatérale du don par le donataire a nécessairement pour but de procurer au donateur un titre de la donation. En effet, le donateur a besoin d'un écrit pour prouver le don manuel, tandis que le donataire est protégé par sa possession qui lui procure un titre suffisant. La déclaration unilatérale du donataire ne s'explique donc que par la volonté de constituer une preuve pour le donateur (1) (2), alors que la déclaration unilatérale du donateur n'aurait pas ce but. Ce raisonnement est critiqué (3) car il existe de nombreux cas où le donataire a besoin d'un écrit pour prouver le don manuel : lorsque sa possession est viciée ou lorsqu'il doit prouver une interversion de titre lors d'une action en restitution intentée par le donateur ( 4). L'Administration a néanmoins confirmé sa position à plusieurs reprises (5) et est suivie par la jurisprudence (6). Malgré les inquiétudes de certains auteurs (7), il ne paraît pas à craindre qu'elle revienne sur ces décisions. 1. Sauf si le donataire a besoin de déclarer la provenance des fonds pour bénéficier par exemple du mécanisme du remploi dans le cadre d'un régime matrimonial de communauté. 2. A. CUVELIER, o.c., p. 43; M. DONNAY,« Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe >>, (mis à jour par A. CUVELIER), Rép. not., tome XV, livre X, n° 91 s ; R. DE V ALKENEER, «Reconnaissance unilatérale et droit d'enregistrement>>, Rev. not. b. 1989, p. 560 ; N. GEELHANO, « De incidentele vermelding van een handgift in een notarièle akte waarin de schenkers zijn tussengekomen >>, T. not. 1989, p. 406; C.E.L., 1975, doss. n° 6013, pp. 190 à 210; contra: F. WEROEFROY, Registratierechten, Kluwer, 1991, p. 1154. 3. M. MUNO, o.c., p. !56; F. DELPORTE, Le don manuel, Diegem, ced. Samson, 1996, pp. 58-59. 4. Cf. infra, chapitre 1, section 3. 5. En ce qui concerne la reconnaissance unilatérale du donataire: décision du !er août 1966, Rec. gén. enr. not., n° 21.042, reprenant une décision du 30 avril 1880; décision du 28 juillet 1951, Rec. gén. enr. not., n° 19.139 pour le cas où cette reconnaissance est annexée à l'inventaire des biens du donateur; réponse du Ministre des Finances à la question du Représentant VAN ROMPUY du 5 décembre 1989, Rec. gén. enr. not., 1990, n° 23.900, cité par M. MUNO, o.c., p. 154. En ce qui concerne la reconnaissance unilatérale du donateur : décision du 7 décembre 1978, Rec. gén. enr. not., n° 22.447. 6. Bruxelles, 23 septembre 1986, Rec. gén. enr. not, n° 23.397 ; Cass., 29 juin 1989, Rec. gén. enr. not., n° 23.778, obs.; Rev. not. b., 1989, p. 599; Rev. gén.fisc., 1989, 308 et note B. PEETERS. 7. M. MUNO, o.c., p. 156; F. DELPORTE, o.c., p. 56 et 62, qui tous deux constatent avec raison que les raisons avancées par 1'Administration pour percevoir les droits, << à savoir que l'écrit est destiné à servir de preuve pour un don manuel, valent [ ... ] tout autant pour la reconnaissance par le donateur qu'un don manuel a eu lieu>>. Néanmoins, il n'entre pas dans les habitudes de l'Administration de modifier une position acquise de si longue date; il y va d'un principe de bonne administration. Elle ne risque donc pas d'invoquer ces arguments en justice, même si la jurisprudence est peut-être prête à la suivre dans ce sens. E. Story-Scientia 417 - W 24.837- La reconnaissance unilatérale par le donateur est donc un excellent moyen de se réserver une preuve du don manuel sans risquer de devoir payer de droits d'enregistrement. Dans la problématique qui nous occupe (la preuve à l'égard du fisc), le donataire, surtout s'il est aussi un héritier du donateur, sera la seule des deux parties à la donation à avoir intérêt à se réserver une preuve pour être sûr que les biens donnés ne soient pas réintégrés à la succession, au décès du donateur. L'enregistrement de la reconnaissance lui procurera date certaine et ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe général. C. Mention unilatérale dans un acte présenté à l'enregistrement II arrive que 1'une des parties à la donation fasse mention de celle-ci dans un autre acte présenté à 1'enregistrement, tout à fait étranger à la donation (1). Cette mention s'explique parfois par le souci de prouver au contrôleur des impôts directs la provenance des fonds servant à une acquisition, afin d'éviter une taxation indiciaire des revenus, ou même par une tentative de se réserver une preuve indirecte de la date du don manuel antérieur: on croit pouvoir prétendre que le don manuel acquiert date certaine en même temps que 1'acte authentique qui le mentionne. Or, seul 1'acte relaté en substance dans l'acte authentique ou dans l'écrit présenté à l'enregistrement acquiert date certaine et non l'acte dont l'écrit ne fait que mentionner l'existence (2). On raisonne dans ce cas de la même manière que s'agissant de la reconnaissance unilatérale: si c'est le donataire qui intervient à l'acte et si la mention ne s'explique que par la volonté de constituer un titre en faveur du donateur, le droit proportionnel sera perçu (3). Si cette mention s'explique par exemple par l'obligation d'une déclaration expresse de remploi immobilier (4), on considérera qu'elle n'a pas pour but de créer un 1. Par exemple, l'acte d'achat d'un bien immeuble dans lequel l'acheteur déclare payer à 1'aide de fonds reçus à titre gratuit. 2. N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991, p. 276277 et références citées. 3. A. CUVELIER, <<Droits d'enregistrement applicables aux donations entre vifs>>, Rép. not., tome III, livre Xl, p. 43; J.-F. TAYMANS, <<Les donations de sommes ou de titres>>, in Les arrangements de famille, Bruxelles, Story-Scientia, 1990, p. 85, note 1 ; P. STIÉNON, <<Problèmes civils et fiscaux relatifs aux dons manuels>>, Rev. gén. fisc., 2/ 1987, p. 44 ; C.E.L., 1976, doss. n° 1734, pp. 352 à 363 ; Bruxelles, 23 septembre 1986, Rec. gén. enr. not., n° 23.397. R. VALKENEER (<<Reconnaissance unilatérale et droit d'enregistrement>>, Rev. not. b., 1989, p. 560) estime cependant que si le donataire ne mentionne pas le nom du donateur, le caractère tout à fait unilatéral de la mention empêcherait la perception du droit proportionnel. 4. L'Administration a également reconnu que la mention du don par le donataire ne donnait pas lieu à la débition du droit proportionnel lorsqu'elle s'expliquait par le souci <<d'anéantir les effets du don manuel suite à une obligation au rapport>> dans le cadre d'un partage anticipé. Rec. gén. enr. not. 7 418 - w 24.837- titre ( 1). Enfin, si c'est le donateur qui mentionne le don manuel dans un autre acte (2), le droit proportionnel ne sera pas non plus perçu. La mention incidente du don manuel dans un acte présenté à 1'enregistrement est donc dangereuse, car souvent, le droit proportionnel pourra être perçu ; bien plus, elle est en général inutile : en ce qui concerne la taxation indiciaire à 1'impôt des personnes physiques, la simple allégation du don par le donataire n'est pas une preuve suffisante de la provenance des fonds; d'autre part, elle ne permet pas de procurer au don mentionné une date certaine. D. Acte notarié ou public étranger De nombreux auteurs (3) conseillent de passer un acte notarié portant la donation (ou constatant un don manuel antérieur) à 1'étranger et éventuellement de 1'y faire enregistrer. Sur le plan civil, les donations sont régies quant à la forme par la règle «locus regit actum » (4). Il suffit donc que l'acte passé à l'étranger respecte les règles de forme de 1'État dans lequel il est conclu. La force probante de 1'acte est également soumise à cette règle. L'acte notarié ou public étranger aura donc date certaine au sens de 1'article 1328 de notre Code civil, du moins si l'autorité étrangère a le pouvoir de certifier la date de manière équivalente aux officiers belges- ou, si l'acte est enregistré, si cette formalité est équivalente à celle instituée en Belgique (5). 1. Décision du 14 juin 1966, Rec. gén. enr. not. 1967, 257 et obs. ; voyez, dans le cas où les deux parties interviennent à des parties différentes de l'acte : N. GEELHAND, << De incidentele vermelding van een handgift in een notariële akte waarin de schenkers zijn tussengekomen >>, T. Not. 1989, p. 406. 2. Mais on n'aperçoit pas très bien dans quel but. 3. P. DE PAGE, <<Successions et donations. Questions de fiscalité et moyens de preuve>>, o.c., p. 563; E. DE WILDE o'ESTMAEL, <<Dons manuels: techniques de preuves (bancaires et autres), pacte adjoint, réserve d'usufruit>>, o.c.; M DE WIN, L'approche fiscale de la « société de patrimoine », Diegem, ced Samson, 1996, p. 51; F. DELPORTE, o.c., p. 49; M. MUNO, o.c., p. 160-161; S. NUDELHOLE, <<Droits d'enregistrement et de succession: en quoi l'introduction d'un facteur international peutelle modifier les données du problème?>>, Journée d'étude Skyroom du 2 octobre 1997; A. BONTE et Ch. LANTONNOIS, Société de patrimoine- La société dans le choix de la voie la moins imposée, Story-Scientia, 1990, p. 240; J. MALHERBE, <<Analyse du nouveau régime des droits de succession en Flandre. Quels sont les avantages des trusts, fondations, fiducies et administratiekantoren? Analyse des derniers développements>>, Journée d'étude Skyroom du 2 octobre 1997. 4. Article 9 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; S. NUDELHOLE, o.c., p. 13. 5. M. MUNO, o.c., p. 160; M. DONNAY, o.c., n° 33 et réf. citées; P. DE PAGE,<< Successions et donation. Questions de fiscalité et moyens de preuve>>, o.c., p. 563, note 24 et réf. citées. E. Story-Scientia - W 24.837- 419 Sur le plan fiscal, on peut déduire de 1'article 19 du Code des droits d'enregistrement a contrario que l'acte notarié passé à l'étranger n'est pas obligatoirement enregistrable en Belgique (1 ). Par contre, 1'enregistrement à 1'étranger ne permet pas d'échapper à l'application de 1'article 7 du Code des droits de succession si la donation a eu lieu dans les trois ans précédant le décès du donataire (2). Pour que 1'opération soit intéressante, il faut bien entendu 1'accomplir dans un pays où le droit sur les donations est moindre, voire inexistant. Au Luxembourg, par exemple, les taux des droits d'enregistrement sont beaucoup moins élevés et varient de 1,8 % pour les dons en ligne directe, 4,8 % pour les dons entre époux à 14,4 % pour les dons entre personnes sans lien de parenté (3). Aux Pays-Bas, le droit de donation- qui n'est pas un droit d'enregistrement mais un droit dû sur la déclaration de la donation (4)n'est dû que par les résidents néerlandais (5). La donation doit également être faite par acte notarié (6), mais les droits de donation ne seront pas exigés si les parties ne résident pas dans le pays (7). Les principes sont les mêmes en Italie (8). Enfin, parmi les pays européens, la Suisse peut également être 1. Si cet acte est présenté à 1'enregistrement en Belgique ou constaté dans un acte obligatoirement enregistrable dans le but de faire titre de la donation, les droits proportionnels seront toutefois perçus. 2. Cet article ne permet en effet d'éviter le droit de succession sur les biens donnés que si la donation a été soumise au droit d'enregistrement belge et aucun autre article du Code ne prévoit de réduction si un droit de donation a été payé à l'étranger; voyez aussi la décision du 1cc juin 1993, Rec. gén. enr. not., n° 24.283. Il y aura donc double imposition, sauf convention internationale préventive de la double imposition. 3. E. HAZARD et L. TUTTOBENE, << La fiscalité patrimoniale belge est-elle attrayante? Aperçu comparatif>>, Rev. gén. fisc., 1997, p. 55. 4. H. SCHUTTEV ÂER, Erven, schenken en fiscus, Deventer, Kluwer, 1996, p. 113. 5. Kluwer belastinggids, Weert, Kluwer, 1989, p. 350: le droit est dû si le donateur est un résident néerlandais, la résidence du donataire étant sans incidence ; voyez aussi J.F. A VERY JONES, D. GOODMAN WOLFE et A. HOLFEUER, << A comparative study of inheritance and gift taxes >>, European taxation, 1994, p. 391. 6. Idem, p. 51; l'acte notarié n'est toutefois, comme en Belgique, pas obligatoire pour les dons manuels. 7. Il semblerait toutefois que les notaires néerlandais ne soient pas toujours disposés à exercer leurs fonctions lorsque ni les parties, ni l'opération n'ont de lien avec les PaysBas : voyez A. BONTE et Ch. LANTONNOIS, o.c., p. 240. 8. A. BONTE et Ch. LANTONNOIS, Société de patrimoine- La société dans le choix de la voie la moins imposée, Story-Scientia, 1990, p. 240. Rec. gén. enr. not. 7 420 - N° 24.837- choisie car dans certains cantons (1 ), aucun droit (2) n'est perçu sur les donations: il s'agit des cantons de Luzem et de Schwyz (3). Si 1'importance des biens à donner vaut le déplacement et le montant des honoraires du notaire, on peut donc recommander cette formule qui assure une preuve incontestable. E. Technique bancaire Les extraits de compte et autres documents bancaires peuvent prouver à suffisance la réalité et la date d'un versement de fonds ou d'un dépôt de titres sur un compte. La tradition est un fait matériel qui n'exige pas l'existence d'un écrit au sens de l'article 1341 du Code civil. D'autre part, le fisc n'exige pas, on 1'a vu, de date certaine au sens de 1'article 1328 du Code civil. Il reste cependant à prouver que ces opérations bancaires recouvrent un don plutôt que l'exécution d'une convention à titre onéreux. Un écrit distinct sera donc nécessaire pour démontrer 1'intention de donner et 1' acceptation du bénéficiaire ( 4). On peut peut-être encore objecter que 1'Administration pourrait se méfier de la sincérité de la date de cet écrit et prétendre qu'il a été rédigé pour les besoins de la cause alors que le versement avait été fait sans animus donandi. Or, puisque cet écrit n'est qu'un instrument probatoire, il ne nous semble pas inacceptable qu'il soit rédigé ultérieurement, pour se réserver la preuve que 1'intention libérale était bien présente au moment du versement. Cette objection de 1'Administration ne nous paraît donc guère défendable. Quoiqu'il en soit, et pour couper court à toute objection, la pratique bancaire a imaginé la solution suivante, susceptible d'être utilisée pour toutes sommes ou titres se trouvant sur un compte : « - le donateur envoie au donataire une simple lettre ou une lettre recommandée lui annonçant son intention de faire une donation d'espèces ou de titres et lui demandant de se rendre tel jour, telle heure, à telle banque ; 1. La compétence de lever des impôts sur les successions et les donations appartient en effet aux cantons: voyez W. RYSER, Introduction au droit fiscal international de la Suisse, Berne, Staempfli & Cie, 1980. 2. Cet impôt est dû également indépendamment de toute formalité d'enregistrement: voyez J.-M. RIVIER,<< L'impôt sur les successions et les donations: ses caractéristiques, sa nature et son champ d'application », Ste uer Revue 1 Revue fiscale, 1996, p. 151 ; P. B6CKLI, lndirekte Steuern und Lenkungssteuern, Base!, Helbing & Lichtenhahn Verlag, 1975, p. 331. 3. D. WEBER,<< Steuerrechtliche aspekte der Unternehmensnachfolge », Steuer Revue 1 Revue fiscale, 1996, p. 367. 4. Bien qu'on puisse prétendre que les documents bancaires qui prouvent la tradition constituent également un commencement de preuve par écrit de la donation elle-même, ce qui permet de prouver les autres éléments constitutifs de celle-ci (animus donandi et acceptation) par témoignages ou présomptions. E. Story-Scientia - N° 24.837- 421 - le donateur et le donataire se retrouvent au jour dit chez 1' intermédiaire financier. Les fonds ou titres sont retirés du compte du donateur et sont déposés sur un compte du donataire ouvert dans la même banque ; - simultanément, le donataire signe un écrit (à ne pas enregistrer) reconnaissant 1'existence de la donation manuelle ou bien envoie un courrier simple ou par recommandé qu'il accepte la donation. » (1 ). Ainsi, la date de la tradition est établie grâce aux documents bancaires et le cachet de la poste fait foi de la date des lettres démontrant 1'ani mus donandi et l'acceptation (2). Une lettre recommandée n'a sans doute pas plus de force probante qu'une lettre ordinaire. Pour prouver que la lettre invoquée était bien dans l'enveloppe cachetée par la poste, un auteur (3) conseille d'utiliser des enveloppes spéciales qui permettent d'apposer le cachet postal directement sur la lettre. Ce même auteur invite également à avertir la banque s'il s'agit d'un versement d'argent à retirer préalablement d'un compte ( 4). Il signale en effet un arrêt non publié refusant la possibilité du don manuel car la banque ne disposait pas physiquement au moment du don de la somme liquide nécessaire pour permettre une telle opération ... On le voit, cette technique est assez complexe et certains notaires sont d'ores et déjà agacés d'avoir à conseiller leurs clients dans l'accomplissement de toutes ces formalités. Elle est toutefois efficace mais il nous paraît bien inutile de prendre autant de précautions, surtout si le don manuel n'est accompagné d'aucun pacte adjoint, car dans ce cas, seule l'Administration devra apporter la preuve de l'existence d'une donation. Si, comme nous le verrons plus loin, le don est accompagné d'une« réserve d'usufruit» et si 1'Administration peut en retirer un ensemble de présomptions précises et concordantes quant à la propriété du de cujus sur les biens à son décès ou si elle invoque la présomption de l'article 9, le donataire devra faire la preuve qu'un don manuel a eu lieu plus de trois ans avant le décès mais il nous semble que les documents bancaires peuvent suffire et que 1'écrit prouvant 1'animus donandi peut très bien avoir été établi ultérieurement. 1. E. DE WILDE D'ESTMAEL, «Dons manuels: techniques de preuve (bancaires et autres), pacte adjoint, réserve d'usufruit>>, o.c.; <<Les donations», o.c., p. 173. 2. D'autre part, on sait que la lettre missive a la même force probante qu'un acte sous seing privé si elle en remplit les conditions relatives à l'écriture et à la signature: voyez sur cette question N. VERHEYDEN-JEANMART, o.c., p. 291 à 297. 3. F. DELPORTE, o.c., p. 70; voyez aussi A. BONTE et Ch. LANTONNOIS, Sociétés de patrimoine - La société dans le choix de la voie la moins imposée, Antwerpen, Kluwer, 1989, p. 237. 4. Le don manuel n'est possible que si l'argent est physiquement transmis; le virement, on le rappelle, ne peut constituer un don manuel. Comme donation indirecte, il ne sera toutefois pas non plus soumis à l'enregistrement et peut donc aussi être utilisé. L'ordre de virement ne peut révéler sa cause car il pourrait alors constituer un acte portant donation nul en la forme. Par contre, on peut conseiller de constater dans un acte ou un échange de lettres ultérieur l'animus donandi et l'acceptation du donataire. Rec. gén. enr. not. 7 422 - N° 24.837- F. Constatation par le notaire de la tradition On a proposé de présenter à l'enregistrement un acte notarié, signé par le notaire seul et mentionnant que le notaire a constaté la remise de valeurs sous forme d'un don manuel, les parties ayant donc effectué la tradition devant lui (1 ). Cet acte signé par le notaire seul ne peut faire titre de la donation et le droit proportionnel ne sera donc pas perçu. Toutefois, cet acte ne fait preuve que de la constatation par le notaire d'un fait matériel et de sa date. La tradition pourrait avoir bien d'autres causes qu'un don manuel. Comme les documents bancaires, 1'acte notarié préconisé ici doit être complété à l'aide d'un écrit démontrant I'animus donandi. On ne recourra donc à l'intervention (plus coûteuse) du notaire que si les biens à transmettre ne peuvent 1'être par le biais d'une banque. G. Procès-verbal notarié de l'assemblée générale de la société dont les titres ont été donnés Pour prouver de manière indirecte la date d'un don manuel de titres au porteur, plusieurs auteurs (2) recommandent de faire comparaître le donataire à une assemblée générale de la société émettrice des titres, tenue devant notaire et dont le procès-verbal serait donc un acte notarié. Ce procès-verbal cite les parties à 1'acte et mentionne donc 1'identité du donataire et le nombre de titres pour lesquels il apparaît (3). L'acte notarié sera obligatoirement enregistré mais sans entraîner laperception du droit proportionnel de donation. En effet, 1'acte ne fait pas titre de la donation mais seulement de la mise en possession du donataire. Seul le transfert, comme dans les deux techniques exposées ci-avant, acquiert donc date certaine au jour de l'établissement de l'acte authentique. Pour éviter que l'Administration puisse émettre des doutes sur le fait que la comparution à 1. Voyez aussi la formule proposée par Léon RAUCENT, << Les donations - formulaire>>, Rép. not., t. III, 1. VII, p. 74: <<le donateur provisionne un notaire par un versement fait par l'intermédiaire de la comptabilité de celui-ci. Le notaire, au jour prévu, retire la somme de son compte, la remet au donateur (contre reçu), qui la remet à son tour au donataire, qui la verse au notaire afin de créditer le compte du donataire à la banque qu'il indique. Le notaire lui délivre un reçu>>. 2. M. MUNO, o.c., p. 161 ; F. DELPORTE, o.c., p. 49; P. DE PAGE,<< Successions et donations. Questions de fiscalité et moyens de preuve >>, o.c., p. 563 ; E. DE WILDE o'ESTMAEL, << Dons manuels: techniques de preuve (bancaires et autres), pacte adjoint, réserve d'usufruit>>, o.c. 3. Comme l'indique un jugement du tribunal de première instance de Tournai,<< le P. V. d'une assemblée générale ne peut constituer une preuve [de la propriété des titres] lorsqu'il n'indique pas le nombre de parts qui sont représentées >> (8 juin 1966, Rec. gén. enr. not., 1967, n° 21.256, cité par F. DELPORTE, o.c., p. 49). E. Story-Scientia - W 24.837- 423 l'assemblée générale d'une autre personne que le précédent propriétaire atteste un véritable changement de propriété des titres (1 ), il faudra donc prouver l' animus donandi par un autre écrit (échange de lettres, reconnaissance unilatérale du donateur que l'on pourra éventuellement enregistrer, acte bilatéral attestant d'un don manuel antérieur... ) H. Mention dans la déclaration de succession On peut se poser la question des conséquences, d'une part, et de l'utilité, d'autre part, d'une mention d'un don manuel accompli par le de cujus dans la déclaration de succession rédigée par les héritiers suite au décès de celui-ci. La reconnaissance d'un don manuel dans une déclaration de succession ne peut normalement pas entraîner la débition des droits d'enregistrement; en effet, elle ne peut être assimilée à une demande d'enregistrement (2), à une présentation d'un écrit formant titre (reconnaissance unilatérale par le donataire) à l'enregistrement. Cependant, cette simple déclaration n'est pas une preuve suffisante du don manuel, ni de sa date et si l'Administration a pu prouver l'existence d'un acte de propriété sur les biens prétendument donnés dans les trois ans précédant le décès, la mention d'un don manuel intervenu avant les trois ans fatidiques ne suffira pas à renverser cette preuve pour éviter la taxation aux droits de succession. Bien plus, même si l'Administration n'a pas démontré l'existence de tels actes, on peut se demander si la déclaration du don ne constitue pas la preuve à fournir par elle d'un acte de propriété (la déclaration de succession remplie par le de cujus à la mort d'un de ses auteurs est en tout cas un acte de propriété dans le chef du de cujus, mais on ne confondra pas ce cas avec l'hypothèse examinée ici). À ce stade, puisqu'il n'est pas prouvé que l'acte a eu lieu dans les trois ans du décès, cet élément ne vaut que comme présomption simple que les biens se retrouvent dans la succession et devra être conforté par d'autres faits. Si l'on considère la déclaration du don comme un aveu, le donataire pourra cependant se prévaloir de l'indivisibilité de celui-ci en ce qui concerne la date déclarée. La reconnaissance du don manuel dans une déclaration de succession n'a donc aucune utilité sur Je plan de la preuve de celui-ci. Section 2 : Don manuel avec pacte adjoint On a aperçu dans le premier chapitre tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir à ce que le don manuel soit assorti d'une réserve d'usufruit, spécialement dans 1. F. DELPORTE, o.c., p. 49. 2. Décision du 13 novembre 1996, Rép. R. J., E 19, 2°.05.03, Rec. gén. enr. not., n° 24.674. Rec. gén. enr. not. 7 424 - N° 24.837- le cadre d'une programmation successorale : le donateur évite à ses héritiers le paiement des droits de succession mais conserve quant à lui la jouissance des biens donnés. Une véritable réserve d'usufruit, on l'a vu également, n'est toutefois pas possible corrélativement au don manuel, car elle s'oppose à 1'exigence de tradition réelle. Pour produire le même résultat, l'argent pourra être donné en stipulant une charge de paiement viager des intérêts produits au donateur, sans incidence fiscale. Par contre, un contrat de prêt ou de dépôt des meubles corporels donnés conclu après le don risque d'amener 1'Administration à considérer que le don manuel est inexistant si le donataire ne parvient pas à apporter la preuve du fait matériel de la tradition et, dès lors, elle réintégrera les biens dans la masse successorale (1 ). Insistons sur le fait qu'en droit civil, la conclusion de ces contrats est parfaitement valide, même si elle entraîne une dépossession du donataire, à condition qu'il ait d'abord été mis en possession par tradition à 1'occasion du don manuel. En droit fiscal par contre, la question de la preuve prend une acuité toute particulière et, dans les cas où c'est au contribuable à rapporter la preuve du don manuel, il sera très important pour lui de pouvoir prouver le fait matériel de la tradition pour que 1'Administration admette 1'existence de ce don. On s'attardera plus longuement sur les modalités possibles d'un don manuel de titres au porteur. Il s'agira plus d'examiner les techniques de réalisation de ce don que les techniques de preuve car on peut utiliser ici les méthodes étudiées à la section précédente. A. Si le donateur ne désire jouir que des revenus des titres donnés, il peut soit stipuler une charge de paiement de ces revenus (2), soit conserver les coupons et ne donner que le manteau des titres (3). Si on peut prouver le don manuel et le pacte adjoint par 1'une des techniques exposées ci-avant, le pacte adjoint n'aura aucune incidence fiscale. B. Si le donateur souhaite se réserver un véritable droit d'usufruit, on pourra déposer les titres entre les mains d'un tiers et notamment sur un 1. Cf. chapitre 2 et toute la discussion sur les moyens d'action de l'Administration après 1'arrêt de Liège du 9 mai 1995. 2. On peut également prévoir en sus une clause d'inaliénabilité des titres: voyez E. DE WILDE D'ESTMAEL, <<Dons manuels: techniques de preuve (bancaires et autres), pacte adjoint, réserve d'usufruit», o.c. 3. Cette technique pose néanmoins quelques problèmes lors du recouponnement des titres, de l'échéance de ceux-ci ou du décès du donateur avant que tous les coupons n'aient été mis en paiement: voyez J.-F. TAYMANS, «Les donations de sommes ou de titres>>, in Les arrangements de famille, Bruxelles, Story-Scientia, 1990, p. 87; S. NUDELHOLE, «Droits d'enregistrement et de succession: en quoi l'introduction d'un facteur international peut"elle modifier les données du problème ? >>,Journée d'étude Skyroom du 2 octobre 1997, p. 8. E. Story-Scientia - N° 24.837- 425 compte titres en banque. II y aura ainsi dépossession et la banque assurera le paiement des intérêts ou dividendes. D'autre part, le donateur pourra exercer ses autres droits d'usufruitier (vote à l'assemblée générale etc.) en produisant une attestation de la banque ( 1). Au décès du donateur cependant, et si le donataire est un héritier, légataire, donataire ou personne interposée (2), l'immatriculation au nom du défunt pour 1'usufruit et au nom d'un tiers pour la nue-propriété entraîne 1'application de 1'article 9 du Code des droits de succession. Cet article présume qu'il y a dans ce cas un legs déguisé et que les biens doivent être réintégrés pour la pleine propriété dans la part successorale du tiers (3). La présomption peut être renversée par la preuve que 1'immatriculation «ne déguise pas une libéralité au profit du tiers». Si on peut prouver qu'il y a eu une donation antérieure à l'immatriculation, celle-ci n'étant que 1'exécution d'une convention de réserve d'usufruit, la présomption de déguisement sera renversée (4) et l'article 9 ne s'appliquera pas (5). Il faudra donc prouver que ce n'est pas l'immatriculation qui opère le transfert de la nue-propriété du donateur au donataire mais que celui-ci a eu lieu antérieurement, à 1'occasion d'un don manuel. Il conviendra dès lors de se réserver une preuve de l'existence et de la date du don au moyen des techniques exposées ci-avant (technique bancaire et échange de lettres (6), reconnaissance unilatérale enregistrée, ou encore acte authentique étranger (7)) et 1. Ph. DE PAGE, << Les donations et le cas particulier des dons manuels de titres », o.c., p. 9; F. DELPORTE, o.c., p. 39, J.-F. TAYMANS, o.c., p. 89. 2. Cf. articles 14 et 33 du Code des droits de succession. Ce sera souvent le cas dans le cadre d'une programmation successorale. Il peut également s'agir d'une personne interposée au sens des articles 911 et Il 00 du Code civil. 3. Quelle que soit la date de 1'immatriculation, donc même si elle a eu lieu plus de trois ans avant le décès. 4. Cass., 24 octobre 1968, Rec. gén. enr. not., n° 21.255 ; Bruxelles, 22 mars 1949, Rec. gén. enr. not., n° 18.778; Liège, 22 décembre 1971, Rev. not. b., 1974,397, Liège, 9 mai 1995, Rec. gén. enr. not., n° 24.516; S. NUDELHOLE, o.c., p. 10; J. MALHERBE, o.c., p. 10; E. DE WILDE D'ESTMAEL, «Les donations>>, o.c., p. 176; J.-F. TAYMANS, o.c., p. 89; Ph. DE PAGE,<< Les donations et les cas particuliers des dons manuels de titres>>, o.c., p. 9; <<Les donations et arrangements de famille et le droit fiscal>>, o.c., p. 10; réponse du Ministre des Finances à une question parlementaire en date du 23 novembre 1995, Rec. gén. enr. not., n° 24.596. 5. Même si la donation antérieure était nulle pour vice de forme : cf. Liège, 9 mai 1995, o.c. 6. J.-F. TAYMANS, o.c., p. 90. 7. J. MALHERBE, «Analyse du nouveau régime des droits de succession en Flandre. Quels sont les avantages des trusts, fondations, fiducies et administratiekantoren ? Analyse des derniers développements>>, Journée d'étude Skyroom du 2 octobre 1997, p. 10; S. NUDELHOLE, «Droits d'enregistrement et de succession: en quoi l'introduction d'un facteur international peut-elle modifier les données du problèmes? >>,Journée d'étude Skyroom du 2 octobre 1997, p. 12. Rec. gén. enr. not. 7 426 - N° 24.837- de veiller à ne transférer les titres sur un compte immatriculé aux deux noms de 1'usufruitier et du nu-propriétaire qu'ultérieurement. C. Pour le donateur que le maintien du contrôle de sa participation dans la société émettrice des titres donnés intéresse plus que les autres aspects de 1'usufruit, les auteurs conseillent des moyens moins « risqués » que 1' immatriculation aux deux noms. Le pacte adjoint peut notamment être un pacte de votation qui organise entre donateur et donataire 1'exercice du droit de vote (1 ), si le donateur est resté lui-même actionnaire. Ce pacte doit toutefois être limité dans le temps et justifié par 1'intérêt social à tout moment (2). On peut également utiliser les techniques offertes par le droit des sociétés, qu'on ne détaillera pas ici: modification des statuts de la société (3), création d'une société en commandite par action dans laquelle les donateurs sont les commandités et les donataires les commanditaires ( 4). On peut enfin créer un trust (5), un administratiekantoor, une fiducie ... Le don manuel n'est alors qu'une des composantes de l'opération. II sera prouvé comme on 1'a vu antérieurement et, si 1'opération dans son ensemble est valide en droit belge et ne comporte pas de simulation, 1'Administration ne pourra la requalifier, s'agissant de la gestion du patrimoine privé (6). 1. Ph. DE PAGE, «Les donations et le cas particulier des dons manuels de titres>>, o.c., p. 10. 2. Article 74ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales; Cass. 13 avril 1989, R.C.J.B., 1991, p. 205, note J.-M. NEUSS EN GRADE. 3. Ph. DE PAGE, idem, p. Il. 4. Ph. DE PAGE, ibidem; A. BONTÉ et Ch. LANTONNOIS, o.c., p. 243. 5. Ph. DE PAGE, ibidem; J. MALHERBE et 0. HERMAND, «Formes étrangères de transmission du patrimoine: le trust et le bureau d'administration>>, in Les sociétés et le patrimoine familial. Convergences et confrontations, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 297 ; Y. MOREAU,<< Comment conserver 1'influence de la famille dans 1'entreprise ? Le recours à des mécanismes internationaux >>, Successions et donations. Journée d'étude Skyroom du 31 mars 1998; Th. AFSCHRIFT, <<L'utilisation des trusts, fiducies, fondations de droit étranger, holdings et autres sociétés étrangères en matière de planning successoral >>, Stratégies de succession et transmission d'entreprise. Journée d'étude Skyroom du 4 avril 1996; F.-X. JEANMART, <<Les véhicules étrangers de transmission du patrimoine familial>>, Sociétés patrimoniales. Séminaire Vanham & Vanham du 26 février 1997; A. BAILLEUX, <<La planification internationale en matière de succession d'entreprises», Le planning successoral d'une entreprise familiale. Séminaire Vanham & Vanham du 18 novembre 1997 ; S. NUDELHOLE, << Trust et fondation, instruments utiles de planification successorale?>>, Successions et donations. Journée d'étude Skyroom du 28 janvier 1997; J. MALHERBE,<< Analyse du nouveau régime des droits de succession en Flandre. Quels sont les avantages des trusts, fondations, fiducies et administratiekantoren ? Analyse des derniers développements »,Journée d'étude Skyroom du 2 octobre 1997. 6. Cf. infra, chapitre 2. E. Story-Scientia - N° 24.837- 427 D. Enfin, si le donateur offre un portefeuille de titres qu'il a acquis à titre spéculatif et qu'il voudrait continuer à faire fructifier par des reventes, des achats, des échanges etc., certains auteurs suggèrent d'accompagner le don manuel d'un mandat irrévocable de gestion. Une telle opération est parfaitement valide en droit civil si la tradition a bien eu lieu mais il semble que si 1'Administration peut prouver un acte d'achat ou de vente (1) des titres composant le portefeuille (2), il serait sans doute vain de lui opposer le don manuel assorti d'un tel pacte. Elle pourra arguer d'une simulation ou de l'inexistence du don, si on n'a pas pu prouver la tradition, pour réintégrer les titres dans la masse successorale (3). Il vaut donc mieux que le donateur se borne à donner des conseils de gestion au donataire qui les exécuterait car un seul acte de disposition par le donateur peut entraîner le jeu de la présomption de 1'article 108 de Code des droits de succession et même si on peut prouver que le donateur-gérant n'agissait qu'en vertu d'un mandat, 1'Administration peut estimer que la véritable volonté des parties était de transmettre les biens au décès tout en évitant les droits de succession et qu'il y a dès lors simulation et legs déguisé. CONCLUSION Après avoir admiré l'ingéniosité des praticiens et rappelé que si l'on veut réellement faire preuve du don manuel, la preuve de la seule tradition ne suffit pas, on ne se risquera pas à évaluer les méthodes ou à tenter de déterminer la« meilleure». Certaines techniques ne conviennent pas, on 1'a vu, mais le choix entre les autres dépend du cas d'espèce. Par contre, on se permettra de rappeler que les cas où on doit prouver un don manuel sont assez rares ( 4), du moins s'il n'y a pas de pacte adjoint. En effet, soit le décès du donateur intervient dans les trois ans de la donation et prouver le don ne permet pas d'échapper au paiement des droits (5), soit le décès survient plus tard et les actes de propriété que 1'Administration peut invoquer ne constituent que des présomptions simples. Or, pour écarter de 1. Étant donné que le donateur-gérant n'agirait qu'à titre de mandataire, il est cependant possible que son nom n'apparaisse pas lors de ces opérations et que l'Administration n'en ait dès lors pas connaissance. 2. Dans les trois ans du décès ou non, mais dans ce second cas, d'autres éléments devront renforcer la présomption simple de propriété du donateur au décès. 3. Sauf application- sans doute très incertaine- du raisonnement tenu dans le chapitre 2. 4. Face à l'Administration, s'entend, car entre successibles, c'est autre chose ... 5. L'intérêt d'une telle preuve peut cependant être, pour les héritiers, de reporter sur le donataire étranger à la succession le paiement des droits. Rec. gén. enr. not. 7 428 - N° 24.837- telles présomptions, la preuve d'un transfert de propriété suffit et celle de 1'animus donandi est superflue ( 1). S'agissant de sommes ou de titres, de simples documents bancaires peuvent donc suffire. Un échange de lettres ou un acte bilatéral démontrant l' animus donandi n'est pas nécessaire et les précautions prises en pratique sont souvent superflues. D'autre part, les bordereaux bancaires, émanés de tiers sont suffisamment probants. Il n'y a aucune nécessité de prendre le risque d'enregistrer un document, fût-ce une reconnaissance unilatérale par le donateur, et encore moins de se déplacer à 1'étranger. Enfin, on peut même éviter le transfert matériel car un virement de compte à compte, que nous n'avons cependant pas choisi d'étudier ici, est un transfert de possession tout autant qu'un versement. Il ne s'agira plus d'un don manuel mais d'une donation indirecte ; les conséquences fiscales sont tout à fait identiques (2). Lorsque le don manuel est accompagné d'une « réserve d'usufruit » sous une des formes examinées-, par contre, il faudra s'en réserver soigneusement la preuve, soit pour s'opposer à l'application de l'article 9 du Code des droits de succession, soit pour renverser la présomption de l'article 108 du même Code ou un faisceau de présomptions concordantes au sens de 1'article 105 lorsque l'Administration aura pu prouver dans le chef du donateur-usufruitier l'existence d'actes« de propriété» qui sont en réalité accomplis à titre d'usufruitier ou de gestionnaire. Les méthodes étudiées pourront alors être utilisées indifféremment, la plus sûre étant peut-être celle de l'acte notarié étranger puisqu'il permet de réaliser une véritable donation avec réserve d'usufruit et que la preuve de la tradition n'est plus nécessaire. Dans les autres cas, la preuve de la tradition est essentielle car c'est son absence qu'invoquera 1' Administration pour démontrer que le don manuel est nul ou inexistant et que les biens appartenaient donc toujours au de cujus au moment du décès. Même face à cette démonstration cependant, on pourra peut-être invoquer le raisonnement suivant lequel, si le don manuel est inexistant, il reste une donation certes nulle en la forme mais qui a été confirmée par tous les héritiers conformément à l'article 1340 du Code civil. C'est ici que l'entente entre héritiers devient plus importante que jamais ... Catherine LAMBERT Assitante au Centre de droit patrimonial de la famille (U.C.L.) Avocat 1. J.-P. BOURS, << Les donations de sommes ou de titres. Aspects fiscaux », in Les arrangements de famille, Bruxelles, Story-Scientia, 1990, p. 112. 2. Pour autant qu'on n'indique pas sur le virement la cause de celui-ci, l'acte sera valable au plan civil car il ne s'agira pas d'un<< acte portant donation». E. Story-Scientia 429 - W 24.838- - W 24.838- LOI DU 19 MAI I998 MODIFIANT LES ARTICLES 55, 60, 61 1 ET 6I 2 DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHÈQUE ET DE GREFFE. Moniteur belge du 14 juillet 1998. ALBERT II, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1•r. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2. À l'article 55, alinéa J<r, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par l'article 147 de la loi du 22 décembre 1989, il est inséré un d), rédigé comme suit: « d) en cas d'application de l'article 53, 2°, que l'acquéreur ou son conjoint obtiendra son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'immeuble acquis.». Art 3. À 1'article 60 du même Code, modifié par les articles 1cr de la loi du 27 février 1978, 39 de la loi du 19 juillet 1979 et 149 de la loi du 22 décembre 1989, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2: «Le bénéfice de la réduction visée à l'article 53, 2°, n'est maintenu que si l'acquéreur ou son conjoint est inscrit à l'adresse de l'immeuble acquis dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Cette inscription doit se faire dans un délai de trois ans prenant cours à la date de l'acte authentique d'acquisition et être maintenue pendant une durée ininterrompue de trois ans au moins. ». Art. 4. L'article 61 1 du même Code, remplacé par l'article 40 de la loi du 19 juillet 1979, modifié par l'article 150 de la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante : «En cas de perte de la réduction pour défaut d'exploitation dans le délai et pendant la durée prévus à l'article 60, alinéa 1er, il est dû par l'acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce montant. En cas de perte de la réduction pour défaut d'inscription dans le délai et pendant la durée prévus à 1'article 60, alinéa 2, il est dû par l'acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce montant. Rec. gén. enr. not. 7 430 -W24.839- Le Ministre des Finances peut toutefois accorder remise totale ou partielle de cet accroissement. ». Art. 5. À l'article 61 2 , inséré par l'article 4 de la loi du 26 juillet 1952, modifié par les articles 47 de la loi du 25 juin 1956, 72, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 et 62, 1o, de la loi du 10 janvier 1978, les mots « des articles 60 et 61 1 » sont remplacés par les mots « des articles 60, alinéa 1cr et 61 1, alinéa 1cr ». Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de 1'État et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 19 mai 1998. ALBERT Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'État : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS OBSERVATIONS À défaut de précision dans la loi, celle-ci est entrée en vigueur le 24 juillet 1998. À annoter: A. CUVELIER, «Droits d'enregistrement et T.V.A. applicables aux ventes d'immeubles », Rép. not., t. VII, 1. VII, nos 154, 196 et 205 ; F. WERDEFROY, Registratierechten, nos 756 et 775 . - N° 24.839- ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT WALLON DU 30 AVRIL I998 RELATIF AU TAUX RÉDUIT SUR LES DROITS DE SUCCESSION EN CAS DE TRANSMISSION D'ENTREPRISES. Moniteur belge du 13 mai 1998. Le Gouvernement wallon, Vu le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, notamment l'article 2 insérant un article 60bis dans le Code des droits de succession ; E. Story-Scientia - N° 24.839- 431 Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1cr, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996 ; Vu l'urgence ; Considérant qu'il y a lieu d'adopter et de publier sans retard les modalités d'exécution du décret-programme précité qui est entré en vigueur le 1cr janvier 1998 afin de permettre aux bénéficiaires de connaître et d' observer les obligations ct dispositions en vue de l'obtention du taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises ; Considérant que le présent arrêté doit être adopté et publié sans retard afin de garantir la sécurité juridique des bénéficiaires qui répondent dès 1'entrée en vigueur du décret aux conditions requises pour bénéficier du tarif réduit des droits de succession de sorte que cet avantage puisse être accordé effectivement avant la fin du délai dans lequel ils sont tenus de déposer la déclaration de succession au bureau de recette compétent ; Considérant que le présent arrêté produit ses effets au 1cr janvier 1998 ; Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de 1'Emploi et de la Formation, Arrête: 1o 2° 3° 4° 5° 6° 7° Article t•r. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: le Ministre : le Ministre qui a les Finances dans ses attributions ; le décret : le chapitre II du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports; l'entreprise: toute personne physique ou personne morale constituée sous la forme commerciale, visée à l'article 60bis, §le', du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret, à l'exclusion des professions libérales qu'elles soient exercées à titre individuel ou sous forme de société ; l'administration: la Direction générale de l'Économie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne ; les successeurs : les personnes déterminées à 1'article 38 du Code des droits de succession et visées à 1'article 60bis du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret ; l'intermédiaire: le mandataire désigné par les successeurs auquel toute signification et communication peuvent être faites valablement par 1'administration ; les titres: les actions et parts sociales à l'exclusion des créances obligatoires. Rec. gén. enr. not. 7 432 - N° 24.839- Art. 2. Le Directeur général de l'administration est habilité à délivrer les attestations visées par le décret. Il peut déléguer cette compétence aux fonctionnaires de l'administration. Art. 3. § 1cr. La demande de délivrance de l'attestation prévue par le décret est envoyée à l'administration par les successeurs ou leur intermédiaire sous pli recommandé. § 2. La demande de délivrance de 1'attestation, dont le modèle figure en annexe 1, mentionne : 1o les nom ct prénoms, la date de naissance, la date de décès du de cujus ct son dernier domicile ; 2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession a été ou sera déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession ; 3° les nom, prénoms et domicile de tous les successeurs ; 4° la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'inscription au registre de commerce, les numéros d'identification à la TVA et à l'ONSS ainsi que 1'adresse de 1'entreprise pour laquelle 1'avantage prévu par 1'article 60bis du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret, est sollicité ; 5° le nombre de travailleurs, engagés par 1'entreprise sous contrat de travail et soumis à l'ONSS, exprimé en équivalent temps plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre du décès du de cujus. Ne sont pas concernés, les travailleurs visés à l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; 6° la valeur nette des avoirs visés à l'article 60bis, §1er, 1°, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret ou de tous les titres visés à l'article 60bis, § 1cr, 2°, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret, calculée conformément à l'article 60bis, § 2, du Code des droits de succession, ainsi que le pourcentage de ceux qui sont en possession du défunt ou des successeurs. § 3. La demande de délivrance de 1'attestation est accompagnée de copies certifiées sincères des documents suivants : 1o soit les comptes annuels de l'année précédant le décès du de cujus, établis conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise, soit l'annexe à la déclaration en matière d'impôt des personnes physiques; 2° soit les déclarations statistiques à l'Office national de la Sécurité sociale et les relevés individuels afférents aux quatre trimestres précédant le triE. Story-Scientia - N° 24.839- 433 mestre de décès du de cujus, soit les documents analogues, délivrés par les institutions compétentes des États membres de 1'Union européenne, en vertu de leur législation, permettant de déduire sans équivoque le nombre de travailleurs employés par 1'entreprise exprimé en équivalent temps plein; 3° les copies du registre des actions nominatives et, le cas échéant, du registre de la dernière assemblée générale ; 4° le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article 60bis, § 1er, alinéa 3, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret. § 4. La demande de délivrance de l'attestation est datée et signée par les successeurs ou leur intermédiaire. Les successeurs ou leur intermédiaire déclarent sur 1'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets. Art. 4. L'administration délivre dans un délai n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à dater de la réception de la demande visée à 1'article 3, en cas de décision favorable, une attestation, dont le modèle figure en annexe Il du présent arrêté. Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à 1'article 3, § 2, ou n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article 3, § 3, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la date de réception par l'administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les successeurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut. L'attestation est délivrée en trois exemplaires dont deux originaux et une copie certifiée conforme datés et signés par le Directeur général de 1'Administration ou son délégué. Le premier original est signifié aux successeurs ou à leur intermédiaire et est destiné à être joint à la déclaration de succession et le deuxième original est envoyé directement au receveur des droits de succession compétent, la copie étant gardée par les successeurs ou leur intermédiaire. Art. 5. § 1cr. Les successeurs ayant bénéficié du taux réduit sur les droits de succession sont tenus de communiquer à 1'Administration au cours de chacune des cinq années qui suivent le décès du de cujus et au plus tard à la fin du trimestre anniversaire du trimestre du décès du de cujus, une déclaration dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté, attestant que les conditions visées à 1'article 60bis, § 3, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret, restent remplies. Cette déclaration mentionne le numéro de 1'attestation délivrée en vertu de 1'article 4 et est accompagnée d'une copie des comptes annuels, des déci aRec. gén. enr. not. 7 434 - N° 24.839- rations statistiques et des relevés individuels de 1'ONSS ainsi que du registre des actions nominatives et, le cas échéant, du registre de 1'assemblée générale de l'année révolue suivant le décès. § 2. En cas de décision favorable, 1'Administration délivre aux successeurs ou à leur intermédiaire, dans les délais visés à 1' article 4, un exemplaire original et une copie certifiée conforme de l'attestation dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté. § 3. En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires, dont deux originaux datés et signés par le Directeur général de 1'Administration ou son délégué et une copie certifiée conforme. Le premier original est délivré aux successeurs ou à leur intermédiaire et le deuxième original est envoyé directement au receveur des droits de succession compétent, tandis que la copie est gardée par les successeurs ou leur intermédiaire. Art. 6. En cas de décision défavorable en ce qui concerne les attestations visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, les successeurs ou leur intermédiaire peuvent introduire un recours par pli recommandé auprès de 1'Administration dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification de la décision. L'Administration instruit le recours et le Ministre notifie sa décision aux successeurs dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours. Art. 7. En cas de non-respect des dispositions visées à l'article 60bis, § 3, les successeurs sont tenus de liquider les droits de succession conformément au chapitre VII du Code des droits de succession. Art. 8. Par dérogation aux articles 3 et 4 du présent arrêté, les successeurs des successions ouvertes entre le 1cr janvier 1998 et le 31 mars 1998 pourront bénéficier du taux réduit aux conditions stipulées par 1'article 60bis du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret, sur simple attestation des successeurs ou de leur intermédiaire adressée simultanément au receveur des droits de succession compétent et à 1'Administration. Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le 1cr janvier 1998. Art. 10. Le Ministre du Budget et Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 30 avril 1998. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon. chargé de l'Économie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R.COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances. de l'Emploi et de la Formation. J.-CI. VAN CAUWENBERGHE E. Story-Scientia 435 -W24.839- Annexe 1 Ministère de la Région wallonne Direction générale de 1'Économie et de 1'Emploi Place de la Wallonie, 1 Jambes Tél. : 081/33.31.11. Formulaire de demande de délivrance de l'attestation en vue de l'obtention du taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises en application de l'article 60bis du Code des droits de succession modifié, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports (Moniteur belge du 27 janvier 1998) et l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises. Partie 1: Renseignements relatifs à la succession L'attestation qui fait l'objet de la présente demande sera utilisée pour solliciter l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession, inséré, en ce qui concerne la Région wallonne par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports. Cette attestation sera annexée à la déclaration de succession de : Nom et prénoms : .......................................................................................................... . Né(e) le: .......................................................... à ........................................................ . Décédé(e) le ...................................................... à ......................................................... . Domicilié(e) en dernier lieu à ....................................................................................... . ........................................................................................................... (adresse complète) qui sera déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession au bureau du Receveur établi à : ........................................................................................................ . (adresse complète du bureau du Receveur compétent) dont la ou les personne(s) ci-après est ou sont le(s) successeur(s) : Nom Prénoms Adresse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... La ou les personnes) précitée(s) présente( nt) la demande de délivrance de l'attestation et désign(ent) le mandataire suivant, en qualité d'intermédiaire, auquel toute signification et communication peuvent être faites valablement par l'Administration : Nom et prénoms: ........................................................................................................... . Adresse: ...................................................................................................................... . Tél.: .......................................................... . Fax: ............................................................. . Rec. gén. enr. not. 7 - w 436 24.839- Partie Il: Renseignements relatifs à l'entreprise Il. 1. Personne physique Nom: ...................................................................................................................... . Prénoms: ................................................................................................................. . Adresse: ................................................................................................................. . Registre de commerce : n° ..................... RC de ........................... Date : .................. . Identification TVA : n° ............................................................................................ . Numéro d'immatriculation à l'ONSS: .................................................................... . Description succincte de l'activité: ........................................................................ . Il. 2. Personne morale Dénomination commerciale : .................................................................................... . Raison sociale : ........................................................................................................ . Forme juridique : .................................................................................................... . Adresse du siège social : ......................................................................................... . Adresse du siège d'exploitation: ............................................................................. . Registre de commerce : n° ............................... RC de ................ Date : .................. . Identification TVA: n° ............................................................................................ . Numéro d'immatriculation à l'ONSS: ...................................................................... . No de Code NACE et description succincte de l'activité : .......................................... . Il. 3. Travailleurs employés au cours des quatre trimestres précédant le trimestre du décès exprimés en équivalent temps plein (1) Régime 5 jours/semaine Régime 6 jours/semaine Trimestres Total A+ B Nbre de jours NJ/65,25 =A Nbre de jours NJ/78,25 = B JC' 2C 3C 4C Il. 4. }'ravailleurs soumis à la législation en vigueur en matière de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne et employés au cours des quatre trimestres exprimés en équivalent temps plein (2) Trimestres 1er 2c 3c 4c E. Story-Scientia Nombre de travailleurs en ETP - 437 N° 24.839- Il. 5. Composition du capital social (3) Nombre de titres en possession du de cujus, de son époux(se) ou de la société mère, avec mention de leur valeur déclarée Nombre de titres des successeurs avec mention de leur valeur déclarée Nombre Nom et prénoms Valeur déclarée Nombre et valeur Il. 6. Valeur nette des avoirs visés à l'article 60bis, § 1cr, 1°, du Code des droits de succession telle qu'elle résulte de l'annexe à la déclaration en matière d'impôt des personnes physiques ( 4) Partie III: Annexes à joindre Le formulaire de demande de délivrance de l'attestation sera accompagné de copies certifiées sincères des documents suivants : 1° soit, pour les personnes morales, les comptes annuels de 1'année précédant le décès du de cujus, établis conformément à 1'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ou en vertu de la législation applicable au lieu où le siège de direction effective est établi, soit, pour les personnes physiques, l'annexe à la déclaration en matière d'impôt des personnes physiques; 2° soit les déclarations statistiques à 1'Office national de Sécurité sociale et les relevés individuels afférents aux quatre trimestres précédant le trimestre de décès du de cujus, soit les documents analogues, délivrés par les Institutions compétentes des États membres de 1'Union européenne, en vertu de leur législation, permettant de déduire sans équivoque le nombre de travailleurs employés par 1'entreprise exprimé en équivalent temps plein ; 3° les copies du registre des actions nominatives et, le cas échéant, du registre de la dernière assemblée générale ; 4° le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article 60bis, § 1",alinéa 3, du Code des droits de succession, inséré en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret. Partie IV: Déclaration sur l'honneur Les soussignés affirment avoir pris connaissance qu'ils sont passibles de peines en vertu de 1'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'État, lorsqu 'ils font sciemment et volontairement des déclarations inexactes ou incomplètes à 1'occasion de la présente demande. Rec. gén. enr. nor. 7 438 - N° 24.839- Les soussignés s'engagent à observer la réglementation en matière de taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises et à fournir à l'Administration tout renseignement utile relatif à la présente demande. Date : Cadre réservé à 1'Administration Date de réception de la demande Le dossier est complet Oui Non Signatures Numéro de dossier attribué Traité par Documents manquants deman- Documents manquants ou dés le .................................... compléments d'information reçus le ................... . * * * Annexe Il Ministère de la Région wallonne Direction générale de 1'Économie et de 1'Emploi Place de la Wallonie, 1 Jambes Tél. : 081133.31.11 Attestation La présente attestation est délivrée en vertu de l'article 60bis du Code des droits de succession, inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports ainsi que de son arrêté d'exécution à: .............................................................................................. (noms, prénoms, adresses) ayant présenté une demande à cet effet le : ................................................................... . en leur qualité de successeurs de : nom et prénoms : ............................................................................................................ . né(e) le: ............................................................... et décédé(e) le: ............................. . pour lequel(laquelle) la déclaration de succession sera déposée, conformément à 1'article 38 du Code des droits de succession, au bureau des droits de succession établi à : ........ . et ayant désigné en qualité d'intermédiaire la personne mentionnée ci-après, à laquelle toute signification et communication peuvent être valablement faites par 1'Administration: Nom et prénom: ........................................................................................................... . Adresse: ....................................................................................................................... . Numéro de téléphone: .............................. Numéro de télécopie: ............................... .. Concernant 1'entreprise : ................................................................................................ . ayant son siège à : ......................................................................................................... . inscrite au registre de commerce de : ............................... sous le numéro : .................. . et ayant le numéro de TVA: ......................................................................................... . E. Story-Scientia -W24.839- 439 Décision de 1'Administration L'entreprise remplit ne remplit pas (5) les conditions visées à l'article 60bis, § 1cr du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transport, pour les raisons suivantes 1. 2. 3. 4. 60bis, 60bis, 60bis, 60bis, (6) § F', 1° § 1", 2°, alinéa 1cr § 1cr, zo, alinéa 2 §le', 2°, alinéa 3 La présente attestation portant le numéro de dossier ....................... est délivrée le .......... . Au nom du Gouvernement wallon, Le Fonctionnaire délégué. Avis important Une réclamation motivée contre la présente décision peut être adressée sous pli recommandé dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification de la présente attestation auprès du Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l'Économie et de l'Emploi, place de la Wallonie, 1, bât. Il, 3c étage, à 5100 Jambes. Dans un délai de trente jours, le Ministre ayant le Budget et les Finances dans ses attributions notifie sa décision. * * * Annexe III Ministère de la Région wallonne Direction générale de l'Économie et de l'Emploi Place de la Wallonie, 1 Jambes Tél.: 081/33.31.11. Notification annuelle du respect des conditions visées à l'article 60bis, § 3 du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne par le décret-programme du 17 décembre 1997. La présente notification est relative à l'attestation délivrée en vue de l'obtention du taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises portant le numéro de dossier .......................................... délivrée aux personnes mentionnées ci-après le ...................................... concernant la succession de : .................................................. . Nom et prénoms: ......................................................................................................... .. Né(e) le: ........................................................ et décédé(e) le: .................................... . Domicilié(e) en dernier lieu à : ...................................................................................... . pour lequel(laquelle) une déclaration de succession a été déposée en vertu de 1'article 38 du Code des droits de succession au bureau des droits de succession, établi à : .............. . le ................................................... et est inscrite sous le numéro : ............................... . Rec. gén. enr. not. 7 440 - N° 24.839- Le ou les successeurs mentionnés ci-après : Prénoms Nom Adresse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. .... ayant désigné le mandataire suivant en qualité d'intermédiaire, auquel toute signification et communication peuvent être faites valablement par 1'Administration : Nom et prénom: ............................................................................................................ . Adresse: ........................................................................................................................ . N° de téléphone : ........................................... N° de télécopie : .................................... .. déclarent 1° qu'ils ont bénéficié d'une réduction des droits de succession en vertu de l'article 60bis du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret; 2° que 1'entreprise a poursuivi son activité au cours de l'exercice ................................. ; 3° que le nombre de travailleurs, exprimé en unités de temps plein a été maintenu à 75 % du nombre déterminé dans la demande de délivrance d'attestation faite le .................. ; 4° que les avoirs investis ou le capital social n'a pas diminué à la suite de prélèvements ou de distributions. Partie 1: Renseignements relatifs à l'entreprise Il. 1. Personne physique Nom: ....................................................................................................................... .. Prénoms: .................................................................................................................. . Adresse: .................................................................................................................... . Registre de commerce : n° ...................... RC de ......................... Date : .................... . Identification TVA : n° ............................................................................................... . Numéro d'immatriculation à I'ONSS: ...................................................................... . Description succincte de 1'activité : .......................................................................... . Il. 2. Personne morale Dénomination commerciale : ................................................................................... .. Raison sociale : ......................................................................................................... . Forme juridique : ...................................................................................................... . Adresse du siège social : .......................................................................................... .. Adresse du siège d'exploitation: .............................................................................. .. Registre de commerce : n° .............................. RC de ..................... date : .............. .. Identification TVA: n° ............................................................................................... . Numéro d'immatriculation à I'ONSS: ...................................................................... . Numéro de code NACE: .......................................................................................... .. Description succincte de 1'activité .............................................................................. . ··································································································································· E. Story-Scientia - 441 N° 24.839- Il. 3. Travailleurs employés au cours des quatre trimestres de l'année révolue suivant le décès exprimés en équivalent temps plein (7) Régime 5 jours/semaine Régime 6 jours/semaine Nbre de jours NJ/65,25 =A Nbre de jours NJ/78,25 = B Trimestres Total A+ B 1cr 2c 3c 4c I}. 4. Travailleurs soumis à la législation en vigueur en matière de sécurité sociale d'un Etat membre de 1'Union européenne et employés au cours des quatre trimestres exprimés en équivalent temps plein (8) Trimestres Nombre de travailleurs en ETP ] cr 2c 3C 4c Il. 5. Composition du capital social (9) Nombre de titres en possession du de cujus, de son époux(se) ou de la société mère, avec mention de leur valeur déclarée Nombre Valeur déclarée Nombre de titres des successeurs avec mention de leur valeur déclarée Nom et prénoms Nombre et valeur Il. 6. Valeur nette des avoirs visés à l'article 60bis, §!er, 1°, du Code des droits de succession telle qu'elle résulte de l'annexe à la déclaration en matière d'impôt des personnes physiques ( 10) Rec. gén. enr. not. 7 442 -W24.839- Partie Il: Annexes à joindre Les copies certifiées sincères des documents suivants sont jointes à la présente notification: 1° soit, pour les personnes morales, les comptes annuels de 1'année révolue suivant le décès du de cujus, établis conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ou en vertu de la législation applicable au lieu où le siège de direction effective est établi, soit, pour les personnes physiques, l'annexe à la déclaration en matière d'impôt des personnes physiques; 2° soit les déclarations statistiques à 1'Office national de Sécurité sociale et les relevés individuels afférents aux quatre trimestres de 1'année révolue suivant le décès du de cujus, soit les documents analogues, délivrés par les Institutions compétentes des États membres de 1'Union européenne, en vertu de leur législation, permettant de déduire sans équivoque le nombre de travailleurs employés par 1'entreprise exprimé en équivalent temps plein ; 3° les copies du registre des actions nominatives et, le cas échéant, du registre de la dernière assemblée générale; 4° le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article 60bis, §le', alinéa 3 du Code des droits de succession, inséré en ce qui concerne la Région wallonne par le décret. Partie Ill: Déclaration sur l'honneur Les soussignés affirment avoir pris connaissance qu'ils sont passibles de peines en vertu de 1'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'État, lorsqu'ils font sciemment et volontairement des déclarations inexactes ou incomplètes à l'occasion de la présente demande. Les soussignés s'engagent à observer la réglementation en matière de taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises et à fournir à l'Administration tout renseignement utile relatif à la présente demande. Date : Signatures Cadre réservé à l'Administration Date de réception de la notification : N° d'attestation initiale: Traité par: Le dossier est complet Oui Non Documents manquants ou compléments d'information reçus le ......................... . Documents manquants demandés le * E. Story-Scientia * * - w 443 24.839- Annexe IV Ministère de la Région wallonne Direction générale de 1'Économie et de 1'Emploi Place de la Wallonie, 1 Jambes Tél. : 081/33.31.11. Attestation annuelle délivrée conformément à l'article 60bis, § 3 du Code des droits de succession, inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports. Vu la première attestation délivrée en date du ...................................................... à : Nom Prénoms Adresse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... Successeur(s) de : .......................................................................................................... . Nom, prénoms : ............................................................................................................. . Décédé(e) le: ................................................................................................................. . au(x)quel(s) la réduction des droits de succession a été accordé en vertu de l'article 60bis du Code des droits de succession, inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret en ce qui concerne l'entreprise: .................................................................................... . ayant son siège à : ......................................................................................................... . inscrite au Registre de commerce de .......................... sous le numéro : ........................ . et assujettie à la TVA sous le numéro : .......................................................................... . Le soussigné atteste que : 1° D'après les informations et documents fournis dans la notification annuelle du ....... inscrite sous le numéro .......................................... , les conditions requises pour bénéficier de la réduction des droits de succession sont remplies conformément à 1'article 60bis du Code des droits de succession, inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret-programme du 17 décembre 1997. 2° D'après les informations et documents fournis dans la notification annuelle du ....... Inscrite sous le numéro ............................................ , les conditions requises pour bénéficier de la réduction des droits de succession ne sont plus remplies pour les raisons suivantes (Il) : Art. 60bis, § 3, 1° a. Art. 60bis, § 3, 2° b. c. Art. 60bis, § 3, 3° La présente attestation est délivrée le ............. et remplace l'attestation en date du .......... . Au nom du Gouvernement wallon, Le fonctionnaire délégué. Rec. gén. enr. not. 7 444 - N° 24.839- Avis important Une réclamation motivée contre la présente décision peut être adressée sous pli recommandé dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification de la présente attestation auprès du Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l'Économie et de l'Emploi, Place de la Wallonie, 1, bât. II, 3c étage à 5100 Jambes. Dans un délai de trente jours, le Ministre ayant le Budget et les Finances dans ses attributions notifie sa décision. (1) Compléter le tableau ci-dessus en mentionnant pour les 4 trimestres précédant le trimestre de décès du de cujus le nombre de journées rémunérées et assimilées pour les employés et ouvriers (à l'exclusion des stagiaires AR n° 230 et des apprentis) en fonction du régime de travail (5 ou 6 jours par semaine). Si l'entreprise occupe ou a occupé des personnes ne prestant pas des journées complètes, indiquez, en annexe, leur nom, les périodes au cours desquelles elles ont travaillé à temps partiel et selon quel horaire. Si le nombre obtenu dans la colonne« Total A+ B >>n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure selon que sa première décimale est ou non égale ou supérieure à 5. (2) Indiquer, en annexe, la législation en vigueur conformément au Règlement (CEE) n° 1408/71. (3) Uniquement pour les personnes morales. ( 4) Uniquement pour les personnes physiques. (5) Biffer la mention inutile ainsi que les cases justificatives. (6) Indiquer la motivation en fait adéquate. (7) Compléter le tableau ci-dessus en mentionnant pour les 4 trimestres précédant le trimestre de décès du de cujus le nombre de journées rémunérées et assimilées pour les employés et ouvriers (à l'exclusion des stagiaires AR no 230 et des apprentis) en fonction du régime de travail (5 ou 6 jours par semaine). Si l'entreprise occupe ou a occupé des personnes ne prestant pas des journées complètes, indiquez, en annexe, leur nom, les périodes au cours desquelles elles ont travaillé à temps partiel et selon quel horaire. Si le nombre obtenu dans la colonne «Total A+ B >> n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure selon que sa première décimale est ou non égale ou supérieure à 5. (8) Indiquer, en annexe, la législation en vigueur conformément au Règlement (CEE) n° 1408/71. (9) Uniquement pour les personnes morales. ( 10) Uniquement pour les personnes physiques. (Il) Cocher la case justificative et indiquer la motivation en fait adéquate. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif au taux réduit pour les droits de succession en cas de transmission d'entreprise. Namur, le 30 avril 1998. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Économie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. E. Story-Scientia VAN CAUWENBERGHE - W 24.841- 445 OBSERVATIONS Le décret-programme du 17 décembre 1997 a été publié sous le n° 24.789 du Rec. gén. enr. not. V. également 1'erratum publié sous le no 24.840, infra. - W 24.840- ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT WALLON DU 30 AVRIL 1998 RELATIF AU TAUX RÉDUIT SUR LES DROITS DE SUCCESSION EN CAS DE TRANSMISSION D'ENTREPRISES.- ERRATUM. Moniteur belge du 11 juillet 1998. L'article 7 de l'arrêté susmentionné, publié dans le Moniteur belge du 13 mai 1998, à la page 15109, doit se lire comme suit: « Art. 7. En cas de non-respect des dispositions visées à 1'article 60bis, § 3, les droits de succession sont liquidés conformément au tarif général des droits de succession. » OBSERVATIONS L'arrêté du Gouvernement wallon est publié sous le no 24.839, supra. À annoter: en marge du no 24.839 du Rec. gén. enr. not. - N° 24.841- LOI DU 8 JUIN 1998 MODIFIANT, EN CE QUI CONCERNE LA PUBLICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PROTÊTS, LA LOI DU 17 JUILLET 1997 RELATIVE AU CONCORDAT JUDICIAIRE, LA LOI DU JO JUIN 1997 PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX PROTÊTS ET LA LOI DU 1er MARS 1961 CONCERNANT L'INTRODUCTION DANS LA LÉGISLATION NATIONALE DE LA LOI UNIFORME SUR LE CHÈQUE ET SA MISE EN VIGUEUR. Rec. gén. enr. not. 7 446 - W 24.841- Moniteur belge du 17 juillet 1998. ALBERT II, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1•r. La présente loi règle une matière visée à 1'article 78 de la Constitution. Art. 2. L'article 6, alinéa 1cr, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire est remplacé par 1'alinéa suivant : « Dans les dix premiers jours de chaque mois, le dépositaire central envoie au président du tribunal de commerce du domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'un commerçant, de 1'établissement principal du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège social du débiteur d'un effet de commerce, un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre, enregistrés le mois précédent et dont le dépositaire central n'a pas encore constaté le paiement ou été avisé de celui-ci. Ce tableau contient les mentions visées à 1'article 3, 1° à 7°, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts. ». Art. 3. L'article 14 de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts est remplacé par la disposition suivante : « Article 14. Le dépositaire central fournit à toute personne qui le demande, sur papier ou sur support informatique, les données figurant dans les tableaux qui ont été rendus publics, conformément à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. Le Roi fixe le montant de la rétribution que le dépositaire central est en droit de réclamer pour cette prestation. ». Art. 4. À 1'article 67 de la loi du 1cr mars 1961 concernant 1' introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur, les mots « La loi du 10 juillet 1877 sur les protêts » sont remplacés par les mots « La loi du 3 juin 1997 sur les protêts ». Art. 5. La présente loi produit ses effets le 1cr janvier 1998. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de 1'État et publiée par le Moniteur belge. Bruxelles, le 8 juin 1998. ALBERT Par le Roi: Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de 1'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS E. Story-Scientia 447 -W 24.842- OBSERVATIONS La loi du 10 juin 1997 a été publiée sous le n° 24.726 du Rec. gén. enr. not. À annoter: en marge du n° 24.726 du Rec. gén. enr. not. - N° 24.842- LOI DU 22 JUIN I998 MODIFIANT LA LOI DU 3 JUIN I997 SUR LES PROTÊTS. Moniteur belge du 18 juillet 1998. ALBERT II, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1•r. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2. À 1'article 3, 3° et 4°, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, les mots « son domicile ou siège social » sont chaque fois remplacés par les mots «son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social ». Art. 3. À 1' article 8, alinéa 2, de la même loi, les mots « du tableau prévu à 1'article 443 de la loi du 18 avril 185 1 sur les faillites, banqueroutes et sursis » sont remplacés par les mots « du tableau visé à 1' article 6 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire ». Art. 4. À 1'article 1 1 de la même loi, les mots « à 1'article 443 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis » sont remplacés par les mots « à 1'article 6 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire ». Art. 5. La présente loi produit ses effets le 1cr janvier 1998. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de 1'État et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 22 juin 1998. ALBERT Par le Roi: Le Ministre de la Justice. T. VAN PARYS Scellé du sceau de 1'Etat : Le Ministre de la Justice. T. VAN PARYS Rec. gén. enr. not. 7 448 - N° 24.843- OBSERVATIONS La loi du 3 juin 1997 a été publiée sous le n° 24.725 du Rec. gén. enr. not. À annoter: en marge du n° 24.725 du Rec. gén. enr. not. - N° 24.843- SUCCESSION (DROIT DE).- PREUVE.- PRÉSOMPTION LÉGALE. A.- ACTE DE PROPRIÉTÉ.- PIÈCES OBTENUES AUPRÈS D'UNE INSTITUTION FINANCIÈRE.- PRÉSOMPTIONS GRAVES, PRÉCISES ET CONCORDANTES DE PROPRIÉTÉ. - B. - PREUVE CONTRAIRE.- RÈGLES DE DROIT COMMUN.- AFFIRMATION QUE LES AVOIRS NON PAS ÉTÉ RETROUVÉS. - PREUVE CONTRAIRE NON RAPPORTÉE. Les pièces obtenues auprès d'une institution financière, sur base d'une enquête visée à l'article 100 du Code des droits de succession, qui établissent que le défunt a, dans les trois ans précédant son décès, acquis des titres et retiré une somme d'argent comptant, permettent de conclure qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes que le défunt était au jour de son décès en la possession des titres et de l'argent. Conformément à l'article 108 du Code des droits de succession, l'Administration ne doit pas prouver que les titres et avoirs, dont une enquête basée sur l'article 100 dudit Code a établit la propriété dans le chef du défunt dans les trois ans précédant son décès, sont encore sa propriété au jour de son décès. Par contre, les successeurs doivent démontrer que ces biens ne font plus partie de ce patrimoine ou bien qu'ils se retrouvent tel quel ou sous une autre forme dans l'actif de la succession. Cette preuve doit être produite selon les règles de droit commun. Jugement du Tribunal de première instance de Termonde du 12 mai 1997. (Traduction) 1. Les demandeurs sont respectivement héritier et légataire de feu Mme J. V. H., décédée le 20 juillet 1988. Le 31 janvier 1989, une déclaration de succession a été déposée au bureau de l'enregistrement de Lokeren. Le notaire J. M., agissant comme mandataire, a déposé une déclaration complé- E. Story-Scientia - w 24.843- 449 mentaire le 7 juin 1990. Les droits et intérêts liquidés sur ces deux déclarations ont été payés. L'Administration a effectué une enquête auprès de la SNCI à Bruxelles et auprès du Bure au d'Affaires W. à Lokeren. Selon le défendeur, il apparaît, au vu de cette enquête, que la défunte, au cours des trois ans précédant son décès, a souscrit un certain nombre de bons de croissance émis par la SNCI par l'intermédiaire du Bureau d'Affaires W., et qu'eiie a retiré de son compte 75.000 francs en argent liquide. Comparant ces données avec la déclaration, il est apparu, selon Je défendeur, qu'il a été omis de déclarer 725.000 francs. Les demandeurs ont été invités par le défendeur à réparer cette omission par le dépôt d'une déclaration complémentaire ou par la preuve que les titres et la somme d'argent n'existaient plus au décès de J.V.H. Attendu que les demandeurs n'ont pu établir ni l'un ni l'autre de ces points, une contrainte a été décernée par 1'Administration le 10 avril 1992. Par exploit du 25 février 1993, signifié par 1'huissier B. R. de Lokeren, les demandeurs soJlicitaient que la contrainte précitée soit annulée et que le Tribunal dise pour droit que plus aucun droit complémentaire, ni intérêt, ni amende, n'étaient dûs du chef de ladite succession. 2. Les demandeurs exposent dans leurs conclusions qu'ils n'ont pas retrouvé les titres et l'argent dans la succession de J.V.H.; selon eux, sur les bordereaux concernant 1'acquisition des bons de croissance, le nom de la défunte n'apparaît nuiie part comme d'aiiieurs celui de l'acheteuse. Enfin, ils prétendent que la signature de la défunte ne peut être retrouvée sur les bordereaux et que les initiales« VH-VH »figurant sur certains d'entre eux ne proviennent pas de la main de la défunte. 3.Attendu que, conformément à l'article 15 du Code des droits de succession, les droits sont dûs sur la totalité des biens qui appartenaient au défunt, où qu'ils se trouvent; Si les héritiers, légataires ou donataires veulent se soustraire à 1'impôt, ils doivent prouver que la présomption légale est injuste, en d'autres termes, fournir la preuve contraire ; Grâce à la présomption légale de 1'article 108 du Code des droits de succession, 1'Administration ne doit pas prouver que les sommes et valeurs appartenant au défunt étaient encore en sa possession au moment de son décès, mais ce sont les héritiers qui doivent prouver que l'argent ou les titres n'en faisaient plus partie, ou qu'ils avaient été remployés dans des biens déjà déclarés à 1'actif de la succession ; Cette preuve contraire doit être fournie selon les règles du droit commun. Rec. gén. enr. not. 7 450 - N° 24.844- 4. Attendu que le défendeur a réalisé une enquête auprès de la SNCI et du Bureau d'affaires W., son agent de Lokeren, et qu'il ressort de cette enquête qu'au cours des trois ans précédant son décès, la défunte a souscrit des bons de croissance pour une valeur nominale de 620.000 francs, qu'elle a retiré 75.000 francs en argent liquide ; Que ces titres et cette somme font partie de sa succession ; Que, tenant compte des pièces produites par le défendeur, il existe des présomptions graves, précises et concordantes qui permettent de conclure que la défunte, au jour de son décès, était en possession des titres et de la somme cités plus haut. Que les demandeurs n'ont fourni aucune preuve contraire, sinon qu'ils prétendent que les titres en question n'ont pas été «retrouvés»; qu'ils n'avancent que des affirmations, qui ne sont renforcées par aucun élément de preuve. 5. Que la preuve du retrait d'argent du 17 juillet 1986 d'un montant de 75.000 francs par la défunte ressort de la liste des opérations de son compte à la SNCI; Que 1'opposition apparaît comme non fondée et doit être rejetée ; POUR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant contradictoirement, déclare la demande recevable mais la rejette comme non fondée. OBSERVATIONS À annoter: M. DONNAY, «Droits de succession », mis à jour par A. CuLOT, Rép. not., t. XV, n° 1232, 1242, 1245 et 1256; J. DECUYPER, «Droits de succession », n°' 1720, 1736 et 1760. -W 24.844- SUCCESSION (DROIT DE).- DONATION DANS LES TROIS ANS PRÉCÉDANT LE DÉCÈS (CODE, ART. 7). -A. -PREUVE À CHARGE DE L'ADMINISTRATION. -PREUVE PAR TOUS MOYENS DE DROIT COMMUN, TÉMOINS ET PRÉSOMPTIONS COMPRIS, À L' EXCEPTION DU SERMENT.- B. -PAS D'OBLIGATION CIVILE OU NATU- E. Story-Scientia -W24.844- 451 RELLE DE COMPENSER L'AIDE ET L'ASSISTANCE APPORTÉE AU DÉFUNT. -INTENTION DE GRATIFIER. SUCCESSION (DROIT DE).- INTÉRÊTS MORATOIRES.- INTÉRÊTS DUS PAR UN LÉGATAIRE VISÉ À L'ARTICLE 7 C. SUCC. -INTÉRÊTS DUS À COMPTER DE L'EXPIRATION DU DÉLAI FIXÉ PAR L'ARTICLE 40 ET NON À COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE. L'article I 05 du Code des droits de succession autorise l'Administration à prouver par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, que le défunt, dans les trois mois précédant son décès, a disposé à titre gratuit de bons de caisse en faveur d'un tiers déterminé. La remise de bons comme contre-prestation ne constitue pas une libéralité lorsque le défunt acquitte une dette provenant d'une obligation, soit civile, soit naturelle. En l'espèce, le défunt n'avait aucune obligation, ni légale, ni conventionnelle, de rémunérer l'aide et l'assistance qui lui étaient fournies. La remise des bons de caisse peut encore moins être considérée comme l'acquittement d'une obligation naturelle, étant donné que leur valeur est hors de proportion avec les prestations fournies dont la réalité est établie, et particulièrement si l'on considère que ces bons de caisse constituaient toute la fortune du défunt. Tout indique donc que le défunt n'a pas transmis les bons de caisse pour s'acquitter d'une dette, mais pour gratifier le tiers par reconnaissance ou comme récompense. Le fait que le défunt l'a institué légataire universel par testament quelques mois après l'acquisition des bons de caisse indique également qu'il agissait dans un esprit de gratification. Le paiement des droits de succession intervient dans les deux mois à compter du jour de l'expiration du délai fixé par l'article 40 du Code des droits de succession (article 77, alinéa I, du même Code). Si le droit n'est pas payé dans ce délai, l'intérêt légal est dû de plein droit à compter de l'expiration de ce délai (article SI du Code des droits de succession) et non à compter de la date de la signification de la contrainte. Arrêt de la Cour d'appel de Gand du 10 mars 1997. (Traduction) ( ... ) Par arrêt intermédiaire du 2 janvier 1995, la Cour a prié les parties de fournir oralement des éclaircissements sur une série de points précisés dans cet arrêt. Rec. gén. enr. not. 7 452 - N° 24.844- 2.1. Le 20 octobre 1986, 1' intimée a décerné contre 1'appelant une contrainte visant au paiement de 220.000 francs de droits de succession et 1.000 francs d'amende pour dépôt tardif, augmentés des intérêts. Le 14 novembre 1986, cette contrainte a été signifiée à 1'appelant avec commandement de payer. Par exploit du 4 mars 1987, 1'intimée a procédé à la saisie-exécution des biens meubles de 1'appelant. 2.2. Par exploit du 3 avril 1987, 1'appelant a fait opposition à la contrainte et à la saisie-exécution et a cité 1'intimée devant le premier juge pour entendre dire que la contrainte était non fondée et que la saisie devait être levée. Le jugement contesté déclare 1'opposition recevable, mais il la rejette comme non fondée et condamne l'appelant aux frais de l'instance. 2.3. En appel, l'appelant demande que son opposition soit déclarée recevable et fondée et que 1'intimée soit condamnée aux frais des deux instances. Subsidiairement, il prétend que les intérêts ne sont dus qu'à partir du 20 octobre 1986, c'est-à-dire à partir de la date à laquelle le commandement de payer lui a été signifié. L'intimée conclut, en ordre principal, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'appelant aux frais. Subsidiairement, il demande, si la Cour juge que les bons de caisse n'ont pas été donnés à 1'appelant dans les trois ans précédant le décès, d'établir si les opérations juridiques de 1'appelant après le décès de B.R. sont ou non régulières et, le cas échéant, d'ordonner des mesures conservatoires. L'intimée prétend que l'appelant, au cas ou sa demande serait reconnue fondée, soit au moins condamné aux frais des deux instances. 3. Par acte du 6 avril 1979, la maison d'habitation du défunt a été expropriée pour 1.000.000 francs. Après son décès, le 9 octobre 1981, ce montant ou sa contre-valeur ne se sont pas retrouvés dans sa succession. Les investigations menées par 1'intimée montrent que le de cujus a acheté le 18 juillet 1979, à la Banque Bruxelles-Lambert, des bons de caisse à cinq ans pour 700.000 francs, et que 1'appelant les a présentés au remboursement à 1'échéance. En ce qui concerne ces bons de caisse, l'intimée considère l'appelant comme légataire particulier et réclame les droits de succession. L'appelant prétend gu' il n'a pas reçu ces bons de caisse gratuitement, mais en contrepartie de soins et de frais d'entretien qu'il a fournis au défunt dans les dernières années de sa vie. Selon 1'appelant, l'intimée ne remplit pas son obligation de prouver qu'il s'agit d'une donation. E. Story-Scientia - N° 24.844- 453 4. Jugement 4.1. Il n'y a aucune raison de penser que les bons de caisse sont entrés en possession de l'appelant de manière illégitime. 4.2. Les biens dont l'Administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations (art. 7, al. 1, Code des droits de succession). Lorsqu 'il est établi que la libéralité a été faite à telle personne déterminée, celle-ci est réputée donataire de la chose donnée (art. 7, al. 2, C. suce.). L'article 105 du Code des droits de succession autorise l'intimée à prouver par tous moyens de droit y compris par témoignages et présomptions, mais à l'exclusion du serment, que le défunt a disposé à titre gratuit au profit de 1'intimée des bons de caisse au cours des trois ans précédant son décès. Il apparaît qu'après l'acquisition des bons de caisse par le défunt aucun montant important n'a été versé sur ses comptes bancaires. Cela constitue une lourde présomption que le transfert a eu lieu gratuitement. C'est à 1'appelant qu'il appartient de renverser cette présomption et de prouver ce qu'il affirme, à savoir que le transfert de propriété a eu lieu à titre onéreux. L'appelant affirme que les bons de caisse ne lui ont pas été donnés gratuitement par le défunt mais lui ont été remis comme contrepartie du fait que l'appelant et son épouse, pendant une dizaine d'années, ont entretenu le ménage du défunt (lessives, repassage, repas, nettoyage, transports, surveillance pendant la maladie) et parce que le défunt, pendant les deux dernières années de sa vie, avait pu habiter gratuitement dans sa caravane sur la propriété de 1'appelant. À 1'appui des soins fournis par 1'appelant et son épouse au défunt, deux pièces sont produites : une attestation de l'administration communale selon laquelle le défunt, décédé le 9 octobre 1991, était inscrit depuis le 21 juin 1980 à 1'adresse de l'appelant, et une attestation du médecin, le Dr D., du 16 août 1996 qui porte ce qui suit: «Je soussigné ai soigné B.R. durant de très nombreuses années jusqu'à sa mort le 9 octobre 1981. Les dernières années, lorsqu'il était invalide, il était conduit chez moi par S.M. ou quelqu'un de sa famille. Lorsque sa situation a empiré, il a habité dans une caravane chez S.M., où la femme de ce dernier 1'aidait plusieurs fois par jour, le soignait et lui donnait à manger. Les derniers mois, les soins hygiéniques sont devenus très lourds et les fonctions de garde-malade ont été assurées par S.M. et sa famille « . Rec. gén. enr. not. 7 454 - N° 24.844- L'appelant ne prouve qu'une partie de ses affirmations. Les pièces produites permettent seulement d'admettre que les soins et 1'aide ont été fournis au défunt, surtout à partir de l'époque où il s'est établi dans sa caravane sur la propriété de 1'appelant, selon 1'attestation d'inscription produite, à partir d'un an et quatre mois avant son décès. La remise des bons de caisse comme contre-prestation ne constitue pas une libéralité lorsque, ce faisant, le défunt acquitte une dette provenant d'une obligation, soit civile, soit naturelle. Le défunt n'avait aucune obligation, ni légale, ni conventionnelle, de rémunérer l'aide et l'assistance qui lui étaient fournies. La remise des bons de caisse peut encore moins être considérée comme 1'acquittement d'une obligation naturelle, étant donné que leur valeur est hors de proportion avec les prestations fournies dont la réalité est établie, et particulièrement si l'on considère que ces bons de caisse constituaient toute la fortune du défunt. Tout indique que le défunt n'a pas transmis les bons de caisse pour s'acquitter d'une dette, mais pour gratifier l'appelant par reconnaissance ou, comme l'appelant l'exprime lui-même,« comme récompense». Le fait que le défunt 1'a institué légataire universel par testament du 18 juillet 1979 indique également qu'il agissait dans un esprit de gratification. Comme 1'appelant ne réussit pas à renverser la présomption grave dont il est question ci-avant, 1'intimée fait à bon droit application de 1' article 7 du Code des droits de succession. 4.3. C'est à tort que l'appelant affirme que sur le montant de 220.000 francs 1'intérêt n'est dû qu'à compter de la date de la signification du commandement. Le paiement des droits de succession intervient dans les deux mois à compter du jour de l'expiration du délai de cinq mois fixé par 1'article 40 du Code des droits de succession (article 77, alinéa 1, du même Code), soit dans les sept mois après le décès. Si le droit n'est pas payé dans ce délai, 1'intérêt légal est dû de plein droit à compter de 1'expiration de ce délai (article 81 du Code des droits de succession), en l'espèce à partir du 1cr mai 1982, ainsi que l'indique la contrainte. POUR CES MOTIFS La Cour déclare 1'appel recevable mais non fondé confirme le jugement attaqué. OBSERVATIONS A. À annoter: M. DONNAY, «Droits de succession», mis à jour par Rép. not., t. XV, nos 1232 et 1257. CULOT, E. Story-Scientia - W 24.845- 455 BIBLIOGRAPHIE - W 24.845- Pratique notariale et droit administratif- Aménagement du territoire, environnement et opérations immobilières des pouvoirs locaux, par l'Association des licenciés en notariat (ALN) sous la direction de Yves Lejeune, avec l'assistance de Pierre-Yves Erneux.- Édition 1998.464 pages, 22 x 27,5 cm.- Relié, cartonné. Prix: 6.460 Bef.- Éditeur : LARCIER, département éditorial de De Boeck & Larder S.A., rue des Minimes, 39, 1000 Bruxelles.- Diffusion: ACCÈS+, Fond Jean Pâques, 4, 1348 Louvain-la-Neuve. Ces dernières années, les dispositions légales et réglementaires n'ont cessé de proliférer dans le domaine du droit public immobilier pour offrir aujourd'hui des solutions souvent différentes dans chaque Région ou dans chaque Communauté de notre pays. La complexité croissante de ces législations est devenue une source importante de difficultés pour 1' activité notariale, encore accentuées par 1'élargissement du devoir d'information et de conseil du notaire. C'est pourquoi l'Association des licenciés en notariat (A.L.N.) a voulu consacrer une journée d'étude à ces questions auxquelles le droit administratif belge apporte des solutions régionalement différenciées, sans écarter cependant certaines autres questions de droit administratif notarial qui se posent de la même façon partout en Belgique. Dans tous les cas, c'est l'intérêt des thèmes pour la pratique notariale qui a constitué le critère de sélection décisif. Le présent ouvrage regroupe les contributions, actualisées pour la plupart d'entre elles, qui furent présentées à 1'occasion de ce colloque. La pratique notariale reste donc le dénominateur commun des différents chapitres comme l'aménagement du territoire et la protection du patrimoine, la réhabilitation des sites d'activités économiques désaffectés, la protection de 1'environnement et la conservation des espaces naturels, la tutelle administrative sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux et la diffusion de 1' information. L'objectif est de dégager, dans chacune de ces matières, les obligations légales s'imposant au praticien, mais aussi les comportements appropriés à adopter face à ces réglementations nouvelles. L'ÉDITEUR Rec. gén. enr. not. 7 456 - N° 24.846- - N° 24.846- Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, par François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, professeur à l'Université catholique de Louvain. - Nouvelle édition entièrement mise à jour.- Édition 1997.-464 pages, 16 x 24 cm.- Prix: 4.200 Bef. - Éditeur : LARCIER S.A., rue des Minimes, 39, 1000 Bruxelles. - Diffusion : ACCÈS+, Fond Jean Pâques, 4, 1348 Louvain-la-Neuve. Le terme « sûreté » vient du latin securitas, qui peut se traduire aussi bien par sécurité : la sûreté protège le créancier contre 1'insolvabilité de son débiteur. S'il dispose d'une sûreté réelle, tout ou partie des actifs du débiteur lui sont réservés par priorité. Fort de 1'engagement d'une sûreté personnelle, il exigera paiement d'un autre débiteur, obligé en sus du premier. Mais pour comprendre l'utilité des sûretés, il est nécessaire d'étudier les principes généraux du droit d'exécution des créanciers, que la loi hypothécaire a ramassés dans ses articles 7 à 9. La première partie de l'ouvrage suit donc le cheminement difficile du créancier impayé, confronté dans ses tentatives de recouvrement, aux prétentions d'autres créanciers. La règle de l'égalité, dont le« concours» assure l'efficacité, s'impose alors. Elle se traduit, en matière commerciale, par l'organisation d'une procédure collective de liquidation : la faillite. Cette première partie conduit naturellement aux sûretés réelles, qui sont autant d'exceptions à la règle d'égalité. Leur étude est complète et couvre aussi bien le champ des sûretés civiles classiques (comme la plupart des privilèges, le gage, 1'hypothèque, etc.) que des sûretés commerciales (comme le gage sur fonds de commerce, le warrant, etc.). L'ouvrage aborde alors le domaine, très différent, des sûretés personnelles et de la plus classique: le cautionnement. Mais la pratique a créé des sûretés nouvelles. Ainsi en est-il de la garantie indépendante et de la lettre de patronage, nées des nécessités de la grande exportation ; elles sont aussi étudiées. Cette seconde édition, complétée, vient à son heure. L'abondance de la jurisprudence et les bouleversements législatifs récents exigeaient la mise à jour d'un ouvrage publié en 1991. Le lecteur y trouvera, singulièrement, un des premiers commentaires de la nouvelle législation relative à la faillite et au concordat judiciaire. L'ÉDITEUR E. Story-Scientia - N° 24.847- 457 -W 24.847- La Direction du RÉPERTOIRE NOTARIAL et les éditions LARCIER annoncent l'ouverture du PRIX ALFRED GENIN pour 1' année 1999. Ce prix est destiné à récompenser 1'auteur de la meilleure étude en rapport direct avec la pratique notariale. - Le prix s'élève à 100.000 francs belges. L'étude couronnée est susceptible d'être publiée dans le cadre de la Collection. -Le - texte proposé: doit constituer une contribution originale et utile au notariat belge ; comportera en principe 50 pages minimum ; peut être rédigé en français ou en néerlandais. - La Direction souhaiterait que, cette année, les sujets suivants soient privilégiés: - le notariat et la médiation ; - le notariat et la transaction ; - le notariat et le droit de 1'environnement ; - les fondations ; - la Convention des droits de 1'Homme et celle des droits de 1'Enfant dans leurs rapports avec le notariat. - Le prix sera décerné en fin d'année 1999. Les candidats sont priés d'envoyer leur demande d'inscription à la Direction du Répertoire Notarial. Un règlement détaillé leur sera remis à cette occasion. Adresse: Direction du Répertoire Notarial, rue Jaumain, n° 11, 5330 Assesse Rec. gén. enr. not. 7 RECYCLAGE EN DROIT Les facultés de Droit de 1'Université catholique de Louvain, des Facultés universitaires Saint-Louis et les Facultés Universitaires Catholiques de Mons organisent leur vingtième session de recyclage en droit. Le programme en est le suivant: Premier cycle- octobre-novembre 1998 «Questions d'actualité sur les P.M.E.» Faillites et concordats: les enjeux pour les P.M.E. par M"" Christine MATRAY, président du Tribunal de commerce de Namur, chargée d'enseignement à l'UMH; Sûretés : entre crédit et discrédit par M. Werner DERIJCKE, assistant à l'UCL; La planification de la transmission du patrimoine et de /'entreprise jàmiliale par MM. Hubert MICHEL, notaire à Charleroi, maître de conférences à l'UCL et Michel DE WOLF, chargé de cours invité à l'UCL, maître de conférences aux FUNDP, réviseur d'entreprises. Second cycle - novembre-décembre 1998 «Questions d'actualité de droit pénal» La médiation pénale, la transaction et les pratiques des parquets par M"" Nadia DE VROEDE, premier substitut du procureur du Roi à Bruxelles, magistrat de liaison en médiation pénale au parquet de Bruxelles et M. Didier VANREUSEL, substitut du procureur général à Mons (pour la conférence donnée à Mons uniquement); La réforme Franchimont par M. Patrick MANDOUX, juge au Tribunal de première instance de Bruxelles, maître de conférences à l' ULB ; La loi sur les stupéfiants et la jurisprudence actuelle par M. Alain DE NAUW, professeur ordinaire à la VUB. * * Dates des conférences l''' cycle : à Bruxelles, les jeudis 22-29 octobre et 12 novembre, de 18 h à 20 h. les jeudis 29 octobre et 12-19 novembre, de 18 h à 20 h. à Mons, 2' cycle : à Bruxelles, les jeudis 19-26 novembre et 3 décembre, de 18 h à 20 h. les jeudis 26 novembre et 3-10 décembre, de 18 h à 20 h. à Mons, Droits d'inscription Le droit d'inscription au premier cycle s'élève à 3.000 FB. Le droit d'inscription au deuxième cycle s'élève à 3.500 FB. Les participants au deuxième cycle recevront le numéro spécial de la Revue de droit pénal entièrement consacré à la réforme Franchimont. Ce numéro spécial tiendra lieu de rapport pour la conférence consacrée à ce sujet. Les participants qui ne souhaitent pas l'obtenir peuvent s'inscrire au deuxième cycle moyennant un droit d'inscription de 3.000 FB. Renseignements et programme détaillé Centre de Documentation et de Recyclage U.C.L. - Faculté de Droit Place Montesquieu, 2/32 - 1348 Louvain-la-Neuve Tél. (010) 47 46 64- Fax (010) 47 82 43 À VENDRE - Collection du Recueil général de 1'enregistrement et du notariat ( 1848 à 1981) ; Traité élémentaire de droit civil belge par Henri De Page, (deuxième édition - 1939), tome 1 au tome X ; Répertoire pratique de droit belge, tome 1 au tome XII ; Cours élémentaire de droit civil par F. Laurent ( 1878), tome 1 au tome IV; Dictionnaire des droits d'enregistrement, de succession et de timbre par Alfred Schickx ( 1898), tome 1 au tome V. Pour tout renseignement s'adresser à Mme Verhaegen Rita, Berchemloslaan, 22, 2600 Berchem (Antwerpen) (03/230.47.20 après 18 heures).