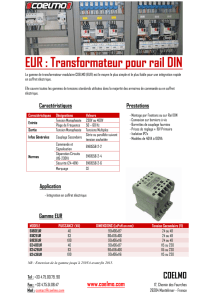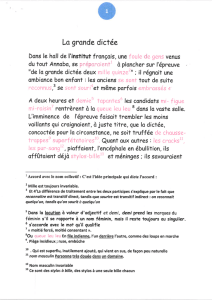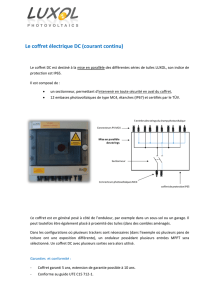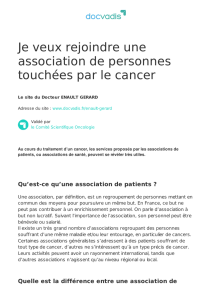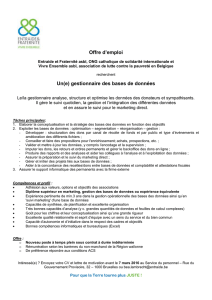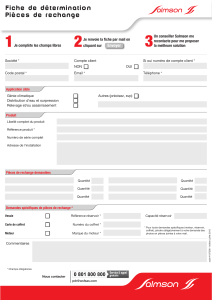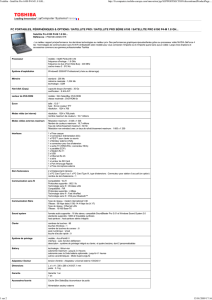o
vrvre
MATERN ELLE
I
10q0
Ç;n
Materne[[e
POUR EXPLORER LE MONDE DU \VIVANT,
DES OBJETS ET DE LA MAT!ERE
Yannick LEFRANçOlS
I
Itustrateu r
Dominique LAGRAULA
Professeure de technologie
à I'ESPE de Paris
Emmanue[te DI MARTINO
I
[[ustratrice
Nicotas BRACH
Directeur d'écote
Personne Ressource en Sciences
dans l'académie de Strasbourg
Dominique LEGOLL
Professeure des écotes
en maternel[e
dans l'académie de Strasbourg
Sous la direction de
Léa SCHNEIDER
Éditrice
Professeure des écotes à Paris
UNIVERSITÉ PNNIS EST CRÉTEIL
BU DE L'IUT DE SÉNART
;ffi
Ouvrage de
288 pages A4
+
r
DVD-Rom
Coffret de
ro8 cartons de Memory
324 cartes-images
12 recettes
B fiches de construction
rz affiches
r plateau de jeu
i
13 rue du Château d'Angleterre . 67300 Schittigheim
Tét. o3 88 t9 gt 67 Fax
88 79 o9 85
.
q
www. acces -ed itio ns. co m
4
5
6
7
Rêpartition des apprentissages sur Ie cycle ro
Trucs et
72
Ouvrages, vidéos et applications autour
du vivant, de [a matière et des
t4
astuces
objets
8
t6
18
20
22
24
27
LA MATIÈRE
LES OBjETS
LES MATÉRIAUX
LES OBjETS DE CONSTRUCTTON
Notions pour l'enseignant
Trucs et astuces
Les p'tits pâtissiers
En quoi c'est fait?
Ça gratte ou ça pique?
Ma maison est [a ptus solide!
Ouvrages autour des matériaux
774
r75
tt6
72o
724
7jo
t34
rEAU
3o
33
36
38
41
44
qG
4a
52
57
58
64
Notions pour I'enseignant
Ça coule de source
Flotte-coule
:.:::i Le radeau de Zouglougtou
On the rocks
Menthe à ['eau
iii'li: Boule de neige
Ouvrages autour de ['eau
67
*
68
tE§
7o
N+ticy:s pour §'*:ls*ignar:Ë
Trurs t êsti:aê$
À r!';=cur: -ql* r;;iur:'É
LÈs nê!trc5 ie i'*rtbie
Les lmhie,: d* ia ir:iir
73
74
ZB
8r
8S
88
90
92
94
101
BR˧ §T L,q
LiJ
138
142
146
148
r51
t54
156
**vrages *t iê*x ààlt*!:r des c*::bres
e[ cle ia [ui.nière
LEs OBJETS MÉCANIQUES
Notions pour l'enseignant
Trucs et astuces
Jne cuisine bien rangée
Les p'tils cLti:inie"c
Pince-mi et P:nce.moi
sont dans une cuisine
Ouvrages, ieux et application
autour de [a cuisine et de [a mécanigue
tss
160
764
t66
169
tl2
21A
zt6
220
224
226
227
zz8
234
236
240
242
â74
175
LES OBJETS MAGNÉTIQUES
1j6
128
182
182
Notions pour I'enseignant
Trucs et astuces
244
Accrochez-vous !
Les p'tits pêcheurs
246
250
Pôle position
)t)
igû
§*§! lt avance tout seul!
256
Ouvrages et ieux autour du magnétisme
258
245
LES OBJETS EN ÉQUIL|BRE
Notions pour I'enseignant
Trucs et astuces
Les culbutos
p'tits Calder
103
Les
Questions d'équilibres
Ouvrages, jeux et balances
autour de l'équilibre
tt7
2oB
209
LES OBJETS ROULANTS
Notions pour I'enseignant
Trucs et astuces
Les gardiens de parking
Les p'tits garagistes
Les constructeurs de voitures
*gËl Le défi des constructeurs
Ouvrages et ieux autour des véhicules
to6
11()
zo6
158
§ÈR§
i'!'ioi ihêâlre i'cmbres
792
793
194
796
798
200
204
B6
L'AIR
Notions pour ['enseignant
Tru6s et astuces
Le nez au vent
Tournez moulinets !
En coup de vent
Un grand bol d'air
Ouvrages et ieux autour de ['air
Notions pour l'enseignant
Trucs et astuces
Comment tu t'appelles?
Les p'tits ingénieurs
Les p'tits architectes
ll suffit de passer le pont
De bas en haut
Ouvrages, jeux et vidéo
autour de [a construction
267
262
264
267
270
LES OBfETS ÉlrCrRlQUrS
Notions pour I'enseignant
Trucs et astuces
Y a-t-i[ un fil dans ['objet?
Les p'tits dépanneurs
Le chemin de ['étectricité
**trt Mon ctown voit rouge
Ouvrages, ieux et vidéos
autour de l'êlectricité
272
273
274
276
279
284
286
classe
La boîte à outils pour [a
287
Liste des tournisseurs et index des ouvrages 288
Sciences à
vivre §
Léa SCHNEIDER, Dominique LAGRAULA, Nicclas BRACH et Dominique LEGOtt à ACCÈS Éditions en iévrier zor5
La toi de refondation de t'Écote de la Répubtique
attribue deux missions essentielles à t'écote mater-
nette. Tout en respectant [e rythme de chacun, [a première écote doit préparer progressivement les
enfants aux apprentissages qui seront dispensés à t'écote étémentaire. Ette doit jouer un rôte clé
dans [a réduction des inégatités et dans [a réussite de tous les enfants qu'e[[e accueitte. L'écote
maternelle place au premier chef de ses priorités ['apprentissage du [angage orat, outiI essentieI
dans [a prévention des difficuttés.
Dans [e domaine de [a découverte du monde et des apprentissages scientifiques et technologiques,
trop peu de collègues de maternetle
de peur d'être btoqués à un moment or* à
un autre par manque d'idées, de ressources ou de matériel. Forts de ce constat, nous avons pris [e
parti de réaliser
SCIENCES
ÀVtVnf
OSENT SE LANCER
MATERNELTE, un
outil complet et concret engtobant
LE VIVANT,
LA MATIÈRE ET LES OBJETS.
Dans [e domaine scientifique et technologique, les élèves ont besoin d'être confrontés [e plus
souvent possibte à des supports concrets et vivants. Pour qu'ils puissent se questionner, observer,
manipuler, chercher et verbatiser, [e cæur des séquences se déroute en atetiers dirigés. Nous avons
néanmoins choisi d'amorcer chaque séquence en classe entière, de manière à créer une émutation
et un vécu communs. Les bitans se font également en classe entière, ce qui permet de favoriser les
échanges entre les groupes et de construire des connaissances communes.
Nous avons fait [e choix de vous proposer des séances guidées et cadrantes. Nos démarches per-
mettent de mobitiser fortement [e langage des enfants. Ettes sont volontairement très structurées
et détaitlées. Cependant, etles ne sont que des EXEMPLES destinés à vous DONNER ENVIE de faire
plus de Sciences et de Technologie dans vos ctasses. Les interactions enseignant-élèves y sont
permanentes. Des propositions de consignes énoncées par ['enseignant sont en italique gras. Les
réponses attendues des étèves sont écrites en italique. Leurs conclusions espérées figurent en
cursive. Ces exemptes de questionnements, d'émissions d'hypothèses, de verbalisations
et
de
conctusions ne sont en aucun cas des modèles à suivre à [a lettre. Vos séances seront d'autant plus
rêussies que les interrogations viendront de vos élèves eux-mêmes, que leurs conctusions seront
formulées avec [eurs propres mots.
Nous n'avons volontairement pas traité les outils numériques car les équipements des écotes mater-
nelles nous ont sembté trop différents les uns des autres. De ptus, ta rapidité avec laquelle les
technologies évoluent ne nous permettait pas de proposer des séquences pérennes. Les tabtettes
arrivent dans les ctasses, mais lesquelles et en quetle quantité ? Ne seront-eltes pas supplantées
dans deux ou trois ans ? À ['heure où nous avons écrit cet ouvrage, iI nous paraissait trop difficite
de vous proposer des séquences réetlement utilisabtes dans ce domaine. Comme vous, nous avons
besoin de temps pour nous adapter au défi numérique qui nous attend.
llos démarches ont été expérimentées en classe et soumises à une analyse critique à [a lumière
-: .::'-- ssages et des progrès des étèves. Conçues comme des situations de communication,
, - r - -: : .-: rsées éveittent ta curiosité des é[èves en privitégiant Ies échanges oraux, Ies
-: -: - -- :i les maniputations de chacun et favorisent Ies découvçrtes scientifiques et
- - ,:e à vous et à tous vos
-:-e
étèves.
LAGRAULA, Nicotas BRACH, Dominique LEGOLL
et Léa
SCHNEIDER
Novembre zor5
['' o[
e
-
:.in officiel spécial n"2 du z6 mars zot5
5. IEXPLORER LE MONDE
5;1 Se repérer dans le temps et l'espace [...]
ÿ2r Explorer [e monde du vivant, des obiets
et de la matière
---=rtrée à I'école materne[[e, les enfants ont déjà des représenta-. --r Leur permettent de prendre des repères dans leur vie quoti- .--= rour les aider à découvrir, organiser et comprendre le monde qui
:: :-.f,uTe, ['enseignant propose des activités qui amènent Ies enfants
-
-::-,./eT, formuler des interrogations plus rationne[les, construire des
: -: ,-s entre Ies phénomènes observés, prévoir des conséquences,
.-. -lê, des caractéristiques susceptibtes d'être catégorisées. Les
. '. -.: commencent à comprendre ce qui distingue [e vivant du non. - r ls manipulent, fabriquent pour se familiariser avec Ies objets et
.: - :
Êl'ê
0blectifs visés et é[éments de progressivité
)écouvrir [e monde vivant
.--.=ignant conduit les enfants à observer les différentes manifesta-. ie Ia vie animale et végétale. lts découvrent le cycle que consti- a naissance, Ia croissance, la reproduction, le vieillissement, la
- ":r assurant les soins nécessaires aux étevages et aux plantations
.-. a classe. lls identifient, nomment ou regroupent des animaux en
- . rr de Ieurs caractéristiques (poils, plumes, écailles...), de Ieurs
- ,=. Ce déplacements (marche, reptation, vo[, nage...), de Ieurs milieux
- : ÊTS Ies activités physiques vécues à ['écote, Ies enfants apprennent
: - :-x connaître et maîtriser [eur corps. lts comprennent qu'i[ [eur ap- :' .: rt, qu'ils doivent en prendre soin pour se maintenir en forme et
'. :'iser leur bien-être. lls apprennent à identifier, désigner et nommer
-. - ilérentes parties du corps. Cette éducation à la santé vise l'acqui. , - de premiers savoirs et savoir-faire relatifs à une hygiène de vie
,. -= E[[e intègre une première approche des questions nutritionne[les
- reut être liée à une éducation au goût.
--. :nfants enrichissent et développent [eurs aptitudes sensorietles,
. =- servent pour distinguer des rêalités différentes selon [eurs caracté-
.. oues otfactives, gustatives, tactiles, auditives et visuelles. Chez les
-s grands, iI s'agit de comparer, classer ou ordonner ces réalités, les
,- -ire grâce au Iangage, les catégoriser.
:-'r. Ies questions de [a protection du vivant et de son environnement
.,-- abordêes dans le cadre d'une découverte de différents milieux, par
--= initiation concrète à une attitude
responsable.
Explorer [a matière
--:
première appréhension du concept de matière est favorisée par
Les enfants
: : iercent régulièrement à des actions variées (transvaser, malaxer, mé.-ger, transporter, modeter, taitler, couper, morceler, assembler, trans'--ner). Tout au [ong du cycle, ils découvrent les effets de leurs actions
::tion directe sur les matériaux dès [a petite section.
Ce qui est attendu des enfants en
et ils utilisent quelques matières ou matériaux naturels (t'eau, [e bois,
la terre, [e sable, ['air...) ou fabriqués par l'homme (le papier, [e carton,
la semoule, [e tissu...).
Les activités qui conduisent à des méLanges, des dissolutions, des
transformations mécaniques ou sous l'effet de la chaleur ou du froid
permettent progressivement d'approcher quelques propriêtés de ces
matières et matériaux, quelques aspect§ de leurs transformations possibtes. Elles sont l'occasion de discussions entre enfants et avec ['enseignant, et permettent de classer, désigner et dêFnir leurs qualitês en
acquêrant [e vocabulaire approprié.
Utiliser, fabriquer, manipuler des objets
L'utilisation d'instruments, d'objets variés, d'outils conduit les enfants
à développer une série d'habitetés, à maniputer et à découvrir
[eurs
usages. De la petite à [a grande section, les enfants apprennent à retier
une action ou [e choix d'un outi[ à t'effet qu'its veulent obtenir: co[[er,
enfiter, assembler, actionner, boutonner, découper, équilibrer, tenir un
outiI scripteur, plier, utiliser un gabarit, manipuler une souris d'ordinateur, agir sur une tabtette numérique... Toutes ces actions se complexifient au [ong du cycle. Pour atteindre t'oblectif qui [eur est fixé ou celui
qu'its se donnent, les enFants apprennent à intégrer progressivement Ia
chronotogie des tâches requises et à ordonner une suite d'actions; en
grande section, ils sont capables d'utiliser un mode d'emploi ou une
fiche de construction i[[ustrés.
Les montages et démontages dans [e cadre des jeux de construction et
de la réalisation de maquettes, Ia fabrication d'objets contribuent à une
première dêcouverte du monde technique.
Les utilisations multiples d'instruments et d'obiets sont ['occasion de
constater des phénomènes physiques, notamment en utilisant des instruments d'optique simples (tes [oupes notamment) ou en agissant avec
des ressorts, des aimants, des poulies, des engrenages, des plans înclinés... Les entants ont besoin d'agir de nombreuses fois pour constater
des régularités qui sont les manifestations des phénomènes physiques
qu'ils étudieront beaucoup plus tard (la gravité, l'attraction entre deux
pôles aimantés, les efrets de [a [umière, etc.).
Tout au [ong du cycte, les enfants prennent conscience des risques liés
à t'usage des objets, notamment dans [e cadre de [a prévention des
accidents domestiques.
Utitiser des outits numériques
Dès [eur plus jeune âge, les enfants sont en contact avec les nouvelles
technologies. Le rôle de l'écote est de leur donner des repères pour
en comprendre ['utitité et commencer à les utiliser de manière adaptêe
(tabtette numérique, ordinateur, appareil photo numêrique...). Des recherches ciblées, via le réseau lnternet, sont effectuées et commentées
par ['enseignant.
Des prolets de classe ou d'écote induisant des retations avec d'autres
enfants favorisent des expêriences de communication à distance. L'enseignant évoque avec les enfants ['idée d'un monde en réseau qui peut
permettre de parler à d'autres personnes parfois très éloignées.
fin d'écote materne[le
- Reconnaître Ies principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal, dans une situation d'observation du réel ou sur une image.
- Connaître [es besoins essentiels de quelques animaux et vêgétaux.
- Situer et nommer [es di[férentes parties du corps humain, sur soi ou sur une reprêsentation.
- Connaître et mettre en oeuvre quelques règtes d'hygiène corporelle et d'une vie saine.
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, couper,
colter, assembler, actionner...).
- Rêatiser des constructions; construire des maquettes simples en fonction de plans ou d'instructions de montage.
- Utitiser des objets numériques: appareil photo, tablette, ordinateur.
- Prendre en compte les risques de I'environnement familier proche (obfets et comportements dangereux, produits toxiques).
Sciences à
vivre
§
iis
I
mment permettre cette exploration
§"t
DES 5tTl.IAT!O},I§ MTTIVAruT˧ ÊT ADAPTÉES À TEGE PE5 E§{FANT§
En permettant aux élèves de maternelle d'explorer [e vivant, la matière
et les objets, on les confronte à des étéments concrets qui suscitent
[eur curiosité. Ces enfants sont curieux de nature et ont envie de comprendre le monde qui les entoure. La présence d'un animat, d'une plante
ou de nouveaux objets va d'emblée les intéresser, leur donner envie
d'apprendre et créer un vécu commun.
Dans Sciences à vivre, nous vous proposons des
vi
sUR LE RÉEL ET SUR LA MANIPULATION
Pour que tes élèves de materneLle puissent s'approprier le vivant,
[a matière et les objets, ils ont besoin de voir et de toucher de vrais
animaux, de vraies ptantes, de vrais matériaux, de vrais objets... En
observant au ptus près et en maniputant, les enfants s'approprient le
réeI et se construisent des représentations qui Ieur permettront de
EN s'APPUYANT
fonder des apprentissages durables.
situations qui s'appuient sur du matériel riche et motivont.
Pour qu'un enfant ait envie de parler, il faut qu'il ait envie d'entrer en
communication. Grâce au vivant, à [a matière et aux objets, I'enfant va
avoir envie de s'exprimer, soit pour partager son ressenti soit pour poser
une question: « c'est froidl C'est chaudl Ça chatouillel C'est quoi ça?... »
Dans Sciences à
?
EN INTERPELLANT LA SENSIBILlTÉ DE TENFANT
Le vivant, la matière et les objets vont créer des situations qui interpeItent la sensibilitê de ['enfant: apporter un animal, Iui faire toucher
une matière inconnue, proposer de nouveaux objets...
Elles vont également faire appel à son vécu: montrer des photos de lui
ou de ses camarades ptantant une graine, Iisant un album ou montrant
des images où un personnage fait la même chose que [ui...
nous voLts proposons des situations déclenchantes motivontes 0insi que des cartes-images
et des jeux de Memory sources de langage.
EN VARIANT LEs SUPPORTS DE LANGAGE
Le lexique du monde du vivant, de [a matière et des ob.iets est intarissabte. Pour chaque notion abordée vont être nommés et mémorisés un
grand nombre de mots: des noms, des verbes et des adlectifs. Dans un
premier temps, ['enfant tâchera de comprendre les mots en rêception
puis iI essaiera progressivement de les rêutiliser en production.
Pour que [e lexique soit mémorisê et utilisé, il faut I'utiliser à plusieurs
reprises et permettre aux étèves de s'en emparer à différents moments:
avant l'activité, [ors de l'activitê, [ors du bilan, mais aussi [ors de jeux
et d'ateliers dirigês de langage. Pour ancrer [e lexique, [e mieux est de
pouvoir varier les représentations: réet, photographie, dessin.
Dans Sciences à vivre, nous vous proposons des ateliers dirigés de langoge s'oppuyant sur du réel, des photographies
et des illustrotions. À la fin de chlque séquence est listé le lexique qui y est abordé et qui peut être mémorisé por les élèves.
sE§ 5âTt-lATr0ht5 sTRL!CTr.'&&ArrE§
Le vivant, [a matière et les objets sont source de beaucoup d'activités
qui structurent la pensée de I'enfant: des tris, des classements, des
dêmarches structurées qui ['amènent à organiser Ie monde qui l'entoure.
Les séquences
EN SUIVANT UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE
Même en maternelte, iI est possibte de suivre une démarche sclentifique
ou technologique structurée, partant d'un questionnement et aboutissant à des réponses scientifiques ou des solutions techniques.
proposées dons Sciences à vivre suivent une démarche structurée pour permettre aux élèves d'organiser
et de comprendre le monde qui les entoure.
EN PROPOSANT DEs ACTIVITÉS QUI OÉVTIOPPENT
Grâce au vivant, à [a matière et aux objets, les étèves apprennent à se
focaliser sur des détaits, à devenir plus méticuleux et plus précis dans
leurs intentions. Cela dêveloppe considérablement leur faculté à observer, ce qui les aidera au quotidien à réussir [eur scolarité.
TOBSER
ION
L'observation fait partie intégrante des activités de dêcouverte du vivant, de [a matière et des objets: observer un animaL, d'abord à ['ceiI nu
puis à La Ioupe, observer Ies détails d'un objet pour pouvoir comprendre
comment iI fonctionne, observer Ie rêsultat d'une action sur Ia matière...
Dans Sciences à vivre, nous proposons des séonces qui développent l'observation.
*§§ I
Grâce à des situations déclenchantes bien choisies, ['enfant va être ame-
né à se poser des questions sur le monde qui ['entoure, développant
ainsi sa capacité à s'interroger de manière rationnelle.
Dans Sciences à
vi
EN METTANT TÉLÈVE EN SITUATION DE RECHERCHE
En posant aux étèves des problèmes qui font sens, [a recherche devient
natureLle et motivante, créant une émulation positive dans [a ctasse.
nous vous proposons des situations qui permettent de mettre les élèves en situation de recherche.
mËs siTi..§,&T§*N§ Gil( §âvELtP+lETdr
La construction et t'utilisation d'oblets apprennent à l'enfant à rendre
ses gestes de plus en plus précis et à identifier les outils les plus efficaces pour une action donnêe.
EN PROPOSANT DEs RECETTES ET DES FICHES DE CONSTRUCTION
Suivre une recette de cuisine ou une fiche de construction, c'est à la
fois suivre une démarche ordonnée et apprendre un certain nombre de
gestes adaptés à une action, un outiI ou un matériau donné.
Dans Sciences à vivre, nous vous proposons douze recettes et huit fiches de construction.
DEs SITUATIONS QUI DÉVELOPPENT LA COLTABORATION
À travers des questionnements, des projets et des défis communs, les
êlèves apprennent à travai[[er ensemble, à échanger [eurs points de vue,
à écouter et à respecter Ieurs camarades.
Dans Sciences à
6
vi
EN PROPOSANT DEs DËFIS
Rien de tel qu'un défi pour permettre à tous les êlèves de trouver des
réponses, mais aussi d'êcouter cettes de Ieurs camarades, se mettre
d'accord et travailler ensemble.
nous vous proposons sept défis adaptés aux élèves de materneLle.
PHASE DE
ET DE PI
Découverte
Situation déctenchante
ü
Réprésentations initiales
J
Questionnement
PHASE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME
De ['ordre de [a connaissance
Comment sovoir?
De l'ordre de [a fabrication
Comment faire?
ü
ü
DÉMARcHE scrENTIFreuE
oÉwrRRcn
Hypothèses
r
rEcH
NoLoGreur
Cahier des charges
ü
ü
Conception
INVESTIGATION
lmaginer, chercher des solutions
Essayer, réatiser des prototypes
Observation
Manipulation
Fabrication
et/ou
J
Fiche de construction
Expérimentation
Amélioration des prototypes
et/o u
Recherche documentaire
UtiIisation
ü
ü
Analyse des résuttats de l'investigation
PHASE DE BILAN
STRUCTURATION
Conclusions
Trace écrite collective
ÉvRluRnoru
À
['oral
Trace écrite
individuette
Fabrication, construction
Sciences à
vivre §
ilise r
C
LES NOTIONS POUR I,TruSTICURUT
LES TRUCS ET ASTUCES
Au début de chaque chapitre, cette page explique brièvement à
l'enseignant les savoirs scientifiques en jeu dans les séquences.
Cette page donne à ['enseignant des conseils pratiques
pour trouver, acheter ou fabriquer [e matériel nécessaire.
Notions pour ['enseignant
È Unc @ùe peût èue
,
À
h
mo.t$
dè dêu, h(one
§ deurnonbgE impliquentdÈ difrculÉ h.hniqùÈ dlfiérente
ribnBUon,
LE DVD-ROM
fin de chaque chapitre, cette page propose une sélection
dbuvrages et de ieux du commerce en [ien avec les notions
abordées.
o!vRAGEs auIouÊ oEs vÉHtcuLEs
vn6uu
ô@,o
vmuml vroum!
o@è
T."jll:,#4,b.:d"
!:
JEUi ÀurouÂ
DEs
@@
Mr:
!,tiu 0j{s:,r6 vdr!Ês
vÉHrcuLÈs
@
nudLè en bo'§à
bdôE vèhtu.!
Les objets roulants. La page 248
-'iï:*:il* '&
Les objets routants. La page 227
LES OUVRAGES ET JEUX
En
t
diiÉDnts
Les obiets roulants. La page 226
I
?
@
Le DVD-ROM comporte tout [e matériel et les documents élèves
cités dans les séquences, en noir et blanc et en couleur, prêts à
être imprimés. ll contient également des vidéos et des photos à
montrer aux é[èves.
LA PAGE DE SEQUENCE
Oraque séquence d'apprentissage se présente sur deux à six pages. E[[e se compose de plusieurs étapes aux modalitês variées.
Eh est organisée par différentes rubriques.
-:
:
Le chapitre
Le tlir
lI rappelle dans quel chapitre
s'inscrit la séquence.
donne une indication
Iudique sur [a séquence
e
Ll
:a:tie
e rappetle
:: , :-:Lle partie
::: :- se situe
L'objectif général
lI concerne ['ensemble
de [a séquence proposée.
Les niveaux
lls précisent à queI niveau de ctasse
s'adresse l'etape. lls peuvent varier
d'une étape à l'autre seton teur difficulté
.;;;itrqre
:-
I :::
::'-e
:-
CeSSOUS
-.
.
::
l'étape
-:::éireI
-: qUl e5l
: :r--
e\! l! ttedi.t,léûèn!
"
Oùel
.
Ensùitu,
dè ld
vrittt.
qLi
t.ntr
er pûnte: :)
:, ...
l? b oa. esr.t.vte. att€ së àë9on1ê
qLbrlwlll à l, ÿdtqe ? !. pla..het .asse
> Que3eWl
l'étape.
Les consignes
En italique gras,
eltes reflètent mot
pour mot les paroles
de l'enseignant.
> Qtelle ponie d. lov.iutê totb. er Pdlneendêrtiet?
r
1
^
ÀAuoisettnqot.h.:.t
, Qrc fait od qÿond !n. vôiu.e lon&
'
ÀcrvtrÊ
a. trn^, r. ,h.. t. g.t.9 ist.
Les réponses attendues
En itatique, etles indiquent
la réponse que l'on peut
attendre des étèves.
à2o mlnutes
.,::i::l
.s or
?
]ûoL.ùt.
tNDTvTDUELLE
1o
hr
ponne
"É
Le
!?il6
dê
t it,neuewnwn*«yont
t4pontat*et'stntoilaaÈ'-
i";.;
roJcr,
dercpÆûN
À.tlviE
> Châque élève dessine une volture Le6eigianl
1,g.nd. e Ce5sin en !nteroseant chaqùe éiève
Le pictogramme
ll permet de se situer
au sein de la démarche.
qu.5üonnonê"t
>
toM t @ Lq @
@ds ent I I êléûenb
d uevoihe? End.n.ndont àûnÿ.nd.tt de
/onure, en denondontà un sardqiste et rclôt
do.t donsùneÿoittre
Proposithi du ffiontaE€
> I'ai ici ûe p*b ÿoir!re lotet qll ûryonê bÉ
les é |tutu
inpûnnb {ûe v ôle rùuh
Noos olbns lo dén@@ et noûn.t taut* le5
ptà.@
déDoltfu
Émon69ê
Les pages
2j4 el
La période de l'annêe
Elte suggère quand
il est iudicieux de
mener la séquence
sur l'année,
en fonction du niveau
de ctasse.
235
Les aorc.rLSiors
En cursive, elles permettent
de visualiser ce qu'iL faut retenir
et donnent un exemple de ce que
l'on peut noter sur une
aFfiche.
Les remarques
pour ['enseignant
Détachées du
déroulement de
[a
séance, eltes attirent
['attention sur des
détaits qui facilitent
sa mtse en æuvre.
LES DÉFIs
se distinguent des
!Éqiences ptus ctassiques
par un changement de
:rrteur. lts sont proposés
:our [a ctasse mais sont
:-core plus porteurs quand
plusieurs classes
Le prolongement
ou la dif[érenciation
lI donne des pistes d'activités
supplémentaires en [ien
avec [a séquence. Elle permet de
savoir comment différencier.
Le cadre lexique
ll indique le lexique mobilisé
tout au long de [a séquence.
Sciences à vivre
R' !i
i ge t
sa
MS
PS
Pr
Pz
P:
P4
P5
Pr
Pz.
rr rn snrurÉ
o o C
GS
P4
P5
o o
C
P3
te
Pz
D.
t)
P4
P5
C
o
C
o o o
C
o
o
o
o
o
o
Pr
l'HyctÈnE
Se laver
La visite médicale
o
o o o o o
LE SCHEMA CORPOREL
o o o
C o
Contours et sithouettes
Le dêplacement de ['enfant
C
C
Le corps articulé
o o o o
o o o o
o o
LES CINQ SENS
Le toucher
Le goût
L'odorat
L'o u ie
La vue
F
Les organes des sens
z
C
C
o
C
C
C
o
C C
o C o
o o o C
C
o
C
o
C
C
C
o C o
o o C
C
C C
C C
C
C
C
C
o
C C
o C
C o o o o o C
o o o o C C o
o o o o C C o
o C C C o o o
o C C C C o o
o o
o
C o o
o o o
o C o
o C o
o C o
o
C
C
o o o
o o o o
o o o o
o C o o
o C o C
C
LES ELEVAGES
Polochon [e poisson
:
Romarin le lapin
Vani[[e [a gerbilte
Margot I'escargot
Stanistas te phasme
EJ
o o o c o o
o o o o o C
o C C o C o
(, C o C C C
(,
C
o
o o
C
C
a o a o C C C
c
o C o o o o o o o
o C o o o o a o o
LA LOCOMOTION
J
o c o
Pigeon vole
Aites, pattes ou nageoires?
o
LA NUTRITION
o
Bon appétit lapin!
À chacun son menu
c
C
C
LA REPRODUCTION
o o o
o o
Tableau de famille
0vipare ou vivipare?
Des
petits dans notre étevage
o
C
o o
C
C
o
LE JARDINAGE
o
C
o o o
o o o o o o C o
C
o
Silence, ça pousse!
o
Graine ou pas graine?
Du bulbe à la fleur
Le cycle du blé
C
C
C
C
c
C
o
o o
a
C
(, o C C
O Périodes où iI est possible de réaliser [a séquence. Pr Septembre - Octobre
O Périodes où iI est conseil[é de réaliser [a séquence. Pz Novembre - Décembre
P3 Janvier - Février
P4 Mars - Avril
P5 Mai - Juin
1()
C
o
C
C
o
a)
I
C
U
C
C
Les
p'tits pâtissiers
En quoi c'est fait?
Ca gratte ou Ça pique?
Ma maison est [a plus solidel
4rJ
Ça coute de source
Ft
otte
-
co u le
Le radeau de Zouglouglou
On the rocks
Menthe à ['eau
Boule de neige
=
Le nez au vent
Tournez moulinets
!
En coup de vent
Un grand bol d'air
A chacun son ombre
Les maîtres
de
I
Les ombres de [a cour
lvton thêâtre d'ombres
I
-+-i*L-
i
Comment tu t'appelles?
p'tits ingénieurs
Les
p'tits architectes
l[ suffit de passer le pont
Les
oÉrt oe bas en haut
(,
Une cuisine bien rangêe
Les
p'tits cuisiniers
Pince-mi et Pince-moi
LTJ
Les gardiens de parking
Les
cÊ
o
p'tits garagistes
Les constructeurs de voitures
Le défi des constructe
Accrochez-vous
v1
!
Les p'tits pêcheurs
Pôte position
LrJ
DÉFl
!l avance tout seul!
Les cutbutos
Les
p'tits Calder
Questions d'équilibres
Y a-t-il un
Les
fil dans l'objet?
p'tits dépanneurs
Le chemin de l'êtectricité
DÉH Mon clown voit
II
o
o
Sciences à vivre
Solution r
Que vous choisissiez ['une ou l,autre des sotutions
pour fabriquer les briques, eltes devront respecter
les proportions suivantes
L:zP
Étater la pâte à set ou
t'argile entre deux tasseaux
d'épaisseur r cm. Couper
les briques au couteau
à l'aide d'un tasseau
fabriquer
des briques ?
P:zH
Les vraies briques
A
lu
V
de r,5 cm pour [a
profondeur et de 3 cm
pour la [ongueur.
Si vous ne souhaitez pas acheter
les briques Tefoc, vous pouvez
vous en fabriquer.
. Soit en pâte à sel (recette 3 dans [e
DVD-Rom et [e coffret).
C'est [a sotution [a plus économique,
mais les briques seront à refaire
régulièrement. Pour la couteur, utitiser
du colorant marron versé dans l,eau
servant au métange.
. Soit en argile.
lI existe de ['argile séchant à I'air
pour les écoles ne possédant pas
de four permettant [a cuisson
de [a terre.
ll est possible d'utiliser
['intérieur des boîtes de
chocotat de type Pyrénéen.
Les blocs à glaçons peuvent
aussi être utilisés mais
les proportions ne
seront plus iustes.
AVEC QUEI OUTIL?
Avec une aiguille de piquage,
un clou ou une vrille.
l[ faut alors que [a pointe
de ['outiI puisse traverser [e matériau
.
î
et s'enfoncer dans un matériau souple, un
sandwich de cartons ou du tiège par exemple.
. Avec une perforatrice.
Pour [e papier, [e carton ou [e plastique fin.
Uniquement si [e trou doit être près des bords.
. Avec des emporte-pièces
+ plaque martyre + marteau.
Permet de percer n'importe
où dans te matériau.
. Avec une perceuse-visseuse
es forêts avec embout spécifique.
À réserver pour [e bois
et les cartons épais.
tE
.
.
'
Pour facititer [e traçage,
iI est préférable d'utiliser
un
matériau assez rigide et ayant
une certaine épaisseur.
Les intercalaires en plastique
épais sont faciles à découper,
ont une rigidité et une épaisseur
suffisantes pour guider [e crayon.
De plus, ils sont [avables.
A [a rentrée, ils sont beaucoup
moins chers.
.
LA TABLE DOIT
Êrne pnorÉeÉr
.
Planche
à découper.
MATÉRIATJ
DolT ÊTRE FxÉ
Au ruban adhésif
double-face.
Avec de la pâte
à modeler.
Avec un serre-joint.
.
prennent en compte les
ioints. L est donc un peu
ptus petit que 2P et P un
peu plus petit que zH.
Les références des
outils cités
se trouvent page zB7.
Sciences à vivre
5
er DES oBJETS
ouvRAGES AUToUR DU vlvANT, DE LA MATIÈne
!
t *r,- ,'
6
q9
\
§,
Mes premières
découvertes
@t
-
/-:
Gattimard ieunesse
@
Mes P'tits Docs
Maxidoc
5téphanie
. 9€
Une collection incontournable
de documentaires avec volets
@@
@@
r.6, 6
1Y;16p
.
O Milan jeunesse
. Entre 8,9o€ et 9,9o€
Des documentaires géants avec
des textes simptes et accessibtes
aux étèves de maternetle.
7,4o€
Une cotlection de documentaires aux pages gtacées
i
n
déchirabtes.
transparents.
Qu'y a-t-iI là-dedans?
Alex Barrow et Mathitde Nivet
O Bayard jeunesse.zor3. r3,5o€
Un documentaire présentant
['intérieur des corps des
plantes, des machines, des
bâtiments.
I
t
I
I
@@
@@@
Dokéo, je comprends
comment ça marche
Ma première boîte
à outils
Cécite lugla @ Nathan jeunesse
.
.
zor4
74,90€
Un documentaire qui répond en
illustrations à des questions sur
les objets du quotidien.
rii
I
I
i:.
6à 6à
q9§,
Drôte d'engin pour
[entin
Avant-après
Anne-Margot Ramstein
@ ALbin Michet . 2013.
Va
Géraldine Elschner et Rémi SaiItard
@ L'élan vert . 2013 . t4,2o€
Anne-Sophie Baumann et Virginie
craire O Tourbitton
-.:
. zot4. t3,99€
Un atbum animé très sotide
dans Iequel [e [ecteur manipule
les outits des grandes opérations de fabrication.
Ce
79,5o
€
très beI imagier met en
Léon petit berger conçoit et
réalise un engin pour Vatentin
regard des étêments (avant) et
leurs évolutions ou régressions
petit mouton qui rétrécit quand
(après).
il pteut.
VIDÉOS ET APPLICATIONS AUTOUR DU VIVANT, DE LA MATIÈNE ET DES OBJETS
Eijl-
@@@
@@
@
Le site.tv
France TV êducation
http://www.lesite.tv/videotheque/r6-of freetablissementh-ecoIe/zoz-decouvrirIe-monde-
http://ed
sciences_2/86-materne[[e
rents suiets, scientifiques ou non.
Des vidéos accessibtes aux élèves de
maternelle. L'étabtissement doit s'abonner:
tarif seton [e nombre d'élèves.
u
cation.fra
n
cetv. fr/deco uverte-des-sciences/
Des vidêos et des leux en [igne sur diffé-
Mon encyclopédie interactive
Dokéo
Apple et Android O Nathan Jeunesse o 3,59€ les ro
fiches d'un domaine ou 74,99€ ['ensemble
Des fiches interactives incitant t'êtève à ta
curiosité. Des zooms pour en savoir plus
ainsi que des ieux pour se tester.
l
LE VIV NT
'Êt
l'r
Dossier hygiène et santé
Notions pour ['enseignant
Trucs et astuces
t6
rB
20
Le schêma corporel
Contours et sithouettes
Le déplacement de ['enfant
Le corps articulé
22
24
27
Les cinq sens
Le toucher
Le goût
3o
L'odorat
l6
L'o uTe
3B
41
La vue
Les organes des sens
44
Ouvrages autour du schêma corporel et des cinq sens
r+6
Les notions abordées
. L'hygiène
. La visite médicale
o La construction du schéma corpore[:
les membres, les articulations
et tes capacités motrices
. La prise de conscience des sensations
associées à chacun des cinq sens
. L'utilisation à bon escient de ses sens
dans des situations ponctuelles
. La découverte du monde, des ob.iets
à travers un sens isolé
. Le lien entre [e sens et I'organe correspondant
Do
ie
gr
ne est capitaI pour contribuer au dévetoppement physique et inte[[ectue[ du corps de ['enfant. Si les premières
; retèvent de ['éducation parentale, ['école s'assure que les élèves connaissent les principates mesures d'hygiène
té. La tâche n'est pas aisée car [e vécu repose essentiel[ement sur des moments familiaux.
rette, iI est difficite de traiter ce domaine sous forme de démarche d'investigation. Les apprentissages reposent
ement sur des séances de langage, à partir de situations ou de supports qui s'appuient sur [e vécu de l'é[ève:
rituels, albums, photographies, illustrations, ieux. Pour vous munir de supports [angagiers, des ieux de Memory
rtes-images sont présents dans [e DVD-Rom et [e coffret.
L'HYGIÈNE DU CORPS: SE LAVER QUOI ET QUAND
?
@@
@@@
Des photos permettant aux étèves
de nommer et d'expliquer les usages
des objets de [a satle de bains.
Des iltustrations permettant de répondre
sCÈ
es
ffre
à
ta question: queltes parties du corps faut-iI
se laver?
tion
Des ittustrations permettant de répondre
à [a question: quand faut-iI se laver les
mains?
Le pigeon
a besoin
d'un bon
.In!
&rê
@@
ins
@@
@@@
Lili se brosse [es dents
Kim Fupz Aakeson et Siri Melchior
Petit tigre ne veut pas prendre son bain.
ll va iouer avec ses amis animaux dont les
parents [ui disent tous d'aller prendre son
bain. Rien n'y fait !
O Gutf Stream éditeur. zor3
.
8,5o€
Liti est grande, eIte sait se brosser Ies
dents. C'est ce que nous dit [e texte. Les
Un album très drôle dans lequeI un pigeou
très sate ne voit pas t'intérêt de prendre u
bain... jusqu'au moment où iI en prend un.
iltustrations nous montrent autre chose.
LE SOMMEIL: POURQUOI JE DOIS DORMIR
?
passage comple
Hormis [e moment de [a sieste, [e sommeiI ne constitue pas un vécu commun partagé à t'écote. l]entrée dans [e sommeil est un
ptus
subtite.
qui
approche
une
nêcessitent
et
d'interrogations
peut
d'émotions
entravée
être
[a traversée de la nuit
I Exploiter des atbums permet d'évoquer ce qui se passe quand on dort, d'extérioriser ses appréhensions, de partager ses rituets.
@
@@@
Dis,
Tom ne veut pas dormir
Marie-Atine Bawin O Mango ieunesse o 2612 o
5€
Tom ne veut pas dormir. Pour gagner du
temps, tous Ies moyens sont bons... iusqu'à
ce que maman se fâche.
tu dors?
UALIMENTATION : POURQUOI JE DOIS MANGER AUSSI DES ALIMENTS QUI NE ME FONT PAS PLAISIR ?
-: :'rcoTe, ['école n'a pas beaucoup de prise. Etle ne doit pas juger les
--.s préparés par les parents au risque de blesser les étèves. lJâge de
. -aternelle est celui où les fruits et légumes sont peu appréciés, les
> Valoriser les goûters à base de pain en organisant une journée sur
:
'
>
-.:rs étant essentiellement composés de gâteaux et de
friandises.
-3aniser des cotlations de fruits ou de légumes sous forme d'ate.'> sensoriels, toucher les atiments, les redécouvrir, les sentir, les
.: -:er prêsentés en petits morceaux, réaliser des recettes... lleffet ne
::': pas immédiat, mais [a valorisation et la dégustation en groupes
:.-rettra à certains de découvrir de nouveaux aliments.
-
ce thème avec les parents, prêparer des toasts avec toutes sortes de
pains et de garnitures sucrées ou salées.
Exptiguer les bienfaits des atiments que l'adulte demande de manger,
rappeler [es conseils que [e pédiatre et les parents ont certainement
déjà donnés.
A MALADIE: QUE SE PASSE-T-IL DANS MON CORPS?
:
-:.our en classe d'un êlève malade est l'occasion de [e faire parler de ce qu'iI a ressenti. Découvrir des atbums qui partent de la maladie
.--et
de structurer les souvenirs, de mettre des mots sur des sensations et des émotions.
Ricn qu'rurc petite grippel
@@@
=o@
','Jnsieur Scarlatine
:- : ::::ut O Gulf Stream éditeur . 2011. 9,5o €
Honsieur Scartatine est un vilain microbe.
-r ver dodu passe, et hopl Monsieur Scar,atine est avaté. Le ver se sent malade...
Atchoum
Stronk Cally O Nord Sud
@@
.
2011
Rien qu'une petite grippe!
. 8,5o€
Auiourd'hui, petit tapin reste au lit!
lI est malade, tout raplapta et...
Atchoum! ll éternue à tout va.
Didier Dufresne et Armelle Modéré
@ L'école des loislrs . 2oo3. 17,70€
Diego a [a grippe. Le médecin vient l'ausculter et lui prescrit des médicaments.
LA VISITE MÉDICALE: QUE VA-T-ON ME FAIRE ?
-i ..e médicale organisêe par le médecin scolaire est l'occasion d'aborder le sujet.
--'.: avoir joué au jeu de Memory du médecin ou découvert ['album ci-dessous, les étèves peuvent réinvestir
, -=.ri-ci dispose d'une maltette avec des objets médicaux.
@@
n Méd^ecin.
l,'_
: _or.v
lî et coflrel O ACCES
-.:
-
Editions
.
@@
Les Petits Cæurs aussi vont chez
2015
)es photos des objets utitisées chez [e
:édecin: une paire gagnante est consti:-rée de [a carte instrument et de la carte
:ù [e médecin ausculte un étève avec cet
'-strum ent.
ce qu'ils ont appris au coin jeu
le docteur
Géraldine CoLlet et Rolland Garrigue
O P'titGlénat. zoro. ro€
Les Petits Cceurs explorent une
sa
d'attente pteine d'inconnus.
monsieur
Un
Mes P'tits Docs: chez [e docteur
.
Stéphanie Ledu et Catherine Brus
@ Mitan
2oo5 . 7,4o€
Ce documentaire aux pages indêchirables
lte
présente [e docteur des enfants: [e pédiatre.
en blouse blanche arrive.
Le corps de
t'enfant
1/
> Voici ['évolution
Le schéma corporel
> La découverte du monde et des autres
passe par ce[[e de soi et de son schéma
des représentations
du
bonhomme.
Les perceptions sensorielles
> lhomme a cinq sens: la vue, l'ouïe, ['odo-
corporet. Seton Hêtène Brochard, [e srhêma
corpore[ est une perception que chacun a
de son propre corps, de ses différentes parties, de sa position par rapport à [a verticale
ou à ['horizontate, de ses mouvements.
rat, [e goût, [e toucher.
> À chaque sens correspond un organe précis
appe[é organe des sens: t'æit, l'oreille, te
nez, [a langue, [a peau.
> Grâce à ces organes, nos sens nous permettent de saisir les odeurs, les goûts, les
températures, les bruits, la Iumière et de
réagir pour nous protéger des dangers qui
> Le schéma corpore[ renvoie à l'image du
corps. lI permet progressivement à l'étève
de prendre conscience de son corps et de
ptace qu'il occupe dans t'espace.
> llimage
de ce corps
commence
à
[a
se
Réalisme fortuit
Bonhomme têtard
construire après [a naissance. ll se structure par ['apprentissage et ['expérience. Les
informations sont multiples: sensorie[les,
tactiles, visuelles, kinesthésiques, vestibu[aires.
> Cette notion de schéma corporel est comptexe. C'est un sujet d'étude pour [a neurobiologie, [a psychanalyse, les neurosciences,
l'ergothérapie et Ia psychomotricité.
> llécole maternette propose de nombreuses
séquences d'apprentissage pour permettre
à ses jeunes élèves de construire leur schéma corporel. Le corps se vit, s'explore à travers [a motricité et les cinq sens. Le [angage
contribue à sa structuration, les activités
graphiques n'étant pas les seules composantes des apprentissages. llenseignant
est témoin de cette progression: il observe
l'évotution des dessins du bonhomme, re-
présentation qu'a l'étève de son propre
corps à un moment donné.
> Attention, l'étève donne au psychomotricien
des informations sur le degré d'évotution
de son schéma corporel. Si [es dessins
d'étève représentent une activité importante à ['écote materneIte, ['enseignant n'a
pas les compétences pour les anatyser ou
se livrer à des tests du bonhomme. Tous les
enfants du monde reproduisent ces mêmes
dessins! Pour Varenka et Olivier Marc, its
retraceraient à [a fois l'histoire de ['enfant,
mémoire du fcetus intra-utérin, de t'æuf fécondé à ['enfant à naître et égatement ['his-
toire de l'évolution de ['homme, des
nous entourent.
> Chaque organe dispose de récepteurs sensoriels qui permettent de transmettre un
stimulus extérieur au système nerveux,
constitué des nerfs, de [a moetle êpinière
et du cerveau. Cetui-ci décode les informations sensorielles et les transforme en perceptions qui permettent de réagir au monde
qui nous entoure.
Le toucher
> Le toucher se fait par ['intermêdiaire de récepteurs qui se trouvent sous notre peau,
dans [e derme. lls
sont
inégatement répar-
tis et leur densité est bien ptus importante
sur [e bout de nos doigts et sur nos lèvres.
Têtard enrichi
Bonhomme complet
L'odorat
> fotfaction ou odorat est le sens qui permet d'analyser tes substances chimiques
votatites de l'air. ll reste encore notre sens
le plus mystérieux même s'i[ est largement
moins développé que celui de [a ptupart
des animaux. C'est un sens qui se fatigue
rapidement, ce qui explique que ['odeur
dans une pièce n'est plus ressentie au bout
d'un moment.
i-
Bonhomme habil[é
pre-
mières bactéries à ['homo sapiens...
Ce qui peut poser problème
> Si [e corps ne doit pas être tabou, [a pudeur de chacun doit être respectée. Les
situations de contact doivent être cadrées. Nous proposons des jeux à deux avec
un éLève qui a un contact physique avec le corps de l'autre. L'enseignant étabtlt des
règtes: on ne fait pas ma[ et on ne met pas I'autre mal à t'aise.
€
Les cinq sens
> Les substances volatiles contenues dans
['air passent par les narines et stimulent les
récepteurs otfactifs. En gagnant [e cerveau,
['influx entre en contact avec des zones dévotues aux émotions et à [a mémoire. Ainsi,
une simpte odeur peut engendrer une êmotion, faire resurgir un souvenir.
goût
Le
s
L'oui'e
À sa surface, ta tangue est composée de nom-
breux organes sensoriels appelés popilles.
s Les bourgeons du goût se trouvent
dans
ces papittes. lls contiennent des récepteurs
gustatifs qui permettent de discerner les
cinq saveurs fondamentales actuettement
> Iloreitte est ['organe qui permet de percevoir les sons. Sa partie visibte, le pavitlon, concentre
[e son vers le conduit auditif et jusqu'au tympan. Cette membrane transmet la vibration à
une chaîne de trois osselets: le marteau, I'enclume et l'étrier. Ce dernier appuie sur une
membrane refermant ['oreilte interne et qui transmet [a vibration au [iquide contenu dans [e
limaçon, où ['information est transmise au cerveau via [e nerf auditif.
identifiées: le sucré, le salé, I'acide, ['amer
et ['umami, dernière saveur de base identifiée en r9o8 pour décrire la saveur des glutamates. Certains chercheurs décrivent une
sixième saveur correspondant à la réglisse
et réftéchissent à une septième saveur pour
le gras.
> \ ces cinq saveurs primaires, iI faut ajouter
ls de chaque dégustation
. Les arômes qui résuttent de ['excitation
des récepteurs olfactifs du nez par tes
mo[êcutes dégagées par les atiments ingérés. Tout [e monde a déjà pu constater
:ue le nez bouché réduit
- ent
.
.
Osselets: marteau,
enclume, étrier
Nerfs auditifs
Conduit
auditif
Trompe d'Eustache
Tympan
i
considérable-
[e goût des aliments.
Oreille externe
Les sensations trigéminales à savoir:
le piquant qui vient de ['actlvation par des
composants du poivre ou du piment des
récepteurs à [a douteur.
- [a fraicheur qui vient de l'activation des
-écepteurs du froid de la bouche par les
ro[écutes de menthols et certains sucres.
.t'astringence qui est provoquêe par ['ac-
.ivation des récepteurs tactites de la
:ouche qui resserre les tissus sous ['effet
:ar exemple des tanins contenus dans [e
Orerlle
moyenne
Oreil e interne
La vue
> [ceil est l'organe de la vue. La lumière passe par la cornée transparente puis par ta pupilte,
qui se rétrécit quand il y a beaucoup de lumière et se dilate quand il y en a peu. Le cristallin
modifie ensuite sa courbure en fonction de [a distance de t'oblet observé pour obtenir une
image nette, réceptionnée par la rétine, où se trouvent les cellules visuetles, les cônes pour La
vision des couteurs et les bâtonnets pour la vision en niveau de gris. Iinformation est ensuite
transmise au cerveau par l'intermédiaire du nerf optique.
.,1
' ..
'
:
.Jtres sens, vue (pour ['anticipation) et
rouT [e croquant) participent égale. : La construction du goût.
-: : oppement du goût est très cutturet,
, ,-,rendant des habitudes atimentaires.
, - .ommence chez [e fætus qui reçoit les
..:.r,.t
'
=
Pupi[[e
Lornee
/
des aliments consommés par sa
':let de l'amer est considéré
comme un
. -.risme de survie pour ['espèce humaine,
nombreux poisons sont amers. Cette
-.'.ion aurait pour rôte de protéger l'être
--.in et relève du réflexe.
.' ::
,
le qui peut poser problème
'
'
--= prentière approche des cinq sens en maternetle peut sembler anodine, voire simptiste. Or, on s'aperçoit vite de
[a com-
=rité des situations car chez les é[èves, les cinq sens interfèrent sans cesse Ies uns avec les autres. L'utilisation des sens
,-'ait le ptus souvent de manière inconsciente. Les perceptions sont parfois subjectives et varient cl'un éLève à un autre.
I - - r découvrir L'étendue des perceptions sensorieltes à [a maternelte, iL est souvent indispensabte cle
supprimer ta perception
.- ette qui est prédotninante. Ce n'est pas facile car certains élèves ne supportent pas qu'on [eur bancle les yeux. ll est alors
-=iérable d'utiliser un dispositif pour cacher I'objet, comme la boîte
à toucher, pour découvrir cet objet autrement que par Ia
Le vivant Le corps de ['enFant
Comment
organiser
des ateliers
sensoriels ?
lI est ptus efficace et motivant de commencer par traiter
les cinq sens ensemble. Pour votre organisation, inviter
les parents à diriger un atetier, tout comme its sont invités
pour les ateliers de cuisine. Chaque parent dirige un
atelier différent et [a classe fait [a rotation des atetiers sur
[a journée'
Récupérer un carton et y découper au
cutter deux trous d'environ dix centimètres de diamètre. Agrafer sur [e pour-
tour de chacun des trous une chaussette
assez [ongue dont les pieds ont'été
découpés pour faire des manchons. Découper Ia face opposée à celte des trous
pour ptacer facilement les différents obiets ou prendre une boîte avec couvercle
pour pouvoir ['ouvrir facitement. Peindre
et décorer [e carton.
lmprimer les [unettes proposées dans [e DVDRom au format A3, les découper et placer des
morceaux de plastique transparent de couleur.
Les intercataires de ctasseur ou les chemises
en plastique fonctionnent égatement. Préparer
des [unettes avec un seu[ æil découpé, pour
l'æit gauche et pour l'æit droit, des lunettes
avec d'autres tai[[es d'ouverture. Utitiser un
papier cartonné suffisamment fort pour que les
lunettes ne cassent Pas trop vite.
20
Mou
Coussin, plusieurs
éponges attachées
ensemble, matérieI en
plastique mou et déformable de [a salle
de jeu...
Le parcours pieds nus offre
à ['élève [a possibitité de
marcher sur des é[éments aux
touchers très divers.
Pour réaliser ce parcours,
récupérer des morceaux de
matériaux de forme rectangulaire
de dimensions 3ox4o sur [equel
iI pourra poser ses deux pieds.
Le matérieI de sa[[e de jeu peut
égatement servir.
Dans les
ma sins
de tissu
Rugueux
réaliser
Protège-éviers placés à
I'envers pour utiliser Ies
ventouses, dos d'éponges
fixés ensemble, sets de
table en fibres tressées...
taetile pieds
Lisse
Vous pouvez éga-
Sous-main de
lement utiliser des bacs
bureau...
et les remptir de graviers,
de
coton, de morceaux d'écorce,
B
uæsxâ
Matériel de salle de
ieu à picots, pailtasson en paitte, paittasson en ptastique à
d'eau, en prévoyant une serviette
après [e bac. Si vous n'êtes pas trop
maniaque, remplissez-[es de semoule,
ça ptaît beaucoup aux étèves mais i[
faudra passer le balai ensuite!Pour
limiter les satissures, placer le bac à
eau après [e bac à semoute. La
semoule tombera dans ['eau
et moins ai[[eurs.
CORPOR
F
=
=
lrJ
ORGANISATIONS VARIÉES
ACTIVITÉS RITU ELLES
Libre
Matériel
les albums inducteurs
ll est où ?
. zoo7. t3,7o€
Christlan Voltz O Éditions du Rouergue
Comptines et rondes
> lI existe beaucoup de comptines et de rondes dans lesquetles on fait intervenir à chaque fois une
partie du corps. En suivant la même structure, iI est facite d'inventer de nouveItes strophes pour
cibler une partie particulière.
> Exemptes de rondes: Sovez-vous planter les choux - Rond, tout rond - Dans mon chAfuou, y'o un robot
- Jean Petit gui donse.
leux de relaxation en binôme
> Un étève agit sur un autre par petit massage, tapotement... Ceta permet à t'élève passif de ressentir des parties de son corps notamment celtes auxquelles il n'a pas facitement accès, [e dos,
['arrière des cuisses.
> Ces exercices doivent évidemment être ludiques et raconter guetque chose. Cetui qui agit utilise
différents gestes avec les doigts, les mains, ceta doit toujours être agréable et respectuéux.
. Laver la petite voiture. Un élève se recroqueville en voiture et l'autre fait les gouttes d'eau,
savonne, essuie, saupoudre de pailtettes...
o Prendre une douche. L'étève est debout, «ta douche» est derrière [ui et iI procède comme pour [a
petite voiture.
o Préparer une pizza. Un êlève est atlongé sur Ie ventre. Le cuisinier pétrit ta pâte, [a roule,
[a recouvre de sauce tomate, y ptace champignons, otives...
Va-t'en Grand Monstre Vert!
Ed Ember ey O L'école des loisirs
'1996'72,2a€
Découvertes d'albums
Ddr, d -ô
Agothe
doe e.lea--LrA-.ec 5a.rAlir
O L'é.ole des 1o;t115.2se2.5,6o€
> Dans ['album llestoù 7, un bonhomme en matériaux détournés apparaît au tur et à mesure qu'un
petit bouton Ie cherche dans ['univers enfantin et poétique de Christian Vottz.
> L'atbum Vo-t'en Grand MonstreVert!fai| apparaître et disparaître les différentes parties du visage,
ce qui permet de travaitter sur ce lexique.
> Dans Agothe, [e corps d'un étève est exploré petit à petit par une fourmi. Un point de vue original
pour travailter les parties du corps.
Représentations
> Beaucoup d'activités artistiques sont possibles pour représenter Ie corps:
- en votume avec de ta pâte à modeler, des Ctippo ou d'autres jeux,
- en dessin,
- à [a peinture.
> Par contraste ou par analogie, Ia comparaison avec [a représentation du corps d'animaux d'étevage
contribue également à [a construction du schéma corporeI de t'élève.
22
Janvrer >
septembre
D
EM
I
>
JUrn
juin
-CLA55E
SALLE DE MOTRICITÉ
25 minutes
Matériel
- r grande feuilte à la taille
::s étèves, d'environ r,5om de
.c'.lgueur et o,8om de largeur
- r craie de cire
POUR UN PETII, LE CORPS EST REPRÉSENTÉ PAR UNE BoULE ET DES TRAITS. TRAcER LE CoNToUR DE cE coRPS DoIT LUI
tAtRL pRENDRE coNsc.tNct eur LLS MLMBRES o\T UNE ÉpAtsstrjR t- euL LE lRoNc coRRESpoND DAVANIAGE À uN
cYLTNDRE eu'À UNE BouLE.
Organisation
> L'enseignant constitue des binômes qui se répartissent dans [a salle de jeu. Un élève se couche sur
[a feuitte de papier [égèrement ptus grande que lui,
> Au préalabte, ['enseignant a dêcoupé une feuitte par binôme et les a disposêes dans Ia salte de jeu.
Contour ressenti par [e toucher
> L'élève accroupi fait [e contour du corps de son copain avec [a main. Cela permet à t'étève couché
de ressentir [e contour de son corps grâce au contact et à ['autre de visuatiser une silhouette.
Contour matérialisé par un tracé
> L'élève accroupi réatise [e contour du corps de son copain avec une craie en cire, pas tachante.
> Si nécessaire, I'enseignant rectifie les tracês des étèves, en général trop [oin du corps.
ATELI ER5
ENTIÈRE
15 minutes
]U]S CLASSE
30 +
Matériel
:s sithouettes de l'étape
précédente
- de [a peinture
- des routeaux
Structuration
> De retour en classe, les sithouettes de t'étape précédente sont
découpées par un adutte. Chaque élève pourra peindre [a sienne
au routeau sur de grandes tables.
> Chacun se reconnaît et découvre son corps reprêsenté à taitte
réelle. Les élèves se repositionnent à ['intérieur pour vérifier
l'exactitude des dimensions.
> lls observent [eur corps, nomment les différentes parties: [a tête,
les bras, les.iambes et [e tronc dont on se rend bien compte ici
qu'iI n'est pas rond.
Le vivant Le corps de ['enfant
F
z,
IrI
TourES LES sÉnrucEs oE motnrcrrÉ coNTRTBUENT ÉvroEnurut À LA coNsrRUcrtott ou scHÉmn coRPoREL oe r'ÉrÈvs
DÈs LoRS eu'ELLES sott exprtctrÉrs: couRtR, sAUTER, GRtMpER, RAMpER, RouLER, LANcER, ATTRAPER, vlsER, DANSER,
REMUER, oNDULER . AUTANT D'AcloNS ootr r'ÉrÈvE pREND D'AUTANT pLUS coNSctENCE LoRsQU'tL LES vERBALtSE, LoRSQU,IL oBSERVE SES PROGRÈS ET DEVIENT PLUS PERFORMANT,
LE5 RoNDES EI ]EUX cHANTÉS PERMETTENT ÉGALEMENI DE NOMMER TOUTES LES PARTIES DU CORPS APRES LES AVOIR
MOB LISEES.
LT copps ST V,T, SE oARLI:
sENTATToN qu'ru n r'ÉrÈve
IT
DESSIN DU BoNHoMMI NE CONSTPLI- PAS LE SCHEMA CORPOPTI MAIS MON-RE LA RTPPÉ.
LA sEeuLN(L À vil\'R ES- uN MoMt \T DANS volRE pRoGpaMMATtoN DE MorRr.r-a ET \E sE IARûut ÈvtDtMME\- PAS
o'Êrne r'uru euE MoMENT où oN pREND coNsctENCE DES cAPAclrES MorRlcES DE soN coRPS
VoUS AVEZ pnÉvu oe TRAITER LE cHAPITRE DE LA LocoMoTIoN CHEZ LES ANIMAUX, PRATIQUER CES ETAPES EN PA.
ou EN DtFFÉRÉ pERMETTRA nux ÉrÈves DE coMpARER LEURs DÉpLACEMErurs À crux DES ANtMAUx ou DE FAIRE
uLtÉnrrunenEur DES RAppRocHEMEurs (voin PtGEoN voLE encrs 58 À 63).
S
RALLÈLE
CLASSE ENTIÈRE
SALLE DE MOTRICITÉ
25 minutes
-r
Matériel
CD du CarnavaI des animaux
de Camille Saint-Saëns
Situation inductrice
> Au préatabte, les étèves ont découvert Le carnavol des onimaux de Camitte Saint-Saëns et vont en
satte de leu pour imiter des déptacements d'anlmaux.
Consigne
> Choisissez un onimol et déplacez-vous comme lui dons lo solle de ieu. Recommencez en imitont
d'outres onimoux!
> Laisser un temps pour qu'un maximum de déplacements aient été mimés. Relancer en vatorisant
certains mimes pour inviter [es autres élèves à changer de déptacement.
Questionnement
> Et vous, comment orrivez-vous à vous déplocet ?
> llenseignant [aisse [es étèves chercher Ieurs possibilités motrices. ll Ies rassembte pour une mise
en commun: les élèves montrent et verbalisent. Évidemment it faudra faire un tri parmi les fantaisies retevant ptus de [a danse pour cibter Ies déptacements réatistes.
> Le recentrage «qu'est-ce que tu foîs dans la cour, dons lo solle de jeu, dehors dans la rue, dons lo
noture?...r, permet d'éliminer et d'identifier des déptacements qu'ils ne pratiquent pas.
Conclusions
> Les étèves ont explicité [es déptacements suivants: sauter, grimper, ramper, marcher, courir.
24
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
20 minutes
:
Matériet
r-:.nmes des déplacements
-,.érieI
page 61 et DVD-Rom)
Verbalisation, catégorisation et répertoire des déplacements
> De retour en ctasse, ['enseignant demande à ses élèves de lui citer à nouveau [es déptacements
réalisés dans [a salte de jeu. Au fur et à mesure, ['enseignant présente les pictogrammes des
déptacements (matériet page 6r) et les explique . Cette corte veut dire souter, morcher, courir...
Discussion autour des déplacements NAGER et VOLER
> ll me reste deux cortes de déplocement dont vous ne m'ovez pos porlé. Certains onimoux arrivent à se
déplocer de cette foçon, de quels déplocements s'ogit-il ?
> L'enseignant donne des indices pour permettre à ses étèves de trouver nager el voler.
> Et vous, orrîvez-vous à voler, à noger ?
> Les étèves prennent conscience qu'ils ne sauront jamais voter avec [eur corps.
Hiérarchisation des déplacements et conclusion
> L'enseignant aide [es étèves à prendre conscience de leurs capacités motrices et à hiérarchiser les
déplacements selon [eur fréquence: Quels déplocements fois-tu le plus souvent, quelquefois? euel
déplocement dois-tu encore opprendre ? Quel déplocement ne souros-tu iomois foire ?
o 1e sais marcher, courir, grimper, sauter, ramper. Bientôt
le saurai nager sans bouée, mais.je ne
saurai jamais voler.
I:ELIER DIRIGÉ DE LANGAGE
DE6À8ÉlÈvEs
2o minutes
MatérieI
-.-,=s-images 4: déplacement
-= é[ève (DVD-Rom et coffret)
- pictogrammes
-..ériel
des déplacements
page 6r et DVD-Rom)
> L'enseignant pose les cartes-images face retournée sur la table (cartes-images 4
DVD-Rom et coffret). Les pictogrammes des déplacements sont également posés sur ta table mais face visible.
> Retournez une corte, dites ce que vous voyez, et cherchez lo carte des déplocements qui correspond.
> Chacun retourne une carte et verbatise ce qu'iI voili c'est une petite fille, elle noge.
> Un étève prend le bon pictogramme et l'associe à sa photo. Les autres vatident ou non la réponse.
Prolongement pour associer les organes au déplacement
> On vo réfléchir pour trouver ovec quelle partie du corps on peut marcher, courir, souter...
> Les étèves proposent leurs réponses. L'enseignant intervient pour faire amêliorer les réponses.
Conclusion
^*..?*t" ?* ** N* y N*
.fu
u.iy,Nilk
f.y",
0 I
oA
. a
..lên ^n,*At^o}*
Jou\ hJJ/-.qver;
.?**
0,
toiJE
-o.Tt^.
.)" yPÀ,o.
eL m,,>
.Wm
mntnt», r\,et,
.a
f*
eL r."et» yæÀ,5
ACTIVITÉ INDIVIDUELLE
25 minutes
Matériel
-r photocopie par étève
- - -Jment page 26 et DVD-Rom)
- ciseaux et colle
Trace écrite individuelte
> L'étève décrit les illustrations et nomme à nouveau [e dêplacement associé à chaque pictogramme.
> Colle l'étiquette des déplacements ô côté de l'illustrotion correspondonte.
Le vivant Le corps de
l'enfant -:l§
Associer un déplacement à son codage.
€
Cotte t'étiquette des déptacements à côté de ['i[lustration correspondante.
o
E
o
J
o
l,
|n
t(ÿ
L
F
o
|,
o
(É
ô-
,=
rÉ
.uE
@o
_IT
f
l
I
I
L
L
L
-r
-I
I
'^
II
$i
I
.,,
-..]
I
I
I
_.1
LE CORPS DE I.'ENFANT
F
-
@
@
lrl
J
L
ARTICULÉ
conscience de ses
I
et de leurs
ACTIVITÉS RITUELLES
2() minutes
T"riu:ii
lmprégnation de comptines sur le schéma corporel
> Les étèves connaissent des comptines dansées, teltes que Jeon petit qui donse, Savez-vous plonter
des choux... En regroupement ou en motricité, t'enseignant tes modifie pour faire intervenir les
épaules, les coudes, [es poignets, le cou, res hanches, les genoux, les chevilles.
Jacques a dit
> jouer
à Jocques a
dit permet de réinvestir
[e vocabulaire, mais également
tion en relation avec les articulations.
> Jocgues a dit: plie tes coudes, tourne les poignets, bolonce
d'utiliser un verbe
tes honches, penche
un rond ovec tes bros, monte tes épaules...
ornrcÉ
or
lo
tête en
d,ac-
orrière, fais
LANGAGE
oE6À8Ér-Èves
zo minutes
Matériel
annequin articu[ê en bois
Situation déclenchante
> L'enseignant a apporté un mannequin articuté en
bois et laisse Ies é[èves le maniputer librement.
Verbalisation et constatations
> Chaque étève présente aux autres une attitude
du mannequin. L'enseignant fait nommer les articutations manipulées. Les autres élèves imitent
la posture du mannequin.
> Certains ont remarqué que ['on ne peut pas faire
ptier les bras et les jambes du mannequin dans
les deux sens. Les autres se rendent compte qu,ils
n'arrivent pas non plus à te faire avec leur corps.
Elargissement de la recherche
> À partir de ces constatations, l,enseignant incite ses étèves à alter ptus [oin.
r
> Cherchez les mouvem1nts possibles et impossibles
les genoux,
faire ovec les coudes, les poignets,
ne pas vous foire mol.
> Les étèves explorent [eurs capacités motrices. lls se mettent évidemment debout à t,intérieur du
coin regroupement pour avoir de ta ptace pour se mouvoir, ils échangent tibrement entre eux. puis
chacun vient faire part de ses observations.
à
les chevilles, les honches et le cou. Bougez lentement pour
Observations, constatations et conclusions
, n, U" k"^rÀ"" "t ?*» J-*l!-o a^r.»
lnr»vnart
urv trsttb, ou, d,o.,rL,o, L:"rt.-.
y@^Jrt ù:n n b" rln hrp*, ),o ræ. poJr& ÿ))ù
u
lJ' "f 0
I
?n
en
I
Le vivant Le corps de ['enfant
CLASSE ENTIÈRE
SALLE DE MOTRICITÉ
20 minutes à renouveler
lnitiation au yoga
> Les séances de yoga se pratiquent dans
Matériel
le livre-CD inducteur
Mon oremier livre de Yooo
Gilles Diederlchs et IVlarlon Bliiet
O Nathan . 2oo9.15€
- r tapis par élève
[e
catme, avec quelques rituels à instaurer: disposer les tapis en cercte, se mettre en chaussettes
pour être à ['aise, s'asseoir en petit yogi entre
chaque posture, réveitter [e corps en le massant
avec des papouilles.
> L'enseignant expticite les bienfaits du yoga:
être soupte comme les animaux du livre, être
calme pour se sentir bien, être fort pour tenir en
êquitibre.
> De séance en séance, les étèves dêcouvrent de
nouveltes postures. Le CD indique tout ce qu'iI y
a à réatiser, les musiques ou chansons maintiennent un ctimat de concentration accrocheur.
Verbalisation
> À ta fin de [a séance, tes élèves verbatisent ce qu'its ont réalisé.
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8ÉLÈves
30 minutes
Matériel
* Par élève:
des membres du
pantin sur un papier [égèrement
cartonné (matérieL page 29
-
r photocopie
et DVD-Rom)
-r
- crSeaux
aiguilte de piquage
- 12 attaches parisiennes
- sandwich de cartons
Présentation et fabrication
> Les élèves observent [a photocopie et essaient de deviner ce dont it s'agit (matériet page 29 et
DVD-Rom).
> L'enseignant exptique t'objectif et [e déroutement.
>
Vous ollez fobriquer un pontin en popier, gui pourro s'articuler comme le pontin en bois.
> Découpez la tête, le tronc et les membres du corps.
> Percez choque trou ovec I'oiguille de piquage.
> Reconstituez le corps du pantin.
> Superposez les trous correspondonts oux orticulotions et enfilez I'attache porisienne.
Utilisation
> Lorsque le pantin est réatisé, les êlèves [e maniputent et forment différentes postures.
ACTIVITÉ INDIVIDUELLE
20 minutes
Matériel
- r photocopie d'un pantln
en paprer
- crayon de papier
- bandeletLes de papier pour écrire
les mots modètes
> Au préalable, [es êlèves ont nommé les articutations du pantin à ['enseignant. ll les a écrites sur
des modèles à disposition des élèves. lI réalise rapidement à côté de chaque mot un dessin pour
permettre à ses élèves d'identifier chaque mot en autonomie.
Consigne
> Écris le nom des articulotions du corps et trace une flèche pour lo relier à I'illustrotion.
> Les étèves annotent leur photocopie du pantin en écrivant les noms des principates articulations.
PROLONGEMENT
> Des pistes d'activité autour de Keith Haring sont proposées dans ['ouvrage Hors-d'æuvre d'arts de
Patrick Straub chez ACCÈS Éditions.
28
Le vivant Le corps de t'enfant
§§
tE5
CINQ
SENS
F
=
lr|
J
ATELIER DIRIGE
DE6À8ÉlÈvrs
purs À L'eccuett
r5 minutes
Matériel
- 8 petits sacs en t ssL
fin contenant chacun:
-rclé
-
-3
r
bitle
- z bitles
bittes ou ptus selon [e niveau
- r paire de ciseaux
-
-r
CtiPPo
1 petite voilure
-rdéàjouer
Questionnement
> À quoi nous servent nos moins? À attroper, à manger, à faire les marionnettes, à peindre...
> pour t'êtève, [a main est engagée dans I'action et it n'explicite que peu son rôle dans [a perception.
Activité de découverte
> llenseignant propose d'utiliser ses mains autrement et pose les petits sacs sur [a table.
> Voici des petits sacs ovec un obiet coché à ?intérieur. À vous de me dire ce qu'il y o dedans sons
ouvrir le sac.
> Les élèves palpent spontanément et s'échangent
les sacs.
Verbalisation
> lts proposent, nomment, contestent et valident
le contenu de chaque sac.
Conclusion
> À quoi ont servi vos moins
ce
?
À toucher pour savoir
qu'il y a à l'intérieur des socs.
ATELIER DIRIGE
DE6À8ÉlÈvrs
PUIS À L'ACCUEIL
30 minutes
Matériel
*rboîteàtoucher
*
Présentation du matériel
> L'enseignant montre et fait nommer les objets sélectionnés. lI exptique l'utitisation de ta boîte à
toucher.
> Plongez vos moins dons les trous, touchez l'obiet et dites-moi ce que vous ressentez.
Des objets durs et mous:
- pâte à modeler
- cube en bois
- balle en mousse
-bitle
*
Des objets piquants et doux:
- brosse à cheveux
- cure'dent
- fourchette
-Ptume
- coton
- Fausse fourrure
)k
*
Des objets Iisses et rugueux:
- savon
- cuittère à soupe
- CliPPo
- caittou avec asPérités
- gatet [isse
-éponge à récurer
Des échantiltons de malières
pour le classement
Verbalisation
> Chacun passe à tour de rôte. lJenseignant choisit les oblets pour faire anatyser des sensations
contraires et ptace dans l'ordre suivant: un objet qui pique, un oblet doux, un obiet mou, un objet
dur, un oblet rugueux, un obiet [isse.
> Un oblet [isse est souvent ressenti comme doux. La diffêrence entre piquant et rugueux est difficite
à percevoir. Avec des PS, quatre sensations suffisent: dur, mou, piquant et doux.
Verbatisation et classement
> Les étèves nomment les sensations ressenties et regroupent [es obiets seton les sensations. fenseignant [aisse Ies discussions s'engager et encourage ses étèves à justifier Ieurs choix.
> Pour les matières que les étèves ont du mat à quatifier, les inciter à utitiser [a joue pour mieux en
ressentir l'effet tactile.
> En MS ou en GS, ['enseignant aioute un ctassement où apparaît [a notion de contraire.
3o
@ @ (ô
:1--:
""pt".bre>
juin
DEIVII-CLASSE
DE MOTRICITÉ
:5 minutes à renouveler
> Les étèves sont pieds nus.
Matériel
-sarcours pieds nus
-:-quette d'eau iroide
' :i'ouette d'eau tiède
- 1 serviette
> Posez les deux pieds sur chaque topis et observez ce que vous ressentez. Avoncez de tapis en topis.
Premier passage
> Dans un premier temps, [es étèves découvrent [e parcours. Lorsqu'its ont fini, l'enseignant les
invite à s'exprimer de façon spontanée: ici c'est doux, là ça pique, là-bos ço me chatouille.
Deuxième passage
> L'enseignant choisit quelques étèves et [eur précise où se placer: ollezà unendroitoùc'estdoux.
Les étèves se placent chacun sur un tapis doux
Troisième passage
> Pour ce passage, ['enseignant a supprimé les bassines d'eau. lt constitue des binômes: un étève
a [es yeux bandés et un autre ['emmène doucement par [e bras sur différents tapis. À chaque fois,
['élève avec les yeux bandés exprime son ressenti à son copain : là, ço pique!
CLASSE ENTIÈRE
SALLE DE MOTRICITÉ
20 minutes
*
-
Matériel
Par binôme:
- r tapis
r ptume
r petite balle
r boule de coton
r boule de papier
Présentation de I'activité
> Les étèves se regroupent en binômes et se
placent sur un tapis: un étève se couche sur le
ventre, un autre s'assoit à côté de lui. Distribuer
quatre oblets à chaque binôme.
> Touchez le dos de votre copain ovec un obiet sons
le lui montrer. Bougez I'objet sur le dos sons foire
mol. ll doit deviner ce que vous ovez choisi.
J
Verbalisation et ressentis
> Les étèves mentionnent le côté agréabte et
ludique de t'activité. Seule [a pointe de [a plume
peut piquer, les autres obiets procurent des
sensations douces ou qui chatouitlent.
Questionnement et conclusion
> Dons votre corps, qu'est-ce qui vous o permis de ressentir ce gue faisoit le copain ?
> À partir des réponses des étèves, ['enseignant oriente [e questionnement pour passer de [a réponse mondosà [a réflexion mo peau et aboutir à:
.E:"ot?^
r\.pn
I
, oal n.e yvn,eL
I
d,e rre»tsnL;n d/.»,cerrtlr;f;a+w.
Le vivant Le corps de
t'enfant È:
@@@
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8Ét-Èvgs
3o minutes
Matériei
-ptume, coton, cure-dent, éponge
Présentation du matérieI et exPloration tactile
> Les étèves touchent et nomment te matériel êparpittê sur [a tabte. llenseignant fait nommer ce qui
est connu des élèves et apporte [e vocabutaire manquant.
à
gratter, fausse fourrure,
laine vierge
- différents papiers texturés récupérés tets échantitlons papier peint
- carton ondulé
- papier de soie
- papler emery
- papier bulte
- toile cirée tisse
-protège-cahier
- feutrine
-balton de baudruche
- corde
Question nement
> Comment pourroit-on closser ces différents motérioux?
> Les étèves vont certainement proposer un classement par couleur, par usage.
> Si [e ctassement par sensation n'est pas apparu spontanément, l'enseignant demande à ses élèves
de fermer les yeux, de toucher tes matériaux et de reformuter [a question.
> Comment peut-on closser les mstérioux qusnd on o les yeux fermés ?
> On pourrait les classer comme [a dernière fois avec les objets: ceux qui sont doux, ceux qui sont
Iisses, ceux qui piquent, ceux qui grattent ou qui ont du retief.
Classement
> Les étèves rêpartissent les matériaux selon Ieur sensation tactite. Pour mieux sentir la sensation,
ils peuvent frotter ['obiet sur leur ioue.
L,ENSEIGNANT GARDE pRÉctEUSEMENT cE MATÉRIEL cLAssÉ pouR LA RÉALtsATloN DU LIVRE TACTILE DE
ATELIER DIRIGÉ
OU AUTONOME
DE6À8Ét-Èvrs
4x3o minutes pour les Ps
30 minutes pour les GS
Matériel
*
Pour le groupe:
-Les rratériaux de ['étape 5
-de la cotle btanche
*
-4 feuitles de papier
Par étève:
Canson A4
de 4 couteurs d'un carré de roxro cm
-les pl.otocopies du poussin.
crocodite, visage de bébé,
-
32
et hérisson (DVD-Rom)
r spirate pour relieuse
Présentation et fabrication
> Le projet est de réaliser un [ivre tactite de quatre pages:
. 1è'" page: doux comme un mouton, ' 3€ page: rugueux comme un crocodite,
. 2" page: piquant comme un hêrisson, o 4e page: lisse comme ma peau'
> Présenter [es matériaux, soit tous (pour les GS), soit une partie du classement à chaque étape.
> Pour chaque page, les élèves collent ['animal au centre de la feuitte
Canson. Puis its cottent autour les matériaux correspondants
(doux, piquant, rugueux ou lisse) qu'its choisissent.
> Relier [es pages avec une spirate.
> Une séquence atternative sur [e toucher est disponible dans le chapitre sur tes matériaux (Ço grotte ou Ça pique? pages 724 à rz9). Plus
axée sur les matériaux, elle consiste à créer un nid douittet pour un
animal après avoir trié des échantiltons de matière.
r'ÉrlpE sutvnlrE
LE CORPS DE t'ENFANT
L
aliments selon leur saveur
CLASSE ENTIÈRE
âPS DE COLLATION
10 minutes
MatérieI
-
r bol par
élève
r: : -r--'rn'res, de poires,
:. -.--". de clémentines
- .-. s dans chaque bo[
Situation inductrice
> L'enseignant annonce [a cotlation comme un moment de jeu.
> le vous oi préporé un goûter de fruits. Vous ollez le déguster dans I'obscurité, ce sero plus rigoto !
A votre ovis, allez-vous reconnoître ce que vous ollez monger dons le noir?
Présentation et déroulement de I'activité
> Les étèves s'assoient à table et découvrent rapidement [e contenu du bol. L'enseignant assombrit
la classe et invite les élèves à goûter. Pendant qu'ils mangent, ils vont repérer tes bruits engendrés
par les fruits croquants et être surpris par [e jus qui sort de ta ctémentine mordue à pleine dent.
> Ne pas savoir du tout ce qu'ils vont manger btoquerait beaucoup d'étèves. C'est pourquoi te fait
d'avoir observé [e contenu du boI est nêcessaire.
Verbalisation
> Les élèves racontent leur perception et nomment les fruits qu'its ont peut-être reconnus: [a pomme
et [a poire croquent, [a banane non, et [a c[émentine a du jus qui coute. Même quand il fait sombre,
on reconnaît les différents goûts.
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8Ér-ÈvEs
3o minutes
. .-. :rtes
-=-
MatérieI
de 4 couLeurs
(44q+z)
> sucrés: confiture,
- e[, chocolat blanc,
yaourt aux fruits
'::s alîments acides:
:'--= citron, cornichon,
- :es aliments salés:
- :. 'romage salé
(féta)
- ::s atiments amers:
: .. - rir
à 85 %, endive
PouR LES Ps,5E LtMtrER AUx ALTMENTs sucnÉs rr serÉs Alouren LES ALTMENTS AcTDES pouR LES MS ET LEs ALTMENTS
AMERS PouR LES GS. VÉRlFlER LEs RtsQUEs o'nLLrnctes ET LES courul\,1ES cuLTURELLES ET RELIGIEUSEs AVANT DE FATRE
GOUTER QUOI QUE CE SOIT, NOTAMMENT LE ]AMBON.
Présentation du matérie[, de t'activité
> L'enseignant lait nommer Ies différents atiments et présente la consigne. levoisvous
foire goûter choque oliment, à vous de me dire
ce que vous ressentez.
Déroulement et verbalisation
> L'enseignant fait goûter chaque échantilton.
Pour faire ressortir ['amertume du chocolat
noir, i[ [e présente après le chocolat btanc.
Pour faire ressortir l'acidité du yaourt nature, il
le fait goûter après [e yaourt aux fruits.
> Les étèves commentent leurs ressentis: c'est
bon, c'est sucré, ço pique, c'est salé, j'oime ou
pas...
Classement en fonction des quatre saveurs
> fenseignant fait poser à ses élèves les atiments sur des assiettes de couteur au fur et à mesure
qu'ils ont été caractérisés: une couteur pour les aliments sucrés, une autre pour les aliments
acides, [es atiments salés et [es aliments amers.
Le vivant Le corps de I'enfant
ATELIER DIRIGE
DE6À8Ét-Èves
zo minutes
Matériel
- jus de banane, ius de kiwi.
jus d'ananas, jus de raisin,
jus de pomme
- banane, kiwi, ananas, raisin,
pomme en petits morceaux
Présentation de t'activité
> llenseignant a entevé les étiquettes des bouteitles. ll propose à ses étèves de goûter un
morceau de fruit, de goûter chaque jus et de
retrouver de queI fruit iI provient.
Dégustation et verbalisation
> Les étèves goûtent chaque fruit et tes nomment.
L'enseignant remplit un gobelet d'un jus de
fruit: [es élèves décrivent et comparent les saveurs. lls doivent ensuite associer [e ius de fruit
au fruit déjà goûté.
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8ÉrÈvrs
20 minutes
Matériel
- 1 pot de sucre
- r pot de sel
- r pot de noix de coco râpée
- r pot de farine
- 1 pot d'amandes en poudre
34
Présentation du matériel et questionnement
> L'enseignant présente les pots sans nommer [eur contenu et précise que ce sont tous des atiments
que I'on peut manger. lI pose [a question i qu'est-ce que c'est?
> Les atiments sont tous btancs, it est difficite de les identifier visueltement. L'enseignant attend celui
qui va proposer de les goûter au préatabte pour les reconnaître et non de iouer aux devinettes.
Dégustations et identifications
> En les goûtant, tes êtèves vont reconnaître facilement [e sel, [e sucre, [a farine. La noix de coco et
['amande en poudre sont ptus comptexes à identifier et nécessitent de faire appet à des saveurs
rencontrées Iors de recettes faites en ctasse ou à la maison.
ATELIER DIRIGE DE LANGAGE
DE 4 ÉLÈVES
15 minutes
*
Matériel
par étève:
r grilte de toto (DVD)
* Pour le groupe:
:aries-images 5: loto du goût
(coffret et DVD-Rom)
-
'
Rappels des différentes saveurs
> Les élèves rappeltent [e ctassement de t'étape 2 et citent pour chaque saveur un atiment: acide
comme Ie citron...
Présentation de cette activité sous forme de jeu de loto
> L'enseignant montre et explique chaque gritte (DVD-Rom). Le nombre de gritles augmente seton [e
niveau de classe: uniquement sa[ê et sucré pour les PS, acide en plus pour les MS et amer pour
les GS.
> Voici lo grille pour placer les aliments sucrés, celle pour les oliments solés (celle pour les aliments
ocides et celle pour les oliments omers). Je vais montrer des cortes ovec un oliment, à vous de me lo
demonder si I'oliment a la saveur indiquée por votre plonche.
Déroulement du jeu
> Les quatre êlèves se répartissent [es quatre
griltes. Chacun Ia remplit avec les cartes des
aliments (cartes-images 5 DVD-Rom et coffret).
> L'enseignant présente une carte aux joueurs et
nomme l'atiment: voici lecitron!
> te prends le citron car i'oi lo grille ocide et le citron
il
tI
est acide
>
!
leu se prête à une discussion sur
la saveur de chaque aliment. Certains élèves
contestent l'attribution de cartes: non, le chocolot noir, je me roppelle, ilest amer, pas sucré !
Le temps de
Conclusion
Trace écrite individuelte
> L'enseignant peut photocopier les planches comptétêes avec les cartes correspondantes
pour constituer une trace écrite à distribuer aux élèves.
ATELIER CUISINE
3r: minutes de préparation
+ 45 minutes de cuisson
Matériet
:-:: ents et ustensiles de [a
::::.: r (DVD-Rom et coffret)
> Préparer [a pâte avec [es élèves à partir de [a recette 1 présente dans le DVD-Rom et le coffret.
> Demander l'aide de parents pour cuire une crêpe à couper en quatre ou quatre mini-crêpes par
étève. Les garnir de confiture de fraises, de jus de citron néanmoins sucré, de tarama ou de fromage salé type féta, de confiture d'oranges amères ou de chocotat noir.
> Pour comparer les saveurs, goûter chaque mini-crêpe dans ['ordre suivant: ta crêpe sa[ée, [a crêpe
acide, [a crêpe amère et la crêpe sucrée à [a confiture de fraises.
> Faire expliciter sa saveur pour chaque crêpe.
Le vivant Le corps de
l'enfant §§
LE CORPS DE t'E\FANT
LE5
CINQ
SEHS
F
=
lrl
J
CLASSE ENTIÈRE
À
cnneue occAStoN
TOUT AU LONG DE I'AruUÉC
Iibre
Matériel
- en fonction de l'occasion
> Exptoiter tes différentes activités rituettes ou liées à des projets pour rendre les êlèves ptus rêceptifs aux odeurs.
. Lors du Iavage des mains, verbatiser ['aspect agréabte et différencier [es différents savons.
. Lors de ta réalisation de recettes, [aisser un temps pour sentir tes atiments odorants ou non,
.
humer les odeurs qui sortent du four.
Lors de moments de relaxation basée sur [a respiration, vaporiser des essences de parfum et respirer,
se boucher les deux narines et constater qu'on ne sent ptus rien. Se boucher une seule narine et sentir
àmoitié, inverser et se boucher l'autre narine, dégager [e nez pour respirer et sentir pleinement.
ATELIER DIRIGE
DE6À8ÉLÈves
PUtS À ÙACCUe[
3o minutes
Matériel
9 pots contenant chacun:
- quartier d'orange
- quartier de citron
- bâton de cannelte
- lavande
- pâte à tartiner au chocolat
*
-ctous de girofle
- vlnalgre
-eau de fleur d'oranger
Présentation du matériel
> L'enseignant montre [es pots remptis. lI fait nommer ce qu'ils contiennent.
Consigne et activité
> Prenez choque pot et sentez son contenu.
> Les étèves sentent et découvrent l'odeur de chaque ingrédient. 5i nécessaire, ['enseignant intervient pour faire circuler [es pots et renommer.
Verbalisation
> ll invite [es étèves à s'exprimer sur [eurs ressentis.
> Quelles odeurs sont ogréobles pour vous
? Quelles
sont les odeurs que vous n'oimez pos
?
ACTIVITÉ DIRIGÉE EN BINôME
À I'nccuEtt5 minutes à renouveler
sur la semaine
MatérieI
-
r foulard
- 10 pots
- quartier d'orange, quartier de
citron, cardamome, lavande, pâte
à tartiner au chocotat. clous de
girofte, sauce nuoc'mâm, morceaux
de savon. vinaigre,
eau de fteur d'oranger,
36
Réinvestissement et tri
> Reprendre [a même activité mais cette fois en bandant [es yeux. L'enseignant fait sentir tes différents pots à un autre êlève qui a [es yeux bandés. Un étève remptace I'enseignant.
> Une fois qu'iI a senti Ie pot, t'élève essaie d'identifier ['odeur. lt dit si ette est agréabte ou non. lttrie
chaque pot en le ptaçant dans la catégorie des odeurs qu'il aime ou dans celle qu'il n'aime pas.
@@@
."o,",bre>
juin
ATELIER DIRIGE
DE4À6Ér-Èvrs
zo minutes
MatérieI
-Z pots transparents
-7 pots opacifiés
'
coton
,,. . :r d'orange, quartier de
-:-ramome, lavande, pâte
: -:- au chocotat, clous de
: -':, eau de fteur d'oranger
Présentation du matériel et consigne
> Les étèves nomment les ingrédients dans les pots transparents. L'enseignant leur présente les pots
opacifiés recouverts d'un peu de coton pour cacher ['atiment tout en laissant passer ['odeur: vorci
des pots masqués. À fintérieur, il y o les mêmes ingrédients que dons les premiers pots. Grôce à leur
odeur retrouve les pots qui contiennent la même chose.
Déroulement
> L'enseignant répartit Ie matériel pour deux élèves qui vont travailler simuttanément. Les autres
observent en attendant leur tour.
> Quand les élèves pensent avoir trouvé, l'enseignant ouvre [e pot pour faire voir ce qu'iI y a à t'intérieur et valider ou non [a réponse.
> lI est possibte de réatiser de ta pâte à sel parfumée
aux êpices en aioutant des ctous de girofle,
de [a cannetle ou des épices à pains d'épices dans
ta pâte à partir de [a recette 3 présente dans
te DVD-Rom et Le coffret.
Le vivant Le corps de
l'enfant
§.-*r
F
=
ul
J
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
15
minutes
Matériel
[e matérieI de [a classe
EN AMoNT, r prut Êtnr luDtctEUX o'evotn tnAvntLLÉ AVEC LES ÉrÈvrs sun LES BRUlrs QUE L'oN PEUT FAIRE AVEc sA
BoucHE, cEUX euE L'oN pEUT FATRE AVEc soN coRps. L'ÉTUDE DES BRUtrs coRPoRELS PRÉcÈDE cELLE DES BRUlrs AVEc
DES OB]ETS.
Questionnement
> Les étèves sont assis au coin regroupement, ['enseignant [eur demande. Qui peutfoire un bruitsons
utiliser so bouche, sons laire un bruit ovec son corps ?
Temps de recherche et propositions
> Cette question les laisse souvent perplexes, les premiers font un bruit avec te corps iusqu'à ce qu'un
étève se lève et propose un bruit teI que faire tomber un obiet, ou lrapper unjeu contre une tabte.
Les premiers bruits sont imités en générat puis [e reste de [a ctasse diversifie les propositions.
CLASSE ENTIÈRE
SALLE DE MOTRICITÉ
30 minutes
Matériel
- 3 ou 4 feuiltes de papiei
- z plumes
- quelques Kapta
- 2 ou 3 obiets en mousse
- I foulard
- 1 clochette
- r petit xylophone
- 3 ou 4 mouchoirs en papier
- carton onduté
- ctseaux
Présentation du matériel et de [a consigne
> Les élèves enlèvent [eurs chaussures pour être en chaussettes.
> L'enseignant divise sa classe en deux groupes: un marche, ['autre observe et écoute.
> promenez-vous dons lo solle, prenez un obiet ou sol, foites un bruit ovec cet obiet. Reposez-le et continuez. Repérez les obiets qui ne font pos de bruit.
Réalisation et verbalisation
> Au cours du passage de chaque groupe, ['enseignant demande à chacun de montrer un bruit de
son choix au groupe qui observe. Un même ob.iet peut produire ptusieurs bruits. Les étèves indiquent égatement les obiets qui ne font pas de bruit.
Questionnement et classement
> euels sont les obiets qui permettent les bruits les plus forts ou les bruits les plus doux?
> Les étèves regroupent tes objets produisant des bruits d'intensité forte, faible, moyenne. Certains
objets peuvent correspondre à ptusieurs groupes seton [e geste utitisé: faire tomber, taper, frotter,
gratter, secouer.
38
@@@
t"ot"'bre>
juin
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8Ér-Èves
puts À I'nccurt
z5 minutes
:
=.:e
Matériel
papier brouilton
:-.ell[e
rempLie d'eau
-
,i
l entonnoir
-r gobelet
:-ayons de couteurs
r:etrte
boute en bois
- r pot vide
Présentation du matériel et consigne
> L'enseignant montre [e matériel et les étèves nomment les objets.
> Trouvez plusieurs foçons de produire un son à portir de ces objets. Ne foites rien tomber por terre.
Manipulation, recherche, réponses
> Les étèves testent, s'imitent. L'enseignant les encourage à chercher une panoptie de bruits possibtes
Actions attendues.
> Bouteitte d'eau: secouer, frotter, gratter, verser dans te gobelet, remptir [a bouteilte avec ['entonnoir.
> Papier: déchirer, secouer, lroisser, ptier, [âcher en l'air.
> Boule et pot: faire rouler [a boute, [a placer dans le pot, [a faire rouler, secouer Ie pot.
> Boîte de crayons: secouer, taper, faire router sur ta tabte, transvaser dans le pot vide.
TELIER SEMI.DIRIGÉ
DE6À8Ér-Èvrs
PUIS À L'AccUEIL
25 minutes
CErrE ÉTApE esr uru nÉ NVEsTlssEMENT DE LA pREcEDENTE sous FoRME DE
tEU.
Présentation de ['activité
Matériel > Un élève se retourne et se cache les yeux. Un autre choisit un objet et une action en réinvestissant
- identique à celui
les actions de l'étape précédente. Celui qui s'est caché les yeux doit reconnaître le bruit en citant
de l'étape précédente
le matêriel utitisé et [e verbe d'action.
Le vivant Le corps de l'enFant
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8Ér-Èvrs
r5 minutes
Matériel
- 1 maracas
- 6 petites bouteitles d'eau
'pois chiche
'
r17
- lentitles
-petits clous
- gravler
- mals
-
r entonnoir
Présentation de t'objet à fabriquer
> L'enseignant montre une maracas. Chacun ['essaie et en ioue. L'enseignant explique que c'est un
instrument de musique et que chaque êlève va fabriquer [a sienne.
Question et recherche
> Àvotre ovis pourquoi lo morocas foit-elle des sons? Parce qu'il y a quelque chose dedons qui fait du
bruit quand on lo secoue !
Ecoute des sons, choix du contenu de [a bouteille
> En regroupement, ['enseignant présente plusieurs objets pour produire des sons. ll remplit plusieurs bouteiltes pour utiliser chaque proposition, ferme le bouchon, secoue chaque bouteilte pour
présenter le son qui en résulte.
> Les é[èves verbalisent les différences entendues seton Ies objets placés dans Ia bouteille. Quand
tous les sons possibtes ont étê écoutés, chacun choisit ce qu'il mettra dans sa bouteitte.
ATTENTtoN, LEs oBJETS À mErrnr DANS LA BourErLLE pouRRAtENT Êtnr olucenEux sANS LA vtGtLANCE DE L'ENSEIGNANT
EN pARTtcuLtER LES pETtrs cLous. VETLLER Évroeiuir,trnt À cE eu'AUCUN ÉrÈvE ue METTE QUot QUE cE solr EN BoucHE.
ATELIER DIRIGE
DE6À8ÉlÈvEs
30 à 40 minutes
MatérieI
- 1 petite bouteitte d'eau par étève
- pois chiche
-|7
- lentiltes
- petits ctous
''ilii;
- 1 entonnoir
- papier journaI
- cotle à papier peint
- peinture acrylique
40
Réalisation de [a maracas
> Les élèves remptissent leur bouteille avec les objets choisis. lts testent Ie son produit et enlèvent
ou ajoutent des objets jusqu'à obtenir un son satisfaisant.
> lts recouvrent ensuite [eur maracas de papler mâché.
> Lorsque ta maracas est sèche, its [a peignent avec de ['acrylique.
tÉ
CORPS DE L'ENfANT
L
F
I
.l
-
visuelles
I
J
À
L'eccurt
5 minutes
Matériel
.
-rÊttes fabriquées
--
gabarit proposé
(DVD- Rom)
:= :apier transparent
de couleur
Présentation du matériel
> À I'aide du gabarit fourni dans te DVD-Rom, réatiser dix paires de Iunettes différentes: deux paires
avec un verre opaque et l'autre transparent et alterner æil gauche et ceil droit, l'une avec les deux
verres translucides avec du papier calque, cinq paires avec des verres de couteurs différentes,
['une avec des verres transparents bardés de rayures noires, I'une avec deux petites ouvertures.
Découverte
> Les élèves s'amusent à porter les dilférentes Iunettes et à verbaliser ce qu'ils voient.
ATELIER DIRIGÉ
Étlpt z METTRE
DE6À8ÉlÈves
PUIS À L,AccUEIL
3o minutes
Matériel
['album inducteur
EN ÉvrDENcE
ntlusroN
ENTRE
rEs couLEURs RÉELLEs
ET
oBsERVÉEs Ms. Gs
Observation des obiets avec des lunettes
> Chacun porte une paire de Iunettes dont [es verres sont de couleurs diffêrentes. L'enseignant place
sur [a table les objets btancs et pose [a question : de quelle couleur sont ces objets?
> Chaque étève donne sa réponse sans entever ses Iunettes. L'enseignant relève [es propositions et
fait réagir sur les contradictions.
Constatations
> Les élèves entèvent leurs lunettes et qualifient [a couteur de chaque objet qui fait l'unanimité.
Reprise de I'expérience avec les objets en couleur
> L'enseignant montre des obiets en couleur et les élèves les caractérisent au préalabte sans Iunettes.
: :: a
.. ::
:.
Co u le
urs
Albin l\iliche[ ]eunesse
. 2A74. 15,9a€différentes couleurs
Émission d'hypothèses et vérification
> Remettez vos lunettes en couleur pour voir les objets. À votre ovis, de quelle couleur vont-ils poroître
> Les élèves observent et rectifient: les couleurs des objets ne sont pas forcément cettes des tu-
nettes, les couleurs se superposent.
-6àSobjetsblancs
S objets unis et ctairs
:,remple en jaune, rose,
bteu clair, vert ctair
?
Conclusion
'
Quand je mets des Iunettes avec des verres de couleur, le vois les couleurs différemment.
Découverte de l'album
> L'enseignant présente l'atbum Couleurs. La maniputation de feuittets de couleurs transtucides travaille sous une autre approche [a perception des couleurs.
Le vivant Le corps de l'enFant
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8Ér-Èves
z5 minutes
Matériel
- ['album inducteur
Dêcouverte de ['album
> L'enseignant lit et manipute [es pages de l'atbum Couleurs.
Expérimentation
> Les étèves ont envie d'expêrimenter les actions évoquées. lts choisissent deux couteurs parmi Ies
couleurs primaires, déposent côte à côte deux gouttes et les mélangent.
Hervé Tullet O Bayard jeunesse
.20r-.
rr,9o€
- gouaches de cou.errs primaires:
jaune primaire, bteu cyan, rouge
magenta et btanc
- papiers blancs
Mise en commun, constatations et conclusion
> Chaque étève exptique les couteurs qu'it a métangées et tes couleurs obtenues. À force de les
constater, ils en déduisent [es couleurs obtenues à partir de chaque métange.
,9u o*
,q.
d,u,
p,uno
d*W
dp
ÿ$t
@,
^J^
"L
> La retecture aÉ t'utUrd, confirme ces conclusions.
\,eht.
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8Ér-ÈvEs
zo minutes
MatérieI
-différentes loupes
-des boîtes-loupes
- matériel interessant à volr en
grand: feuitle d'arbre, insecte,
plume, pièce de monnaie, morceau
de roche, morceau de tissu...
Présentation du matériel
> L'enseignant montre les loupes et explique comment s'en servir.
> Plocez un objet à I'intérieur, remettez le couvercle-loupe et plocez
votre æil correctement pour voir en grond.
Observation
> L'élève découvre en visible des étéments miniatures qu'it distinguait à peine sans Ia [oupe.
Conclusion
.fl *uS.
*WY
dp» n">Inu.".Bn"L>
y *
de rwn drb
dÂf-l)t
f*
*
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8Ér-ÈvEs
30 minutes
Matêriel
-
r gabarit des Iunettes
par élève (DVD-Rom)
-des feuitles en ptastique
translucide
r feuilte cartonnée A3 pour
paires
de Iunettes
4
- cray0ns
- crSeaux
-aiguittes de piquage
42
Fabrication des [unettes
> Les élèves de GS peuvent dessiner [es Iunettes sur du papier légèrement cartonné à t'aide d'un
gabarit présent dans [e DVD-Rom puis les découper avec des ciseaux et les êvider avec une aiguilte
de piquage. Puis its choisissent une couleur de plastique transtucide, coupent seton le gabarit, et
enfin co[[ent [es verres à l'arrière des montures avec l'aide d'un adutte.
Le vivant Le corps de l'enfant
LE CORPS DE L'ENFANT
F
z,
=
ul
J
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
10 minutes
Matériel
- pictogrammes des 5 sens
(matériel page 43 et DVD-Rom)
Présentation du matériel
> llenseignant accroche chaque pictogramme au tabteau (matériet page 43 et DVD-Rom). Les étèves
décrivent ce qu'ils voient.
> Une fois que chaque organe des sens a été nommé, ['enseignant fait associer ['organe au sens qui
lui correspond ; l'(ElL permet de VOIR et voici lo corte pour LA VUE.
> Poursuivre pour chaque sens. La carte de la main demande ptus de discussion pour rappeter que c'est
LA PEAU qui permet LE TOUCHER mais que c'est compliqué de représenter la peau sur un dessin.
> Seton [e niveau de langage des élèves, utitiser [e verbe peut être plus facile qu'utitiser [e nom,
notamment pour entendre et ['ouie. Dans ce cas, formuter ainsi: voici lo corte ovec I'OREILLE pour
ENTENDRE.
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
5
temps de regroupement dans
la même journée
20 minutes (toucher)
+ 5 minutes (entendre)
+ 10 minutes (sentir)
+ r5 minutes (goûter)
+ 5 minutes (voir)
Maiériei
- boîte à toucher
1 orange entière et 1 orange
coupée en petits morceaux
- r clémentine entière et z clérnentines coupées en petits morceaux
- r kiwi entier et r kiwi coupéen
-r
petits morceaux
boule de pâte à modeter
-
r
boute en bois
- 1 coLÿerture et z chaises
pour tabriquer un paravent
-1 bonnet ou r toulard
pour chaque é[ève
Présentation du matériel et questionnement
> L'enseignant montre [a boîte à toucher contenant les obiets.
> Aujourd'hui, nous ollons foire le jeu des objets mystères: cinq obiets sont cochés dons cette boîte.
Vous ollez vous servir de votre corps pour ovoir le plus d'informotions possibles sur ces obiets.
Que peut-on utilîser pour sovoir quelque chose sur ces objets ?
> Les étèves proposent les mains, [e nez...
> L'enseignant explique ['ordre dans lequet its vont explorer les oblets: en premier avec [es mains,
ensuite avec les oreittes, puis avec [e nez, [a bouche et enfin avec les yeux. Chaque exptoration
sensorielte se déroute sur une même journée à un moment de regroupement différent.
Avec les mains
> Les étèves touchent [es objets directement dans
Ia boîte à toucher et observent:
- lo forme en boute de chaque oblet,
- les différentes tailles de chaque objet,
- les différentes textures.
- 3 coupeites contenant
les [ruils coLpés
Avec les oreilles
> L'enseignant se fabrique un paravent avec deux
chaises et une couverture de la salte de sieste.
ll Iaisse tomber chaque ob jet,
les élèves discernent
- le bruit sec et fort de [a boute en bois,
- les bruits plus ou moins étoulfés des aulres.
Avec le nez
> Les élèves ont les yeux bandés.
> L'enseignant prend les coupelles de fruits prédécoupés, [a boute en bois et [a pâte à modeter. lI fait sentir à tout [e monde les cinq obiets dans l'ordre: kiwi,
clémentine, boule en bois, pâte à modeter, orange.
> Les êtèves repèrent:
-lesobjetsguiontuneodeuret ceux qui n'en ont
presque pas,
- les odeurs coroctéristiques.
> À ce stade, certains obiets sont identifiabtes et
peuvent être identifiés.
tt4
Avec [a bouche
> L'enseignant précise que deux obiets ne sont pas
comestibtes. lt fait goûter des morceaux de fruits.
Les élèves identifient:
- les différentes soveurs,
- les différents goûts et essaient de les reconnoître.
> La dégustation permet à nouveau d'identifier des
objets ou de valider les réponses déjà trouvées.
Avec les yeux
> Les êlèves vont donner d'emb[ée [e nom de chaque
objet, te jeu des obiets mystères est rêsotu. L'enseignant leur demande ce que la vue leur a permis de
découvrir à savoir:
- t'identification immédiate et définitive des objets,
- leur couleur.
CLASSE ENTIÈRE
:CIN REGROUPEMENT
2o minutes
Matériel
-r
affiche
, - - =s des pictogrammes
::: : ::'rs (matérieI page 43
Stru ctu ratio n
> Les cinq pictogrammes sont cottés sur ['affiche. Les élèves dictent à l'enseignant ce que permet
chaque sens en faisant appeI aux constations de t'étape précédente.
et DVD-Rom)
Le vivant Le corps de
t'enfant +=
OUVRAGES AUTOUR DU SCHÉMA CORPOREL
6à
\,-/ 6à6à
\, \_-/
mier livre
Gittes Diederichs et Marion Bi[let
O Nathan . zoog. t5€
Ce livre-CD articute te yoga
sur trois axes: la souptesse, [e
calme et t'équilibre. En réalisant
les postures adaptées, l'élève
renforce son schêma corpore[.
@@
6à
6à 6à
\__,/ \__/ \_-/
Va-t'en Grand Monstre
Agathe
l[ est où?
Vert
Pascal Teutade et Jean-Charles
Sarrazin O L'école des loirisrs
Christian Vottz O Éditions du
!
Eo tmberley O -'école des loiris's
. 1996 . 72,20 €
Un grand monstre vert apparaît
par accumutation page après
page, puis disparaît. Album de
référence pour travaitler sur Ies
parties du visage.
-,
6à
6è)
grandirl
Tony Ross @ Gallimard jeunesse.
Lydia Devos et Arnaud Made[énat
O Editions Le Pommier . zot3 . t3€
Augustine est perplexe: revenue à sa maison de campagne,
e[[e remarque qu'il a suffi d'un
hiver pour que ses objets familiers soient devenus trop petits.
Elte est trop grande pour eux.
)ôll
.
.)i^).EAi€
La fourmi Agathe rencontre une
drôle de montagne mouvante,
au sommet de [aquelle pousse
un arbre rose et chaud...
Rouergue.2007.13,7o€
Un petit bouton cherche
quelqu'un sous un ramassis
de cailtou, fil de fer, bouton,
per[es...Au fur et à mesure, it
reconstitue un bonhomme.
;,,
@@@
.le veux
@@
/, oô€
La petite princesse veut absoIument grandir. EIte interroge
donc les adultes qui ['entourent
pour savoir comment faire mais
@@@
éà
Quand i'étais petit
Quand je serai grand
lvlario Ramos O PasteI fécote des
lotsirs.ry97.13,2o€
Cet atbum sans texte montre un
animal adulte. Derrière le rabat
se trouve l'enfant qui sommei[[e
en Iui.
les conseils qu'ils lui donnent
sont bien difficites à apptiquer.
Pitta: et Cetvai, O Gallimard je:nesse Giboutées . 2ao7 . 12,20€
Un petit garçon se prend à imaginer [e monde quand il sera
grand. Joies et désagrêments
sont abordés tout simplement,
avec humour et tendresse.
OUVRAGES AUTOUR DES CINQ SENS
Des ouvrages autour du toucher sont proposés dans [e chapitre sur [es matériaux page 134.
-
6À r;À
@@@
@@@
Des goûts et des odeurs
Couleurs
Hervé Tullet O Bayard jeunesse
. 2074 . 11,90 €
Couleurs
jeunesse
Au f ur et à mesure du livre,
Grâce à des transparents de
l'élève est incité à utiliser ses
doigts pour caresser, frotter,
tapoter, secouer, métanger Ies
couleurs qui sont sur [es pages.
couleurs, ce Iivre permet à
t'élève de modifier Iui-même Ies
images pour faire apparaître
[e résuttat de combinaisons de
couleurs.
Caiherine Rayner
e
Ka(éidoscope
.
2014
.
12,Eo
€
Freddo est un chien qui sent Ia
rose. Et ça, iI n'aime pas. Ators
il va se balader pour retrouver
sa bonne odeur à [ui.
Pittau et Gervais
{Zà
Ferme les yeux
Albin Nlichet
15,9o€
@
. 2014.
Victoria Pérez Escriv et CLaudia
Ranucci O Syros . 2or4 . 5,50 €
À chaque page, deux frères
décrivent Ie monde tel qu'ils
[e perçoivent. L'un a [es yeux
ouverts, I'autre fermés. De quoi
se rendre compte que la vue
inftuence énormément notre
perception du monde.
6
Vi
Dossier élevages
Elevages à gogo
t+8
52
La locomotion
Notions pour I'enseignant
Pigeon vole
Aites, pattes ou nageoires?
57
58
64
[a nutrition
Notions pour I'enseignant
Bon appétit lapin!
A chacun son menu
67
6B
7o
La reproduction
Notions pour I'enseignant
Tabteau de famitte
Ovipare ou vivipare?
Des petits dans notre élevage
Ouvrages et jeux autour de [a vie animale
73
74
78
8r
8l
Les notions abordées
.
.
.
.
.
.
Les bases du concept de vivant à travers
I'observation des grandes fonctions
Les différents modes de déplacement
et leurs organes spécifiqueé
Les organes sensoriels spécifiques
de certains animaux
L'alimentation des animaux, la relation entre
un animal et [e choix d'aliments spécifiques
à chaque espèce
Les ovipares et les vivipares
Le cycle de vie complet de [a naissance à la mort
Mettre en place un étevage dans sa classe, dans [e cadre de ['enseignement des Sciences, permet d'aborder et de traiter de
nombreux champs d'apprentissages qui vont aider t'étève à construire [e concept de vivant.
DES RÈGLES À RESPECTER
> lI n'existe aucune tégistation particutière règlementant [a mise
en
place d'étevage dans [a classe.
> En l'absence de textes règtementaires précis sur ce suiet, une disposition tégistative existe cependant. Elte est de portée générate
et s'applique à tous les produits et tous les services. ll s'agit de
I'article L.zzt.r du code de [a consommation:
«Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions prévisibles par
le professionne[, présenter [a sécurité à taquetle on peut tégitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à [a santé des perso
n
dans Ia ctasse est donc [aissée à ta seule appréciation des enseignants qui doivent toujours vérifier que l'étevage mis en place respecte certaines règtes concernant [a protection et les conditions
de vie de l'animat, t'hygiène et la sécurité des étèves.
> lI n'existe pas non plus de liste d'animaux autorisés ou non dans
les écoles.
> De nombreux animaux peuvent faire t'obiet d'un élevage en ctasse,
chaque espèce pouvant présenter des avantages et des inconvénients seton les objectifs que ['on s'est fixé.
> Nous vous conseiltons nêanmoins de vérifier qu'aucun étève n'est
attergique aux animaux à poits ou à ptumes. Le cas échéant ['éte-
nes».
> La note de service n"85-779 du 3o avril 1985 pubtiée au BO nozo
du r5 mai 1985 apporte des informations concernant [es élevages
et I'introduction d'animaux en ctasse. La pertinence d'un étevage
vage ne pourrait être insta[[é dans [a sa[[e de classe car même
sans contact physique avec ['animat, les poits sont disséminés
dans ['air.
POURQUOI METTRE EN PLACE UN ÉLEVAGE DANS SA CLASSE
> L'élevage en ctasse permet de confronter directement les étèves
à
la notion fondamentate de vivant.
> lI assure [a mise en place de façon pertinente des différentes
étapes de [a dêmarche d'investigation scientifiques (questionner,
chercher, tester, expérimenter, modétiser, représenter, concLure) et
contribue à développer l'observation, processus inteltectueI qui
nécessite un apprentissage progressif.
?
> L'observation continue des animaux élevés va permettre [a mise
en évidence des caractères fondamentaux communs à tous les
êtres vivants:
- la naissance, [a croissance, [a reproduction et la mort,
- [a nutrition et les régimes alimentaires,
- [a locomotion,
- les interactions avec l'environnement.
> L'étevage génère des situations extrêmement motivantes et crée un
vécu commun indispensabte à la construction des connaissances.
> lt sensibitise aussi Ies étèves aux questions liées à ta protection de
[a nature (EDD) et les responsabilise quant au respect de [a vie et
du bien-être animat.
QUEL ANIMAL CHOISIR
?
Le choix de I'animal est important.
> L'enseignant doit se fixer des obiectifs et en fonction de cela choisir
['animaI adéquat à étever. Même si parfois, c'est I'opportunité d'introduire I'animal en ctasse qui va induire ['élevage et la recherche
d'objectifs à travaitler.
> La comparaison de ptusieurs étevages peut être un moyen très efficace de mettre en évidence certains concepts. Ainsi, les gerbittes
et [es escargots permettent d'observer des modes de reproduction
différents et une première approche des reproductions ovipares
et vivipares.
> Bien sûr, d'autres êlevages sont possibles, mais à exptoiter scientifiquement ptutôt au cycle z: papitlons, poussins, gendarmes et
autres petites bêtes de [a cour de récréation, animaux de la mare...
> Les amphibiens sont protégés, on ne peut ptus en prélever dans [a
nature et leur étevage est donc impossibte.
Quets pièges éviter?
> Avant d'instatter un étevage dans sa classe, il faut savoir:
- ce que ['on va faire des animaux pendant les congés scolaires,
- ce que ['on va faire des animaux à ta fin de ['année scolaire,
- ce que ['on fera des petits en cas de reproductions nombreuses
et répétées.
Où s'en procurer?
> Se faire prêter un animaI pour une durée déterminée est une solution idéate:
- prêt par un êlève, des connaissances, une ferme...,
- prêt par certains ESPE pour des durées données,
- en animalerie,
- sur certains sites dédiés: www.insecte.org, petites annonces sur
www.phasmes.com
QUEL ANIMAL CHOISIR
AN
?
IMAL
À
INTÉRÊTS DE t'ÉLEVAGE
.
Saletés générées: [es gerbi[[es passent leur temps à
réamênager leur cage et exputsent chaque jour un peu de
titière.
.
Croissance exponentielle du nombre de petits: savoir quoi
faire des petits (animalerie, don aux enfants ou sur inter-
o Observation aisée des différents modes de déptacement:
sauter, courir, marcher, grimper.
o Observation de [a reproduction vivipare.
Gerbi[[e
Poisson
.
Reproduction rapide et relativement aisée.
.
AnimaI suscitant [a curiositê, ['adhésion et ['empathie.
.
Beaucoup moins d'odeurs que les autres rongeurs car
gerbille urine peu.
.
Appréhension de [a relation entre [e déptacement et
milieu de vie.
.
net, co[[ègues...).
[a
.
Agressivité et conflits entre individus dans la même cage
qui peuvent atter jusqu'à Ia mort. Si un individu est séparé
du groupe pendant plus de z4h, iI ne sera plus accepté.
.
À part [e nourrissage, aucune interaction possible avec
['anima[.
.
Aquarium à nettoyer régulièrement.
.
Longue durêe de vie de l'anima[, dont iI faut pouvoir
s'occuper pendant plusieurs années, y compris pendant les
vacances: si possible, préférer [e prêt.
.
S'approvisionner en feuilles de ronces même en hiver.
.
Entretien du terrarium: iI faut sortir tous [es phasmes...
même les petits que l'on a du mal à trouver et séparer les
æufs et les crottes.
[e
Possibilité de mener une investigation sur Ie rêgime ali
mentaire.
Lapin
.
Phasme
Escargots
AnimaI suscitant [a curiosité, ['adhésion et ['empathie.
.
Observation du cycte de vie comptet, ce qui permet d'aborder [a notion de vie et de mort.
.
Reproduction parthénogênêtique relativement aisée mais
longue (3 mois minimum).
o Certaines espèces de phasmes sont toxiques (ex: Oreo-
.
AnimaI qui oblige à focaliser le regard, qui rend l'êlève
particulièrement actif dans l'observation.
.
. Observation de [a reproduction ovipare.
. Reproduction rapide et relativement aisée.
. Observation d'un mode de déptacement spécifique.
QUELLES LOUPES CHOISIR
phoetes peruvana).
Le phasme se met en bâton: ses antennes et ses pattes
se co[[ent le long de son thorax et abdomen. ll peut même
faire [e mort. C'est son mécanisme d'autodéfense.
. Entretien du terrarium.
. Prélever des individus dans [a nature est interdit
les boîtes-loupes
Les loupes USB
-)È-
,:es
:
de ro
simples
= letda
-:
:c
Ref.
R nr€
ro loupes @ Nathan
Rét 3r3-3-o9-
Loupe sur pied
3o5128-8.
4,7o€ pièce
18,2o€
dans
certaines régions à certaines périodes.
?
Les loupes à main
:-.=rble
slvorn
@ Wesco
ro boîtes-[oupes
petit modèle
@ Celda
Rêf. 5u64.55.
t5,65€
dæ
Pour une
6 boîtes-loupes
@ Nathan
Réf. 3r3-3-o9-
3o5o9o-8.
17,6o€
Boîte-[oupe triple
vue @ Wesco
observation fine
8,9o€ pièce
['e nse ign a nt.
menée par
Prix très variable.
Dossier élevages
le poisson
le [apin
À pRÉVotn: aquarium, gravier, au molns une vraie ptante
pour oxygéner.
nitle
la gerbitte
À pnÉVOtn: cage d'environ un mètre de [ong, litière
végêtale, paiLle foin, biberon, un abri.
tanislas
le phasme
À pnÉVOln: terrarium ou aquarium, fibre humidifiêe,
CARTÊ D'DENTITÉ
À pnÉvOln: terrarium ou aquarium, fibre humidifiée,
CARTE D'IDENTIlÉ
o *
,e) @
so
oô«r@o.?@
@)
branches de ronce.
Comment garder une trace écrite?
Pour garder une trace écrite de votre étevage, nous vous proposons d'êtabtir en fin de séquence
une carte d'identitê de ['animal relatant [es principales observations (DVD-Rom et coffret).
L'organisation de cette carte d'identité est la même quelque soit l'animat étudiê, de manière
à pouvoir les comparer. ll est possibte d'en êtablir d'autres à partir d'animaux famitiers, d'animaux rencontrés lors d'une sortie, dans des livres ou des vidéos. Des cartes-images permettent
de la compléter (Cartes-images 6 et 7 dans [e DVD-Rom et [e coffret).
EIEVAGE
z,
Émv
ESÀ
lrl
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
20 à 30 minutes
-l'animal ptacé dans un récipient
transparent: boîte ou sachet dans
le cas du poisson
- cage, IerrariLm ou aquarir,m
- accessoires (voir pages 5o et 5r)
-nourriture adaptée à ['animal
Situation déclenchante
L'enseignant a caché sous un drap une
boîte ou un sachet transparent contenant
l'anima
[.
lI propose de faire deviner aux élèves de
queI animal it s'agit à t'aide d'une petite
n ette.
Lorsqu'un étève donne [e nom de I'animal
ou d'un animaI proche, retirer le drap.
devi
PoLR LE phASME. "RÉsFN-FR pt u-ô- r r -LnRARtUM ET DEMANDER nux ÉrÈvrs ot nepÉnEn
L'AN tMAL.
Les é[èves verbatisent ce qu'ils savent
sur ['animaI et ce qu'ils voient.
L'enseignant note Ies premières observations et les questions si certaines surgissent, en précisant qu'on essaiera d'y répondre plus tard.
L'enseignant fait remarquer aux êlèves que [a boîte ou [e sachet dans lequeI se trouve ['animal
n'est pas très confortabte et [eur demande s'its savent comment on pourrait mieux ['instatter.
.
Dans [e cas d'un animal en cage, iI présente Ie matêriel. Les élèves nomment ce qu'i[s voient et
essaient de comprendre la fonction de chaque objet.
.
Dans [e cas d'un animaI en aquarium,
ils ptacent [es petits caittoux au fond de
['aquarium, remplissent l'aquarium et
lâchent l'animaI dans ['eau (voir situation
problème Comment remplir l'aquarium
page 138).
Dans le cas d'un animaI en terrarium,
les élèves placent de [a terre, quelques
caittoux, de Ia mousse, une branche,
quetques feuilles, une petite fleur avec
ses racines si c'est possibte. L'enseignant
apporte le terme terrorium: dons un aquorium il y a de l'eou, ici on o mis de lo terre,
on dit terrorium.
52
5
minutes par iour
Matériel
- l'animaI dans sa cage,
n terrarium ou son aquarium
nourriture adaptée à l'animal
Nous ovons bien instollé notre onimol, mois que fout-il encore lui donner?
À manger, sinon ilvo mourir!
Et que monge notre onimol?
Les é[èves ont des connaissances
et proposent des aliments. D'autres ne sont pas sûrs.
L'enseignant note Ies hypothèses.
Pour les animaux ne risquant pas d'en mourir, à partir de ta MS, it est possible de mener une démarche d'investigation en expérimentant différents aliments (voi Bon appétit lopin! pages 68 et 69).
Pour te poisson, expliquer que ['animaI mange uniquement des granulés.
Exptiquer qu'iI faudra nourrir l'animaI régutièrement et définir les rôles de chacun.
Dans [e cas des gerbiltes, du [apin ou des escargots, les étèves pourront apporter tous les jours de
Ia nourriture et la donner [ors de ['accueit.
Dans [e cas du poisson, un êtève différent est chargé chaque jour de le nourrir.
§
1() à 20
minutes
Matériel
- ['animal dans sa cage,
son aquarium ou son terrarium
Au départ ['enseignant Iaisse ses é[èves s'exprimer librement. Puis iI centre Ies questions pour
orienter Ies observations. lI note égatement leurs questions.
Que foit I'onimol ?
Les élèves verbatisent [eurs observations.
)uverte sensorielle
Si ['animaI est serein, [e sortir et [aisser les étèves [e toucher après avoir précisé qu'iI faut faire
très attention à ne pas [ui faire mat.
Les mains de ['enseignant sont en dessous des leurs, prêtes à récupérer ['animaI au cas où.
Au-detà de Ia dimension ludique, cette approche par le toucher est nécessaire pour construire des
connaissances: présence de poits, contractions musculaires d'un animal vivant, mouvement des
moustaches, traces de bave...
Cette observation par [e toucher renforce les observations visuettes.
CERTATNS
ÉrÈvrs
rue
vouDRoNT pAs roucHER L'ANtMAL. NE pAs LEs FoRcER.
Le vivant La vie
animate §§
CLASSE ENTIERE
COIN REGROUPEMENT
15
minutes
Matériel
- ['animal
-
r affiche
Présentation du matériel
> Quetques jours après avoir accueilti ['anima[, ptusieurs questions ont surgi naturellement de [a
bouche des élèves. L'enseignant les note au fur et à mesure et les retit à ['ensemble de [a ctasse.
> Nous ollons noter toutes les questions qu'on se pose sur notre onimol de monière à ne pas les oublier.
Ça nous permettra de sovoir exoctement ce qu'on cherche quond on observe notre onimol,
> Noter [e titre sur t'affiche et les questions déjà posées par les étèves.
> Certoins d'entre vous se posent-ils d'outres questions sur notre onimal?
> Noter les questions et montrer de temps en temps I'animal ou des traces de son activité pour
générer de nouvetles questions. Si les étèves ont du ma[ à en trouver de nouvetles, en proposer.
> Si de nouvettes questions surgissent ptus tard, tes ajouter. Écrire les rêponses dès que la ctasse a
réussi à en trouver.
V
-,1,
U5l æ re
cD
Jo
CD
*ny\
00,)o
In
h. dÉIl^". ,!?
B-'ü
Yp il'vo/ÿfr\.a dDhl:
n
n
y.,,
.-," Aré!Éb?
f" î-"
,r, yJtu
te,rttu
h* À 1^-
ôôn
a
_
-0
),ph eL*A,\Â Lb ôml dÀ ffi
6I\
)lô^
t ôt tr
)Jet»
rM
c; Un
G0n
0
0
(w,rÏæ
Û)(
b
I
r6i
ô
->
|
r
ùh cnr-a
c".Lt-/J (( )o,ü
Jo-ü'Utr
üt> Mfù
Jo'r\L'dh
JonL
Mnv (
(o
»
*A
.o*nl*T- @\*Yi
rl I h
l.^*
0 0
[", "
"'-:^'
-r
-'G
! )oil Lu0 y,y !
-)
CHAQUE euEsTloN pouRRA ÊTRE LE potNT oe oÉpnnr D'uNE NouvELLE oBsERVAT|oN, o'urr expÉnrueruTATroN ou D'uNE
REcHERcHE DocuMENTATRE. MÊME L'ENSETGNANT pErJT NE pAs sAVotR ET s'AppuyER suR UNE REcHERcnr poue eÉporuonr
AUx euEsnoNs oes ÉrÈves.
CETTE ÉTApE
rsr
oÉveroppÉe DANs P/6EoN vorE pAGE 58.
ATELIER DIRIGÉ DE LANGAGE
DE6À8Ér-ÈvEs
15
minutes
Matêriel
- ['animal
- [a carte d'identité de ['animal
(DVD-Rom et coffret)
Comparaison
>
>
>
>
>
>
>
>
L'enseignant fait comparer [e corps de ['animal au corps de t'étève.
Votre corps et celui de l'onimal sont-ils poreils?
Les étèves énumèrent les points communs et [es diffêrences facilement identifiabtes.
L'enseignant demande des précisions supptémentaires concernant [a taitle et [a forme des oreittes
ou de [a queue, [a différence de taitle entre les pattes avant et arrière, ['emptacement des pattes...
lI apporte [e vocabutaire nécessaire: moustaches, museau, griffes, queue, nageoires, écaitles,
branchies, pied, coquitte, tentacutes, abdomen, thorax...
La comparaison suscite de nouveltes interrogations qui peuvent être aioutées à I'affiche de l'étape
p rêcédente.
Cette observation permettra de répondre à certaines questions de l'affiche.
Pour certaines parties du corps, la réponse n'est pas évidente et nécessitera une observation à [a
[oupe ou une recherche documentaire.
Structuration
> Les élèves commencent à remplir [a carte d'identité avec les éléments observés (DVD-Rom et
coffret).
54
septembre s juin
ATELIERS SEMI-DIRIGÉS
DE6À8Ér-Èves
zo minutes
Matériel
- puzzle
-=.éments prédécoupés en carton
- crates
-::lle
- pâte à modeter
- fi[ de fer
repositionnable en bombe
PLUStEURS RECoNSTtruloNS soNT posstBLEs EN
FoNcloN
DU NtvEAU DEs ELEVEs
Reconstitution d'un puzzle
> Les étèves tentent de reconstituer un puzzte de l'animaI et nomment ses parties.
Reconstitution de la silhouette et empreinte
> Reconstituez un lopin, recouvrez d'une feuille et frottez ovec lo croie ô plat.
PouR euE
rrs
ÉrÉruerurs pnÉoÉcoupÉs EN cARToN NE BoUGENT pAs LoRs
Dr.J
FRorrAcE, rL Esr RECoMMANDE DE LEs
FAIRE TENIR AVEC DE LA COLLE REPOSITIONNABLE EN BOMBE.
Réatisation en volume
> Représentez le corps de l'onimol en pôte à modeler
/
ovec du
fil
de fer.
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8Ér-Èvrs
10 à 15 minutes
Matériel
*
1 escargot
ou
Par êtève:
-
r
r
loupe
phasme
MANIPULER UNE LOUPE N'EST PAS INNÉ: LE PREMIER REFLEXE VA ETRE DE PLACER LA LOUPE SUR L'ANIiMAL, AU RISQUE
or L'Écnasrn, Urur ncr vrrÉ oE oÉcouvtnte DE cET oBJET EN AMoNT EST DoNC NECESSA RE, EN REMpLAçANT LES vRAts
ANIMAUX PAR DES JOUETS EN PLASTIQU
Observation de I'escargot
> Grâce à [a [oupe, les êlèves aperçoivent les yeux au bout des longs tentacules. lls en déduisent
que ces tentacutes servent à voir. L'enseignant Ieur apprend que Ies tentacutes courts servent à
toucher comme si c'étoient des mains.
> La bouche n'est pas visibte au premier coup d'æi[, les élèves ont cru qu'ils n'en avaient pas. C'est
[orsque ['escargot se déplace contre une surface transparente qu'iI est [e ptus facile de ['observer.
Observation du phasme
> On voit mieux [a différence entre pattes et antennes en plaçant ['animal dans une boîte [oupe.
> lI est possible de voir les yeux et éventueltement [es mandibules.
> On peut égatement visualiser [a segmentation entre Ie thorax et l'abdomen.
Observation du poisson
> lI est possibte d'observer à [a [oupe un poisson acheté chez [e poissonnier pour mettre en êvidence Ies écaittes, la bouche, Ies branchies.
Le vivant La vie
animale §§
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8ÉlÈves
zo à 3o minutes
lr rsr trurÉnessntr
DE DEMANDER nux ÉrÈvEs oe nÉnrrsen uN DEsstN D'oBsERVATIoN À cHneur srADE DE rn oÉmnncHe.
FUR ET À tvtesune, tLs GAGNERoNT EN coNFtANcE ET AFFTNERoNT LEURS oBSERVATtoNs pouR oBTENtR uN DEsstN DE
PLUS EN PLUS PRECIS.
Au
*
Matériel
Par étève:
- r animaI
- 1 Crayon
- r feuilte
* Pour te groupe:
t'affiche de ['anima[ à [égender
(DVD-Rom et coffret)
Dessins d'observation
> Dessinez I'onimol pour qu'on voit bien toutes les porties nécessoires de son corps.
> L'enseignant annote les dessins ou écrit [es mots nécessaires sur l'affiche de l'anima[ à légender
(DVD-Rom et coffret).
Comparaison des dessins
> En comparant [eurs dessins, les étèves prennent conscience de [eurs oublis ou de [eurs ajouts.
> Lorsqu'il y a un doute sur un détait, il est possible de vêrifier sur I'animat.
Cerre Érepe esr oÉveroppÉe
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
10 à 15 minutes
Matériel
- des photographies
- des vidéos
des livres documentaires
DANs DEs pETtrs DANS uorBe
Étrvnet
pAGES 81 À 84.
Recontexua lisation
> Rêgutièrement, l'affiche avec les questions sur ['animaI est comptétée avec les réponses trouvêes
aux questions posêes. Pour certaines questions, il s'agira d'avoir recours à la documentation.
> Où pourroit-on trouver une rêponse à cette question? Dans des livres!
Recherche documentaire
> Les élèves cherchent des indices [eur permettant de répondre aux questions.
> Si les questions demeurent, ['enseignant Iit des extraits de documentaires y répondant.
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
15
minutes
Rappet
> L'enseignant reprend les différents points déjà comptétés
- affiche de la carte d'identité
(DVD-Rom et coffret)
- ca'tes-images 6:
aniraux pour ca-te d'identité
(DVD Rom et coflret)
- cartes-images 7:
ali11e-ts (DVD-Ron et cof'ret)
CARTE D' DENT TE
avec les étèves.
> Its complètent [es réponses manquantes et placent les
étiquettes au bon endroit.
Trace écrite individuette
> La carte d'identité peut être photocopiée pour chaque êtève
pour son cahier.
> lts peuvent [a personnaliser en cotlant des étiquettes ou
en dessinant.
56
æ§o@§o@
Les notions abordées
pour l'enseignant
que la locomotion ?
- , ln est La faculté pour un être vivant de se mouvoir
. ---
Que[ organe pour quet déplacement?
pour
on est une fonction essentielte qui permet de distin-
=. .-l-naux des vêgétaux.
' -:-
les animaux se déplacent-ils?
( se déplacent pour se nourrir, pour se reproduire, pour
trouver des condie plus ctémentes.
- --=dateur ou poursuivre une proie, pour
--
> Pour une même fonction «se déplacer», les organes de dépta-
cement sont adaptés au milieu de vie. De manière générate, on
trouve des pattes pour [e milieu terre, des aites pour le milieu air
et des nageoires pour [e mitieu eau.
> Chez [es vertêbrés, des modifications très importantes sont apparues pour adapter tes membres au type de déplacement matgré
une organisation générale commune du squelette. Ainsi la patte
antérieure du cheva[, t'aite de la chauve-souris et la nageoire du
dauphin ont subi d'importantes modifications qui les adaptent au
mitieu de vie dans [equeI its évotuent.
déplacements pour quel milieu de vie ?
,-:- cn est une suite de mouvements qui entraînent un dê-.-, 0n peut associer [es déptacements au mitieu de vie: un
: -: se déptace pas de la même façon dans l'eau, dans ['air
.:=rre.
.,-.
Ce déplacement peut être [a nage ou la proputsion
e voI dans ['air. une progression bipède, quadrupède
DAUPH N
-- :JT teffe.
-= se déplacent que dans un seul milieu, comme les pois:,': que d'autres sont capables de se mouvoir dans ptu-
- leux, comme les canards.
:-:::T, c'est toujours prendre
-.
appui sur quetque chose de
- : - lour marcher, courir, ramper, sauter,
-:_ :ûur nager,
.
::uT voler.
..-, les animaux nagent. ll existe certes des animaux mar: -lrlme Ie crabe, mais s'ils vivent dans l'eau, le dépta-
. . .e fait sur une surface sotide correspondant aux fonds
: - -:s. Le singe qui grimpe dans I'arbre n'est pas aérien pour
: -ertains animaux tels les gerris arrivent à marcher sur
-=: exempte est permis grâce aux forces de tension de sur-
: :
le
-,-
iau et constitue un cas particulier.
motion chez l'homme
rotion est une fonction commune aux
-:: r: ses différents modes de déptacements
. . : .onstruction de son schéma corpore[.
animaux
et
à
par ['êtève contri
CHAUVE SOURIS
-= qui peut poser problème
est impossibte à étudier à partir de photos d'animaux ou de recherches documentaires.
' r' :.c:notion
' - ''roiiver une recherche et s'interroger sur [a locomotion, L'élève doit être conlronté à ['observation d'un animal vivant qui
. .=:lace (élevages, sorties) et à des vidéos d'animaux se déptaçant.
I
' , - lien intégrer un mode de déplacement comme [a reptation, iI est intéressant que ['élève puisse faire un paratLèle avec
:
-:
.'opres possibilités de ramper en salle de motricité.
Le vivant La vie
animale §§
LA TOCOMOTION
z,
=
@
@
ul
PIGEON
ldentifier et
CLASSE ENTIERE
COIN REGROUPEMENT
OU
SALLE DE MOTRICITÉ
ro minutes à renouveler
2 ou 3 fois
:.''
;'. Sr
51
vort
vous
pAssEz DrRE(
N'AVEz pAs D'ÉLEVAGE DANS
N'AVEZ
DANs LA cLAssE,
clAssE, pASsEz
DTRECTEMENT À L'ÉTApE
lBrs
Situation déclenchante et questionnement
> L'enseignant sort ['animaI de Ia classe et [e ptace au milieu des élèves.
> Comment se déploce cet onimol ?
Matériel
- ['animaI de l'étevage
- [a carte d'identité de l'animal
(DVD-Rom et coffret)
> Pour ['observation des petits mammifères tets que lapins et gerbitles, utitisez ['espace autour d'un
grand tapis. Les étèves sont assis tout autour pour matériatiser une barrière. On peut égatement
observer ces déplacements autour d'une tabte, mais l'espace est ptus petit, l'animaI se contente
souvent de marcher.
L'observation des insectes peut se faire au regroupement sur [e sol, sur une partie du corps ou sur
[e tableau de [a classe.
Le dêptacement de ['escargot peut se faire sur une ardoise btanche pour mettre en évidence [e mucus
(la bave). En ptongeant son pied dans du colorant alimentaire, on visualise le tracé du déplacement.
Les é[èves observent et nomment Ies déplacements. lls identifient les organes impliqués.
Mimer les sauts du lapin permet de différencier corporetlement le rôle des pattes avant et des
pattes arrière, puis de [e décrire verbalement.
L'enseignant relance par des questions pour affiner ['observation. lI apporte [e vocabulaire nécessaire: les nageoires du poisson, ['escargot rampe sur son pied.
Le phasme marche et grimpe dans toutes les positions.
Les é[èves ênumèrent Ies déplacements caractéristiques de l'animaI et les organes imptiqués.
^*À
t0t
or,r
fl,
W.r.r* "" 0. 4",^*
SoilB.'.-f aill,,ù
c\^r.rr.no
.t.y-,\ m),pi,r),
?*
L^n, or.J^n
St]-uLprù.
'uJ.e.,rhtét
58
d. L*-
*t1,.
(DVD-Rom et cotfret)
.LASSE ENTIÈRE
:. .. REGROUPEMENT
25 à 30 minutes
. r3: déplacements
,:: :- --'raux (DVD-Rom)
' '.=j déptacenents
. -.;= 6r et DVD-Rom)
Questionnement et hypothèses
> Comment se déplocent les outres onimouxT
> L'enseignant [aisse les étèves réagir, citer différents animaux et dêptacements, faire des hypothèses.
Recherche
> L'enseignant propose de visionner des vidéos sur [e déptacement des animaux (DVD-Rom).
> Observez comment choque onîmol se déploce.
> Les étèves nomment les animaux et [es dêplacements qu'its connaissent.
> Si nécessaire, Ie groupe valide, corrige Ies réponses.
> L'enseignant présente pour chaque déptacement cité un pictogramme.
Conclusion
> À Ia fin de ta séance, tes étèves ont répertorié tous tes déptacements des animaux. Les piitogrammes accrochés au tableau permettent d'en garder une trace.
DEMI-CLA55E
- ., REGROUPEMENT
20 minutes
-:- -:s
:
-: :- :
Matériet
des déptacements
lage 61 et DVD-Rom)
L'enseignant distribue Ies cartes-images de Ia Iocomotion des animaux (DVD-Rom et coffret).
Chacun nomme son animal et cite son mode de dêplacement. Les autres valident ou non. Une
vérification avec le DVD-Rom reste possible.
- cartes-images 8:
- -:motion des animaux
1'DVD-Rom
et coffret)
0u
-=irations des animaux
(matériet page 6z)
- ordinateur et DVD
accessibles si besoin
L'enseignant accroche au tabteau les sept pictogrammes des déptacements.
Accrochez l'imoge de votre onimol sur le pictogromme du déplocement qui lui convient.
CERTATNS ANTMAUX
oNT pLUsrEURs DÉpLAcEMENT5. S'rL N'y pAs oe oÉent LoRseuE L'ÉLÈVE AccRocHE soru erutuer À
D'AUTREs soNT posstBLEs, fENSETGNANT pEr.JT TNTERVENTR pouR ALLER pLUs LotN DAN5
utt oÉpLnceruett ALoRS euE
L'ANALvsE. CoMME tL FAUDRA AssoctER IJN ANIMAL À
VOIRE TRIPLE.
prusrruns oÉeLncruexrs, LEs
TMAGEs
soNT pREVUEs EN DouBLE,
Le vlvant La vie
animale
jp
CLASSE ENTIERE
SALLE DE rrnOrntCtrÉ
zo minutes
Réinvestissement
L'enseignant propose que les étèves se déplacent comme les animaux qu'iI va citer.
Déplocez-vous comme ... un escorgot!
Les êtèves rampent et prennent conscience qu'ils utitisent I'ensemble de leur corps.
fois te déplacement choisi. Les élèves valident ou corrlgent Ieurs déptacements et prennent conscience des contraintes et caractéristiques de chaque déptacement proposé: quand je rampe comme I'escargot, j'ovance lentement, je n'utilise pas mes bros ou mes iambes,
Un étève nomme à chaque
j'utilise tout mon corps.
ACTIVITÉ INDIVIDUELLE
2() minutes
Matériel
-1 photocopie par
élève
(document page 63 et DVD-Rom)
- colte
- clseaux
Lenseignant présente Ie matériet. Les é[èves nomment tout ce qu'its reconnaissent.
Collez choque onimol sous son déplocement. 9'il y o plusieurs fois le même onimol, c'est gu'il peut se
déplocer de plusieurs foçons.
CERTATNS
ANrMAux oNT pLUS EURs DÉpLAcEMENTS ET Do vENT DoNC Êrnp
corrÉs
PLUS EURs Fols
> L'enseignant peut choisir [e niveau de difficulté.
.
.
6o
Niveau simpte: les étèves classent seton [e déplacement de ['animaI sur ['image.
Niveaux ptus complexes: les étèves connaissent les autres façons de se déptacer et associent
['animal à ses autres déptacements.
I
\
I?
Le vivant La vie animate
ILLUSTRATIONS ANIMAUX
ii'ili
6:
Classer un animal selon son déptacement.
€
PIGEON VOLE
Colle chaque animal sous son déplacement.
A
,^
.f M
Èâ
tA rocoMoTloil
F
OU
z,
moteur
lrl
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
20 minutes
Matériel
r
ptateau de jeu
(DVD-Rom et coffret)
- 24 carTes de jeu 8
-
(DVD-Rom et coffret)
Situation déclenchante
> L'enseignant propose un nouveau ieu et en explique rapidement les règtes.
> Vous êtes une petîte boule et vous devez vous déplocer sur ce chemin pour orriver le premier à lo
dernière cose. Sur le chemin, it foudro morcher, courir, grimper, sauter, noger, voler, romper, mois
toute seule la boule ne peut pas ovoncer. Des onimoux vont vous oider et vous prêter une partie de leur
corps pour vous permettre de vous déplocer.
Questionnement
> euelle portie de leur corps les onimaux doivent-ils vous donner pour que votre boule puisse se déplocer?
> Les élèves réfléchissent et sont amenés à citer [es pattes, [es aites et [es nageoires.
Présentation des cartes
> l]enseignant pose [es cartes sur ta tabte, face cachée. Les élèves tes retournent les unes.après [es
autres et dêcrivent à chaque fois ce qu'its voient.
Observation et verbalisation
> Pour chaque carte, les étèves reconnaissent l'animal, observent et nomment ses organes de déptacement. lls identifient également les pictogrammes des dêplacements possibles.
Présentation du plateau
> L'enseignant fait repérer à ses étèves tes diffêrentes parties du parcours: [e chemin principal où it
faut marcher ou courir, les passages où it faut nager et [es trois raccourcis que ['on peut emprunter
en grimpant, en sautant, en rampant ou en volant.
Explication de ta règte du ieu
> Choque joueur o trois cortes devant lui. Pour ovoncer, il pioche une quotrième corte puis choisit celle
qu'il veut utiliser. tl lo dépose au centre et déplace son pion d'une cose. Si I'onimol choisi peut courir,
peut avoncer de trois coses, souf s'il veut s'orrêter ovont pour pouvoir prendre un raccourci.
> La corte Atout permet de posser portout.
> Choque joueur joue à tour de rôle. Le premier joueur qui atteint lo cose d'orrivée a gogné.
6q
il
25 minutes
t
Matériel
LE pLATEAU DE rEU coNVrENr pouR DEs
pnnrrrs À
DEUx, TRors
ou euArRE
ËLÈvES MAxTMU^4.
L'enseignant fait reformuler [es règles du jeu et [a partie débute.
Pour 4 élèves:
- r plateau de jeu
/D-Rom et coffret)
24 cartes de jeu 8
/D-Rom et coffret)
- 4 ptons
Le
joueur ptace au centre [a carte qu'il utilise et verbalise.
prends les pottes du tigre pour courir et j'avance de deux cases.
prends
le corps du serpent pour ramper et ie posse sous lo barrière. C'est un raccourci.
' Je
o Je prends les ailes de lo cigogne pour
voler et prendre ce roccourci.
o
Je
Au
FIL DEs PARTIEs, LEs ÉrÈvEs corusenveNT srRATÉGTeuEMENT DANs LEUR MArN CERTATNES cARTES
eu,rLs pouRRoNT
IMARCHER ou couRtR MAls LEs
GARDER POI.JR NAGER OU GRIMPER
urlLlsER PLUs Lottt. Exervprr: sl PosstBLE, NE pAs urtLtsER LEs PATTES DE L'ouRs pouR
20 minutes
Matériel
photocopie par élève
(document page 66)
Les étèves identifient les colonnes du tabteau et tes organes de déptacement choisis.
;igne
Colle dons choque colonne les orgones qui permettent le déplacement demondé.
Le vivant La vie
animale
6!
Associer un organe moteur aux déplacements qu'iI permet.
AI
LES, PATTES OU NAGEOIRES?
€
Co[[e dans chaque colonne [es organes qui permettent te déptacement demandé.
A
L
'^
ID
7
M
"f
§u
ns pour l'enseignant
'
,
.t
. :-,,,' t",a ,.
.. ?) ta t al\.',
Les notions abordées
i
":
Qu'est-ce que le régime alimentaire
-r --:rition
:
correspond à toutes Ies fonctions assurant l'approvi.- =-t en matière et en énergie d'un organisme nécessaire à
, = et à son développement. Elle comprend I'alimentation, [a
:::: on, [a respiration, la circulation et l'excrétion.
digestion
nutriments
excrétion
Gros intestin
lntestin grêle
+
a
aa
a
Atimen ts
-i-
non-digérés
=:l0n
I
lr
circulation
Vaisseaux
Sangurns
1.
.l
Co2
.
._l
CO2
respiration
0rga nes
- - =st-ce qane E'æâim*ertætâæm?
" -:-nentation désigne Ia manière dont s'atimente un animal et ce
- -ange: sa prise de nourriture et son régime alimentaire. C'est
: : :ornposante de la nutrition qui est travaittée à ta maternetle.
" -,,: es animaux se nourrissent. L'observation directe des ani-,-,, ['observation des traces d'un repas et Ia recherche docu=
-
maux, de végêtaux ou parfois des deux. C'est sur [a base de cette
diffêrence d'origine des atiments que ['on a étabti une ctassification des régimes alimentaires.
> Les animaux qui ont un régime alimentaire carnivore se nourrissent
d'aliments d'origine animate. Ce sont les zoophages. Exemples: le
hibou, te [ion, [a couteuvre, le héron, [a coccinelte, ['étoile de mer...
Certains régimes carnivores sont très spécialisês.
. Les insectivores ne consomment que des insectes.
Ex: t'hirondette.
. Les charognards ne mangent que des cadavres. Ex: le vautour.
. Les piscivores ne mangent que des poissons. Ex: [e martinpêcheu
O2
02 +glucose
-:rre permettent de le mettre en évidence à [a maternelte.
?
> Le régime alimentaire définit Ia façon dont un animal se nourrit.
Son régime alimentaire peut être constitué exctusivement d'ani-
r.
> Les animaux qui ont un régime alimentaire vêgêtarien se nourrissent d'atiments d'origine végétale et de substances produites
par les végétaux comme [a sève ou [e nectar. Ce sont des phytophages. Exemples: le phasme, ta gerbille, [e [apin, [e cerf...
Ce régime alimentaire peut égatement être très spécialisé.
o Les herbivores ne mangent que de l'herbe. Ex: la vache.
. Les granivores ne mangent que des graines. Ex: le verdier d'Europe.
.
Les nectarivores ne se nourrissent que de nectar sécrété par les
fleurs. Ex: te cotibri.
> D'autres animaux ont un régime alimentaire omnivore. lls se nourrissent à [a fois d'atiments d'origine animate et d'atiments d'origine
végétate. Exemples: [e renard, [e sangtier, le raton [aveur, ['ours,
Ie merte...
Ce régime peut étonnamment être aussi très spêcialisé.
o Les ptanctophages ne consomment que du ptancton d'origine
animale et végétale. Ex: [a bateine.
> Le régime alimentaire a une inftuence sur [e comportement de t'animal (prêdateur, proie), sur [a structure anatomique de certaines
parties du corps (bouche, dents, griffes, estomac...).
> lI peut varierau cours de [a vie de ['animal. Le jeune mammifère se
nourrit de lait materne[ au dêbut de sa vie puis adopte [e régime
atimentaire de son espèce.
> lI peut également varier en fonction des saisons quand [a quantité de nourriture disponible change. Le raton Iaveur se nourrit
beaucoup de [arves, d'æufs, d'oisiltons et de vers de terre au printemps, puis de fruits, graines et baies en automne.
> Les animaux qui sont exclusifs dans leur régime atimentaire sont
souvent plus vulnérabtes à la sélection naturetle que les omnivores. Ex: [e panda.
Le vivant La vie
animale
*
LA NUTRITION
F
=
ul
J
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
ou colN Élevnee
2() minutes
Situation inductrice
> La ctasse travailte actuetlement sur un projet étevage ou accueitle un [apin pour quetques iours.
ANALoGUE PEUT ÊTRE errectuÉr AVEC D'AUTRES ANIMAUX ÉrEvÉs eu clAssE, NoTAMMENT
TIÉONIE, ELLE POURRAIT SE MENER AVEC TOUS LEs ANIMAUX, MAIS CERTAINS MANGENT PEU ET LENTEMENT
pnÉrÉneNcES ALIMENTAIRES FoRTES
ET L,AL|MENT restÉ pounntt DANS LA cAGE (pHnsue). CERTATNs ANTMAUX our oes
ur eÉvÈrr pAs cE euE L'ANrrvlAL sAUVAGE MANGERAIT (cenetrre). ON NE PLAcERA PAs DANs uN
UNE expÉntmerurnrtoN
Matêriel
L,ECARGOT. Eru
- aucun
er üexpÉnrmetrlrroru
AQUARTUM DES ALTMENTS
À resren cHEz LE potSsoN, DE PEIJR DE LE VOIR MOURIR RAPIDEMENT.
enseignant interroge sa classe i que vo-t'on donner à monger ou lopin ?
Les étèves font appet à des connaissances qu'ils ont déià et vont certainement proposer
des carottes, du pain dur, du chou...
L
L,enseignant Ies encourage à proposer d'autres aliments : pour sovoir ce que monge ce lapin, on vo
fui prof,oser tous les jouri deux oiiments différents et on regardero ce gu'il o mongé et ce qu'il o loissé.
Les é[èves aioutent des aliments'
llenseignant s'arrange pour en choisir six à huit avec quetques-uns que [e tapin ne mange pas
(iambon, thon, fromage...).
Cependant, it étimine tout de suite des aliments qui sont toxiques pour Ie [apin en ['exptiquant.
. Le lopin monge le chocolot mois ço peut le rendre oveugle !
. Lo solode donne la diorrhée ou lopin noin.
. tt fout toujours que le lopin oit du foin pour ses dents.
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
5
minutes à rênouveler
plusieurs fois
Matériel
- cage avec [e laPin
- carotte
- chou
- pomme
- pain dur
- fromage
- iambon
- thon
- autres propositions des étèves
Expérimentat!on
> Certains étèves ont apporté des aliments cités prêcêdemment. Celui qui a apporté un atiment [e
met dans [a cage.
RAssAslÉ PAR uN
CHorsrR DEUx ALIMENTs À rn rots er eu QuenrtrÉ mooÉnÉr PouR QUE LE LAPTN NE PUl55E PAS ÊTRE
srur. pln RESpEcr DU gteru-Êtne ANtMAL, oN NE DoNNE pAs uN sEUL ALTMENT AU LAPIN SACHANT QU'lL N'EN IVIANGERA PAs'
Le tapin est gourmand, tes étèves pourront observer le matin et dans [a journée les atiments auxquets it a touché. Les élèves responsables du nourrissage sont chargés égatement de ['observation'
Les étèves étabtissent ta Iiste des aliments que le [apin mange et ceux
qu'il ne mange pas.
Évtren Lrs TERMES AtME /Er n'ntme PA5, TRoP ANTHRoPoMoRPHIqUES
Étabtir une tiste de préférence parmi [es atiments que mange Ie lapin: présenter deux atiments
simultanément. Observer Iequet est choisi en premier, ceux mangés totatement ou partietlement.
6E
.]
CLASsE ENTIÈRE
N REGROUPEMENT
20 minutes
L'enseignant montre les cartes-images 7 (DVD-Rom et coffret). Les élèves reconnaissent et nomment les aliments.
Au tobleou, occrochez dons lo première colonne les oliments que le lopin monge et dons I'autre, les
oliments gu'il ne monge pos.
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8ÉlÈves
z5 minutes
Matériel
- albums documentaires
=:'nagazines pour élèves
,= ::tionnés par l'enseignant
Questionnement
> L'enseignant demande à ses élèves si tous les lapins mangent les mêmes aliments que [e [eur.
. Comment sovoir ce que mongent LES lopins?
. Regarde moîtresse, tu os apporté des Livres qui expliquent la vie du lopin.
Consultation des documentaires
> En ciblant [a recherche et en observant les images, [es étèves vont pouvoir apporter des réponses.
> L'enseignant peut [ire pour apporter des réponses non illustrées.
ra_000
tlo.-À Le^
rcrqpnn
0 d-
st\^Aræ d
o,YdnsJ,5
Ajouter des atiments non encor
Vn ,^n-ftne, \,eh biltr\t> lnaun:o-r[
la recherche documentaire (ma'rs, navet...).
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
20 minutes
-t
affiche
- cartes-images Z:
: -=-is (DVD-Rom et coffret)
. :arte d'identité du lapin
(DVD-Rom et coffret)
- -,::ls prises ou des images
des aliments testés
-...s découpées d'atiments
L'enseignant propose de réaliser une affiche qui récapitule ce que mangent les Iapins.
A partir de [a structuration de l'étape 3 déjà accrochée au tabteau, les élèves complètent
[a cotonne « mange » avec [es informations de l'étape 4.
lls comptètent êgalement la carte d'identité du Iapin (DVD-Rom et coffret).
Le vivant La vie
animale S§
LA NUTRITION
F
=
SON MENU
àun
lrl
J
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
15
minutes
Matériel
fatbum inducteur
Situation inductrice
> Les élèves connaissent l'atbum Bon appétit!
Monsieur Lopin. Monsieur Lapin n'aime plus
[es carottes et demande à d'autres animaux
ce qu'its mangent, jusqu'au moment où iI
rencontre Ie renard...
5t rr oÉeur
ET LA FtN DE L'HtsrotRE RELÈVENT DE LA
FrcrroN, LEs BÉporuses DEs ANtMAUx euerur À leun
ALtMENTAT|oN soNT ExAcrEs D'uN potNT DE vuE Bto
LOG I QU E.
Questionnement
Bon oppétit! Monsieur Lopin
r aJdF Boujor
O L'école des loisirs.2013.8,7o€
- éléments ptastifiés de I'atbum
- r bouche barrée et 7 bouches
ouvertes (DVD-Rom)
> Qui monge quoi?
> Les élèves se souviennent.
La
grenouille mange
des mouches, l'oiseau des vers, le lapin ne monge pas la carotte.
> Chaque étève accroche au tableau sa réponse avec les étéments ptastifiés (DVD-Rom).
La bouche ouverte signifie «mange», la bouche barrée signifie «ne mange pas».
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
15
minutes
Matériel
cartes d'identité déjà réatisées
au cours de I'année
à partir des étevages
7o
Lancement d'un projet de réalisation d'une affiche
> Nous allons foire une gronde offiche qui présente des onimoux et explique ce qu'ils mongent.
Quels onimoux connoissons-nous déjà ?
Réponses
À partir de cartes d'identité d'animaux étudiés en élevage.
> Les étèves citent des animaux observés en élevage et dont on a noté ['atimentation.
À partir des connaissances personnelles des élèves.
> Les étèves nomment un animaI qu'ils connaissent (animaI domestique, visite...) et précisent com
ment iI faut [e nourrir.
> L'enseignant prend des notes.
ATELIER SEMI-DIRIGÉ
DE6À8Ér-Èvrs
zo minutes
Matériel
t
-:ins 2 documentaires par
ie€=l i Ê'r'rprunter dans une BCD:
- magazines type Wakou
- livres documentaires
Questionnement
> Voilà des mogozines et des livres qui expliquent lo vie des animoux. Que veut-on sovoir sur les animoux pour réaliser notre affiche ? On veut sovoir ce qu'ils mangent.
Consigne
> Feuilletez les documentoires, cherchez des images où on voit un animol monger et où I'on peut reconnoître ce qu'il monge.
> Plocez un popier pour garder lo poge. À lo fin, chocun me présentero ce qu'il a trouvé.
Recherche
> Les élèves cherchent des photos, mettent les papiers pour garder la page.
> De temps en temps, t'enseignant [es questionne pour voir comment ils s'en sortent, llvérifie qu'its
ont bien choisi un animaI en train de manger où ['atiment est identifiable. Pour ceux qui ont du mat,
iI peut Ieur choisir [es documentaires [es ptus riches.
Conclusion
> Chaque élève expose ses recherches. L'enseignant [aisse les marque-pages pour photocopies.
ATELIER SEMI-DIRIGÉ
DE
,...
6 À 8 Ér-Èvrs
z5 minutes
:écoupées des animaux
-étiquettes
-rodèles avec les
-rodèles
noms
des animaux
avec [es noms
des alinents mangés
-coLle
- ctseaux
AvEc DEs GS, ot't pEur rRrER LES ALTMENTS seLolr L'oRlGrNe: vÉcÉrerE ou ANtMALE.
FATRE
ALoRS L'ÉTApE 5.
Présentation de I'activité
> Les élèves nomment chaque animaI et ce qu'on le voit manger sur [a photo.
> Voilà les onimoux trouvês. Chocun choisit une photocopie et découpe soigneusement lo photo.
> Vous êcrivez le nom de l'animol sur une étiquette et ce qu'îl monge sur une outre étiquette.
Réalisation
> Les élèves coupent et écrivent grâce aux modètes préparês par l'enseignant.
lL v n eenucoup DE PAprERs suR LA TABLE ENTRE LEs pHorocoplEs, Les oÉcouences, Les rvooÈrrs er res Éttquettrs
L'roÉlr senatt o'Écntnr sun uN AUTRE EspAcE euE cELUt DU DÉcoupAGE.
Le vivant La vie
animale
fX
I
ATELIER SEMI-DIRIGÉ
or6À8ÉrÈves
z5 minutes
-;ges
découpées des animaux
- étiquettes
- modètes avec Ies noms
des animaux
- modètes avec les noms
des aliments mangés
- colle et ciseaux
Présentation de t'activité
> Les élèves nomment chaque animaI et ce qu'on [e voit manger sur [a photo.
> Voilà les onimoux que vous ovez trouvês. Chocun choisit une photocopie et découpe lo photo.
> Vous écrivez le nom de I'animal sur une étiquette et ce qu'il monge sur une outre étiquette.
Réalisation
> Les êtèves coupent et écrivent grâce aux modètes préparés par l'enseignant.
Classement
> Pormi ces onimoux, certoins mongent d'outres onimoux, d'outres mongent des plontes.
> Posez votre feuille sur l'affiche rouge si votre onimol monge un outre onimol, ou posez-le sur I'offiche
verte s'Îl monge une plonte ou quelque chose qui vient d'une plonte.
> Chaque étève vient poser sa feuitte en justifiant son choix.
Observation des deux affiches
> Quand les deux affiches sont terminées, l'enseignant amène les termes carnivore et végétarien.
> Les étèves citent ators des exemptes d'animaux végêtariens ou carnivores.
PAV
d.dt
dr.)"
(Û"'
DANS cETTE pnel,rrÈne AppRocHE vÉcÉTAnrEu/cnnrrvonr, L'ruserclrnNT vETLLERA A ulLrsER DES ExEMpLES cARIcATURAUX: UN ANIMAT QUI MANGE DU YAOURT OU DES CROQUETTES EST TROP COMPLEXE A ANALYSER.
72
ms pour l'enseignant
.:'-rduction regroupe tous Ies processus permettant Ia per_
-: J1 des espèces par la naissance de nouveaux organismes.
'
,' --e des activités fondamentates des êtres vivants.
-: 'lgUe
. -: reproduction sexuée. Elle est assurée par ta fécondation et
, .-contre des gamètes mâ[es et femeltes. EIe est très impor_
:-'=
-:
cat elle assure [e brassage génétique entre les individus
même espèce.
, -= reproduction asexuée ou multiptication végétative. Elle per_
:
, sans fécondation ni gamètes, d,avoir des descendants tous
,--rlques génétiquement. Seules certaines espèces d,animaux
'..
-
.
primitifs peuvent se muttiplier de cette façon, à partir d,un
unicellulaires, cer_
-es hydres d'eau douce, certaines anémones de mer...).
: ,ridu isotê (des protozoaires: individus
, :a'riculiers
chez les animaux.
La parthénogénèse, considérée comme un mode de reproduc_
.:r sexuée car elle fait intervenir des gamètes, est la facuttê
-: l'ovute non fécondê à pouvoir se développer. Ette produit, te
:,s souvent, un individu femelle identique à sa mère. parfois,
=rtaines formes de parthénogénèses, par des phénomènes de
'-sions complexes, peuvent ne donner que des mâles ou encore
.
-:s mâtes et des femeltes.
lans la nature, on trouve ce mode de reproduction chez des
'rsectes (phasmes, fourmis, abeittes...),
des annélides et ptus
-arement chez certains vertébrês:
certains requins, le dragon
-e Komodo..-
rour certaines espèces de phasmes, ce mode de reproduction
:st teltement
.
répandu que ['on n'a jamais encore identifiê d,in_
:ividus mâles dans I'espèce.
L'hermaphrodisme. Tous les escargots sont hermaphrodites. lls
sont à [a fois mâles et femetles et peuvent produire des gamètes
nâles et des gamètes lemeIes simultanêment. lts ne peuvent
:ependant pas s'autoféconder et doivent toujours être deux in_
dividus pour se reproduire. C'est une fécondation croisée et [es
deux individus se fécondent mutuettement.
Ce
Les notions abordées
Ovipare ou vivipare
?
> Un animal ovipare est un animal dont ta femeile pond des ceufs.
Le
dévetoppement et [a croissance de l,embryon se dêroulent hors du
corps de la femetle dans cet ceuf.
Pour que l'æuf puisse se développer, il doit avoir êté fécondé par
le mâle. Selon les espèces, cette fécondation résulte de I'accouple_
ment des parents: le mâte dépose sa semence dans le corps de [a
femelle (ex: la poule) ou le mâte peut féconder les ovutes après
leur ponte (ex: les grenouitles).
lJembryon se développe ensuite dans cette enveloppe extêrieure
solide chez Ies oiseaux, ptutôt gélatineuse chez Ies poissons et [es
batraciens ou de forme particulière chez certains requins. L,æuf
contient toutes les réserves nécessaires au bon développement
de ['embryon.
Lorsque te petit sort de ['æul on appette ceta l'éclosion.
Les oiseaux, les batraciens, les insectes, [es araignées, beaucoup
de reptiles et de poissons sont ovipares.
> Un animal vivipare est un animal dont la femelte assure [e dé_
veloppement de I'embryon dans son utêrus. La nutrition de ce
dernier est mise en place par [e placenta via [e cordon ombilical
et la femetle va le garder dans son corps jusqu,à l,expulsion. Tous
les mammifères sont vivipares à l,exception de l,ornithorynque et
de l'échidné.
Croissance et développement des animaux
> Tout anima[, au cours du temps, se dévetoppe par une succession
de différentes phases: la naissance, te dévetoppement et [a croissance, l'âge adutte, [e vieillissement et la mort.
Certains animaux possèdent un développement direct: te jeune
ressemble à t'adutte dès sa naissance. D,autres connaissent un
développement indirect: Ia [arve subit des transformations importantes appelées métamorphoses pour devenir adulte.
> La croissance des animaux est définie par opposition à cette des
végétaux qui se poursuit tout au tong de [eur vie.
Généralement, [a croissance s'arrête à ta maturitê sexuelte de I,ani_
mat. Elle peut être continue si ette se poursuit en permanence
lusqu'à ['âge adulte (ex: ta gerbille) ou discontinue si e[e résutte
d'une succession de mues car [,augmentation de taille n,a alors
lieu qu'au moment de la mue (ex: te phasme).
qui peut poser problème
> A part la naissance d'un petit frère ou d'une petite sæur, les étèves ont
souvent peu de vécu dans ce domaine.
ll faut donc prendre le temps de recueitlir [es représentations initiales et privitégier [es
observations d,étevages pour
construire des connaissances.
Le vivant La vie
animate §§
tA
1{UTRITIOT
F
=
DE
EI
J
CLASSE ENTIÈRE
REGROU PEMENT
20 minutes
Matériel
l'atbum inducteur
lDÉALEMENT, cE cHAptrRE EST À TRAtTER EN AMoNT
ou
EN EXpLotrATlotl o'utlE SoRTlE À LA FERME.
L'enseignant tit t'album un peu perdu. Un bébé chouette tombé du nid ne retrouve plus sa maman,
un écureuiI tente de ['aider mais a bien du mal à reconnaître sa maman, iI lui présente d'autres
animaux: un Iapin, une grenouitle, un ours...
À la fin de t'histoire, l'enseignant demande à ses êlèves si un bébé chouette peut avoir un tapin
comme maman. lI retance [es questions pour les amener à expliquer, {Jn bébé et la moman sont les
mêmes onimaux, la maman d'un bébé ours est un ours.
rr
O Thierry Magnier. 2011
.
14,80€
FEMELLEs rst egonoÉ À fÉTAPE 3. NE cRÉEz PAs DE LA coNFUsloN EN
LE vocABULAtRE DEs pETtrs, mÂres
N'ulLIsANT euE LE TERME nppnopntÉ AU RrseuE DE pAssER À côrÉ oe L'oB,EcrtF DE cETTE Étnpr: Lr pettt
AppARTTENT À
rn uÊue
EspÈce Que sES PARENTS.
ATELIER DIRIGÉ DE LANGAGE
DE4À6Ét-Èves
zo minutes
MatérieI
Memory B: petits-parents
(DVD-Rom et coffret)
lenseignant montre Ies cartes du jeu. Les é[èves reconnaissent et nomment [es animaux. lts
constatent qu'it y a des cartes avec des bébés animaux et d'autres avec le papa et la moman.
L'enseignant explique la règte du Memory consistant à apparier un bébé anima[ à ses parents.
En jouant, ['élève reconnaît les parents d'un petit grâce à [eurs ressemblances morphologiques.
ll nomme chaque animaI avec ['aide de l'enseignant.
74
:- :i
DIRIGÉ DE L,qNGAGE
DE4À6Ér_Èvrs
z5 minutes
Matériel
- cartes-images ro:
=-=:ciation petit-mâle -femette
(DVD-Rom et coffret)
Appropriation du matériel et apport de vocabulaire
> L'enseignant dispose les images au centre de la tabte et donne [a consigne (cartes-images 10 dans
le DVD-Rom et le coffret).
Reconstituez une famille d'onimaux de votre choix.
> À tour de rôle, chaque élève, prend trois images pour reconstituer une familte.
> Quand toutes les familtes sont assembtées, l'enseignant fait nommer les cartes à ses étèves.
> lls vont utiliser les termes de mamon etpopa. L'enseignant apporte maintenant des rectificatifs de
vocabutaire: on ne dit pas « la moman » mais lo femelle et on ne dit pos « le papo » mois le môle,
> L'enseignant fait rêpéter [e vocabutaire exact pour chaque carte, teI que poule, coq, poussin...
Jeu de cartes et utilisation de ce vocabulaire
> L'enseignant distribue atéatoirement les cartes
aux é[èves. Chacun dispose les cartes devant
lui et choisit une familte à reconstituer. pour
obtenir Ies cartes qui Iui manquent, l,étève
doit [a demander à celui qui l,a en utilisant tes
termes appropriês: Adom, donne-moi le coq s'il
te plaît.
> L'étève qui coltecte [e plus de familtes a gagné.
ACTIVITÉ INDIVIDUELLE
3() minutes
-
r photocopie
MatÉriel
par élève
(document page 76 ou 77)
- ciseaux et colte
Colle les onimoux d'une même fomille ensemble,
Les élèves posent puis cotlent. L'enseignant détermine [e nombre d'étiquettes seton le niveau
des
élèves:3 familles pour un PS,4 pour un MS,5 pour un
GS.
À ta fin de t'activité, chacun nomme à l'enseignant [es animaux qu,il a cottés.
CLASSE ENTIÈRE
REGROUPEMENT
25 minutes
Matériel
I'album inducteur
Lecture de I'album et verbatisation
L'enseignant lit t'atbum Le premier jourde mavie. ll fait verbaliser ce que les élèves ont retenu:
c'est un livre qui exptique comment certains animaux s'occupent de Ieurs petits.
Connoissez-vous d'outres comportements d,animoux ovec leur petit ?
Les étèves apportent des étéments de réponse grâce à leur culture, constatent peut-être aussi que
certains animaux se débrouillent seuls après la narssance.
Le premier jour de mo vie
Steve lenl ins et Robin Page
O Circoniere . 2o1j . t2€
Le vivant La vie
animale
ÿ§
cQ
0
qi
U
tQ,)
o_
tn
fTl
CJ
a)
<c)
=
ô'
a
ô
=
:
!
ô
x
=
rE
.E
C
(o
(n
q.)
-o
da
.9
U
o
(/)
O
(n
t
l
I
U;
q
U
(-
I
G.'
(u
E
((l)
E
LIJ
J
J
q
(,
c
E
(o
:
E
tr
LU
o
l
c.)
E
((U
E
c.)
C
:
E
xJ
(o
LU
.E
(-
m
tt)
J
É
l"
a
o
qL
ro
a2
(t,
o
U
a
Associer des animaux d'une même espèce.
LEAU DE FAMILLE
:s animaux d'une
€
même fami[[e dans [e même enctos.
.e§§§§
ww§§ÿ
I
LA NUTRITION
I
F
=
ul
J
CLASSE ENTIÈRE
REGROUPEMENT
25 minutes
Matériel
- ['atbum inducteur
Situation déctenchante Pour aboutir à un questionnement
te petit manchot
> llenseignant tit te début de t'atbum D'où viennent tes bébés animaux? Lorsque
demande'
et
lecture
[a
interrompt
['enseignant
pose tiquesti on d'oùviennenttesbébés?,
ilssortentdesæufs'
probable:
ptus
ta
Réponse
> Etvous,sovez-vousd,oûviennentlesbêbés?
> Est-ce que tous les onîmoux sortent d'un æuf?
petite sceur pour
> lJenseignant peut faire réfêrence à [a naissance d'un petit frère ou d'une
du
ventre'
sortir
peuvent
aussi
petits
que
des
de
trouver
permetire à ses étèves
qui sortent du ventre ?
onimaux
des
qui
connaît
et
æuf
d'un
gui
sortent
onimaux
>
connoît des
Qui
Rechenche et réPonses
[ecture de
> Les étèves apportent Ieurs réponses personnelles, puis ['enseignant poursuit la
commune'
cutture
une
d'avoir
étèves
[es
permettre
à
tous
pour étargir ies recherches et
D'où viennent les bébés onimoux?
Anna lMllbourne et Laura Wood
oLcDor
"'/o11'o'5oé
i;*;;;;5 **
u o d",u o )r\aL/Î cyt
;:".\^'
J?
loer-o.-L.
*î -" --
or^ ...{
eL do^-r.aæ-o an)Ltmr,-'x
otn tanrprJ- dL @rthP
ATELIER DIRIGÉ DE LANGAGE
EN DEMI.CLASSE
20 minutes
Matêriel
- ooster fourni avec ['atbum
D'oit viènnent les bébés animoux?
Verbalisation et consigne
> Les êtèves reformulent le contenu de ['atbum'
qui sortent du ventre'
> citez des onimoux de I'olbum qui sortent d'un æuf et cîtez-en d'outres
Réponses et apport de vocabulaire
des colonnes' i[ écrit
> Les élèves apportent [es réponses. llenseignanttrace un tableau: dans une
du
ventre de [eur mère'
qui
sortent
ceux
['autre
dans
tes noms des animaux!ui iortent d'un æuJ,
> llenseignant introduit ators les termes d'ovipares et de vivipares'
Dêcouverte du poster et appropriation des termes précédents
> L'enseignant Présente le Poster.
soit écrit'
> sur le poster, pour les onimoux ovipores, l'indice << æuf » est soit dessiné,
R.echerche à
partir des inrages du poster.
>observeleposteretprécisepourchoqueonimols,îlestovîporeouvivÎpore.
mode de reproduc> Les élèves identifient chaque animat puis à t'aide des indices dêterminent son
poster'
du
écrits
[es
lit
['enseignant
tion. Si nécessaire,
È Lenseignant raioute les noms des animaux dans tes colonnes du tabteau.
78
janvrer
20 minutes
Matériel
cartes-images u:
pare ou vivipare?
D-Rom et coffret)
juin
Présentation du matériel et hypothèses
L'enseignant montre des photos d'animaux et demande pour chacun s'iI est ovipare ou vivipare
(cartes-images t dans te DVD-Rom et le coffret).
Pour chaque image, les étèves proposent une réponse: je pense que le petit du canord sort d'un æuf,
je pense que le conard est ovipare.
Cette hypothèse devra être vérifiêe plus tard pour être validêe. Les étèves sont d'accord ou non
avec les propositions et le font savoir.
fication des réponses
Puis I'enseignant dispose face cachée les photos permettant la vatidation. Un élève retourne une
carte, dêcrit ce qu'iI voiti c'est un conard qui o pondu des æufs, le canard est bien ovipore.
Quand tous les élèves ont retourné toutes les cartes, l'enseignant fait ctasser [es animaux ovipares
et les animaux vivipares en accrochant [es photos dans deux colonnes au tableau.
5 minutes
Matériel
photocopie par élève
)age 80 et DVD-Rom)
- ciseaux et colle
Les élèves nomment les animaux. L'enseignant énonce [a consigne et expticite chaque colonne du
tableau avec le symbote qui permet de mémoriser partie ovipare et partie vivipare: t'euf pour les
animaux ovipares et ['æuf barré pour [es vivipares qui naissent comme nous.
Coupe et colle les onimaux dons la bonne colonne: les onimoux ovipores dons lo colonne ovec l'æuf et
les onimoux vivîpares dons lo colonne avec l'æuf borré.
Feuilteter I'album À qui est cet æuf? et découvrir queI animaI va sortir de chaque æuf. Cet album
permet d'observer différents types d'æufs et de dêcouvrir à quet animal it appartient.
Dêcrire diffêrents æufs d'après [eur taitte, leur couteur, leur forme... à partir d'êchantitlons d'æufs
apportés par des élèves ou plus facilement à partir d'ittustrations de documentaires.
Le vivant La vie
animale p§
C[asser [es animaux selon [eur mode de naissance.
€
CEUF OU PAS CEUF?
Découpe et co[[e les animaux dans [a bonne colonne: les animaux ovipares dans
ta cotonne avec ['æuf et les animaux vivipares dans [a cotonne avec ['æuf barré.
VIVI PARE
OVI PARE
f
I
I
I
I
I
l
I
.t 'tl
l
LA REPRODUCTION
F
-
=
rl
J
l
CLASSE ENTIÈRE
REGROUPEMENT
25 minutes
Matériel
- ê[evage de Ia classe
> Dans un êlevage, vous aurez certainement l'occasion d,observer des naissances.
> L'enseignant exptique qu'it y a un papa et une maman dans Ia cage, dans [e terrarium. Comme [es
animaux observês ne sont pas encore des parents, l'enseignant corrige son vocabutaire et apporte
les termes môle et femelle.
Questionnement et hypothèses
> L'enseignant interroge ses é[èves, de préférence avant les naissances.
> Comment vont noître les petits ?
> Certains é[èves pensent que tous tes bébês sortent d'un æuf. D'autres sont ptus informés, surtout
s'its ont un petit frère ou une petite scur et savent qu'un bébé peut sortir du ventre de ta mère.
> Pour les gerbilles, on vo découvrir comment ço se posse: si elles sortent d'un æuf, on verro les morceoux de coquille.
CLASSE ENTIÈRE
R EG
RO U PEM ENT
15
minutes
Matériel
- élevage ovipare
>
Dans [e terrarium des escargots, on observe un iour
des petites boutes blanches translucides plaquées
contre [a paroi du pot en verre et enfouies dans [a
terre.
> Qu'est-ce que c'est? Je crois que ce sont des æufs.
> Qui o pondu ces æufs? C'est l'escargot qui les a pondus !
L'EscARGor
Étntt
uEnmapnnoDtrE, oN NE pEUT pAs
pARLER
DE MALE OU DE FEMEI IF.
> Dans le terrarium des phasmes aussi, on peut observer des æufs, mais ils sont ptus difficites à trouver.
L'enseignant doit guider ses élèves et les aider à distinguer les æufs des crottes.
> Que vont devenir ces æufs? Des petits escorgots ou des petits phasmes vont naître et sortir des æufs.
CLASSE ENTIÈRE
REGROUPEMENT
ro minutes à renouveler
dans [a journée
Matériel
- étevage de la classe
Dans [a cage des gerbilles, les élèves découvrent un
matin la portêe lovée dans un coin.
On ne voit aucune trace d'æuf, tes bébés sont sortis
du ventre.
L'enseignant fait observer ces petits sans Ies toucher
ou les dêranger et fait dêcrire ce qu'on voit.
. Les petits escargots sont minuscutes et [eur
coquiIte est transparente et fragite.
. Les petits phasmes sont à pelne visibtes.
Quelquefois on peut encore observer [a coquilte de ['æuf accrochêe à [eurs pattes.
Les petites gerbitles ressemblent pour ['instant à de gros vers rose foncés. On voit à peine les
quatre pattes, etles n'ont pas de poits, et [eurs yeux sont fermés.
La femelle s'occupe de ses petits sans qu'on comprenne toujours bien ce qu,elte fait.
LEs solNs or re mÈnE voNT TNTERpELLER res ÉrÈvrs cnn srs runrutÈnts soNT BRUseuEs. tLs AURoNT BEsotN
eu,oN
LEUR ExpLreuE eu'ELLE NE FAtr pAs pouR AUTANT MAL À ses prrrrs.
Le vivant La vie
animale
3
CLASSE ENTIÈRE
REG ROU PEMENT
SOUS FORME DE RITUELS Observations
Pour I'escargot. Les æufs pondus sont d'abord ctairs et brittants puis deviennent beiges et ptus
mâts. lts éctosent trois semaines après la ponte. L'escargot grossit et la coquille se colore. Sa taitle
augmente et etle est définitive [orsque sa coquitle a un bourretet au bout de plusieurs mois.
Matériel
- élevage
- appareil photo
> Pour le phasme. Les æufs éctosent deux à quatre mois après la ponte. Le petit ressemble à l'adutte
et il va grandir par mues successives que ['on peut observer (six mues en six mois environ).
> Pour la gerbitle. Les petits naissent après vingt-quatre à vingt-six jours de gestation. lls pèsent trois
grammes et sont dépourvus de poits, sourds et aveugtes. lls ressemblent à de gros versrouges. Au
bout de sept jours, [es poits apparaissent. Au bout de quinze lours, ils se déplacent à ['aveugle dans
[a cage. Au bout de vingt lours, [eurs yeux s'ouvrent et its commencent à manger comme les aduttes.
lls grandissent.
Activités des élèves
Prendre des photos et faire des dessins d'observation,
> Verbaliser les changements et Ies évotutions. Dater ces observations sur le calendrier.
,r§
s
2miJJcD
21ue
ÀgE
+"^L
,,
'
LÉ
6 +êIt'À
âa
Pl+AsH€
LA
l '+'e['À
GEegir-rE
2() minutes
Matériel
- photos prises [ors
du développement
OU
- cartes-images 12:
nages séquentielles croissance
(DVD-Rom et coffret)
L'enseignant distribue [es photos. Les êlèves les décrivent et situent [e moment de la photo.
Retrouvez I'ordre chronologique du développement des petits.
Les élèves accrochent [eur photo au tableau dans ['ordre en justifiant Ieur
ch
oix.
r',
i'
25 minutes
Matériet
- r photocopie par élève
cument page 84 et DVD-Rom)
Consigne
Découpe les étiquettes et colle-les dons I'ordre chronologique.
20 à 25 minutes
Matériel
- cartes-images 12:
ages séquentielles croissance
(DVD-Rom et coffret)
L'enseignant montre des images séquentietles de [a croissance du poussin ou de [a grenouille
(cartes-images 72 dans [e DVD-Rom et [e coffret).
Les élèves décrivent Ies images et font des observations.
L'enseignant invite les étèves à remettre Ies images dans I'ordre chronologique et les incite à justi-
fier [eur choix. ll les pousse à utiliser des connecteurs temporels.
Le groupe valide. La chronologie peut être verbalisêe à nouveau
et prise en dictée à I'adutte.
Le vivant La vie animale
§§
Ordonner les êtapes de développement et de croissance des petits.
€
DES PETITS QUI GRANDISSENT!
Cotte les illustrations dans ['ordre chronologique.
t+++l
LII-L]
tl
DocUMENTAIRES AUToUR DES ANIMAUX o,ÉtevAce
L'escargot
Le Iapiq
: -: sa;=;-lcÊÊ ;:ati.ii"elies
.:,ri:,
t!,1
:je
ril jeitre:se
aA
@@
Mes premières découvertes
Gerbil[es
O Gallimard jeunesse . 9€
Une cottection de documentaires avec
a.l:ir .ia 9t:
-= coLlection de documentaires formi-
::
es pour parler de diflérents animaux
. =: humour et vérité scientifique. Existe
, - - - [e [apin, l'escargot et [e phasme.
-
@@@
Heike Schmidt-Rôger
O Editions Ulmer
.
2oo9
.
Z,9o€
Un documentaire reLativement accessibte
si on s'en tient aux photographies et à
quetques textes courts.
votets transparents. Existe pour le poisson,
['escargot et Ie Iapin.
ALBUMS AUTOUR DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE
3@@
6à6à
\_-/ \-./ 6à
\_-,/
6à 6à
Qui a mangé?
--:-7
. t4€
-"album graphique d'un escargot qui aimerait bien se méta'irorphoser en un autre anima[.
Anne Crausaz
O Éditions MeMo
.
2011
.
12,20€
À chaque page un tégume a été
mangé... Qui se cache là-dessous
?
6À
/â
Le voyage de ['escargot
Le petit poisson rouge
Ruth Brown
O Gaitimard jeunesse
Eric Battut
Le
.
2ooo
.
12€
trajet d'un escargot dans
félan vert . 2012. 12,20€
Une revisite du conte Le petit
choperon rouge avec un pois@
une petite parcetle de fardin
quand it pense gravir des obstactes incroyables.
5On rouge.
@@
@@
JEUX AUTOUR DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE
6à
@
Puzztes Les animaux
Encastrement ANIMO
poisson
:
ref. 3t33o9375t56o
. A-Nathan
partir de 28,5o€
Quatre puzzles composés de
trois pièces avec des photos
réettes d'animaux.
O-Goula rel. 74o -126.79oo2o
. A partir de 9,5o€
Encastrement en bois de
quatre pièces.
Puzzle [apin
Puzzle en hêtre massif de sept
pièces. Existe aussi pour le
lapin, [e papitlon, [e poisson.
O Au bois enchanté
. A partir de 29,90€
Un puzzle en hêtre massif
de sept pièces peint à [a main.
OUVRAGES AUTOUR DE LA REPRODUCTION
6"ÿf
@@
Chris Haughton
@ Thierry Magnier
apa ma maman
.
2011
.
14,80
€
Un bébé chouette tombé du nid
ne retrouve ptus sa maman.
Bénédicte Guettier
@ Loulou & Cie
@@@
@@
@@@
Un peu perdu
,;."ô
.
2oo9
.
11,20€
Un imagier des papas, des
mamans et des bébés.
Lucas et Lola aiment
tes bébés animaux
Sylvie Misslin et Marie Paruit
O Amaterra 2014. 72,95€
Steve lenkins
@ Circonftexe
Un livre animé pour découvrir
[es animaux et Ieurs petits.
Un atbum qui explique comment certains animaux s'oc-
. zot1. tz€
cupent de Ieurs petits.
2
6à
@@@
Petit, petit, petit
!
Stéphane Frattini
O Mitan
.
2oo9
.
72,90€
Un livre à votet permettant
d'associer un petit animat
à sa maman.
D'où viennent les bébés
animaux?
Anna Milbourne et Serena Riglietti
o Éditions Usborne 2ot3.9,5o€
.
Chouchou sait que tes bêbés
manchots sortent des æufs.
Une discussion avec un bébé
phoque lui apprend qu'il n'en
est pas ainsi pour tous.
6à
@
À qui est cet æuf?
Troughton
O Piccolia . 2013.
Maxidoc:
de ['æuf à [a poute
GUV
Ce superbe
12€
album itlustre
@ IMitan
[e
monde merveilteux des ceufs et
des bêbés animaux. Huit æufs
sont prêsentês... Qui en sortira?
jeunesse. zoro.8,9o€
Un documentaire géant avec
des textes simptes pour visualiser les étapes de dévetoppement du poussin, de t'æuf à ta
po
u
le.
OUVRAGES AUTOUR DE L'ALIMENTATION
6à
6à6à6à
\, \_-/ \--./
@
Ctaude Boujon
Keith Fautkner et Jonathan Lambert
Françoise Laurent et Capucine Mazilte
@ Les éditions du Ricochet . 2014 .
loisirs.2oo7.77,zo€
Monsieur Lapin n'aime ptus les
carottes. lt quitte sa maison
pour aller regarder dans
['assiette de ses voisins.
O Casterman
6è)
6à
@ L'écote des
. 7996. :12,95€
Un [ivre animé dans lequel [a
grenouilte à grande bouche
demande à plusieurs animaux
ce qu'its mangent.
Bon appétit les animaux!
tz,5o
€
Un documentaire pour dêcouvrir
tous les régimes alimentaires
des animaux!
C'est l'heure de manger
Steve Jenkins et Robin Page
@ Circonflexe 2o13 . 10€
Un documentaire qui permet de
découvrir ce que mangent les
animaux.
I
VI
88
Dossier iardinage
Notions pour I'enseignant
9o
Trucs et astuces
92
Silence, ça pousse!
Graine ou pas graine?
Du bulbe à ta fleur
101
103
Le cycte du blé
ro6
Ouvrages autour de la vie végétale
Exploitation de sorties
110
94
Les notions abordées
a7
ttl
et porteur de sens pour les enfants dès l'école materne[le,
pas à garantir la réalisation de ce proiet.
malheureusement
ne
suffit
enseignant
d'un
enthousiasme
mais [e seul
Créer et entretenir un jardin est évidemment un projet motivant
AVANT DE COMMENCER
Se renseigner sur t'événement
Travailler avec des partenaires
> I[ vous faut t'appui total de votre école et surtout [e soutien de [a
municipatitê.
o Les terrains de t'écote appartiennent à Ia mairie et les aménagements permanents nécessitent son accord.
. La mairie peut apporter un soutien [ogistique pour [a mise en ptace
de bacs ou de ptates-bandes. Ette peut aussi accorder un soutien
financier pour l'achat de Ptantes.
. Des agents municipaux peuvent vous aider à rendre [e terrain
cuttivabte, à arroser, à entretenir.
> Commencez par de petites surfaces pour garder la maîtrise des ptantations et de ['entretien des parcettes.
> Renseignez-vous et recherchez des bênévoles auprès d'associations.
Créer du [ien social, des rencontres entre générations
> lnvitez des personnes âgées ou non, passionnées de iardin et ftattêes de transmettre des savoirs à [a jeunesse, ravies d'apporter de
l'aide pour l'entretien (arrachage des mauvaises herbes, taitte...).
La semaine du jardinoge à l'école
> Cette semaine est parrainée par les ministères de l'Éducation
nationate, de l'Écotogie et du Développement Durable. Connaître
[es partenaires et tes distributeurs pour chaque région de France.
S'organiser dans [e temps
> Avant de démarrer te projet, choisissez les ptantations selon [a saison et [e temps dont on dispose, en prenant en compte notamment
les vacances scotaires.
Se poser les bonnes questions
o Quetqu'un peut-il s'occuper du jardin pendant les vacances? Seton [a
réponse vous pourrez cuttiver ou non des ptantes qui se récottent en
automne, des ptantes qui poussent sans entretien ou des ptantes qui
ont un grand besoin en eau.
. 0ù y a-t-il du soleil et un point d'eau dans [a cour?
. De quet budget disposons-nous? Les graines, bulbes et autres
ptantes à transptanter ont un coût car chaque élève va les utitiser.
Consulter absolument [e site fardinons à l'école
www.ia rdinons-alecole.org
> C'est une véritabte mine de renseignements pour dêmarrer un lardin,
notamment pour connaître les dates de ftoraison et de récottes.
Carottes
Courgettes
Fèves
Haricots et petits pois
Laitue
Mai's
Mars à juin
Entre3et5mois
Entre2et3mois
Entre3et4mois
Entre2et3mois
Mars-avril
Environ 2 mois
Nlai-juin
Avrit-mai
Environ 5 moîs
Septembre-octobre
Mars à juillet
Mars à mai
Jacinthe
Septembre-octobre
Entre3et6semaines
Avril à août
Entrezà4mois
Juillet à octobre
rit-m
a i
Ma
Septembre à mi-octobre
Novembre à février
Se
Avrit-mai o Juittet-août
-u
n
luin juillet
-
'
Septembre - octobre
Toute ['année
à novembre
Toute l'année
Mars à août
Octobre à décembre
Mars à mai
Octobre à février
2 mois plus tard
Septembre à janvier
Décembre à mai
Septembre à novembre
Février à mai
Muscari
Septembre à novembre
lvlars à mai
Mars à juin
luin à octobre
Arums
re-n ove m b re
IVla
avr
Février à mai
Crocus êt ionquille
Glaleuls
b
mai à octobre
Mars à mai
Mars à juin
Janvier à mars
Dahtia
ptem
Avrit-mai
Septembre-octobre
Perce-neige
ju in
Mars à juittet
Framboisier
Tulipes
IMa i-
Juin à septembre
Ivlai à iuittet
Entre3et5mois
Entre5et6mois
Av
traisier
Amarytlis
Juin-novembre
mi-luiltet à octobre
Avrit-mai
Tomate
Basilic
Menthe
Ciboulette
Persil
ln
Février à avril
Pommes de terre
Potiron
Radis
lMa i- ju
I\,1ars à
juitlet
Mars à mai
Juillet à septembre
Juin à octobre
JARDINER EN PLEINE TEBRE OU EN BACS
?
.lravail de ta terre est une activité particutièrement pertinente pour
..
--
enfants de maternelle. prévoyez au moins trois séances pour
ser chaque outil et enlever les cailtoux, aérer et aplanir te terrain,
- =re si les aduttes ont déjà rendu ce terrain cultivable.
.-:lner en pteine terre permet d'utitiser correctement tous les outits
= lardinage. La surface doit être attongée, ni trop [arge pour ne
.. être obtigé de piétiner la terre, ni trop étroite pour éviter les
.,:rdents de serlouette et de râteaux. Aménager un terrain en plate.-Ce est une bonne solution et les élèves restent propres,
Pour les écoles qui n'ont pas de possibilité de travaiIer directement
[a terre, la culture en bacs permet néanmoins de réatiser un jardin,
la hauteur des bacs correspond à la hauteur des cuisses des élèves.
Utitisez les bacs pour planter plutôt les plantes vivaces et persistantes (butbes, ptantes aromatiques, fraisiers), afin que ces ptantes
ne vous gênent pas l'année suivante pour travailter [a terre d,un
espace que vous remanierez chaque année.
N'oubliez pas d'utitiser l'espace vertical [e long des clôtures, les
plantes grimpantes sont vigoureuses et ont plein d,astuces pour
s'accrocher.
rpproche sensorielle du jardin et du.iardinage correspond bien à l'âge des élèves de maternelle
et peut être facilement associée à d,autres
oiets menés dans [a classe. ll n'est évidemment pas nécessaire de planter les six coins ci -dessous.
Iarrosoi
r
La fourche
4
r
Le transplantoir
Le ptantoir
à bulbes
Le râteau
lnstatlation d'un compost et d'un récupêrateur d'eau en concertation avec [a municipatité
Le vivant La vie végétaie
I
Les plantes sont des organismes autotrophes, c'est-à-dire capabtes
de produire leur propre matière organique à partir du Co, de l'air,
des sels mlnéraux du sot et en utilisant l'ênergie sotaire. E[les se
distinguent égatement des animaux par [eur enracinement dans [e
sol pour un grand nombre d'espèces et donc d'une faibte mobitité.
Le terme de vêgétaux n'existe ptus dans la ctassification actuette des
êtres vlvants. Les plantes vertes regroupent les algues vertes, les
mousses, tes fougères, les conifères, les angiospermes (ou plantes
à fteurs). C'est ce dernier groupe qui est étudié dans cette partie.
ptante est un organisme moins comptexe qu'un animaI du point
de vue de ses tissus et organes. Ette est constituée de racines, tiges,
feui[[es, bourgeons, fleu rs.
LJne
Un butbe est un organe végétat souterrain formé par un bourgeon
entouré de feuilles rapprochées et charnues.
Les feuilles externes sont mortes, desséchêes et ont un rÔ[e protec'
teur. Les feuittes plus internes sont remplies de réserves nutritives
qui permettent à ta ptante de reformer chaque année ses parties
aérien nes.
Certains bulbes s'achètent et se ptantent à ['automne: amaryltis'
jacinthe. D'autres se plantent au printemps: crocus narcisse, iris.
tulipe, muscain.
Pour une plantation en pleine terre, en règte gênérale' iI faut planter
tes bulbes à une profondeur égate à deux fois sa hauteur et utitiser
de préférence un plantoir à butbe.
et protège I'embryon vé'
gétat obtenu après fêcondation de ['ovute. La graine permet une
Une graine est une structure qui contient
reproduction sexuée, la nouveIte plante combine les informations
gênétlques des gamètes mâles et femettes.
La graine est ette-même souvent contenue dans le fruit. lI existe
quatre sortes de fruits:
- tes fruits charnus à plusieurs graines comme la pomme,
- les fruits charnus à une seule graine comme la cerise,
- les fruits secs à plusieurs graines comme la gousse de haricot,
- les fruits secs à une seule graine comme Ie gland.
ATTENTION. Le classement fruit et tégumes correspond à une habitude
atimentaire et ne repose en rien sur une distinction botanique: certains tégumes sont des fruits charnus comme [a tomate, d'autres des
fruits secs comme les haricots. Les épinards, choux, salades sont des
feuittes, on mange t'inftorescence de l'artichaut, la tige et la racine de
[a carotte, les tubercutes de la pomme de terre, [a tige renflée du céteri.
Trois facteurs sont déterminants:
- [a température,
- t'humidité,
- ['oxygénation.
Attention à certaines idées reçues: les graines n'ont pas besoin de
tumière pour germer et heureusement car c'est très sombre sous [a
te rre
!
Phénomène de dormance: certaines graines doivent subir une période de froid avant de germer, cette dormance en climat tempéré
préserve les graines d'une germination prématurée en automne.
À savoir en conséquence: pour faire germer des pépins de pomme,
les placer trois semaines au rêfrigérateur.
> Le tronc de t'arbre correspond ainsi à une tige, c'est-à-dire ['organe
qui permet ta circutation de la sève et [e port de [a plante'
> Une ptantute est une jeune pousse issue de l'embryon après germination de [a graine.
9o
It suffit de ta mouiller sans [a noyer' En plus de ['eau, la graine dolt
être oxygénêe. Le substrat (terre, coton.") permet de contenir ['eau
tout en permettant une aération.
Le substrat n'est là que pour conserver I'eau nécessaire à [a graine,
[a graine ne monge pas [a terre, elte possède ses propres réserves et
la ptante n'utitisera que ptus tard les sets minéraux du sot. Lors de la
croissance de ta ptante, [a terre permet un meitleur enracinement de
[a plante, tes plantutes du germoir et du coton ptoient et retombent
sur le côté au bout d'un moment.
La tongêvité des graines est variabte d'une espèce à ['autre, en
moyenne de deux à cinq ans, et dépend beaucoup des conditions de
conservation (tempêrature et degré de dessiccation).
stades de la germination
Premières feuilles
.
- Coÿlédons
type de reproduction permet l'obtention d'une nouvette ptante qui a les mêmes quatités
que [a plante mère.
La muttiptication asexuée naturette s'opère à partir :
- des bulbes (attention, [à aussi [es bulbes ont besoin d'une pêriode de froid pour fleurir),
- de tiges rampantes comme [es stolons,
- de tiges souterraines comme les rhizomes et tubercules.
[homme a inventé d'autres opérations comme [e bouturage, le marcottage, te greffage, la culture en tube.
La reproduction asexuée est un moyen de reproduction plus sûr et plus rapide que [a reproduction sexuée.
Ette peut être naturette ou engendrée par ['homme. Ce
t
I
Ce qui peut poser problème
> Le vivant est souvent représenté par les animaux. En faisant pousser une plante, l'enfant va se rendre compte qu'etle a des
besoins nutritifs, qu'elte se développe, se reproduit et meurt.
> La représentation d'une ptante pour un enfant de maternette correspond à une fteur. Ce mot fteur est pour eux un terme
générique qui désigne aussi bien [es feuitles qu'une plante. C'est pourquoi beaucoup de petits désignent par Ie mot fteur des
étéments qui n'en sont pas comme Les feuitles, Ies petites plantes herbacées.
> Les enfants ne savent pas définir [a graine par sa nature, mais ils possèdent déjà des connaissances sur sa fonction et son
besoin en eau. lls ont souvent une représentation fausse concernant [e besoin en terre: si le plus souvent une graine germe
dans [a terre, ceta n'est pas une nécessité pour elle, mais même en expérimentant des germinations sur du coton, ou directement sur un germoir, cette représentation du besoin en terre persiste Iongtemps.
Le vivant La vie végétate
pl
Quelles graines utiliser ?
Iutllisation de graines variées permet d'aborder les notions de tormes et de grandeurs et d'associer un type de graine à une plante
précis=
Les graines sélectionnées ci-dessous ne demandent aucune précaution particutière et germent rapidement. Vous pouvez réduire les coûts =privitégiant des graines que ['on peut acheter au rayon atimentaire de magasin bio ou non (tentittes, haricots, pois chiches, soja, mais, alfa .
-^..^
u/etile_-.1-
\
Les graines de
Les graines de haricot
radis
Petites graines claires qui germent
très rapidement. Le [égume radis
s'obtient trois à quatre semaines
après [a germination. Pour observer
ces petits radis, il faut ctairsemer tes
plantules: les élèves ont tendance
à planter trop et à trop serrer. Pour
que la racine du radis grossisse et
Morphologie la plus caricaturale
de la graine. Existent en plusieurs
couleurs. Germination facilement
observable même pour un petit,
et rapide (48 h) : au bout de trois
semaines, la plante a produit
plusieurs stades de feuiltes.
i
devienne le radis, arracher les plants
trop rapprochés.
Les lentilles
Brunes ou vertes,
germination également
très rapide (z4h).
Les graines de basilic
Très petites et noires. La germination est visible au bout de
cinq à sept jours. lntéressantes
à comparer aux graines ptus
rapides de radis, haricot,
lentittes, car du coup on a
['impression qu'iI ne se passe
rien jusqu'à ce que...
de petits pois
Germination comparabte
à ce[[e du haricot mais
[es feuittes découpées
de [a plante sont très
d
iiférentes.
t
La ptantule sort de [a
coque, bel effet!
Graines un peu plus petites
que [es graines de haricot,
mais le soja fait partie de ta
même famille. Germination
visibte au bout de 48h.
Alfala, Iuzerne
Les pois chiches
Germent au bout de
quatre ou cinq lours.
Lem
ll germe au bout
d'une semaine.
tes cargopses:
fruits secs dans
tesquels t'embrgon
est intimement
soudé. On parte du
coup de grains et
non de graines!
Le blé
On peut extraire [es grains
directement de l'épi, ce
qui permet un bon support
pédagogique pour visualiser
le cycle d'une plante.
,!
I
§*
§
.Le gazon
Mêtange de caryopses de graminées,
l'ensembte ressemble à des débris
de foin et n'est pas immédiatement
identifiable comme groines.
Au début, on pense égatement qu'iI
ne se passe rien, mais i[ germe au
bout de sept à dix jours.
)ans quoi planter?
Germination sur du coton
: r bstrat
> Recouvrir une barquette de coton, placer les graines, recouvrir
-:
TERREAIJ
:
-erreau est [e substrat idéat: c'est une terre enrichie en matière
..nique et minérate. C'est un substrat plus léger que la terre grâce à
,
-'ésence de fibres et d'écorces.
_: ÏERRE
. -:rre est un substrat
.
natureI dont la composition est essentiettement
=rminée par [a nature de [a roche mère. Elle varie ainsi énormément
les régions.
.:r
.:
COMPOST
.
-ompost est [e rêsultat du recyctage et de [a décomposition de ma.-=s organiques. Son rôle principaI est d'enrichir le soI ou [e terreau
ricro-organismes, éléments minéraux et humus. ll doit être mêlan:.. la terre et ne peut pas être utilisé pur.
de
coton et arroser sans noyer.
§. On peut utitiser un cure-dent ou une pique à brochette avec [e nom
de [a plante et quetques graines scotchées.
Les graines ont besoin d'eau pour germer mais égatement
d'oxygène. Lors de l'arrosage, iI ne faut pas noyer le mitieu, [a
graine serait asphyxiée et ne germerait ptus. Pour éviter que
['eau ne stagne au fond du pot, utitiser de préférence des pots troués
au fond.
Pour les plantations dans du coton, étiminer ['eau qui n'a pas été absorbée par les fibres de coton.
De manière générale, les germinations ratées [e sont essentiellement
parce qu'elles ont été trop arrosées.
-:S COPEAJX DE BOIS OU SCIURES
-: copeaux de bois peuvent remptacer le terreau pour les bricolages
. -ête à cheveux (page 98 et fiche de construction r).
-convénient. Pour des enfants qui ont toujours ptanté dans du terreau,
ser des copeaux ne correspond pas à un réeI réinvestissement, il
.-ait plus pédagogique de faire une étape pour montrer aux enfants
-: Ia terre n'est pas indispensabte à [a germination et utitiser d'autres
,:strats (coton, rien comme le germoir, copeaux).
-,antages. Les copeaux de bois ou sciures sont moins satissants, ils
, -t trop gros pour passer à travers Ies mailles du coltant, Ia tête
,.enue est moins [ourde et conserve plus facilement sa forme ronde.
:
écipients: acheter ou récupérer
.
Gobelets en plastique. À percer au fond.
.
Pots en verre de confiture.
Attention de ne pas asphyxier les graines
.l'arrosage. En plaquant les graines contre les parois, mise en évi-ence du système racinaire à moindre frais.
.
Pots en terre. De préférence troués au fond.
.
Jardinières
.
Pots en terreau. A acheter en jardinerie. Très pratiques pour transplan-
:er dans [e jardin de ['école.
.
Bacs en ptastique.
.
Autres. Amusez-vous en détournant des objets (vieittes basl<ets, boîte
à æufs, valise, boîte à thé...) et lancez-vous dans un proiet artistique
À récupérer chez te fteuriste
Plantation de bulbes en intérieur
De nombreux bulbes sont toxiques et les étèves ne doivent
jamais porter les butbes à [eur bouche.
Pour faire pousser des butbes dans sa ctasse, si on veut qu'ils
fteurissent, il faut [eur faire subir un traitement spéciat appeté forçage.
Les bulbes doivent être placés au réfrigérateur pour une durêe de 6
semaines. Le forçage évite que la tige et les feuittes ne se dévetoppent
avant les racines et ne permettent pas [e fleurissement.
On peut pratiquer [a cutture en carafe dans des
vases spéciaux mais on peut également les
fabriquer soi-même en coupant une bouteille
d'eau minérale en deux. La partie supérieure est
placée retournée sur [a partie inférieure. Dans
cetle ci, on place le butbe qui doit affleurer ['eau.
ro hème.
Cermt§maÊiog's dams *êil
l,4ettez vos graines à tremper [a veille dans un
,
On peut
germo§r
bol d'eau.
Répartissez les sur les plateaux du germoir.
Rincez et arrosez matin
la coupetle du fond.
et soir. lleau en surptus tombe
dans
égate-
ment pratiquer [a culture à [a chinoise
dans un récipient peu profond. On y
étate une couche de gravier.iusqu'à
mi-hauteur, on place ensuite les bulbes
bien serrés en évitant qu'ils ne se
touchent. 0n remptit d'eau lusqu'au
niveau supérieur du gravier et on com-
ptète avec une deuxième couche
de
gravier pour bien caler [e tout.
Le vivant La vie végétate
pl
F
SILENCE, ÇA POUSSE!
=
Découvrir les différents stades
de la germination d'une graine
lr!
J
ETAPE T
L'enseignant tit t'album Touiours rien?
L'enseignant a apporté des graines dans Ieur sachet d'achat: radis, haricots, soia, basilic
ll Ies sort pour les montrer à ses êlèves. Qu'est-ce que c'est? Des groines'
Qu'est-ce qu'une groine? On la met dans la terre.
ll fout l'arroser et après Ça pousse.
L'enseignant invite à deviner son proiet.
Touiours rien
O Éditions du Rouergue
.
?
Christian Voltz
1999 . 11,7a€
- pots en terre cuite
- z cuitlères
- terreau
- ptusieurs sortes de graines:
haricots, soia, radis, basitic
À votre ovis, pourquoi oi-ie ocheté des groines ?
Pour Les planter, comme Monsieur Louis !
It dévoile [e reste du matêriet: les pots, [a terre.
Comment doit-on foire pour les planter? llfaut
mettre de la terre et les graines dans les pots.
Deux par deux, des enlants vlennent au centre
du regroupement pour ptanter les dlffêrentes
graines dans les différents pots. Un échanti[lon de chaque gralne est disposé dans une petite assiette pour se rappeter comment étaient [es
gra
r
n
es.
euand les graines sont plantées, [es enfants verbatisent. D'abord, on remplit le pot ovec la terre en
à'une cuillère. Après on creuse un trou avec le doigt. Ensuite, on plante quelques graines et
on les recouvre ovec la terre. À la fin on arrose.
se servant
rur à I'album
faut attendre, comme Monsieur Louis.
page
où Monsieur Louis dit: «Je t'attends», puis tourner [a page
de
l'atbum
la
à
nouveau
Montrer
et expliquer qu'it va fatloir taisser passer plusieurs journées et plusieurs nuits avant de pouvoir
observer te rêsuttat. Nous ollons dormir, et choque matin, quond vous orriverez à l'école, nous obsetverons nos plontotions pour voir si ça o poussé.
Et mointenont, que doit-on foire ? ll
94
@@
,,r. iuin
P5.MS
ETAPE z
15
minutes
> L'enseignant dit qu'it connaît d'autres façons de ptanter des graines.
Matêriel
- barquettes
- coton
- germorr
les de haricot, soja,
lentilles, basitic
Dons lo terre, on ne voit pos ce qui se posse, on est commeMonsieur Louis, on ne soit pos si ço pousse
ou non. Moi, je connois deux outres façons de foire germer les groines et on pourro tout voîr.
oposition d'autres dispositifs de plantations
> L'enseignant explique à ses élèves deux autres façons de [aire germer les graines.
> Sur d u coton. Prenez une borquette, recouvrez-lo de coton, posez les graines dessus, recouvrez de
coton et orrosez légèrement.
UTtLTSER DES GRAINES DE HARICOT, DE
SO]A, ET DE BASILIC
ê
§
."ÿ
N
Dans un germoir. Prenezlesgroinesmisesôtremperdansunverre,réportissez-lessurunétogedu
germoir et ortosez-les !
UTtLtSER LEs GRATNES DE soJA, RADts, LENTILLEs. EvtrER LEs GRossEs GRAtNEs coMME LE HARtcor.
ETAPE 3
20 à 30 minutes
L'enseignant fait nommer [e matériel. Les enfants rêinvestissent t'étape précédente en reformulant
Par étève
ce qu'its vont faire.
:
r gobelet transparent
percé au fond
:rochettes sectionnée
en 2 morceaux
Pour le groupe:
-des graines de radis,
sola, haricot et basilic
- des cuiltères
- du terreau
-Jettes prénom et des
ec [e nom des graines
Choisissez vos groÎnes et plontez-les dons un petit pot. Essoyez de ne pos renverser la terre,
ipulations
À tour de rô[e, chaque enfant remplit son pot, décide de ce qu'it souhaite planter. Pour un petit de
quatre ans, ta tâche n'est pas si facile et correspond à des objectifs de motricité fine. L'enseignant
jette un coup d'æil à l'arrosage pour réguler.
Chaque élève précise sur son pot queltes graines iI a ptantées grâce à des étiquettes.
Le vivant La vie
végétale
pJ
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
15 à 20 minutes
Prt4semtation du matéri*l
*
-
1-
os retraçant les étaPes
plantations (DVD-Rom)
- 4 iItustrations retraçant
Les étapes des plantations
(nTatériet page 99 et DVD-R0m)
P5.M5
Érnee 4
L'enseignant montre tes photos. Les étèves
font Ia correspondance entre [es actions
montrées et leurs actions précédentes.
trdre
e"
chrcsio{ogielue dee êtaP*s
llenseignant demande d'accrocher au tableau
[es photos dans ['ordre chronologique.
De ta phcto à t'image
r
llenseignant montre ensuite les illustrations.
Les étèves verbalisent à nouveau chaque
action et associent l'image avec la photo,
ce qui les amène à ordonner les images
dans ['ordre chronotogique'
ACTIVITÉ INDIVIDUELLE
15 à 2()
minutes
tfiatérieI
- r photocopie Par élève
(document Page 1oo., rvr--1:[]
ii-À55Ë EruT:àRË
i{ $És R0,,1 pË l\4 [!§T
5 à ro minutes par iour
sous forme de rituels
r.fl
Émpr
PS.Ms
s
Frê*entatio* du mat$rieT
r, llenseignant montre Ie document et l'exptique.
eonsigne
* Colle les itllustrotions dons I'ordre chronologique.
P5.M5
Érnpe o
I
fdatérieI
- [es plantules des étapes I et z
- r appareil Photo
Tous [es jours, [es étèves observent tes pots en germination. L'enseignant prend des photos.
font apparaître des évolutions successives.
Certainesplantationspoussentplusvitequed'autres:onvoitquelquechosesortirdeterre.
Les dilférentes phases de dêvetoppement
.
autres pots, il faudra encore attendre (bosilic)'
. Dans le germoir et sur le coton, lo graine a grosst.
Pour
Les
LES GRAINES precÉEs
.
.
La
La
onus
peou de lo graine s'est déchirée.
plantule se développe et forme des racines et une tige'
Au eour DL L-5 ouos, oN
.
UNE ASSIETTE PERMETTENT LA coMPARAlsoN'
Lo racine, ta tige,
le
pFUT DTSTRTBULP
tr\E
Pl
aNIULI
DE
soiA À C\AQLE
ÉLÈvF.
reste de lo graine et même des petites feuilles opparoissent au bout de 4-5
iou'.
LES DEUX COTYLEDON:
LA PTANTULE DU HARICOT MET BIEN TU ÉVIOTNCE LE SYSTÈME RACINAIRE DE PLUS EN PLUS POILU:
DE LA GRATNE QUt s'ouvRENT PouR LAlssER SoRTLR LA TIGE.
oN volr QU'lL S'EST PAssÉ
LES GRATNES DE BAs L c soNT pLUS DtFFrc LES À oBSERVER. AvEc LES GRAINES DE RADIs
NE SONT PAS AUSSI MANIPULABLES ET OBSERVABLES
QUELQUE CHOSE ET QUE LA GRATNE I CEnmÉ mnts nu oÉaur ELLES
QUE LES GRA NES DE HARICOT OU DE 5O]A
> En distribuant une plantute de sept iours aux étèves, et en demandant de toucher les racines de
la
ptante, [es étèves vont constater qu'ettes sont mouiltées, ['enseignant [eur exptique que [es racines
permettent à la ptante d'aspirer I'eau comme une petite pailte.
> L'enseignant nomme et fait répéter [es termes feuilles, tige et rocines.
96
@ @ ru"
15
*
minutes
lffiatériel
Par étève:
- r feuitle A4
1 crayon à papier
iuin
ETAPE 7
Dessinez lo groine qui o germé ovec lo tige, les racines,
les petites
feuilles.
À la fin de la séance, l'enseignant annote les dessins
des étèves.
[,\\o§,T]l
.
.r.
N,lo$l
I
.v?. L.t LY6
\_t
',L
__ ogrclNf_
Étnpt a
15
,s-images
minutes
Matérieâ
13 : germination
aine (DVD-Rom et coffret)
rt-mêtrage sans parole de
ian Voltz Der kleine Kriffer
Découverte des cartes et commentaires des élèves
L'enseignant a posé toutes les cartes face cachée. Les étèves tes retournent au fur et à mesure et
expticitent ce qu'its voient.
L'enseignant induit un ctassement graines de l'atbum ou graines rée lles.
Les élèves essaient d'associer [a photo avec une ittustration (cartes-images 13 dans te DVD-Rom et
Ie coffret.
L'enseignant leur demande d'observer ce qui n'est pas iuste sur les ittustrations de l'album.
. lln'y a pas les rocines!
o Nous, on a des petites
feuilles, pos une fleur.
graine
Et
la
pour
s'ouvre
laisser pousser les feuilles, elle sort même de lo terre en vrai. Ce sont les
'
rocines qui restent dons la terre.
L'enseignant montre également [e film Monsieur Louis und der kleine Ktiffer directement inspiré de
['atbum Touiours rien et réalisé par Christian Voltz Iui-même. Le film permet d'appréhender davantage la notion de durée. La germination permet de structurer le temps qui passe. La fin de t'atbum
a été [égèrement modifiée, une seconde fleur pousse pour Monsieur Louis.
Le vivant La vie
végétale
ÿ/
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8Ér-Èvrs
ETAPE
PS.
9
M5
zo minutes
Pour [es PS:
germination
du haricot en terre
.r frise
de la pâte à fixer puis de Ia colte
- 4 photos de
La
Pour les MS:
-5
photos de la germination
du haricot en terre
-5 photos de [a germination
du haricot sur du coton
-5 photos de [a germination
du'adis du ge"noir
- 5 photos de La germination
du radis en terre
- z, f"ises ba-oearx de pap e.
cartonné de zox6ocm
' de Ia colte
Avec des PS, chaque groupe ordonne quatre photos de germination identiques du haricot
dans Ia terre.
Avec des MS, la ctasse est divisée en quatre groupes. Chaque groupe ordonne cinq photos
de germinations différentes.
. Germination du haricot dans Ia terre.
. Germination du radis dans le germoir.
MatêrieI
-
r photocopie
par élève
du mini-livre de la germination
(DV D-R o m)
- crseaux
Germination du haricot dans du coton.
Germination du radis dans [a terre.
L'enseignant présente les photos prises auparavant. Les étèves commentent chaque photo.
Les photos rangées, Ies êlèves retracent verbalement Ies différentes étapes de la germination.
lts cotlent tes photos sur le bandeau de papier pour réatiser une frise chronotogique. Les photos
sont d'abord fixées avec de [a pâte à fixer puis collées définitivement à [a fin.
ETAPE
25 à 35 minutes
.
.
ro
MS
Distribution du matériel et réalisation du mini-livre à partir de [a gernrination de la graine de haricot
> L'enseignant distribue [e document qui retrace les étapes de [a germination en cinq étapes.
. La graine est plantée dans [a terre.
. Une radicute sort de la graine.
.
.
.
Le système racinaire se dévetoppe.
Les cotylédons de ta plantule émergent de [a terre.
La ptante a deux feui[[es et deux coty[édons
> Le [ivre est déjà prédécoupé, mais avant te pliage les iltustrations paraissent être à l'envers (voir
Trucs et astuces page 12).
> L'enseignant aide les étèves à plier et à réatiser [eur mini livre.
> La dernière page est Iaissée btanche pour [eur permettre de dessiner, d'écrire te moi
GRAINE.
> ll est possibte de proposer la fabrication d'une tête à cheveux avec un coltant et des graines
gazon à partir de ta fiche de construction r (DVD-Rom et coffret).
98
de
Érnprs
DES PLANTATToNS
I
I
I
I]
UNIVERSITÉ PNRIS EST
CRÉTEIL
EU DE L'IUT DE SÉrUENi.-.-
Le vivant La vie
végétale
tp
T_l
-@
Ui
E
.o
P
(§
P
C
a
o
l/)
!
OJ
l,
(u
o_
(o
tl
P
\(Ll
(,
(u
L
q)
C
C
o
EL
o
c\..
O
LU
z
t
CI
oi
=
o
'b,,
É
LU
F
Z
J
o_
a
l
C
o
o
-o
!-
-C
U
OJ
l-
Elo
(/)
E
(o
E
(,
C
o
'{=
(§
!-
+J
(.r)
l.ll
LU
à
a
J
=(,
q
o
o
U
RAINE OU PAS GRAINE
GRAINE
GRAINE?
Expérimenter pour déterminer ce qui est une graine
I
ETAPE T
Les étèves connaissent déjà t'atbum Toujours rient
Après ta lecture de L'histoire du bonbon, l'enseignant questionne ses étèves.
Est-ce qu'un bonbon peut pousser comme on le roconte dons cette histoire?
Les élèves se doutent bien que non, mais la situation est tentonte, ils se prêtent volontiers ou jeu.
stionnement
L'enseignant utitise cette motivation pour les faire s'interroger. Comment pourroit-on le vêrifîer?
On n'a qu'à le plonter comme les groines, on l'orrose, et on attend pour voir s'il pousse!
L'enseignant sort un bonbon du matérieI et dévoite [es autres oblets sans montrer [es embaltages.
Les étèves vont reconnaître notamment tout ce qu'its ont délà mangé: coquiltettes, pois chiches,
tournesot. La semoule va les induire en erreur par sa forme et le fait que [e couscous est aussi
appeté graine. Les graines de haricot, Ientitles et soia sont identifiées comme graines grâce au
chapitre précédent et prennent un rôte de témoin.
lerche
Triez ce quî est une groine et ce qui n'est pas une groine.
Les élèves vont voutoir répondre immédiatement. L'enseignant les pousse à entrer dans un
protocote en [eur demandant Comment faire pow être absolument sûr?
Les étèves
vont proposer la même sotution que pour le bonbon : ilfout
les
planter.
othèses
L'enseignant a préparé deux cartons avec des morceaux de scotch double face.
ll montre chaque obiet et demande à un élève s'iI faut [e placer sur le carton «oui, c'est une
groine» ou sur [e catton «non, ce n'est pos une graine». À chaque fois, il cotte te nom de t'objet.
." g.
L'histoire du bonbon
ade O 'école oe..o -ir.
1997
. 5,6a€
Ln pnÉpnnnrtoru scRUpuLEUsE vous Évttenn oes oÉsnenÉmeruTs. TourEs cEs
ruÉrnrucErur rr r'Érepe PEUT vtTE DEvENtR HARAS5ANTE !
GRATNEs
soNT pETtrEs, RouLENT,
sr
des graines déjà connues:
-.ricots, soja, radis, Ientitles
- des graines inconnues:
... 'èves, pois chiches, graines
r. -=tits pois, de tournesol, de
capucine, mars, semoule
- des coquiItettes, caitloux,
, -bons en Forme de dragées
,
:, :s cartonnées où sont déjà
: - :s titres oui c'est une groine
'e 1'est pos une groine el oi-t
.: -: déjà placés des morceaux
de scotch doubte face
- des étiquettes avec
le nom de chaque objet
,a1
Le vlvant La vie
végétale 1O1
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8Ér-Èves
z5 minutes
barq uettes à compartiments
en terreau
- z boîtes vides de ro ceufs
- coton
-objets à faire germer
- étiquettes avec le nom
de chaque objet
ETAPE z
0N REpREND EN pETrr GRoUpE cE eut vtENT o'Êtnr rntr EN GRAND GRouPE.
CHAeUE ENFANT vn À ruouvrnu ÉMETTRE UNE HyporHEsE EN pLAçANT DANs uN pREMtER TRr 5oN oBJET, ET vA ENFIN
PLANTER SON OBJET DANS UNE BARQUETTE DE GERMINATION EN SE SERVANT DU COTON.
Consigne
> ll y o deux boîtes à æufs : une pour celles que vous pensez être des groines, une pour les objets qui
n'en sont pos. ChoÎsissez et plocez les objets dons les boîtes.
Manipulations
> Chacun prend un objet et [e place dans [a boîte à æufs de son choix, pour matérialiser son hypothèse.
> Lorsque tout est réparti, les objets de [a boîte à æufs hypothèse oui, c'estune groine sont mises à
germer dans [a barquette oui.De la même manière les graines de ta boîte à æufs non, cen'estpos
une groine sont mises à germer dans la barquette non.
Les graines sont posées sur du coton puis recouvertes de coton et arrosées.
LEs HyporHÈsES DEs GRoupEs NE sERoNT pas roncÉueut Lts mÊrvtEs euE CELLES coLLÉES suR LEs cARToNs PAR
GRAND GRoupE. CE N'Esr p,qs eÊruarur. LEs ENFANTS pLANTERoNT EN FoNcloN DU TRt DU GRouPE.
ci-A§5§
Er{ rf âiîË
{:ÛNru R§GR*UPËMËh}T
Émer
LE
3
25 minutes
Au bout d'une dizaine de jours, [es résultats sont bien visibles.
- des obiets et des graines testês
-les z feritles cartonnées
hypothèses
- z nouvetles Ieuitles cartonnées
pour matérialiser les conclusions
- scotch double face
- papier affiche
- feutres
Lesé[èvesobserventsansdifficultêetconctuentfacilement: regorde,Çopousse,c'estbienune
groine ! lci, rien n'o poussé !
L'enseignant passe en revue chaque objet pour faire constater si oui ou non c'est une graine, et si
oui ou non t'hypothèse de dêpart êtait juste ou fausse? il y a souvent des erreurs sur Ia semoute
supposée graine, et sur les grosses graines comme [es fèves.
Les caiItoux, coquiltettes et bonbons ont valeur de témoin pour prouver que tout ne germe pas
quand on ['arrose.
L'enseignant a accroché les hypothèses du groupe ctasse sur Ies feuiltes cartonnées. Les enfants
citent le nom de ce qui étaient bien une graine et les noms de ce qui n'en êtaient pas, et comparent
les conclusions aux hypothèses de départ.
EN GÉNÉRAL pERsoNNE NE sE souvtENT ÊtnE
L'eutrun o'urur uvpotHÈsE
FAUSSE !!
De [a même façon que pour les hypothèses, les enfants cotlent à t'aide de scotch double face les
objets sur les cartons oui, c'est bien une graine et non, ce n'est pos une graine.
Une affiche est réatisée. Elle présente Ies hypothèses et conclusions déjà é[aborées.
nG3
F
-rt
DU BULBE À LA FLEUR
-
pement d'un
et l'anatomie d'une fleur
I
J
P5.MS.GS
ETAPE T
15
minutes
LIRE ABSoLUMENT LEs rRUcs ET AsrucES: ToxtcrrÉ, FoRçAGE DEs BULBEs, MoNTAGE EN CARAFE
rr
laorurncE À
rn
cHrNotsE.
Ff,atérieI
butbe de narcisse
bulbe de muscaris
-r butbe de crocus
r butbe de iacinthe
L
ation déclenchante
L'enseignant propose de fteurir ta cour. ll montre différents types de butbes (déià forcés), exptique
ce que c'est et ce qu'on va en faire. Cesontdesbulbes.Cenesontposdesgrossesgruines,moisen
les orrosont on vo observer ce qui pousse. Vous allez plonter les bulbes dans les jordinières.
lI y a des bulbes de ptusieurs tailtes: des petits, des gros, des très gros. lls ont une forme arrondie
et pointue. L'enseignant exptique que [a partie pointue du butbe doit être ptacée vers te haut.
Qu'est-ce qui vo pousser à portir de ces bulbes?
Les enfants essaient de répondre. Certains réinvestissent les acquis de [a germination
15
minutes
Materiel
feuiItes de dessin
1 crayon à paprer
Érnpe z
Chaque enfant matêriatise ses hypothèses par un dessin.
Dessinez comment vous allez plonter votre bulbe dans lo jordinière, puis ce gui vo se posser.
,j(.flf
I
9tlLll
Érnpe
r
PS.MS.GS
2() minutes
lVtatériel
* par étève:
:e déjà forcé (iacinthe,
;aris, crocus, amaryltis)
*
Pour le groupe:
Ces piques à brochette
- des étiquettes
Les enfants ayant choisi un même bulbe se retrouvent autour de [a même jardinière.
Prenez un bulbe. Déposez une couche de graviers au fond puis remplissez la iardinière de terre.
Foites un trou plus ou moins profond selon lo grosseur de votre bulbe: it ne doit pas être trop enfoui
sous la terre.
Plocez votre bulbe ovec la portie pointue en hout, et recouvrez de terre.
À la fin, une étiquette avec le nom du butbe est fixée sur chaque lardinière par une pique à brochette.
'k
Pour ['enseignant:
- r butbe de narcisse
rteitte sectionnée en z
L'enseignant explique une autre technique de ptantation pour bien observer
ll installe le bulbe de narcisse en carafe.
tout ce qui va se passer.
Les jardinières sont ptacêes dans la cour. Le bulbe de narcisse reste en Lld55E.
Le bulbe à I'intérieur se développera ptus vite car jusqu'en avril, it fait plus chaud à ['intérieur
Le vivant La vie
végétale
1Ol
@ @ Gà novembre révrier
ACTIVITES RITUELLES
AU COIN REGROUPEMENT
-bulbe placé en carafe
des feuitles de dessin
- des crayons à papier
.des bandelettes de papie'
-1 appareil photo
- r catendrier de la classe
- cartes-images 14:
stades de dévetoppement du butbe
(DVD-Rom et coffret)
- affiche: butbe à [égender
(DVD-Rom et coffret)
- affiche: stades de développement
du bulbe (DVD-Rom et coffret)
.
.
Prendre des photos et faire des dessins d'observation.
Dater les relevés sur le calendrier de [a ctasse.
2" stâde: apparitiôn et croissance de [a tige
Activités des é[èves, à atterner sur trois iours.
. Prendre des photos et faire des dessins d'observation.
. Mesurer [a [ongueur de [a tige du bulbe à t'aide d'une bandelette en papier.
. Dater [es retevés sur [e catendrier de la classe.
3" stade: apparitiofi des bourgeons floraux et dêvelopperme*t de [a fleur
Activités des étèves.
. Prendre des photos et faire des dessins d'observation.
. Dater tes retevês sur [e calendrier de [a classe.
o Nommer toutes les parties de la plante: racines, tige, feuiltes, bourgeons, fleur, pétales.
LEs DEsstNs D'oBSrBvnrror.r successrrs sottt À
cHAeuE Fors pLUs RtGoUREUX, pLUs pRÉcrs. Sr
BESOIN, LEs ELEVES PEUVENT LES REPRENDRE ET
LES ANNOTER EN COLLANT DES ETIQUETTES OU EN
ÉcRtvANT LEs Mors sutvANTs: RActNEs, TrGE,
FEUILLES, FLEUR.
ATËLIIR SËMI.D!R16É
RE6ÀEÉr-Èvrs
25 minutes
Étlpr
s
eonsigne
> Ploce les illustrations dons I'ordre pour expliquer le développement du bulbe.
Matériel
- 1 photocopie par é[ève
(document page 1o5 ., ,Ur:}:il]
CLASSE ENTIERE
COUR DE RECREATION
Âûatêriel
des jardinières avec bulbes
de ['étape
104
3
Réalisation de [a eonsigne et verba[Êsaâion
> Les étèves travailtent en autonomie pour ptacer les photos. Avant de les coller, l'enseignant intervient
pour les faire verbaliser les diffêrents stades en réinvestissant [e ocabutaire.
ETAPE
6
M5.
G5
R6investisserneni différê
> Les élèves réinvestissent [eurs connaissances à partir du dêveloppement des bulbes ptacés à l'extérieur.
> lls observent que les ptantes sont différentes en fonction des différents butbes plantês.
-@
>'-
?
\
LU
m
J
l
m
l
o
F
Z
LU
c;
=
o
'b,/l
o
o
E
o
l-
.C
U
OJ
LU
!t-
o_
o_
L
9
LU
o
(,
(o
E
(,
E
o
(§
L
(,
LU
o
LIJ
J
J
=
LO
q
q,
o
U
F
=
LE CYCLE DU BL
=
Découvrir le cycle de vie d'une plante
EI
J
15
minutes
['album inducteur
La grosse faim de P'tit Bonhomme
Pierre Delye et Cécile Hudrisier
O Didier leunesse . 2012 . 5,5o€
1 botte de bté d'une
quarantaine d'épis
25 minutes
r
*
&4aiétie{
Par élève:
épi de blé avec sa tige et des
racines si possibte
-
-lcrayonapaprer
r feuitte avec [a consigne
L'enseignant tit t'atbum Lo grosse faim de P'tit
Bonhomme.
À Ia fin de ta tecture, it interroge les élèves sur
la provenance du pain.
llenseignant a apporté une petite botte de bté
qu'iI a récoltée pendant t'été, en prenant soin
de conserver quelques racines. lI montre un êpi
et sa tige aux étèves.
te vous oi apporté du blé. Nous ollons l'observer
ottentivement. Décrivezle moi. ll y a une longue
tige, des racines, et une portie en haut ovec des
sortes de cheveux. Oui, on oppelle cette portie
l'épi, et les poils sont appelés lo borbe.
Savez-vous où se trouvoient les rocines de cette
plonte ovont que ie lo cueille? Dans la terre.
L'enseignant nomme à nouveau chaque partie,
de la racine vers l'épi. Lorsqu'il arrive à t'épi, it
exptique que cetui-ci renferme plein de grains
de bté, en extrait un et Ie montre aux étèves.
ETAPE Z
Choque élève vo essoyer de dessiner du blé en I'observont attentivement.
Quefaut-ildessinerpourquel'onvoitquec'estdublé?
llfoutdessinerlatige,l'épietlesrocines.
llne fois qu'on o réussi à dessiner toutes les porties du blé, on vo onnoter le dessin.
lJenseignant exptique ce que veut dire onnoter en montrant un exemple au tableau. l[ écrit ensuite
tes différents mots dont les élèves vont avoir besoin pour annoter leur dessin, de manière à ce
qu'i[s puissent [es copier: RACINES, TIGE, ÉPl, BARBE, GRAIN DE BLÉ.
L'enseignant distribue du blé à chaque élève.
Les étèves dessinent te bté puis l'annotent.
lL EST PossrBLE DE PRoPoSER
DEs
ÉTreuETTEs AUTocoLLANTES AVEc LES Mors
DÉlÀ ÉcRrrs AUX ÉLÈvEs LENTs ou AyANT DEs
EN cAPtrALEs D'tMPRtMERlE.
to6
orrrrcuLtÉs À Écntnr oes mots
@@
septemlrre
luin
ETAPE 1
5 minutes
tnÈs counrr, crrre Érner,
-
r
r
A{âtér;ei
Par élève:
ou z épis de blé
petite barquette
*
pEUT AVorR rreu À
rn sulrE
DE r'Érnpe
pnÉcÉorrrr.
ipulations
Nous ollons mointenont récolter les groins de blé qui se trouvent dons l'épi. Chacun met ses grains de
blé dons une petite borquette et le reste dons une gronde borquette.
Pour 4 à 6 élèves:
r grande barquette
ETAPE 4
10 à 15 minutes
['atbum inducteur
:se foim de P'tit Bonhomme
: erre Delye et Cécile Hudrisier
: )idier leunesse . 2012 . 5,5o€
-1 barquette avec
quelques grains de blé
--ette avec des tiges de bté
-r pilon et un mortier
ou une pince plate
:
- cartes-images 15:
bté (DVD-Rom et coffret)
ce moissonneuse-batteuse
(DVD-Rom)
Demander aux étèves de raconter brièvement I'histoire de La grosse faim de P'tit Bonhomme et de
rappeter qu'il faut du bté pour faire de [a farine et de Ia farine pour faire du pain.
Montrer [e contenu d'une petite barquette. Maintenont, nous ovons des grains de blé, mois nous
n'ovons pos de forine ! Comment faire pour obtenir
de lo forine ovec ces groins de blé ?
Laisser les élèves faire quelques propositions.
Montrer [e mortier et [e piton ou [a pince et
écraser quelques grains de bté. Montrer [e résuttat: une poudre btanch e. C'est de la farine !
Montrer le contenu d'une grande barquette.
Que foit-on ovec ce qui reste? Avec la tige du blé?
Ces tiges ne vous font pos penser à guelgue chose?
e
Sr res ÉrÈves N'oNT pAs o'toÉr, rxpLreurn euE c'Esr
DE LA pAtLLE ET DEMANDER À euor rlle senr. GÉrÉnnreMENT, cERTAINs ÉrÈvrs snvEtr euE L'oN ulLlsE LA pATLLE coMME LTrtERE ou coMME NouRRrruRE pouR LES ANTMAUx.
CERTAtNs sE souvtENNENT euE L'uN DES TRots pETtrs cocHoNS ulLtsE LA pAtLLE pouR coNSTRUIRE sn mntsoN PnÉctSER QUE DANS LE CAS D'UNE MAIsoN DoNT LE ToIT EST EN PAILLE, oN APPELLE LA PAILLE DU cHAUME ET LA MAISoN UNE
CHAUM]ERE.
-vidéo de moutin à farine
(DV D-Rom)
Montrer des photos ou des vidêos (cartes-images 15 et vidéos dans Ie DVD-Rom et le coffret) pour
que les élèves visualisent ce qu'est une moissonneuse-batteuse, une botte de paitte, un moutin.
Pour [eur permettre de mémoriser [e vocabulaire, faire [e Iien avec la chanson Meunier, tu dors.
l-.o a".a
t
rl
*
-.
a. W. 9rt". a.»
V"r*
t) mu),Un.
hrr* a- ?^
l)
c\.sJ.,tJ,pru
da ).
Le vlvant La vie
végétale 1Ol
ATELIER SEMI-DIRIGÉ
DE6À8ÉlÈves
3o à 4o minutes
Par élève:
-
r petit
r
blouse
saladier
'
1 Verre
r grande cuit[ère
-
r petite
cuitlère
- 1 torchon
- 1 sachet de levure
Pour [e groupe:
- la recette z (DVD et coffret)
- r kito de farine réparti dans
3 ou 4 récipients
-z grands récipients remptis
d'eau tiède
- du sel fin
-de l'huile d'olive
Érner
5
Présentation du proiet
> Maintenont gue nous ovons de la forine, nous ollons pouvoir foire du poin comme dans I'olbum Lo
grosse loim de P'tit Bonhomme. Pour vous oider, ie vous oi opporté une recette (recette z dons le DVDRom et le coffret).
Lecture de [a recette
> Un élève s'aide des itlustrations pour nommer les ingrédients. Un autre étève fait de même pour
les ustensiles, et un troisième déchiffre les étapes de [a recette.
> L'enseignant distribue les ustensites et expticite les attendus i chocun vo réolisersa boule de poin,
gue nous ollons cuire ensuite. Vous ollez foire le mélonge des ingrédients dans votre solodier. Vous
ovez chocun un verre et un solodier, mois il y o un récipient de forine et d'eou pour plusieurs. ll vo donc
folloir portoger et ottendre son tour.
St r'ou
te DtsposE pAs DE
suFFtsAMMENT DE sALADTERs, tL Esr posstBLE
or nÉnrrsrn
UNE BoULE DE pArN pouR DEUx.
Réalisation de [a recette
> Les étèves réalisent [eur boule de pain en suivant les étapes de [a recette.
> L'enseignant peut intervenir pour rappeter à un étève où iI en est dans [a recette et [e faire verbaliser.
Quand chacun a obtenu une boule de pain, [a recouvrir d'un torchon humide.
Après ['activité, les boules de pain sont mises à reposer pendant une heure. Etles sont ensuite
rassembtées sur une plaque de cuisson avec un petit papier indiquant Ie prénom de chaque enfant
et sont cuites dans [e four de l'école. Les boules sont mises à refroidir.
Les boules de pain sont montrées à ['ensemble de [a classe. Les étèves [es ayant rêalisées rap-
petlent [es êtapes de Ia recette.
Chacun goûte sa boule de pain et en donne un petit morceau à ses camarades.
Certains donnent leur avis : je trouve que ce pain est trop/pas ossez salé. Je trouve que ce pain est dur.
Je trouve que ce pain est meilleur que celui de lo contine...
108
Érnpr
z
10 minutes
frilatÉriet
par êlève:
- 1 pot en terreau
*
*
Pour le groupe:
rêcupérés
à l'étape 3
- du terreau
- des petles
:es étiquettes autocotlantes
- des crayons
- r arrosoir rempti d'eau
:s grains de b[és
Mointenont que nous savons comment foire de la forine et comment foire du poin, j'oimerais sovoir
comment foire pour ovoir encore plus de poin.
Pour ovoir plus de poin, il fout avoir plus de ... farine. Pour ovoir plus de forine, il fout ovoir plus de... blé
Comment faire pour ovoir plus de blé ? ll faut plonter des groins de blé !
lisation des plantations
Voici un petit pot pour chocun d'entre vous. Vous ollez y mettre de lo terre avec une pelle et y plonter
des groines. Quond vous ourez terminé, n'oubliez pos d'écrire votre prénom sur une étiquette et de lo
coller sur votre borquette.
Après avoir ptanté leurs graines, les élèves Ies arrosent avec un arrosoir.
CEs PLANTATIoNs nÉnrtsÉes EN clAssE voNT pERMETTRE DE BrEN oBsERVER LEUR ÉvoLUTIoN suR LE couRT TERME, MAts
LEs coNDITloNs NE PERMETTRoNT pAs D'oBTENTR oes Épts or erÉ À À4arucrrÉ. PouR uNE oBsERVATtoN suR DU pLUS
LoNG TERME, lL Esr coNsEtLLÉ DE PLANTER quELeuES ennrrs À L'rxrÉnrrun, roÉnLrmenr onus uu cnncÉ DE IARDtNAGE.
EN PLANTANT EN ocroBRE ou EN NovEMBRE, tL FAUDRA ATTENDRE JUrN pouR votR DE vRAts Épts oe erÉ sE FoRMER.
ETAPE
z à 3 minutes par iour
Matériet
- les ptantations
de l'étape précédente
8
Observation
> Tous [es jours, les élèves observent leurs ptantations. Au bout de quetques jours, on observe
quelques pousses.
Prendre des photos rêgulièrement pour garder une trace des différentes étapes de [a germination.
> Les pousses ressembtent à de I'herbe, que ['on appelle communément herbe à chat.
> Après une quinzaine de jours, Ia croissance ralentit, Ies ptantations sont à l'étroit. Pour poursuivre
['observation, it faudrait repiquer les semis en pleine terre et attendre plusieurs mois.
-:XIQUE
.:rbes : récolter. nroudre.
'roms: b[é, grain de blé, tige, racines, barbe, épi, dessin d'observation, farine, moissonleuse-batteuse, moisson, botte de paitte,
-tir,
meunier, meules, chaume, chaumière.
Le vivant La vie
végétale
lOp
OUVRAGES AUTOUR DU JARDINAGE
-
@@@
fMÀ
Le grand [ivre du jardin
6à
fGà
@@
Le secret du potager
Un [oup dans [e potager
La fête de [a tomate
Claire BouillL:r Et Quentln arréban
Ce livre fourmitte d'idées, de
Luc Foccroulle et Annici< Massorr
@ IvlijaCe . 2üog o 11€
Satomi lchikawa
aO L'é(.oie des loisirs
recettes, de jeux ou d'activités pour tous ceux qui aiment
profiter de leur jardin et de [a
nature autour de chez eux.
Quand Papy se met en tête
d'initier Liti au jardinage, etle
râte. Mais bientôt, elle voit
grandir sa graine de haricot.
3 !aliirard
jeunesse
. 2a14. 11,8o€
. 1l€
Monsieur Loup a tellement faim
qu'it décide de faire pousser des
légumes. Très vite, iI récolte et
cuisine de bons petits ptats.
lo Mijade " 2co9
:
zorz
" rtr,zo€
Un petit ptant était bradé au
supermarché. Hana ['a réclamé
à son papa et ['a planté dans [e
potager de sa grand-mère.
OUVRAGES AUTOUR DES GRAINES
6à
rMà6à
\--l .-',
\J
Toujours rien
?
Cirristian Voltz (ô Edilions du
ô1999an,7û€RoLergue
Monsieur Louis ptante une
graine. Le temps passe et
chaque matin Monsieur Louis
s'étonne qu'it n'y ait toujours
@@9@
'ai grandi ici
@@
6à
.f
Dix petites graines
Anne Crausaz
[c) Editions lÿiemo
Ruth Brown
r.. (rdllimard jo,,l-..se o ,6s1 o'-2€
Jack et [e haricot
magrque
.
2oc8
.
14,20
€
Une petite graine est tombée.
Elle germe, se développe, mat-
Les étapes de la germination,
[e cycle de [a graine à [a fleur
gré les élêments et les animaux
qui s'acharnent contre elle.
sous forme d'album à compter.
Anne RcVer
[ditions Liio n 2010. ]1,99€
Une version simplifiée, foliment
illustrée et très bon marché du
@
célèbre conte anglais.
rien. lls'impatiente.
OUVRAGES SUR LE BLÉ ET LE PAIN
@@
6à /6à
La grosse faim de P'tit
bonhomme
La petite poule rousse
Pierre Delye et Cécile Hudrisier
@ Didier jeunesse o
2s12. 5,5o€
Un atbum en randonnée qui
permet de visualiser tout ce
dont on a besoin pour avoir
du pain.
Pierre Delye et Cécile Hudrisier
@ Didier jeunesse . 2c73. 5,5o€
La petite poule rousse plante
du bté. Elte voudrait bien un
peu d'aide mais personne ne
veut ['aider.
@
Non, je n'ai jamais
mangé Ça
!
lennifer Dalrympie
@ fécote des loisirs a 2ç66
r 5,6o€
Léo sème du blé avec son Papi
à l'automne. lI observe le blé
grandir .iusqu'à sa transformation en farine.
e,
Mes P'tits Docs: [e pain
5téohanie Ledu
O tolilan . zaog n 7,4o€.
Un documentaire qui explique
les êtapes de [a fabrication du
pain puis retrace Ies diffêrentes
manières de [e faire.
II
OUVHAGES AUTOUR D'UNE SOBTIE À
IE
TENNAC
t
&
@@@
Ce documentaire permet de
Ce [ivre animé permet d'explo
rer le monde de la ferme avec
découvrir en détail ['univers de
[a ferme.
beaucoup de plaisir.
OUVRAGES AUTOUR D'UNE SORTIE AU ZOO
-agnifique livre à rabats
.-C format pour deviner
un
-alselon son pelage.
Un livre à volets pour découvrir
[es détails des peaux de différents animaux.
@@@
@@
livre à volets pour identifier
es animaux à partir de détaits.
Une petite fitle a disparu ainsi
que tous les animaux du zoo !
Un
@@
@@
Un documentaire très comptet
avec pages transparentes.
Un livre grand format pour prêsenter les animaux de [a ferme
et les comparer entre eux.
OUVRAGES AUTOUR D'UNE SORTIE EN FORÊT
@@
@@
Le défiIé de [a vie vu par une
feuilte. Le cycle de ['arbre au
Un mervei[[eux documentaire
avec des transparents pour
découvrir la vie de ta forêt.
cours des saisons est
également abordé.
@@
Un imagier photo sur les arbres
de nos régions qui permet
d'identifier un arbre grâce à ses
feuittes.
OUVRAGES AUTOUR DE SORTIES
EN MILIEU NATUREL
@@@
Dans ce beau livre de photos,
[e lecteur est invité à recon-
naître les [êgumes à partir d'un
très gros plan et à découvrir
des informations à Ieur suiet.
Un documentaire à toucher
pour connaître Ies petites
bêtes.
Même principe que Espèce de
cornichon mais pour la découverte des fruits.
Un [ivre animé qui explique
vie des petites bêtes.
a
Un documentaire agrémenté
d'une lampe magique pour aider
à explorer ['univers de [a forêt.
TIÈR
Notions pour l'enseignant
774
Trucs et astuces
115
Les p'tits pâtissiers
quoi c'est fait?
ça gratte ou ça pique?
Ma maison est [a plus soLide
tt6
En
!
Ouvrages autour des matériaux
Les notions abordées
.
.
Les propriétés des matériaux
Les sensations tactiles
o La transformation des matériaux
120
124
130
734
Les états de [a matière
Les propriétés de la matière
> La matière existe à ['état naturel sous trois états: sotide, liquide,
> Un matériau est caractérisé par:
gaze ux.
'
Un solide a une forme gui ne dépend pas de so.n contenant.
Ses particutes sont serrées les unes contre les autres. Ettes ne
bougent pas.
'Un tiquide prend [a forme de son contenant.
La surface de sépa-
ration entre te tiquide et ['air est toujours horizontate. Un tiquide
occupe un votume propre: un litre d'eau occupera toujours te
même volume même si la forme du volume diffère. Les particules
d'un tiquide sont proches mais elles peuvent se déplacer dans
toutes les directions.
o Un gaz n'a ni forme ni volume propre, it occupe toute [a place
qu'on tui donne.
> Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent
dans toutes les directions.
OrotOO
eoo)o
riau dur, comme le verre par exemple, peut être fragite),
- sa conductivité thermique, capacité à transmettre ta chaleur.
- sa cond uctivité étectriq ue, capacité à laisser circuler un courant
étectriQ ue
,
- son magnétisme, capacité à attirer les éléments ferreux,
- sa maItéabilité, capacité à être déformé,
- sa ftottabilité, capacité à flotter sur l'eau,
- son étasticité, capacité à se déformer sous l'action de forces et
à retrouver sa forme initiale.
ffirffiæ
> La notion de flottabitité est abordée dans [e chapitre sur l'eau,
(oooo
Particules d'un liquide
Particules d'un gaz
> Toute matière est susceptible de passer d'un état à l'autre sous
des conditions de température et de pression.
Le cas des solides en grains, comme [e sable et [e sucre, est difficite à traiter car chaque grain est un solide mais un ensemble de
grains se comporte en partie comme un liquide. En effet, i[ prend
la forme du rêcipient dans leque[ on [e verse mais [a surface de
séparation ne sera pas horizontale.
tt4
- sa dureté (cette propriété est testée à ['aide du test de ta rayure,
entre deux matériaux, te ptus dur est celui qui raye ['autre),
- sa fragitité (un matériau fragile se casse facilement. Un maté-
æ
OroOO
:l:?:?,
- sa couleur,
- son état de surface,
- sa forme,
Où trouver du bois
?
Parmi les jetons de jeux, les
jeux de constructions, les
cui[[ères en bois en récupérant
des cagettes pour légumes,
Dans les grandes surfaces de bricolage. Le gros æuvre se trouve au
rayon matériaux, mais iI est difficite
d'en acheter en petites quantités.
Dans les rayons décoration ou jardinage, iI existe des sacs de cai[[oux
pour décoration à mettre au fond
des chutes de bois dans les
grandes surfaces de bricolage,
des boîtes de fromage, des
bâtonnets de glace, également
vendus pour les Ioisirs créatifs.
des vases.
Où trouver du sable
ffiffi frræuvmn dN
sggÉgmËl
En récupérant des boîtes de
conserve, des canettes, des
ustensiles de cuisine, des clefs,
des pièces de monnaie...
où
tro uver
les
matéria ux ?
Où trouver du plastique?
En récupérant divers emballages.
Pour [es plastiques souples, penser aux intercalaires, pochettes ou
chemises plastique.
?
Dans les grandes surfaces de
bricolage, il existe du sable
spécifique pour les bacs à
sable des enfants. Dans [e
rayon jardinerie, on trouve des
sables décoratifs.
Où trouver du verre
?
En récupérant des pots de
yaourt ou des petits pots
de bébé. En achetant des
mosai'ques au rayon loisirs
et création.
Où trouver de [a brigue
?
Brique Tefoc, dans les magasins
de jouets ou sur lnternet.
Où trouver de ta pailte
?
Dans les animaleries
ou les jardineries.
ffiesg*æe*a
Papier de verre, éponge à récurer, gant
de crin...
I
Coton, fausse fourrure, tissu,
feutrine...
\
Bois
que...
Qu'utiliser
po ur
la reconnaissance
de sensations
tacti[es
?
\
Plastique, métaI de canette...
ffæda=fl# +N kæssæÂ*
Carton ondu[é, embal[age
intérieur de petits gâteaux...
Papier bu[[es, papier peint
à motifs en relief...
La matière Les matériaux
ul
É,
,ul
t=
J
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
10 à 15 minutes
Matériel
-
r
boute de pâte à sel
[a recette 3 (DVD-Rom et coffret)
Situation inductrice
> L'enseignant arrive avec une boute de pâte à set. Les étèves ne [a touchent pas.
Questionnement
> l[ les interroge sur ce qu'its voient. lls décrivent la pâte et font des hypothèses sur sa nature.
> L'enseignant distribue un petit bout de pâte à chaque élève pour [es inviter à décrire plus finement. lI les interroge sur [a texture, ['odeur, [e goût: ette est molle, on peut ['écraser, on sent des
petits grains. Ette a l'odeur du pain, du sel. Ette est satée.
Trace écrite
> L'enseignant rédige une affiche pour rêsumer ce qui a été dit:
o vLoat,Le
,
U*
oA
"" 0" [Lor
Â.r,r^,,
Gn0
,)cÿ\mp i (n4.lp
'Co*J*,
, A"'lP^"'l
al- | Âta
a.
vctu
I'clJée
^*
Lancement du projet et hypothèses
> le vous propose de fabrîquer de lo pôte comme celle que nous ovons observée.
> À votre avis, de quoi ovons-nous besoin ? Du sel, de la forine, du beurre, du sucre.
> Vous me donnez
les ingrédients pour
foire un gâteou ! Comment savoir quels sont les ingrédients?
ll faut la recette.
Lecture de [a recette
> L'enseignant affiche [a recette au tabteau
(recette 3 dans [e DVD-Rom et le coffret).
> I'oi lo recette, nous ollons lo lire.
> Les êtèves décodent la recette. L'enseignant
montre les ustensiles nécessaires ainsi que les
ingrédie nts.
rlçoltruÉs LoRs DE L'ÉTAPE 5, LA
pÂre À srr ootr Êrnr cutre.
ApRÈs AU MotNS uNE JouRNÉE DE sÉcHnee À L'AtR Ltane,
rL y A DEUx MoDES DE cutssoN DE rn pÂle À seL:
. AU FouR TRADTTloNNEL À rempÉnnrune 80o, DE 2 À
3 H sELoN res ÉpnrssEuqs À cutne. CnnquÈrrmenrs
UNE Fors LEs oBiETs
posstBLEs oe
.
rl cnoûrr
FO RT E.
AU MrcRo-oNDES EN
st
LA TEMpÉRATURE Esr rRop
postloN oÉcorucÉrnrror, or 30s
LA curssoN complÈre. LEs zoNEs NoN
cutrES sE votENT cAR ELLES N'oNT pns Ln iuÊme couLEUR. UNE curssot't À uNE purssANCE rnoe ronre
ou rRop LoNGUE pEUT FATRE pRENDRE FEU À r'ÉrÉmenr
EN 30s
luseu'À
rt/
À
x1§
cutnt er ooNc
neîr\4rn L'APPAREtL.
@
La pâte à sct
@
,or"rbre>juin
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8Ér-Èves
3o à 4o minutes
Réalisation
>
.:
MatérieI
DVD-Rom et coffret)
colorant atimentaire
..=rsi[es et ingrédients
de [a recette
le vous oi préparé
des gobelets ovec de I'eou colorée, des épices à oiouter si vous voulez que votre
pôte à sel soit odoronte,
PouR QUE rrs ÉLÈves PUtssENT MALAxER FAcTLEMENT LA BouLE, pRoposER uN pETrr voLUME DE BAsE.
coMME uNE
TASSE A CAFE OU UN POT DE PETIT SUISSE
> Les élèves suivent les étapes de la recette. Chacun obtient une petite boute de pâte de couleurs et
d'odeurs différentes.
Les ÉrÈvEs nunorur À.HolslR LA couLEUR ET L'oDEUR DE LEUR pÂTE À ser La pÂrr À ser DE cHAeuE ÉrÈve
DANs uN sAc PLASTIQUE AVEc soN PRÉNoM ET rratsr au nÉratcÉnerruc
lusqu'À Le sÉeNce sutvANTE.
rsr nlucÉr
DEMI.CLASSE
z5 à 3o minutes
Matériet
-r
:
;t Par élève:
boule de pâte à sel
* Pour [e groupe:
.outeaux en plastique
-des emporte.pièces
-
- des moutes
- r routeau
rasseaux d'épaisseurs
identiques
Manipulations
> La pâte à sel fabriquée est mise à disposition pour qu'elle puisse être manipulée [ibrement. Des
outils, couteaux en plastique, roulettes, emporte-pièces divers, moules sont disponibtes.
> lts explorent les différentes possibitités de mise en æuvre. lt peut être intéressant de [eur montrer
- comment faire des plaques régutières avec un rouleau positionné sur deux
cales de même épaisseur,
- [a technique du cotombin.
Verbalisation
Une liste des actions possibles sur Ia pâte à seI est construite par I'enseignant lors de l,atelier. ll fait
nommer [es actions que les étèves sont en train de réatiser et prend tes actions en photos: mataxer,
étaler, router, aplatir, décorer, découper, mouter, appuyer, enrouler, émietter...
Structuration
> Après séchage, des productions types des différentes techniques sont affichées et légendées.
La matière Les matériaux
ATELIER SEMI.DIRIGÉ
DE6À8Ér-Èvrs
r5 à zo minutes
Matériel
*
'l
Par élève:
- r feuille
illlstrat ons
d'outits (matériel page 19
PhotocoPie des
et DVD-Rom)
*
Pour le groupe:
- cartes-inages 1b: vien"oiseries
(DVD-Rom et coFlret)
- crayons de couleur
- ctSeaux
- cotle
Bilan
> À t'aide des affichages, ['enseignant fait reverbaliser ce qu'its ont appris sur [a pâte à sel.
que ie ne vous ai pos encore dite, c'est que lo pôte à sel peut être cuite. J'oi cuit
certoines de vos productions, voilà ce qu'elles sont devenues. C'est devenu dur ! Lo pôte à sel est un
> ll y o une chose
motériou mou qui devient dur quond on le cuit.
Lancement du proiet
> Nous allons réolîser des viennoiseries en pôte à sel pour le coin cuisine.
> Où trouve-t-on des viennoiseries? À la boulongerre.
Que lles vi e n n oise ri es con n o issez-vo us ?
> Les élèves citent des viennoiseries, ['enseignant montre [eurs photos (cartes-images 16 dans te
DVD-Rom et [e coffret).
Conception
> Tout d'obord, vous ollez dessiner en couleur
ce gue vous voulez fobriquer. Puis vous collerez ô côté de
votre dessin les illustrations des outils dont vous durez besoin.
> Les étèves dessinent [eur projet, découpent et coltent les outils nécessaires (matériet page 119 et
DVD-Rom).
ATELIER SEMI.DIRIGÉ
DE6À8ÉLÈves
25 à 30 minutes
Matériel
- les ustensiles et'ingrédients
de [a recette
- cotorant alimentaire
- les dessins de l'étape précêdente
- cartes-images 16:
Réalisation
> Chaque étève réatise son projet, de la fabrication de [a pâte à ta finition. Une fois [a fabrication
terminée, l'enseignant évatue avec t'étève si elte correspond bien au prolet forme, couleur, outils
utitisés. L'enseignant interroge l'étève sur [a pertinence de [a technique choisie.
viennoiseries (DVD-Rom et coffret)
Cuisson et instaltation
> Après [eur cuisson par ['enseignant, les réalisations sont installées dans [e coin cuisine. Chaque
étève nomme sa viennoiserie.
DIFFÉRENCIATION
/
TRANS\
> D'autres projets selon la même démarche sont possibtes: décorations de Noë1, suspensions pour mobiles, fruits et légumes, poissons, animaux, formes, biioux, cadres photos, pions de jeux de sociêté...
118
ILLUSTRATIONS DES OUTILS
1
photocopie par é[ève
V
F
Les oblets Les matériaux
tE5
MATERIAUX
lr|
É,
.lrl
l-
=
J
Â-E!
ER DIRlGE DE LANGAGE
DE4À6ÉlÈvrs
zo à z5 minutes
*
Matériel
Le même type d'objet
dans différentes matières
(gobelet, cuitlères, jouets,
boîtes...):
- en bois
- en métaI
- en ptastique
- en porcelaine
- en verre
- en carton
*
Des objets de [a c[asse
de différentes matières:
- paprer
Situation déclenchante
> Une collection de gobelets est proposée aux élèves à ['occasion d'une instaltation du coin cuisine,
de sa rêorganisation ou tout simptement de son rangement.
Questionnement
> Que pouvez-vous dire sur ces objets?
> lnciter à parter des matières, des propriétés.
C'est chaud, c'est froid quand on touche, cela se
casse, c'est solide, c'est transporent...
> Connaissez-vous d'autres obiets dons les mêmes
motières7
> Les étèves citent des objets du quotidien et
l'enseignant Ies incite à prêciser Ia matière ainsi
'tissu
- laine
- cutr
- mousse
- terre...
>
que Ia sensation tactile de ce matériau.
Y o-t-il des obiets qui nous entourent qui sont
dons d'autres motières? Popier, tissu, loine, cuir,
mousse, terre...
Recherche
> L'enseignant propose une chasse aux matériaux: les étèves cherchent des oblets dans [a ctasse et
les positionnent devant le bon gobetet en verbatisant [e matériau constituant l'oblet.
I
À L'Accu EtL pEN DANT
UNE À DEUX SEMAINES
10 minutes
MatérieI
des grandes boîtes en carton
Questionnement
> Pendant la durée de la sêquence, mettre à
disposition des êtèves des grandes boîtes en
carton dans [esquetles ils peuvent déposer des
objets ayant tous [e même matériau de base.
Lors de ['accueit, its peuvent apporter des objets venant de chez eux ou chercher des objets
dans [a classe.
Chaque carton est différencié par un objet trouvé
dans l'étape précédente et pris en photo.
> Un carton peut servir à regrouper [es objets
m
ulti- maté rio ux.
> lt est aussi possible de faire la semaine du bois,
du plastique, du papier...
12()
mars >JUtn
CLASSE ENTIERE
COIN REGROUPEMENT
20 minutes
Matériel
.. :oîles en carton de l'étape
précédente et les obiets
s'y trouvant
:. rhotographies des objets
-r affiche par boîte
> Les oblets de chaque boîte sont sortis
un à un et nommés. La classe vatide te
DES OBJETS
PLASTIOUE
classement de cet objet dans ce carton.
> Cette énumêration peut donner lieu à
des questionnements sur la fonction
des objets, [eur lieu de rangement, [es
consignes à respecter pour les utitiser...
> Une affiche par matêriau est réatisêe
avec les photos des obiets et leur désignatio n.
> Selon le nombre d'oblets, iI est possibte
de faire un carton parjour pour que la
sêance ne soit pas trop [ongue.
:
- :?
DIRIGÉ DE LANGAGE
DE6À8Ér-Èvrs
20 minutes
Matériel
-: on de bois, cuir, métal,
: -: :Lastique, tissu en coton
-:
- cartes-images 1Z:
matières d'origine
(DVD-Rom et coffret)
Questionnement
> Montrer un échantilton de matêriau puis
demander d'où il vient.
> Montrer [es photos correspondantes et
expliquer comment [e matériau a été
obtenu (cartes-images 1Z dans le DVDRom et [e coffret).
Jeu d'association
> Demander à chaque élève d'associer
un
échantitton à une photo en verbalisant.
lL EST DrFFtctLE DE MoNTRER L'oBTENTtoN
ItÉrer rr
DU
DU pLASTteuE. PouR cES DEUX MA,
rÉprnux, tr EST Dtrfl.,. F pouo _ES
rL
rvrs ot
SE RENDRE COMPTE DE LA TRANSFORMATION QUI
NoN SEULEMENT LEUR pARLE oe ttnrtÈne qu'trs
N,oNT ]AMAIS VUE MAIs QU DE PLUS PAsSE DE
L'Étnr rreuror À L'ÉTAr soLtDE
ACTIVITÉ INDIVIDUELLE
5 à 15
minutes
MatérieI
photocopie par élève
r _:_rment pages 122 et 123
et DVD-Rom)
-des échantiltons déià
: --=s de bois, papier, carton,
tissu, métaI
:- .cotch doubte face pour les
=:rantillons dilficites à coller
:: rme le métaI et [e plastique
-r
> Pour que cette trace écrite ait du sens, iI faut que les matières puissent être cotlées sur
[e docu-
ment. ll faut donc la réserver aux matières pour lesquelles il est facile de récupêrer des échantillons (Irucs et ostuces page rt5).
La matière Les matériaux
l
=
.!
t
È,
=
-o
p
(IJ
o
/(g
\(u
P
5
G)
o
t-
-o
o
E
-o
(o
=
iÈ
qJ
(n
o
(,
(u
(r)
OJ
=
UÂi
qË
.,
'b,.,)
G)'=
(§ .L
L)
=ru<u
L râr
'r'- /(L)
r(U
Hioi6
EEF
J--
r(6
!-G)
E O!
OEl-
Éô.o
sus
(J
(-
c\..
F
f,
F
a
!
I-
ÈJ
ÈJ
=(.r)
.Y
+)ErG)É=
.Cl
J--
EEC
ooo
'*,==
.l-J
(O ÈJ
(!-
-c,ro
vt
(-
<!!
JL)(J
\(U
\O)
LU
=G)OJOJ
ô
===
ooo
(orO(§
o
l
c
Z
LU
.C .C .C
UUU
U1U1(n
===
ooo
(ra6
ooo
----ooo
U(JU
hu I (PS-MS) Donner uniquement les échanti[lons de matières et cacher les deux consignes inutiles.
h.u z (MS performants et GS) Donner les échantillons de matière, [es 6 étiquettes-mots et cacher
--
-s gne inutile.
3 (GS)Donner les échanti[[ons de matière, les 6 étiquettes-mots et les 6 i[[ustrations
-..:ières d'origine.
ITI
.,4ÉTAL
PAPIER
-_ÀsTrQUE BO|S
I_L]
CARToN
TTSSU
rIl
ÉTAL PAPIER
--_{slQUE
BOIS
II]
',,1
ITI
.,iÉTAL
PAPIER
r {STIQUE BOIS
-trl
CARToN
TISSU
CARToN
TISSU
TT]
II]
T_T]
IIl
TTT
I
l
li
I
l
É,
trl
F
=
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
10 minutes
Matériel
['album inducteur
qul
esÉ
gê nid
Situation déclenchante
> L'enseignant tit t'atbum À qui est ce nid?
> ll présente ensuite à I'ensembte de [a classe une nouvetle mascotte, sous [a forme d'une peluche
animate dont t'habitat est un nid, une souris par exempte.
> le vous présente... une nouvelle morionnette qui o un problème à vous poser:
«J'orme beoucoup votre closse, mois il me monque une chose importonte pour m'y sentir bien Je voudrois que vous me fobr(uiez un nid
bien dourllet
A qui est ce nid
P, oliê. 2o1J. 12r
peluche d'un animal
CLy--oJghron O
-r
v vant dans un nid: oiseau, souris...
"
Questionnement
> Sovez-vous ce qu'est un nid? La maison des oiseaux.
> Oui, mois on appelle oussi nid lo moison des souris, des hamsters, des serpents, des guêpes et de
beoucoup d'autres onimoux. Et un nid douillet? Un nid bien doux.
> Comment foîre un nid douillet à ... ? ll faut trouver des matières douces.
ATELIER DIRIGÉ DE LANGAGE
DE4À6ÉLÈvrs
15 à 20
minutes
Matériel
- des échantiltons de matières
douces, rugueuses, lisses,
bossetées, ondulées, moltes, dures
- 1 barquette par sensation tactile:
4 pour [es PS,
6 pour les MS
LEs sENsATroNs LEs pLUs srMpLEs À EXpLotrER soNT Doux ET RUGUEUx. cEs tvlATtÈREs soNT LES pLus sttupLrs À
TRouvER. LtssE ET BossELÉ ou otourÉ soNT AUSsr DEs sENsATToNS ASSEZ FAcTLES À crnrurn. Le enoerÈme esr que
souvENT UNE MÊNrE mlrrÈnr prur Êrne oouce ET LrssE ou DoucE ET oNDULÉE. ATTENTIoN AUx ÉcHANTtLLoNs cHotsts
Consigne
> Pour trouver les matières qui vont nous servir
à fobriquer le nid de ..., il nous fout closser toutes les
motières que je vous oi opportées.
> Touchez toutes les matières qui sont sur lo toble et dites-moi ce que vous sentez.
Maniputations
> Les élèves touchent Ies matières et verbalisent [a sensation tactite.
> L'enseignant verbatise à nouveau en utitisant [e vocabutaire pertinent si nécessaire: rugueux pour
ço grotte, ondutê pour ço foit desvagues, bosselé pour ça o des bulles.
> Pour les matières que [es étèves ont du ma[ à quatifier, les inciter à utiliser tajoue pour mieux
sentir l'effet tactite de la matière.
> Choisir un échantitlon pour chaque sensation tactile. Le ptacer dans une barquette pour constituer
un échantitton témoin.
Classement
> Les élèves proposent, pour chaque échantitlon,
un classement dans une des barquettes en expticitant Ieur proposition: je trouve que ce bout
de bois est doux mois qu'ilest oussi très dur, il
va faire mal à la mascotte. Je trouve cette éponge
à lo fois douce et molle, ... la moscotte va bien
s'enfoncer dedans.
> Les élèves peuvent s'aider de t'échantitlon
témoin pour valider leur classement.
] \
CLASSE ENTIÈRE
REGROUPEMENT
10 minutes
-:s
Matériel
synboles associés
aux sensations
: : ::ge rz8 et DVD-Rom)
.
--:rtillon
par sensation
Trace écrite: dictée à I'adulte
> Qu'ovez-vous dêcouvert lors de l'otelier? Quond on touche une motière, elle peut être douce, lisse...
> Pourquoi ovons-nous touché les matières? Pour fobriquer le nid douillet de .... Nous avons touché des
motières. ll y en a des douces, des rugueuses, des molles, des dures, des lisses, des bosselées.
Présentation des symboles associés à chaque sensation
> L'enseignant affiche tes symboles au tableau (matériet page 128 et DVD-Rom).
> Quel symbole choisiriez-vous pour doux? La plume.
> Discussion cotlective autour des symboles. Fixation d'un échantilton de [a matière dont la sensation tactile est itlustrée à côté du symbole.
St DEs SYMBoLES NE FoNT pAs L'uNANIMtrÉ, tL
ARRtvER À uN coNsENsus.
Esr possrBLE
DE LEs TRANsFoRMER
sous LA DtcrÉE ors ÉLÈvEs poun
:_ELIER AUTONOME
DE4À5Ér-ÈvEs
10 à 15
:, roins
,,
.
minutes
Matériel
3 échantillons
: -.ur chaque sensation
-des barquettes
-:oles des sensations
:age 128 et DVD-Rom)
Présentation de l'activité
> L'enseignant fait reverbaliser [a signification de chaque symbole (matériel page 128 et DVD-Rom)
et demande à différents élèves de trouver un échantitlon témoin pour chaque barquette.
> Chacun à votre tour, prenez un échontillon, nommez lo sensotion puis foites posser oux outres êlèves
pour qu'ils vérifient.5i tout le monde est d'occord, mettez l'échontillon dons la bonne borquette.
Loissez sur lo table les échontîllons pour lesquels vous n'orrivez pos à vous mettre d'occord,
Manipulations et classement
> Les étèves touchent les matières et êtablissent le classement.
La matière Les matériarLx
CLASSE ENTIERE
COIN REGROUPEMENT
1()
minutes
Matériel
- cartes-images 18:
matières d'origine
(DVD-Rom et coffret)
Rappet
> Que nous ovoit demondé ...? De lui fabriquer un nid douillet.
> Qu'ovons-nous foit? Nous ovons trouvé des motières douces.
> Et mointenont? ll fout faire le nid.
Observation
> I'oi apporté des photos de nids, dêcrivez-les (cortes-imoges tB dons le DVD-Rom et le coffret).
> Les étèves doivent faire ressortir les notions d'endroit plus ou moins fermé, fait avec des matières
com posites.
> Pour ..., comment foire ?
Propositions des élèves
> Les étèves proposent d'utitiser divers contenants, selon tes possibitités de la classe: une boîte à
choussures, un soladier, une barquette...
> Ce contenant doit être garni des échantittons classés doux.
ATELIER AUTONOME
DE4À6Ét-Èvrs
10 à 15 minutes
Matériel
r boîte à chaussures
recouverte
d'adhésif doubte face
- des échantittons de matières
douces
Réalisation du nid
> Après décision sur Ie contenant le plus adéquat en fonction de la dimension de la petuche, les
élèves garnissent te nid d'échantittons qu'ils ont choisis dans ta barquette des matières douces.
NE pRoposER euE DE pETtrs ÉcHANTTLLoNS oe nnllrÈnr À ce eue
rous
LEs ÉrÈves pu ssENT GARN R LE NID
lnstallation de ...
> L'enseignant instatle la peluche dans son nid et Iui demande s'il est assez douiItet pour elle.
,126
TE INDIVIDUELLE
15 à 20 minutes
MatérieI
: -: ocopie par élève
....':29 et DVD-Rom)
-.-. [ons de matières
Questionnement
> Trouvez un échantillon de motière pour choque sensotion toctile.
> Posez choque échontillon dons le corré sous le bon symbole.
> Quond vous ovez terminé, appelez-moi,
> Rappeler [a signification de chaque symbote si nécessaire.
Activité des élèves
> Quand ['enseignant est appelê, iI s'assure que le vocabulaire est acquis et que les matières choi-
sies sont bien représentatives de la sensation symbotisée. Les élèves cotlent alors les échantittons.
_:-
ER SEMI-DIRIGÉ
rE4À8Ér-ÈvEs
20 à 25 minutes
--
:.,-rpie
rt
Matériel
par étève:
du mini-tivre
:.. -..ières (DVD-Rom)
: -::::opie de la souris
: . :.-tonné (DVD.Rom)
- 1 Crayon
-: paire de ciseaux
-15 cm de ficelle
ou un scoubidou
:: .: résiI doubte face
::- ,.d'autoagrippant
(facuttatit)
't pour [e groupe:
. :' . - . Llons de matières
E:
PROLONGEMENT
> ll est possible de transformer la trace écrite individuelle en mini-livre retraçant [a fabrication du
nid sous forme d'histoire (mini-livre des matières dans [e DVD-Rom et te coffret).
> Après la lecture d'un livre terminé, l'enseignant demande à chaque élève de colter à la bonne place
un échantillon de matières comme dans la trace écrite précédente.
> La petite souris est découpée (DVD-Rom): détourée pour les élèves capables de dêcouper correctement ou selon le rectangle l'entourant. Elte est sotidarisée au mini-tivre à t'aide d,un fit ou d,un
scoubidou de 15 cm représentant sa queue, scotchê à une extrémité sur la page à l,emplacement
3
de la croix ainsi qu'à ['arrière de ta souris. E[e peut ainsi se promener de page en page.
> Une pastitle autoagrippante positionnée en page 3 pour un des deux étéments, l,autre êtant fixé à
['arrière de la souris, peut servir à la ranger.
toucher,
La matière Les matériaux
PICTOGRAMMES DES MATIÈRES
tzB
Une photocopie par élève
Associer un matériau au symbole reprêsentant sa sensation tactile.
ÇA GRATTE OU ÇA PIQUE?
Co[[e les bons échantil[ons sous chaque symbote.
\§§§\
€
EI
É
E!
,lrl
F
=
les plus
J
CLASSE ENTIERE
COIN REGROUPEMENT
20 minutes
Matériet
['album inducteur
Les
Paul
O Père Castor
F
Tro petits
Fran
rt
-r
cochons
is et Gerda l\4uller
amarion . i999. 4,2a€-
Des échantillons
o.t ,
,,.,:;:ii;
Situation déclenchante
> L'enseignant Iit I'album Les trois petits cochons.
Questionnement
> Amener [es étèves à verbatiser que les cochons utitisent
des matériaux très différents pour fabriquer leur maison:
ta paitte, [e bois, les briques.
> Faire circuter des échantittons et Ies afficher au tableau.
> Quelles sont les différences entre ces trois motériaux ?
> Les amener à parter de Ieur sotidité. La couteur, la
facilitê d'utitisation, [e prix des matêriaux peuvent être
discutés puisqu'it en est question dans I'album.
> D'après I'olbum quel est le motériau le plus solide ? Quel est le plus fragile ?
> Comment pouvons-nous vérifier si c'est vroi?
> Les amener à ta possibititê de faire des tests pour vêrifier ta sotidité des trois matériaux.
-brindittes de bois
brique Tefoc ou son équivalent
labriqué maison
LES ÉTApEs
TER soNT DES ATELTERS orntcÉs penmerrnNT DE TE5TER sELoN PLUsIEURS cARACTÉRISTIQUES
MtsES EN Jeu Érnrr tDENTteuEs, cHaQuE Ét-Ève NE PASsE oottc Qu'À uN DEs rRols
crnssr Esr DtvtsÉE EN TRots GRoupES, sotr tL EST Ausst posslBLE DE DoUBLER CERTAINS ATELIERS.
2,2}ts,2
rrs mntÉntnux. Les coupÉteruces
ATEL|ERs.
Sotr rn
(Trucs et astuces page r3)
ATELIER DIRIGE
DE4À6Ét-Èves
10 à 15 minutes
Matériel
- des brins de paitle
- des brindiltes de bois
- des bandes de papier
- des bandes de carton épais
-
r brique Tefoc ou
r
brique Lego
son équivalent
fabriqué maison
(Trucs et ostuces page r3)
Questionnement
> Comment le loup orrive-t-Îl à détruire la première moison ? En soufflant.
> Comment peut-on vérifier si un matériou résiste ou souffle du loup ? En faisont comme lui :
en soufflont dessus /avec un ventiloteur /ovec un sèche-cheveux.
Présentation de l'atetier
> Sur lo table it y o les motêrioux utilisés par les petits cochons. J'ai ajouté du popier, du corton, du plostique. Vous ollez poser l'échantillon sur le support. Puis vous allez souffler. Si l'échontillon s'envole,
gu'en concluez-vous? Le matériau ne résiste pas au souffle.
> Avec les motérioux restonts, vous allez recommencer mois en utilisont le sèche-cheveux, que vous me
demonderez de broncher. Vous ollez observer ce qui se posse.
Tests
> Les élèves font les tests en essayant les matériaux chacun à leur tour. Le fait d'avoir aloutê papier,
carton et ptastique, étargit te test en permettant à chaque étève d'être responsable d'au moins un test.
Conclusion
> Qu'ovez-vous constaté ? Lo poille, le corton et le popier s'envolent ovec notre souffle.
Le bois et le plastique s'envolent avec le sèche'cheveux.
Lo brique ne s'envole ni ovec le souffle, ni ovec le sèche-cheveux.
> Avez-vous une explication ? Les motérioux légers s'envolent, les plus lourds résistent 0u vent.
Trace êcrite individuelte
> Dessinez le test que vous ovez fait.
> Les élèves dessinent [eur test et dictent à ['enseignant les [égendes à apposer
13G
et les conctusions.
ATELIER DIRIGÉ
DE4À6ÉlÈves
ro à r5 minutes
Matériel
- des brins de pailte
-des brinditles de bois
-des bandes de papier
.. , bardes
de carton épais
-
: : -= tefoc
r brique
Lego
ou son équivaLent
fabriqué maison
=tucs et ostuces page r3)
-:-.eau et r plaque martyre
Questionnement
> Après ovoir soufflé, que foit le loup? ll tope sur la metson.
> Que dit-on d'un motériau qui résiste à des coups? ll est solide. On dit qu'il résiste ouxchocs.
> Comment peut-on vérifier si un motériou est solide? En faisant comme le loup: en topant dessus /en
essayont de le casser en deux ovec les moins /avec un marteou /en faisant tomber le matériau por terre.
Présentatiôn de ['atelier
> Sur la toble, il y a les motêrioux utilisés par les petits cochons. I'ai ojouté du popier, du corton, du
plostique. Vous ollez poser l'échontillon sur le support pour ne pos abîmer lo toble. Puis vous allez le
toper ovec votre moin. 9'il résiste, vous essoyez de le couper en deux touiours ovec vos moins. S'il se
cosse dons un de ces deux cos, qu'en concluez-vous ? Le motériau n'est pas très solide.
> Avec les matérioux restonts, vous ollez foire 2 nouveoux tests, Vous loissez tomber le motériou du
haut de lo toble. S'il résiste, vous le topez avec un morteou.
Tests
> Les étèves font les tests en essayant [es matériaux chacun à [eur tour. Le fait d'avoir ajouté papier,
carton et ptastique étargit te test mais permet aussi [a réatisation d'au moins un test par élève.
Conclusion
> Qu'ovez-vous constoté? La paille et le popier se plient et se cassent facilement ovec les moins. lls
sont fragiks. Le corton et le bois sont plus solides mois on arrive quond même à les casser. Les deux
briques sont très solides: nous ne sommes pas orrivés à les casser.
Trace écrite individuelle
> Dessinez le test que vous ovez foit,
> Les élèves dessinent [eur test et dictent à t'enseignant tes tégendes à apposer et [es conclusions.
La matière Les matériaux
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
10 à 15 minutes
Matériel
- des brins de paitle mis en botte,
I
Rappel
> Dans fhistoire, lo moison du troisième petit cochon est solide cor elle résiste ou souffle et oux couq
du loup. Mois une vraie moÎson ne doit-elle être que solide ? À guoi doit-elte résisteii Au vent, au
soleil, à la neige et à la pluie.
assembtés par un élastique
- des brindilles de bois mises en
botte assemblées par un étastique
- des bandes de papier
assez larges
- des bandes de carton épais
assez [arges
- r plaque Lego
- r mur de brique Tefoc ou son
équivalent fabriqué maison
(Trucs et astuces page r3)
-
1
petit arrosoir
- de l'eau
- des feuilles de papier
- 1 barquette par échantillon pour
éviter de mettre de ['eau partout
- des é[éments type kapla,
permettant de pencher
les barquettes
> Qu'est-ce que celo veut dire qu'un motériou résiste ô lo pluie ?
> lnciter les élèves à verbaliser que l'eau ne doit pas traverser [e matériau.
> Celo s'oppelle l'Împerméabilité. Un motériou qui ne loisse pos posser I'eou est imperméoble.
> comment vérifier qu'un motériou est imperméable ? En les plongeont dans l'eau.
> Vais-je voir si I'eou troverse le matériou? Non. pourquoi ?
> Cette proposition génératement vient de [a confusion entre imperméobilité et
flottobilité.
> Pour sortir de cette confusion, prendre l'exemple de la brique.
> Àvotre ovis, les briques protègent-etles de la pluie? Oui, beaucoup de maisons sont
fabriquées
en brique.
> Donc si ie lo plonge dons I'eou, que vo-t-il se passer ?
> Génératement, les étèves à ce moment sont perptexes et rêalisent que le test proposé ne va rien
dire sur ta propriété.
> ll faut un test qui nous permet de voir si I'eou ne troverse pos le motériou quond it pteut.
> Ce test est difficite à imaginer par les élèves. Si aucune idée permettant de tester réeltement
l'imperméabitité du matériau ne vient, l,enseignant propose Ie test suivant.
Présentation de l'atelier
> Sur la toble, il y o les motérioux utÎlisés por les petits cochons, J'oi ojouté du papier, du corton, du
plostique. Vous ollez poser l'échontîllon sur une feuille de popier dons une borquette.
Mointenont, vous positionnez le Koplo sous un côté de lo borquette pour la pencher.
Puis vous versez doucement de I'eou sur l'échantilton.
Ensuite vous soulevez l'échontillon et vous regardez si lo feuitle de popier est mouillée ou non là où se
trouvoit le matériou.
Tests
> Les étèves font les tests en essayant les matériaux chacun à [eur tour. Le fait d'avoir ajouté papier,
carton et plastique, é[argit le test mais permet aussi que chaque étève puisse passer.
Conclusion
> Qu'ovez-vous constoté ? Le papier et le corton
ne sont pas imperméables. Les fagots de poille et de
bois laissent un peu passer l'eau mois c'est porce qu'il y o des trous. Le plostiqué et la brique sont
imperméables.
Trace écrite individuetle
> Dessinez le test que vous ovez foit.
> Les élèves dessinent [eur test et dictent à l'enseignant tes tégendes à apposer
ar2
et [es conctusions.
-_
CLASSE ENTIÈRE
N REGROUPEMENT
15 à 20 minutes
Matériel
r affiche
Rappels
> Le bilan commence par un rappeI des trois tests menés. Nousavonsmenédestestspoursavoir
quels matériaux résistent ou vent, aux chocs et à la pLuie.
> Les êlèves ayant mené les tests racontent aux autres ce qu'ils ont fait et verbatisent à nouveau
[eurs bilans.
La poille et le popier s'envolent ovec natre souffle
Le bots, le c0rton et le plostique s'envolent ovec le sèche-cheveux.
La brique ne s'envole ni avec le souffle, ni avec le sèche-cheveux.
La paille et le popier se cossent focilement ovec les moins lls sont frogiles.
Le corton et le bois sont plus solides, mais on arrive quand même à les cosser.
Les deux briques sont très solides: nous ne sommes pas arrivés à les cosser.
Le papier et le corton ne sont pas imperméobles.
Les fagots de poille et de bois loissent un peu passer I'eou, mais c'est porce qu'il y o des trous.
Le pl0stique et l0 brique sant imperméables
-,
CLASSE ENTIÈRE
N REGROUPEMENT
10 à 15 minutes
Matériel
- L'atbum
-=s Trois petits cochons
:-,ntiItons de matières
.-'rom écrit au tableau
: -3 pliée en mini-livre
- :s et astuces page rz)
.
- 1 Crayon
)
- I'affiche réatisée
l'étape précédente
Présentation du projet
> Pour que vous oyez chocun le livre des Trois petits cochons, vous ollez me dicter I'histoire. Nous ollons
y aiouter ce que nous ovons trouvé. Chocun d'entre vous ouro olors son mini-livre.
Réécriture de I'histoire
> L'enseignant fait verbaliser à nouveau ['histoire et écrit les phrases sous [a dictée des é[èves.
> Son support est une feuitte A3, pliée sous forme de mini-livre (voi Trucs etostuces page r.2)
> Sur chaque page du mini-tivre, une ptace est [aissée [ibre pour que les élèves puissent dessiner.
Les matériaux sont écrits en capitales d'imprimerie comme au tableau [ors de Ia première étape.
Reproduction du mini-livre
> Une fois le mini-livre rédigé, l'enseignant [e photocopie en le réduisant ou non.
_ .i
TÉ INDIVIDUELLE
20 à 30 minutes
Matériel
* Par élève:
' :: pie A3 du mini-livre
.= è ['étape précédente
, -e fourni (DVD-Rom)
,.
-::
Crayons de couleur
-.ntiltons et leur nom
écrit au tabteau
Démonstration de [a réalisation du mini-livre
> Les étèves ptient, découpent et montent Ie mini-tivre en suivant [a démonstration de ['enseignant
(voi Trucs et astuces page 12).
Consigne
> Mointenont que vous ovez votre mini-livre, vous pouvez illustrer choque poge.
Dessins
> Pour que les élèves repèrent Ia teneur du texte et donc ['ittustration à faire, [eur rappeler qu'i[s
peuvent repérer [e matériau dont iI est question en comparant [e nom du matériau qui aura été
écrit en Iettres d'imprimerie au tableau.
lEs:
l-.
|ff,.:
tester,
paille,
b
ffler, briser,
le,
léger,
La matière Les matériaux
OUVRAGES AUTOUR DES MATÉRIAUX
i
*irÉ
à
§,ê
,o@
Pâte à sel
.lca O Fieurus o 2s11o 7,9o€
Des modèles de bricolages en
pâte à sel iltustrés en quatre à
cinq étapes.
@@
@@@
@@
Miniatures en pâte à seI
. 1a€
À qui est ce nid?
Guy Troughton
O Piccolia . 2a13. t2€
Batthazar et les matièreà toucher
À chaque page sont proposés
ptusieurs modè[es pour fabriquer des miniatures en pâte à
seI sur diflérents thèmes.
Livre devinette à rabats qui
invite [e [ecteur à trouver à qui
O
appartiennent des nids.
té ses amis. lts viennent vêtus
!(arine ThibouLt
O Fleurus . 2a12
trois petits cochons
PauL Francois
Pour carnaval, Balthazar a
irr
de déguisements en matières
toucher.
-
à
§,
@@
Les
Mar'e-nélène Place et taro ire l-or
Hatier jeunesse . 2a14 . 12,15€-
iO Père Castor Flammarion
.
D'où ça vieni?
L'arbre en bois
et Gerda lvluller
1999
Trois petits cochons
construisent chacun une maison
dans un matériau différent.
Phiiippe Coi'entin
Anne-5ophie Baumann et Mé[anie
O L'écote cies [oisirs. zooo. rz,zc€
La table de chevet raconte son
Combes O Nathan
arbre en bois.
. 2o14. i7,95=Un livre animé qui explique la
provenance ou Ia fabricatiodes objets du quotidien.
histoire: avant, etle était
un
@@
(9
@@
@
Mes maisons du monde
Chacun sa maison
Gare au gaspi!
C[émentine Sourdais
PauI Faucher et Alexandre Chem
O Père Castor Flan''marion . zorz
Mes P'tits Docs :
les maisons du monde
' S"- e'--.ê)Se. -)15. 8,-o€
Cinq doubte-pages à votets et un
pop-up présentant extérieur et
intérieur d'habitats typiques de
pays aux climats très différents.
.
15.25€
Cet album nous invite à rencontrer huit enfants du monde
en habits traditionnels et à les
associer à un type d'habitat.
5téphanie Ledu et DeIphine Vanfrey
O l\,litan . 2ao6 . 7,4o€
Geneviève Rousseau et Estelie Àle:-:
O l\4ijade .2012.11 €
Phitémon met en appticatior
Ce documentaire aux pages
indéchirables présente des
ce qu'iI apprend en ctasse sur
maisons du monde entier
étonnantes.
p la
les gestes à faire pour aider
nète.
Ia
Notions pour ['enseignant
B6
Ça coule de source
Flotte-co u Ie
-.,::t: Le radeau de Zouglouglou
0n the rocks
Menthe à ['eau
': -1:' Boule de neige
Ouvrages autour de I'eau
138
742
146
148
751
754
t56
Les notions abordées
. Le transport d'un liquide
. Une première approche de ta ftottabitité
. Les différents états de I'eau
. Une première approche de la solubilité:
mélanges de substances avec I'eau
Les trois états de ['eau
Le cycle de ['eau
> La matière eau peut se présenter sous trois états: solide, tiquide
ou gazeux. Ce sont les différentes façons dont les motécutes
> Entre ciel et terre, ['eau est en circulation permanente depuis des
d'eau sont liées entre e[[es qui définissent son état: les Iiaisons
sont fortes pour de ['eau solide, ptus faibtes pour de t'eau [iquide
et presque inexistantes pour de ['eau à t'état gazeux.
mittiards d'années. Etle se transforme en permanence, changeant
d'état au cours de son cycle naturel dans l'atmosphère, à [a surface et dans les sous-sols de notre ptanète.
Chaque état présente des caractéristiques physiques particulières:
- ['eau solide est incompressibte et a une forme indépendante
de son récipient,
- t'eau liquide est peu compressible et sa forme s'adapte à son
récipient,
- ['eau gazeuse est compressible et occupe tout [e volume disponibte dans un récipient.
> Les changements d'états de ['eau correspondent au passage d'un
état à un autre. On peut les reprêsenter et les nommer sur [e
schêma suivant:
Sotide
Cette eau qui circute en permanence sur [a terre est une ressource
Liquide
.
ry:;__,,.,,*
Gaz
On peut observer assez facilement les trois états de ['eau et le
passage de ['un à l'autre dans [a vie quotidienne.
lleau liquide qui chauffe dans la casserote bout à too o et devient
de ['eau à l'état gazeux: [a vapeur d'eau. Attention, [a vapeur
.
d'eau est invisibte. Ce que ['on voit au dessus de la casserote et
qui est habituetlement appeté vapeur d'eau est de ['eau [iquide
sous forme de fines gouttelettes.
La neige qui fond montre [e passage de ['eau sotide à ['eau
tiquide
.lleau liquide placée
au congélateur devient de ['eau solide dans
[e bac à glaçons.
.
136
En soufftant sur un miroir, [a vapeur d'eau présente dans ['air à
['état gazeux se condense en gouttelettes d'eau tiquide, ta buée.
vitate qu'iI est important de préserver.
lleau un mitieu de vie à découvrir et à protéger, I'eau et son usage
quotidien (consommation, traitement, utilisation) sont des thèmes
que ['on peut aborder dès ['écote maternetle.
INFLUENCE DE LA DENSITÉ
-
. - -stat c'est légen
Ça
flotte ou c'est lourd, ça coule n'est
pas
= :cur expllquer pourquoi un corps plongé dans de L'eau
. :- coute. ll faut faire référence au principe de [a poussée
- -ède pour expliquer correctement ce phénomène.
-:
..
-
-
..
> Plus un ftuide est dense, ptus [a poussée d'Archimède subie par
un oblet plongé dans ce ftuide sera importante.
u
tlongé dons un liquide au repos subit une force verticale
D0s vers le
haut et opposée au poids du volume de fluide
-elte force est oppelée poussée d'Archimède.
--:\CE
DU POIDS
Eau douce
votume, un obiet coute ou ftotte en fonction de
,-_:Ur.
Eau salée
> lleau satée, plus dense que ['eau douce, exerce une poussée
d'Archimède ptus importante sur les objets qui y sont plongés
car son poids est supérieur à celui de ['eau douce à volume égat.
C'est pour cette raison que certains obiets flottent dans ['eau de
mer alors qu'ils coulent dans ['eau douce.
> À l'inverse, plus un objet a une densité importante, plus son
poids est important et plus iI a de chances de couler. C'est pour
ceta que certains matériaux flottent plus facilement que d'autres.
INFTUENCE DE
'.rlère boîte ne contient que de t'air. Ette llotte car son
-. =st moins important que le poids de ['eau déplacée.
--..r ème boîte contient du sable. Elle s'enfonce un peu car
- ls est ptus important mais toujours inférieur à celui de
-
-'e[[e déptace.
ème boîte est remptie de sable. Etle coute car son poids
: érieur à celui de l'eau qu'elle déplace.
-
-.
.
tA
FORME
> Pour un même poids, un obiet ftotte
ou coule en fonction de sa forme.
> Une boute d'acier va couter car son
poids est supérieur au poids du volume d'eau qu'ette déplace. Si on
fabrique [a coque d'un bateau avec
de ['acier, ce bateau a une surface de contact avec ['eau ptus importante, ce qui lui permet de déptacer plus d'eau. Le poids de [a
coque creuse et de ['air qu'e[[e contient devient ainsi inférieur à
celui de ['eau qu'elle déptace. Donc [e bateau ftotte.
> À t'écote primaire, il n'y a pas d'explications possibles de ce phénomène. On peut observer que des objets de même forme mais
de matières différentes n'ont pas [a même ftottabitité (ex: une
cuillère en bois, une cui[tère en métat, une cuiltère en plastique).
0n peut égatement amener les élèves à remarquer que tout obiet
lourd peut flotter s'il est creux ou s'i[ a une très grande surface
et que c'est [a forme qui est déterminante.
-e qui peut poser problème
' :-'--.::tite section, tes enfants n'ont que peu de notions des propriétés tiées à ta fLuidité de ['eau. Que de l'eau s'écoule
d'un contenant percé qu'ils ont choisi pourtransporter de ['eau ne manquera pas de les surprendre.
par les
-
^-cvenne et grande sections, Ies élèves associent souvent ta flottabilité d'un objet à sa taiIte ou son poids.
.- :rlets utitisês dans le chapitre Flotte/Cou[e doivent être testé-c par ['enseignant au préatabte.
-, oâte à modeler est en généraI un matériau qui coule, mais attention cependant, iI existe des pâtes à modeter qui
- r::ent.
-= capier atuminium est du métal mais lorsqu'il est comprimé en boule, il flotte car il y a beaucoup d'air qui est resté
égé à t'intérieur dans les ptis de ta boule.
-: papier flotte puis coule car il absorbe ['eau. Certains papiers coutent plus vite que d'autres.
-
La matière L'eau
E
É,
ul
COULE DE SOURCE
t-
liser des objets qui permettent de transporter l'eau
=
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
25 minutes
Matériel
- aquarlum
- point d'eau à proximité
- Seau
-bol
- gobelet
'gobelet
Percé
- cuiltères de différentes tailles
- ecumotre
- passorre
- serviette
- serpitlère
Situation probtème déclenchante
> L'aquarium est posé [oin du robinet de Ia ctasse, iI sera trop [ourd à porter quand iI sera rempti.
> Comment foire pour remplir l'aguorium ?
Questionnement, recherche, proposition
> Les enfants sont en situation de recherche. Lidée de transporter n'est pas évidente immédiatemen:
à cet âge, I'enseignant retance si besoin en induisant la nécessité de contenant.
EN TRANSpoRTANT uu sEnu o'rnu pnÈs oe r'neuln uM, rL N'EST pAS NÉcESSAtRE DE FATRE TRANsPoRTER L'EAU DANs UNE
cutLLÈRE ou uN GoBELET À TRAVERS LA cLAssE suR TourE LA SEANcE.
Manipulations et observation
> Lorsque t'idée de transporter avec des objets, notamment ceux du coin cuisine, a été proposée,
l'enseignant incite à un large choix de contenants et comptète pour arriver au matériel cité.
> Les é[èves remptissent ['aquarium. Les contenants non adaptés laissent l'eau s'échapper. L'enseignant doit to[érer que de ['eau se renverse un peu, iI incite à [a verbalisation, aux commentaires.
Conclusion
.'!"o-
rre ne,tj no^ sf,h.e l'\,.rL\na\[Bp o,Lre. r'i,rnnod.e
0* -,-;
er\
bhr^p.r\æ^
Poun nLrpn pLUs Lo N: LA
A"il,^,"r,r?".,
TATLLE DU
**l
| J"à ]",t. r-r'r^;,-* JL r*^-L
0
""rlr11-.
coNTENANT pERMET DE REMpLtR pLUS ou MotNS RAPTDEMENT L'AQUARIUM.
ATELIER AUTONOME
DE4À6ÉlÈves
15 minutes
Matériel
- bac à eau
- tabliers
- objets de ['étape I
- pailles
- bouteitles
-moutin à eau
- serpitlière
138
Consigne
> lJtilisez te boc à eou comme vous voulez, sons mouiller pot terre et sons mouiller les copoins.
ÊTne RIGoUREUX QUANT AU RESPEcT DE CETTE CONSIGNE POUR PLACER LES ENFANIS EN SITUATION
rr eec À Eau pEur Êrne MIs À DtsPostrtolt oEs ÉrÈves À r'nccurtr, eu
ATELTER sATELLtTE ET ÊTRE ulIsÉ souvENT. LEs ÉrÈvEs ATMENT TELLEMENT JoUER AVEc L'EAU QU'lLS soNT cAPABLES
FA RE BEAUcoup o'grronts PouR NE PAs ru Êrnr pntvÉs
fENsEIGNANT
oo
o'nuroruoiure Cerrr cousrcue REspEcrÉE,
Manipulations
> Les êtèves ne se [assent pas de remptir, vider, verser, transvaser, actionner [e moulin à eau.
L'exploration de [a matière eau est intarissabte, ils sont Ioin d'avoir fait [e tour de ses propriétés.
DE
(pè
mai> juin
ATELIER DIRIGÉ
DE4À6Ér-Èves
zo minutes
Consigne
> Tronsportez I'eau du seou à lo bossine en utilisant les objets à disposition.
Matériet
-r
-r
'i:-
- z bassines
- 2 Seaux
- r gobetet
Maniputations
> Chaque enfant choisit le matériet,
te et passe plusieurs fois.
gobelet percé
-r
-r
louche
bouteilte
bouteilte percée
- r entonnoir
- 1 ecum0rre
- r cuittère
- 1 eponge
serviettes de couteurs
-.our matérialiser le tri
Verbalisation
> À chaque passage, ['enfant est invité à verbaliser ce qu'iI a fait, s'it a réussi à remptir. ll pourra
éventuetlement atler plus loin dans ses commentaires en jugeant de ta quantité d'eau déposée
dans [a bassine et en comparant les contenus de chaque contenant.
Tri
> Les élèves posent sur ['une ou ['autre serviette les objets selon qu'its permettent ou non
de transporter l'eau.
L'enseignant prend des photos tout au Iong de ['atelier.
.//
CEnrntrus oBIETS soNT pLUs EFFtcAcEs AU DEBUT cAR tLS TRANSeoRTENT uNE GRANDE QUANTITÉ D,EAU. MAIS PoUR VIDER LE
FoND rL FAUT uN pETtr coNTENAur (cutrrÈne, eertr coarrrr) er poun nÉcupÉnen rrs oenrtÈnes GourrEs rL raut L'Époruce.
CLASSE ENTIÈRE
:OIN REGROUPEMENT
15
minutes
MatêrieI
-photos prises tors
de l'étape précédente
i Iustrations des objets
à
trier (DVD-Rom)
Verbalisation
> L'enseignant montre tes photos prises [ors de ['étape précédente. Les étèves commentent ce qu'its
font, nomment les objets utitisés et mentionnent s'ils permettaient ou non de transporter l'eau du
seau à Ia bassine.
Tri
> L'enseignant montre les illustrations des ob.iets (DVD-Rom) et trace deux colonnes au tableau.
> Placez dons cette colonne les images des objets quî permettent de tronsporter I'eau et dons I'outre
colonne les objets qui ne le permettent pos.
> Un étève choisit un dessin et [e place dans [a bonne colonne, [e reste du groupe valide ou non.
La matière L'eau
@
ACTIVITÉ INDIVIDUELLE
20 minutes
Matériel
- 1 photocopie par élève
(document page 141
",
,Urll:[]
Présentation de I'activité
> Colle les objets qui permettent de tronsporter I'eou dons lo bossine pleine et ceux quÎ ne permettent
pos de tronsporter I'eau dons la bassine vide.
ATELIER DIRIGÉ
DE4À6Ér-Èves
zo minutes
Matériel
- saladier
de cornichons)
- pot de confiture
-petit pot bébe
- 2 bouteitles en plastique
(r à remptir et r pour verser)
-gobelets (petit et grand)
-cuillères (petite et grande)
- entonnoir
- louche
- bassine remplie d'eau
- eponge
- torchon
-papier essuie-tout
- mouchoir
-pot (type pot
Présentation de ['atelier
> Remplisez le solodier, les pots, lo bouteille à I'aide des outres obiets.
Manipulations
> L'enseignant laisse les êlèves se débrouilter, même quand its renversent.
> ll observe si tes étèves adaptent t'outil à la situation, s'its savent se servir de l'entonnoir. À défaut
iI retance la situation : Là, tu os mis plus d'eou sur lo toble que dans lo bouteille, commeil foirc ?
!:
Verbalisation
> Les enfants expliquent teur difficutté à remplir te petit pot et [a bouteitte. Ceux qui sont parvenus à
remplir correctement [es contenants expliquent comment its ont fait, quels obiets its ont choisis et
comment its Ies utitisent.
Questionnement
> Comment enlever I'eau ?
> L'enseignant demande aux étèves d'essuyer [a table et [e matériet. ll [eur met à disposition éponge,
serviette, torchon, papier essuie-tout, mouchoirs.
> Les étèves commentent t'efficacité de chaque outit. L'enseignant verbalise et introduit les verbes
essuyer, essorer, éponger et absorber.
PROLONGEMENT
> Verser dans différents contenants dont l'ouverture devient de plus en plus étroite.
,,40
Trier les objets selon leur capacité à transporter ['eau.
]UI TRANSPORTE [EAU?
'[*
,-
les objets qui permettent de transporter ['eau dans [a bassine pleine
-iux qui ne permettent pas de transporter ['eau dans [a bassine vide.
€
ul
É,
.ul
F
=
J
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
20 minutes
Matériel
-t'album inducteur
Situation déclenchante
> llenseignant fait découvrir t'album Le boteou de Monsieur Zouglouglou.
> Dans cet album en randonnée, Monsieur Zougtouglou a construit un bateau avec une noix.
Au fur et à mesure qu'il vogue sur [a rivière, it invite ptusieurs animaux à monter dedans.
À ta fin, une petite puce tes reioint sans rien demander et fait couler le bateau.
> llenseignant raconte t'histoire en matériatisant les actions à chaque page (personnages sur le
DVD-
Rom).
> ll prend une noix, [a casse en deux parties et montre [a coque aux élèves. Étant trop petite pour
itlustrer [e reste de l'atbum, ['enseignant explique qu'it prend une assiette pour faire [e bateau.
Découverte
> Chaque personnage est ptacé sur t'assiette au fur et à mesure de l'histoire, quand [a petite puce
Le bateou de M. Zouglouglou
Coline PromeYrat
O Didler leunesse . 20oo'
11,95
saute sur [e bateau, ['enseignant s'arrange pour appuyer discrètement sur I'assiette: les élèves
observent [e bateau couler au fond de I'aquarium avec à chaque fois [e même plaisir.
€
-r
aquarium rempli d'eau
-les personnages de l'histoire pho'
tccopiés et pLastifiés iru?;I.J]
-1 petite assiette en Ptastique
ATELIER DIRIGE
DE4À6ÉLÈvrs
30 minutes
Matériel
- bac à ea.r
* Diftérents objets du
quotidien, des petits et des grands,
des lourds et des Légers:
- petite et grande cuittère
en bois, en métal, en ptastique
-balte en ptastique
Pâte à modeter
- noix de coco
- feutre
- crayon à PaPier
- ctef
':ii::::
-
Au pnÉnrngLr,
LES ENFANTs oNT DÉjÀ utrrrsÉ
DE RESPECTER LA CONSIGNE DE CETTE ETAPE'
Lr BAc À
EAU Artru oE s'AppnoPnten
re mntÉnter
ET D'AccEPTER
Présentation du matériel
> Les enfants nomment ce qu'its voient.
Questionnement
> eue vo-t-il se posser si on pose un obiet dons I'eou ? tl va nager, tomber, couler, voguer (idem l'histoire)Consigne
> Posez doucement un obiet sur l'eou et observez ce qui se posse.
Tests et maniputations
> Chaque enfant choisit un obiet, [e pose, observe et verbalise : îl coule, il flotte.
> puis, ['enseignant tui demande d'anticiper ce gui va se passer: Peut-être que mon obietvo couler, ie
crois que mon obiet va flotter.
bille
- assiette en plastique
'cube en bois
- 2 plateaux
Conclusion
> fenseignant fait sortir te matérieI du bac à eau, en posant sur un ptateau les objets qui ont couté
et sur ['autre les objets qui ont ftottê.
.?nt*
dontæ W^L*
Jb[,,^-Pr"f
Ol)
6à janvier > iuin
@ nor"rore>juin
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8ÉlÈvrs
zo minutes
Matériel
-aquarium rempLi d'eau
- r baLle de golf
- l petite bille en métal
-, petite et
une grande bille
en verre
-
stit caillou et un gros galet
::-
re et une grande boule de
polystyrène
- r boule e- bois, à oélaLt
- - rorceau de bois plus gros
:ue la boule de pétanque
'. . )- e et une grosse
boule
de pâte à moderer
,-: :ougie en forme de boule
. :n liège ou par défaut un
bouchon en liège coupé
Description du matériel
Mise en évidence des différentes tailles et masses
> Les enfants nomment et décrivent [e matérie[:
je vois plein de boules, il y en a des petites et des
grandes, mais pas toutes pareilles.
> ll y o encore outre chose qui est différent entre
ces boules.
> L'enseignant invite un étève à porter et à soupeser les boules dans la main.
> ll y a des boules qui sont légères et d'outres qui
sont lourdes.
§
Mise en évidence des différentes matières
> Qu'est-ce qui n'est pos pareil? Elles ne sont pls
foites avec la même matière.
> L'enseignant fait nommer les matières que les enfants connaissent et aident à nommer les
autres.
> Les êlèves classent les boules selon la matière.
ATTENTIoN AUx BouLEs EN PLASTIQUE: LE PLAsTIQUE couLE, MArs coMME EN
CET OBJET FLOTIE.
cÉtÉnnr r'oeyer
EN
pLAsleuE Esr
cREtJx,
Représentations initiales et hypothèses
> Quelles sont les boules qui vont couler et quelles sont celles qui vont
flotter?
> Les étèves vont certainement penser que tes petites boules flottent et que les ptus grosses
coulent
ou que [es tégères flottent et que les plus [ourdes coulent.
Expérimentation
> Mettez lo main dans I'eau et posez doucement lo boule ou
fond de l'oquorium. Observez si elle reste
ou fond ou si elle remonte pour flotter.
Observation
> Les boutes qui ftottent et celtes qui coulent ne correspondent pas aux hypothèses des élèves
Conclusions
.fl,uad*»
. Y*1,
A.'!*o
m
.)VVadæ,»
car"lrrt
0.
.ar-y*P,Y,",*
BiEN sÛR, lL EST PosslBLE DE FATRE FLorrER ors unrtÈnes eur couLENT EN MoDTFTANT
LEUR FoRME, MArs CoNSTATER
L'ttttpoRTarucr DE LA MATIÈRE ToNcERNANT LA FLorrAB rtrÉ o'utt oBJET EST uN
oBlEclF suFFtsANT À rn rtu or r,Écore
MAÏERN ELLE.
La matière L'eau
I
I
ATELIER SEMI.DIRIGE
I
DE6À8Ét-Èves
3o minutes
Matériel
- aquarium rempti d'eau
-Pailte
-plume
'brinditle
-crayon à papier
- clseaux
clef
..
- bouchon
,o;!:
- trombone
- duplo
-r
Présentation du matériel
> lJaquarium est disposé au mitieu de [a tabte, les objets à trier à côté, tes enfants nomment ce
qu'ils voient, its reconnaissent certains objets de l'étape z, d'autres ont été remplacés.
l
Hypothèses
> plocez les étiquettes des obiets ou fond de l'oquorium si vous pensez qu'ils coulent et ou-dessus du
niveau de I'eau si vous pensez qu'ils flottent.
Vérification
> Avont de coller les étiguettes, vérifiez à I'oîde des vrois objets puis collez son étiquette ou bon endroiL
lr
-bougie
-caittou
photocopie par élève
(document page 145
., ,Urll:[]
PROLONGEMENT
> Pour aller ptus toin, it est possibte d'essayer de faire flotter une matière qui coule en modifiant
sa
forme.
> Pour cela, it est possibte de réatiser une expérience avec de ta pâte à modeter: ette coute si elle est
en boute et ftotte si elte a [a forme d'une assiette ou de [a coque d'un bateau.
TESTER L'ExpÉRtENcr Au pnÉnLneLr, cAR cERTATNES pÂrEs À
744
uooeren
eN aouLr.
FLoTTENT
^ilÊmr
tl
(u
o
LL
=(,
'o-j
t_
-o
G
(§
=
e
ç-
(t)
=
=
a
E
(=
o
CJ
G)
0.)
a
a
!=
-cc
(,
(=
,r)
(,
a
t
.4,
q.)
E
(§
=
I
t
qJ
q2
I
=
o
I
U
§-
(n
LU
E
J
l
C
O
O
l
o
LU
F
I-
9
LL
t
J
'g-
(o
=
o
§
G)
E
E
C
o
(È
r=
o
G)
-o
o
(u
=
o
ço
.C
U
o
!
G)
(u
=
o
I
'{=
\OJ
L
(}
o
o
lJ
\
)
EI
É,
,EJ
LE RADEAU DE ZOUGLOUGLOU
Fabriquer une embarcation qui flotte
=
DÉCOUVRIR LE DÉFI
DEs ALBUMs DANs LESeuELs lL y A DEs RADEAUX urtrtsÉs pnn LES pERSoNNAGEs sERoNT À LA DtsPostrtoN oEs ÉrÈvEs
LoRS DES TEMps D'ACCUE L DES sEMAtNEs pnÉcÉorures VotR DERN Ènr pnce DE cE cHAPtrRE.
10 à 15 minutes
['album inducteur
Situation déclenchante
> L'enseignant lit ou retit l'album Le bateau de Monsieur Zouglouglou.
Questionnement
> Comment pourrions-nous oider Zouglouglou pour qu'il puisse emmener tous ses omis dons son
emborcotion ? Lui fobriquer un plus gros bateau.
Le bateou de M. Zouglouglou
Coline Promeyrat
O Didier leunesse . zooo. rr,95 €
- les personnages de l'album
plastifiés scotchés sur r bouchon
Défi
>
Choque groupe imagine une emborcotion qui permettro A Zouglouglou d'emmener tous ses omis.
> tl foudro que tous les personnages puissent tenir dons l'emborcotion et que celle-ci ne coule pos.
(DVD-Ro m)
DESSINER TEMBARCATION
10 à 15 minutes
- des bouteitles vides
- du papier
- du carton
- des gobelets
- des bouchons
-des pailtes
- des piques à brochettes
-de l'adhésil
de la cotle
- des canettes
- des leuilLes plastiques
- des branches
-des étastiques
feuille de papier par groupe
Observation
> Choque groupe vo oller rcgorder tout le motériel que vous pouvez
utiliser pour fobriquer l'emborcotion de Zouglouglou.
Consigne
> Après avoir discuté entre vous, choque groupe doit dessiner
I'emborcotion qu'il o imaginée. Quond c'est terminé, je posse dons
choque groupe et vous me dictez le motéilel dont vous ollez ovoir
besoin.
Dessin
> Chaque groupe dessine son embarcation que ['enseignant vient
[égender.
FABRIQUER UN RADEAU
25 à 30 minutes
Cerrr
ÉrnpE
prur
ÊrnE RÉrrÉRÉE luseu'À ce euE
rous
LEs GRoUPES AtENr RELEVE LE
DEFI
Essais
le
,,46
matériel demandé par le groupe
[ors de l'étape précédente
-,e maté.iel oe récupération
de l'étape précédente
> Chaque groupe réalise ['embarcation imaginêe.
> À chaque essai, ['embarcation est mise à ['eau et testée avec tous les personnages.
> Les difficuttés [es plus courantes sont:
- ['emptoi de matériaux non imperméables qui vont donc couler au bout d'un moment,
- I'emptoi de matériaux qui ne flottent pas,
- t'assemblage des éléments entre eux: la première action que les élèves vont tester est [e coltagÉ
mais la colle vinytique habituelte ne résiste pas à ['eau, de même pour ['adhésif.
Le projet initiaI va être remanié plusieurs fois avant d'arriver à une embarcation satisfaisante.
PRÉPARATION DE LA PRÉSENTATION
15 à 20
minutes
embarcation du groupe
- [es photos prises
par l'enseignant
Verbalisation
> Rocontez-moi comment vous êtes orrivés à cette fobricotion ?
En montrant les photos, I'enseignant aide les étèves à reverbatiser toute [eur démarche en veittant
au réemploi du vocabutaire spécifique et des connecteurs temporels: en premier nous ovons fait un
bateau en papier, mois le papier a absorbé de l'eau, il n'est pas imperméable, notre bateou o coulé. Puis...
PRÉSENTATION DU DÉFI
4 ou 5 x 10 minutes
A peÉvotn suR UNE sEMAtNE. CHAeuE GRoupE pRÉsENTE sA soLUTtoN À L'eNsEMeLe DE LA cLASSE suR uN TEMps
DE
REGROUPEMENT.
-les embarcations
de chaque groupe
-: 3eTsonnages de l'atbum
:: .:otchés sur un bouchon
(DVD-Ro m)
lnsta[[ation
> Mise en ptace de ['espace permettant aux groupes de passer et de relever Ie défi.
Passage des groupes
> Chaque groupe passe, fait sa présentation orate et une démonstration du dêfi relevé
Questions
L'enseignant et Ies autres élèves demandent des explications si nêcessaire.
15
minutes
des photos prises Iors
de [a présentation
-r affiche
Bilan
> Chaque groupe étant passé, L s solutions trou ,ées sont Listées u tabLeau.
Le terme de radeau est introduit s'i[ ne ['a pas encore été.
>
Trace écrite
> Une affiche collective est réalisée en dictée à l'adutte.
:JUào-
aünlné,
*ffi
L:no u.
In
q
W,fi*r,
,î.o
[rSt- n o n n î,1*
l)
ù»
dà" U*"-
I
0
=-:es: relever un défi, ftotter, couter, tester, assembler, dissoudre.
:-s:
-adeau, embarcation.
- : ectifs : perméable, imperméable.
La matière feau
lrJ
É
,Ul
l-
=
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
3 x 1() minutes en dêbut
de matinée, fin de matinée
et fin d'après-midi en hiver
Matériel
- z bols
-de la neige
- de [a gtace
Situation inductrice
> ll a neigé et gelé dehors. La ctasse a récupéré de [a neige et de
[a gtace dans des bots.
L'enseignant prend des photographies des bots à chaque étape
de la démarche.
Approche sensoriette
> Les bots circulent de main en main, les enfants observent [a
gtace et [a neige, [es différencient visuellement: [a glace est
transparente, avec des morceaux comme du verre, [a neige est
blanche et ressemble à de [a poudre.
> En les touchant, [es élèves constatent que [a gtace et [a neige sont très froides.
Questionnement et hypothèse
> Que vo-t-il se posser si on loisse les bols dons la closse ? Tout va fondre !
Vérification
> En fin de matinée, [a classe observe à nouveau [es bols. Verbatiser les observations: dans les deux
bots, it y a de ['eau.
> D'où vîent cette eou ? De la gloce et de lo neige qui ont fondu.
Conclusion
. Q,^^a Ur
fî^"-
A-,
"1,
*'*r.f p' L^t, ç-
* t". ^$^.^-
e-n, eDrJ,.
Questionnement
> Que se posse-t-il si on remet les bols dehors
?
Hypothèses des é[èves
> Chacun donne son idée, ['enseignant êcrit pour garder en mémoire les différentes propositions.
Expérimentation et observation
> Remettre les bots à ['extérieur et observer [e résuttat quetques heures ptus tard: l'eau des deux
bols est devenue dure et froide: c'est de [a gtace.
Conclusion
.Lno* i.hL lr,^r.j+,.r"É"* nÿt-.,
y " ,-y.
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
15
minutes
Matériel
- moutes à mutfins
-boutes de cotittons
-con[ettis
-perles
748
Situation inductrice
> lJenseignant propose de fabriquer de jolis glaçons dans tes différents moules et de [es décorer.
Questionnement
> Comment foire des gloçons ? Mettre I'eau dans les moules. Placer dehors ou f roid ou ou congéloteur.
> À quel moment fout-il mettre les décorotions?
> Laisser la discussion s'engager entre ceux qui ont déjà bien compris ce qui va se passer et ceux
qui ne se représentent pas encore totalement [a situation. Les étèves argumentent.
> Comment décorer son gloçon ? En rajoutant des petits objets, des petits jouets, des morceaux de papiers brillonts... En rajoutant des gouttes de peinture, encres, gouoche pour des effets différents.
> Avec les boutes de cotilton, les perles et les confettis I'enseignant a déià induit des étéments de
réponse. Les élèves peuvent proposer d'autres décorations.
@@
ATELIER SEMI-DIRIGÉ
D'AUTANT o'ÉlÈves
QUE DE MOULES
zo minutes
Matériet
- moules à muffins
- boules de cotitton
-confettis
:
- fèves
décorations de Noël
bouteilte rempiie d'eau
- encre avec pipette
décembre> mars
Présentation de son idée
> L'enseignant demande à chacun comment iI veut décorer son gtaçon et comment il va procéder.
Réalisation
> Le matérieI est à disposition. Les êlèves s'organisent, l'enseignant n'est là que pour faire
verbatiser, retancer et réguler au besoin.
> Quand chaque enfant a fabriqué son glaçon, il faut mettre les moutes dehors ou au congélateur et
attendre Ie lendemain.
CLASSE ENTIÈRE
:OIN REGROUPEMENT
3 x 10 minutes
Matériel
- les glaçons réalisés
s de l'étape précédente
Observations
> Les élèves admirent [eurs glaçons. On peut les sortir pour mieux les voir, les toucher, ils commencent
un peu à fondre dans les doigts. Quand on les remet, ils rentrent parfaitement dans [e moute.
Remettre les glaçons dans [es moules, [es mettre de côté pour les oublier.
lvlÊ[4E sr LEs ENFANTS SAVENT eu'uN GLAçoN rouo À r'rr.rrÉnrrup, Tous NE soNT pAS pEnsueoÉs euE LE GLAçoN eu'rLS
oNT FABRTeUE vA EGALEMENT FoNDRE. eUAND tLS FoNT uN cÀrenu rn pÂTE sE TRANsFoRT\,rE EN GÂTEAU sous L'AcloN DE
LA CHALEUR ET RESTE SOL DE EN REFRo D]SSANT. CETTE REPRESENTATIoN DE TRANSFoRMAT oN IRREVERsIBLE VA CoRRES.
poNDRE À cERTAtNS ENFANTs, L'ENjEU DE rn sÉeNcg coNS srE A MoNTRER DES TRANsFoRMATtoNS REVERSTBLES.
> Plus tard, Ies enfants observent à nouveau leurs gtaçons tout fondus.
Verbatisation
> Le gLoçon est redevenu de l'eau Liquide.
Questionnement
> Est-ce que Ie gloçon peut se tronsformer à choque fois en eou liquide et redevenir de lo gloce
Comment le vérifier ?
?
> Les étèves proposent de refaire la même manipulation, remettre les moules dehors.
Expérimentation
> Recommencer Ies opérations de geI et de dégel.
Conclusion
La matière L'eau
CLASSE ENTIERE
COIN REGROUPEMENT
5 minutes
Matériel
- aucun
Érnpe 5
FATRE LA RELATIoN ENTRE
LA FoRME DU GLAçoN ET LE
MoULE
M5'GS
Défi
> Proposer ce défi aux étèves: faire des glaçons pointus.
Temps de réflexion et propositions des élèves
> Les étèves font des propositions: casser [es gtaçons en pointe, faire fondre [e bout...
> par [,argumentation et te dialogue, on pourra déjà éliminer les propositions irrêatisabtes. Cetles
pas très
réatisables en ctasse sont testèes et critiquées: te gtaçon que ['on taitte en pointe n'est
rêussi et seu[ ['enseignant peut te faire, faire fondre en pointe est doutoureux pour [es mains!
Relance par l'enseignant
> Si on ne peut pos ogir sur le gloçon, que peut-on choisir ? Quelles formes ovoient les gloçons
à gôteoux.
Des formes oirondies. Pourquoi ? Parce qu'on les avait mis dans moules
Donc, si on ne peut pos ogir sur Ie gloçon, que peut-on choisir ? Le moule'
?
Conclusion
,9-^p;"- a". W
t0
8"^,[
a\DJ/rplv d*b
^^'lP"
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
15 à
zo minutes
Matêriet
- pâte à modeler
- objer en forme de cône,
de pyramide ou de cube
-moule en triangte
Temps de recherche
> Les élèves recherchent dans [a ctasse, à [a maison, des oblets hermêtiques et creux pouvant faire
office de moule.
> Certains enfants vont voutoir te fabriquer avec du papier. Or, [e remptissage avec ['eau va s'avérer
impossibte avec des objets en papier ou carton, ou si it y a du vide qui [aisse ['eau s'écouter.
> llenseignant propose ators de reformuler les critères du moule?
- ll ne doit pas être en carton ou en papier. ll ne doit pas avoir de trous'
> Les étèves proposent des solutions qui respectent ces différents critères:
-
Apporter de lo moison des cônes à glace.
- Trouver des obiets creux en forme de pyromide ou de cube ouvert'
- Faire I'empreinte d'une pyramide dans de lo pâte à modeler et s'en servir comme moule.
Fabrication
> Les étèves remptissent [e moute qu'its ont réatisé ou choisi et observent les gtaçons obtenus.
Analyse
> pourquoi le moule doit-il être pointu? Parce que lorsqu'on met l'eau dons le moule, elle se met dans
cette forme, et après le glaçon gorde la même forme.
Conclusion
,- %,
' ,h. ,A A h'r,'rr- a* ^^'"ÿ-.
-- "ÿ.".
tr--=- l'
0
Réinvestir
> S'amuser à faire des glaçons de toutes les formes.
150
E
É
MENTHE À TEAU
II
t-
{
=
(
_l
J
CLASSE ENTIERE
COIN REGROUPEMENT
15
:
:-
minutes
Matériet
'ansparent de r[ de volume
rempli d'eau potable
-r
- roog de sucre
cuiilère par enfanl
Étlpr r
DÉcouvRtR LA DtssoLUTtoN
Approche sensorielle du matériel
> L'enseignant prêsente [a cruche remptie d'eau ainsi que le bol rempli de sucre. Les élèves goûtent
[es contenus pour reconnaître et nommer l'eau et le sucre.
Questionnement et hypothèses
> Que vo-t-il se posser si on mélange le sucre dons I'eou ?
> Les enfants s'interrogent et proposent des réponses.
Expérimentation et observations
> Lun d'eux vient verser [e sucre dans l'eau puis mé[ange avec une cuil[ère en bois.
> Au départ, le sucre est visible dans [a cruche, on voit les grains de sucre tomber dans l'eau, ['eau
devient btanchâtre puis au bout de 3o secondes elle est à nouveau limpide.
> Le sucre a disporu !
Vérification
> L'enseignant fait goûter ['eau. Les élèves constatent qu'elte est
sucrée alors qu'au début elte ne ['était pas.
Conctusion
'b
ATELIER DIRIGÉ
DE
6
ÉLÈVES
25 minutes
rr
Matériet
pots en verre transparents
avec couverc[e
- eau
- sucre
- sel
- noix de coco
- farine
-sirop d'argent
- lait en poudre
6,i xx#;:r**
Êtapzz
EXpÉRTMENTER DEs MÉLANGES
vt^^
*'^^ *" Y'L
xÉrÉnocÈres
ET
HoMoGÈNEs
Gs
Prêsentation du matériel
> L'enseignant montre six pots contenant chacun une substance
btanche. Les atiments choisis sont tous btancs. Pour [es reconnaître, il faut les goûter.
> L'enseignant montre également les pots en verre remptis d'eau.
Déduction de la consigne en réinitiatisant les acquis
> À votre ovis, qu'ollez-vous foire ovec ces oliments et les pots d'eou ?
> C'est une manière déguisée de rappeler le mé[ange sucre et eau.
> Consigne reformutée par ['enseignant.
Mélangez chaque aliment dons un pot d'eau, refermez le pot et secouez-le pour mélonger !
Manipulations
> Chaque élève s'occupe d'un aliment, [e verse dans le pot, referme, secoue le pot et s'attend à ce
que [e mêtange redevienne transparent comme avec [e sucre.
Observation
>Chaque étève n'obtient pas la même chose. Les différentes observations s'opposent:
ce
rta
i
n
es su bstan ces
d
i sp
a
ra i ssent, d'a
utre
no
n.
> Force est de constater que [a farine et Ia noix de coco ne se mêlangent pas comme [e sucre, Ie set,
le sirop et [e lait en poudre.
La matière
L'ea u
ATELIER SEMI-DIRIGÉ
DE4À6Ét-Èves
3o minutes
Matériel
- 6 pots en verre transparents
refermables type petits O",t OriO.Î:
- café solubte
- chocoLat en poudre solubte
(attention, certains fortement
dosés en cacao ne [e sont Pas)
- huile
Réinvestissement
> L'enseignant fait nommer te matérieI mais on ne fait plus goûter.
Consigne
> Mêlongez le sucrc, le cofé, le chocolot en poudre, I'huile, le soble et le sircp avec de I'eau dons un pot
à choque fois diffêrent. Refermez les pots et secouez pour mélonger. Observez les pots pour trier d'un
côté ceux où I'eàu s'est mélongée ovec ce gu'on o mis dedons et ceux où l'eou ne s'est pas mélongée.
> L'enseignant introduit ici Ies termes de sotubte et non sotuble.
-sabte
-sirop de menthe
- colle
- une photocopie par étève
(document page 152
el
DVD-Rom)
Expérimentation
> Les étèves ont l'expérience nécessaire pour manipuler et faire Ie tri.
ATTENTtoN À te pns METTRE TRop or sorurÉ (exemeLe ou sucne) DANs LE soLVANT (r'enu) cnn LoRsQUE LE MÉLANGE
INNIVT À SATURATION, TC SOLUTÉ NE DISPARAÎT PLUS MAIS 5E DÉPOSE AU FOND DU MELANGE.
slRoP DANs
euAND oN vERsE DE L'EAU DANs DU slRop, Le mÉr,qucr s'opÈne trusrnntnuÉueut. Mnts sl oN vERsE DU
LE
L,EAU, LE stRop DEscEND AU FoND DU vERRE cAR rn oeusrtÉ DES DEUx LtQUtDEs N'EST PAs Ln uÊur. lL FAUT AGITER
Tour pouR oBTENIR uN mÉLeucE HoMoGENE.
LA-r EN PÇiDRa
ia
5,Â.Ê Dr ÿE{T"E
-^t
1 ÀÉË
5ABLE
HUI LE
tlf-;tÉ
5ULÿDL-,A(
l\J
<.n't,at
f
;v;vJ--
Trace écrite individuelte
>
feste choque motière à ta dîsposition puis colle son êtiquette dans lo bonne colonne.
> Les élèves posent et collent leurs images dans [e tableau.
r52
Trier les matières solubles dans ['eau.
€
SCLUBLE OU PAS SOLUBLE?
Teste chaque matière à ta disposition puis cotle son étiquette
dans [a bonne colonne.
NON SOLUBLE
SOLUBLE
+
+
1
1
I
I
I
I
lrJ
É,
,uJ
=
DÉCoUVRIR LE DÉFI
10 à 15 minutes
AvANT DE coMMENCER Lr oÉrt, r'ensrrcruANT DEMANDE AUX pARENTS D'AMENER uN
por
DE vERRE AVEc
couvERcLE
ET
UNE FIGURINE ENTRANT DANS LE POT
au moins l boule de neige
réaIisée par l'enseignant
Situation déclenchante
> L'enseignant présente une boule de neige qu'iI a fabriquée. lt ta fait circuter pour que chaque étève
puisse la retourner et ['observer. ll explique gue chacun va en réaliser une.
Questionnement
> 5i nous voulons fobriguer une boule de neige, que devons-nous ovoir ? Un pot avec un couvercle,
de L'eau, un personnage, de La neige. L'enseignant rédige la Iiste du matériel nécessaire au tabteau.
> Est-ce vraiment de lo neige ? Non, cela représente de Ia neige, c'est blanc.
Défi
> ll
vo
folloir trouver ovec quoi nous ollons pouvoir foire de lo neige,
Hypothèses
> Que connoissez-vous comme motière blonche qui pourroit nous servir pour foire lo neige ? Du sel, de
forine, du sucre, du popier, des bouts de plastique, du riz, du coton, du tissu blanc, des paillettes...
> Choque groupe vo tester les éléments qu'il pense être la neige de la boule de neige.
Lc
TESTER LES MATIÈRES COMESTIBLES
10 à 15 minutes
les malières alimenls nonmées
lors de ['étape précédente
- farine, sel, sucre, riz, fécule...
- des pots avec couvercle
-Jne petite cuilLè'e par mariè'e
à tester
Préparation des tests
> Nous ollons foire deux séries de tests, d'obord les oliments puis les outres motières.
> Chaque groupe va chercher les matières qu'il souhaite tester. fenseignant fait en sorte que toutes
les matières soient testées mais qu'il n'y en ait pas ptus de quatre par groupe.
Consigne et tests
>
Un élève remplit le pot d'eou ovec soin, un outre
verse une cuillère de la matière testée dons
I'eou, un troisième ferme le pot, Puis, oprès ovoir
essoyé, vous posez le pot devont lo motière que
vous ovez testée pour vous en souvenir.
> Chaque groupe réatise les tests qu'i[ a choisis.
Constats
> Qu'ovez-vous constaté aprèsvostests
?
LE NtvEAU DE LANGAGE sena rnÈs otrrÉnerut seLou
euE res sÉnruces MENTHE À fEAU - FlorrE-couLE soNT
mrtÉes nvnrur ce oÉrt ou NoN.5l ELLEs NE LE soNT
PAs, LE VOCABULAIRE SCIENTIFIQUE SERA INTRODUIT À
cerre Érnpr.
> lly a des matières qui sont solubles dans l'eau, comme le sel et Le sucre, elles ne peuvent pas foire
de la neige. lly a des matières qui troublent I'eoLt comme la forine et la fécule, eLles non plus ne
conviennent pas. lly a des matières qui coulent tout de suite, comme Le riz, ce n'est pos beou.
Bilan
CE BILAN PEUT ÊTRE MENÉ EN CLASSE ENTIÈRE UNE FOIS QUE TOUS LES GRoUPES SERoNT PAsSES AUx PREMIERS TESTS.
t
",\]3.," d.s,n v> th,oL,ueh
0-lr
afurPmpn),.
cîulÊ
754
url€
mali,ei,e
^.o -l^J0"
d,o
.u.
0.o- ou *e V*JP*
r.o,o
0no- nt
o-
TESTER LES AUTRES MATIÈRES
25 à 30
minutes Préparation des tests et questionnement
-ious les éléments
btancs
=:ertoriés [ors de l'étape r
hors aliments
--: er, tissu, coton, gobelet,
:-e. bouchons en plastique
. :, perles, pailles, gomme...
:
-r
ou z paires de ciseaux
- 1OU 2 rapes
-des barquettes
- des pots avec couvercle
-une petite cuiltère
par matière à tester
> Chaque groupe va chercher les matières qu'iI souhaite tester. Lors de cette étape, les groupes vont
rencontrer ta difficutté de faire des petits bouts des matières blanches à [eur disposition.
>Quedevez-vousfoire? llfoutfairedespetitsbouts.Commentfoire? Endécoupant,déchirant,rôpant.
> llenseignant introduit l'outit râpe si [es étèves n'y pensent pas.
Tests et constats
> Chaque groupe réalise les tests choisis par [e groupe.
Constats
> Qu'ovez-vous constoté après vos tests ?
ll y a des matières qui flottent comme le polystyrène, le tissu,
le papier,
elles ne peuvent pas faire de la neige.
Ily a des motières qui coulent tout de suite, comme les perles, ce
n'est pas beau.
lLy a des matières qui coulent doucement, elles peuvent foire de lo neige.
Bi[a n
,lno -olrn'oo o^-WùIr t o!
o/*.r
.J^r.- "*u *4"-}^ "" ?.--L
, J-il LrÈ,b u-l,e rLe ,uv*nyuzr,I *.o.
û"-J" o
"^
ar.r
- {^.*l*
-,\]à.-o nô1-16nÀ
il\Àr-"
FABRIQUER LES BOULES DE NEIGE
15 à
20 minutes
* Par élève:
- 1 pot avec couvercte
- r figurine
*
Fabrication
> Chaque étève choisit parmi les matières possibtes cetle qu'il souhaite pour faire Ia neige. Certains
réalisent [eurs brisures de gomme ou autres, pendant que d'autres après avoir poncê l'intérieur de
Ieur couvercte passent à ['atelier cotlage de Ia figurine avec t'enseignant.
Pour la classe:
-tes matières choisies
- rapes
- ctseaux
- barquettes
-lpistoletàcolte
EN FoNcr oN DE LA TA LLE DE LA F GURtNE,
PISTOLET A COLLE.
rn
nÉHeussEn À r'ntoe o'un BoucHoN EN pLAsr euE ET FtxER LE Tour
AU
STRUCTURATION ET TRACE ÉCRITE
15
minutes
- des photos prises
lors de [a fabrication
Bilan et affiche
> Qu'ovons-nous oppris en fobriquont ces boules de neige ? ll y o des
matières solubles et non solubles, d'autres qui troublent l'eau. lly
o des matières qui flottent et d'outres qui coulent plus ou moins
doucement.
Verbes: relever un défi, flotter, couler, tester, dissoudre, râper.
Noms: boute de neige, brisure, copeau, râpe.
Adjectifs: perméabte, imperméable, solubte, insolubte.
La matière L'eau
ALBUMS AUTOUR DE L'EAU
q,
6à 6À
@@
0ù va ['eau?
Le bateau de Monsieur
lÊarn." Ashbé
Zougto uglou
. . - p,:r"e.-cc'.1,.0€
L'eau du seau va dans [e verre.
Et où va ['eau du plat? Cette
eau-là va dans [e bot à pois. Et
quand Lili boit, où va t'eau du
bot à pois ? Dans le pot de Liti !
La familte Souris et
mare aux Iibellutes
Coline Promeyrat et Ste[any Devaux
O Didier jeunesse . uooo . rr,95€
Monsieur Zougtougtou construit
un bateau avec la coque d'une
noix. Plusieurs animaux montent
à bord.
6à
\, 6à
\,
Ær
,6à
\-/
Les deux maisons
Quand it pleut
@
Christine Be ge{ et Christophe l\4ertin
O Le baron per.hé.2013.14€
Par une nuit de terribte tem-
l(azuo waTnura
O -ecole des lo',ir>.2ooj. r.2o=
Aujourd'hui les quatorze petites
pête, un navire sombre. Un
mystérieux coffre est êpargné
par Ies flots.
souris embarquent sur un radeau
à [a poursuite des Iibellutes et
@@@
@@@
Voità ta pluie
lunko Nal<amura
O Editions À,aemo.
Dans [eur maison de set se
La ptuie réveitte un enfant de
sa sieste et L'attire dehors. ll
. zoog . tz,5o€
Les animaux de la savane
s'annoncent Ia venue de [a
observe ators les événements
que la pluie amène et ce que
ptuie: le porc-épic la flaire, Les
zèbrent Ia voient, [es singes
fait chacun.
t'entendent.
disputent le p'tit vieux tout en
seI et Ia p'tite vieitte tout en
sucre. Un jour, le p'tit vieux
met sa femme dehors.
l,4anVa stojic
O Circonflexe
15€
des grenouitles.
Deux manchots
!
Didier l(owarsl(y et Samuel Ribeyron
O D d er je-r esse . 2011 . !,;o €
zor4.
[a
sur un glaçon
Sylvain Diez
@ l(aléidoscope o 2s15 c 9,9o€
Deux manchots se préLassent
sur un glaçon quand crac!
ennuis commencent.
AUTRES OUVRAGES AUTOUR DE L'EAU
@@
Les secrets de ['eau
@@
premières découvertes
@@
:
E.irnanueI Chanut
Pierre-Marie Valat
Douze expériences faciles pour découvrir
des propriétés étonnantes de I'eau.
O Galtimard ]eunesse
.
leunesse. 2o08. 9€
Un Iivre documentaire sur les bateaux
avec des volets transparents.
@ GaLlimard
2610 c
9€
Un livre documentaire sur ['eau avec
des voteis transparents.
Les
t§
t- Ër
§à*
Notions pour l'enseignant
158
Trucs et astuces
t59
Le nez au vent
Tournez moulinets
En coup de vent
16o
764
!
t66
Un grand bot d'air
169
Ouvrages et jeux autour de ['air
772
Les notions abordées
u
le §Ès+rivsrtr §* i'*!r è i'*sl§iitr:r
ië sȧùi':r:.§::* ris l'sii § l'i;r;+-iris:::
s S:.'* §i**:èrs §SL1i§{ts §s le l-::sr'.*:r!*iisalii:;r
u
ris i':=ir
La constitution de ['air
> llair est un métange de gaz constitué en votume de zf/" de
dioxygène, de 78"/" de diazote et d'environ r % d'autres gaz: du
dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau, et des gaz présents à
l'état de traces.
NOM DU GAZ
7o
> L'air possède les propriétés d'un gaz: i[ est compressible,
expansible et é[astique.
> Une expérience avec une seringue permet
.
pnÉseur
Diazote (Nz)
78'À
Dioxygène (Oz)
27o/"
Argon (Ar)
o,93'/"
de mettre
en
évidence ces propriétés.
Lorsqu'on comprime un gaz, l'espace vide entre les molécutes
diminue, donc [e votume occupé par [e gaz diminue: [a pression
du gaz augmente. 0n dit que [e gaz est comPressible.
Vapeur d'eau (Hz0)
Gaz carbonique (COz)
o,033 %
Néon (Ne)
o,oo187o
Krypton (Kr)
o,ooo1147o
Dihydrogène (Hz)
o,oooo5
7o
Protoxyde d'azote (NzO)
o,oooo5
7o
Xénon (Xe)
o,ooooo877o
Ozone (O3)
o - o,ooooolTo
Les propriétés de ['air
[air est pesant. On peut utiliser un batlon de footbatl et
È
.
À ['inverse, si on augmente [e votume occupé par un gaz, ['espace
vide entre les particules augmente: la pression du gaz diminue.
0n dit que [e gaz est expansible.
une
batance pour mettre en évidence sa masse.
Un gaz enfermé dans un rêcipient
a
touiours tendance
reprendre son volume et sa pression initiate.
On dit que [e gaz est êlastique.
{*
qu§ Ssrst
ssssr s§}*{èsT:*
.',o;:i
*
ui:ti ce ilu'à i;; fiir ii:..:tirle rJss ilüiiisiLrird:ssEirlnis. ies éii:ut: aii:iri tiri-t.ctlùi:re rit la rr.lsiirl=liiê ile I'aii.
ÿi:ur iirs tni:i:ts Ci F{:iiie Siiii+i:, jTiieslCÈrlia,.-ç,,,:ni iis ilc leiçùi:reiri l}ils *ntil.È i';it'ccn:ir* prêsent- ilaiiii!I .riltiri.ii
aÈ
il ü i l-4.
>,{ l"*i-aii: *i:::*ineiie. l'éii:ve i:e ür=n,l:t i*rscj*nat rj* i'i:rrsielcl rii: i';ti;'i*isrr*'il i:-çl en üû:.ivttaai'ii.
F i.: yeii: iii;1sl:lr* d* i';!r i:r iilili,rei,'reni. :i i,.eu1 ètre i= prêt*.rie à lle sr*iriiirc:.l!:e *r éviije;lct i1t i: pié:el'.t C: i'.r:t"
:,.is ::rL;r
tlB
iiier i,er-. uiil Iii.qt i1t icn:clenee pi:r i'ciÈris i:e l'r:xi:li;rre rji. i',:ir, ig:lr-nr:i:i a i'iltiir.,"r'.
§ffi §§§§§s* §æ §
Sectionner le fond de [a
bouteille. Le remptacer par un
balton de baudruche découpé.
Placer une plume dans le goulot
et tirer [e batlon. Relacher.
Ptanter une paille à travers [e
goulot d'une petite bouteilte.
ss§. s§§ §s
§§
§§ §ê
Sectionner le fond de la bouteilte
qui sera plongée dans ['eau.
Mettre un batton sur [e goulot.
lrJ
É,
,lrl
F
=
CLASSE ËNTIERE
couR
DE
nÉcnÉsrtoru
r5 minutes
Matériel
l'appareil photo
:-:
:
-:.
:.1
i::
i
i i
i.:
:i i: i': i:
:-l
ii :l
i
il È
t..
s- par une matinée venteuse,
l'enseignant propose à ses étèves de se rendre dans la cour pour dê-
couvrir ce qui se passe.
+ par des questions, ['enseignant invite ['enfant à se centrer sur ses ressentis: sensation de frais,
voire de froid, sensation désagréable ou non.
:. Que se posse-t-il sur votre corps quond le vent souffle ?
." Et mointenont, fermez les yeux
!
;- Ouvrez les yeux et regordez outour de vous: que voit-on quond le vent souffle
?
Pendant ce temps, I'enseignant prend des photos qui seront exploitées [ors de l'étape 3.
CLÂSSE §NTIERË
COIFI REGRÛLJFEIlNENT
ro minutes
to1atérieI
- aucun
Verbalisation
> L'enseignant laisse un temps où les enfants s'expriment [ibrement: moi i'ai peur du vent! Moi ie
trouve ça rigolo ! Moi i'avois froid !
> Lorsque les enfants se réfèrent à ce qu'its ont observé avec [eurs sens, l'enseignant les fait formuler à nouveau en leur reposant [a question.
> Que se passe-t-il sur votre corPs quond le vent souffle?
- Le vent caresse, chatouille, pique, frappe le visage. Le vent est froid, très froid. Le vent fait bouger
mes cheveux, mes hobits.
- Le vent fait du bruit quond il souffle.
- Je vois les
feuilles qui bougent.
- Le vent fait bouger les branches des arbres.
- Tu os les joues et le nez tout rouges.
> L'enseignant écrit quetques propos des élèves pour en garder une trace.
:-ELIER DIR!GE DE LANGAGE
DE6À8Ér-Èvrs
zo minutes
:.
-les
*-: g
1';;, l s5 :
§ :
:1
l.i.
i: i.
ii
s lenseignant
t"'
- des photos prises
lors de L'étape r
pictogrammes des sens
vue-toucher-oure
-atériel
:-l: l-l
page 43 et DVD-Rom)
- r affiche
=
i:,-:
:i:
accroche au tabteau les photos prises dans la cour. Les êlèves se reconnaissent et
rappeltent ce qu'ils ont ressenti.0n pourra également relire les notes écrites en dictée à ['adutte
pour bien avoir ['ensemble des observations sensorieItes.
:i.:.i-i:i:i:i':.: i::: rl'l:*-:::-: S:=l lt:: aa .=::::J=: ai=:::-:.=i:,=:r:::il-,-:l:
+ L'enseignant décroche [es photos du tableau pour y accrocher trois pictogrammes représentant
un
celt, une oreille, une main (matériel page 43 et DVD-Rom).
r- Ces trois pictogrammes sont connus des enfants s'ils ont dêjà travaitté sur les cinq sens.
s Les enfants rappellent de quoi iI s'agit:
- un æil pour ittustrer ce qu'on peut voir,
- une oreiIte pour représenter ce qu'on peut entendre,
- une main pour tout ce qui touche [a peau.
;- Plocez choque photo sous I'organe des sens qui vous o permis de ressentir lo sensotion.
s. Les étèves vont associer une photo à un organe, en argumentant leur choix: une photo avec les
joues rouges peut être placêe sous l'æiI parce qu'on voit du rouge, ou sous [a main parce que c'est
associé au froid, à un picotement.
s L'enseignant note ce que disent [es étèves pour accompagner les photos.
s À partir des photos, ['enseignant construit une affiche qui associe les organes des sens, les photos
que Ies étèves ont ptacées er [eurs principaux commentaires.
DJ-t
d,,'o»
Ô
0- .*tr,
ie vois
p i'.n,.r.,
($ i.,"n,
La mâtière L'air l{=i-i
CLASSE ENTIÈRE
couR
DE
nÉcBÉlrrou
25 minutes
:-:.i*ttr ir.:
-5à8moulinets
- 6 à 8 sachets en plastique
6 à 8 foulards et rubans de [a
salle de motricité
-6àSmanchesàair
§ilil=::::* i::*r:rl:'ir+
§ L'enseignant présente [e matérieI aux élèves et le nomme.
i* :rl
*
i*i !:: r: S
Utilisez ce que vous voulez comme vous voulez, mois gordez toujours le motériel dons votre moin !
: i::,_:
i:+=-.-:ir:itaia:r'].<*:v*:'i,.+ll:li:::::
* Le moulinet tourne très vite.
> Le sachet va s'envoLer si je le lôche.
* La manche à air flotte et fait du bruit.
* Le foulard «vole».
CLASSE ENTIÈRE
couR
DE
nÉcnÉnrrou
20 minutes
il*ti.i:i
- des mo"ceaux le papier
des baltons de baudruche gonfLés
- des plumes
- des morceaux de riss.rs
- des sachets en plastique
- des feutres
- des petites voitures
- des baltes
- des jouets de la cuisire
- des cubes en bois
Èiêç*r:i+lir"-* iir ::st§ri+1.
E L'enseignant montre les objets. Les enfants [es reconnaissent et les nomment.
. .:'ql.::.r:.ats;!:
;:
:-" lr.l:tir*
* Que se posse-t-il
si je lôche ces obiets dons lo cour quond il y o du vent
sachet va voler, Le papier aussi, La voiture va tomber...
", Comment sovoir qui o roison ? Pour vérifier, il fout essayer...
?
Le
*: * * ii::: i*:: r:::
s
-:
Chaque obiet est tenu en I'air puis [âchê. L'enseignant régule l'activité mais [aisse ses étèves
expérimenter ['ensembte du matérie[.
Co*stataticns et {onctu6iûHs
È Les enfants constatent que chaque objet s'envote ou retombe immédiatement.
AvEc DES pETtrs, DANS LA couR, ET AVEC DU VENT tL EST tMposstBLE D'uTlLtsER CETTE SEIJLE MANrpuLAT|oN
pouR srRUcruRER DEs coNNAtssANcEs. CETTE rxpÉntuEutnttott vn ooruc Êrne REpRtsE DANS LA clAssE AVEc
TJN
r63
VENTILATEUR.
CLASSE EI{TIÈRE
COIN REGRÛUPEMENT
r5 minutes
F:
':iû
ar
i:
i
- identique à celui
de t'étape précédente
- z boîtes
- 1 ventilateur
-r
affiche
Verba[isaii*n
> L'enseignant êtale au sol tous [es objets expérimentés à t'étape précêdente. Les élèves rappellent
ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont observé dans [a cour.
> lI montre ators le ventilateur et explique qu'iI va servir à faire du ventdedans pour voir si t'oblet
s'envote ou tombe par terre.
Tests
> Chaque objet est testé devant [e ventilateur:
un enfant tient puis lâche cet objet.
Consigne
> Triez les objets dons chocune des deux boîtes: si
I'objet s'est envolé, plocez-le dons cette boîte. S'il
est retombé por terre, plocez-le dons I'outre boîte.
lfl
> Chaque étève à tour de rôte choisit un objet et
! Er!ÿôLg
propose une réponse. Le reste du groupe valide
ou non son choix.
Tr+i: ë:rit*
+ Une affiche est réalisée à partir des photos et des conctusions des étapes précédentes
ILYA
S'ENVOLENT P,'\S
FtÈi §t * i §
a§
ÿ
i"
§
*,q*lTË
> Des exercices de retaxation sur [e souffle peuvent se faire en salle de motricité.
> En musique, il est possibte de faire découvrir des instruments à vent.
i..e
:nailèie L'r i
ul
É,
,lrl
F
=
J
CLASSE E§IT§ERI
CtlN
RËGROUPEtvIENT
10 minutes
Présentation du proiet
> Connoissez-vous cet obiet ? À quoi sert-il
fl6attÉrie§
?
À s'amuser.
- r moutinet
(gabarit sur te DVD-Rom)
> Comment I'utilise-t-on ? ll faut le mettre dons
le vent. ll faut courir en le tenant en l'air.
> Si nécessaire, les êtèves testent [es
propositions.
> Vous ollez en réoliser un chocun.
Anticipatlon de la fabrication
> Comment devons-nous foire? Quel motériel
devons-nous ovoir?
> Le moulinet passe de mains en mains.
Chaque élève, avec [e moulinet en mains,
nomme un des étémenTs: un bôton, un clou,
un bouchon, une perle, un morceou de papier.
\
ÂTEtIER DIRIGE
$Ë6À8ËrÈvss
15 à
zo minutes
-fiche de construction
,,i
:"i
2
(DVD-Rom et coffret)
-l
moulinet
Ë Se.on la labrication choisie:
- r pholocopie par étève
(DVD-Ro m)
ou
-r
teuille d'origami papier
ou plastique (vendu par OPITEC
référence 4t499 les zo à 5,99€)
par élève
avec
(DVD-Rom)
[e gabarit
r gabarit de traçage réatisé
a
S::
i,.i.-:.
:
t ï:
i: ::
:
+.!'oi trouvé des b6tons, des clous, des bouchons, des perles,
y Pour les oiles du moulinet, j'oi du popier mois comment sovoir ce qu'il fout en foire ? ll faut démonter
Le moulinet déjà fait.
llli 1.1-:5ii:;;1
:* Un élève retire [e clou. Le papier peut ainsi être déptié.
:]
t
i
:i j :..i :r + :: i: = r: i.
>Quepouvez-vousdiredecemorceoudepopier?
dons les coins. ll y a des traits découpés.
s,: ii
a-r
i
:
i-:
::
*
:
I
:
:s
C'estuncarré.llyauntrouaumilieu.
llyadestrous
È.ili::,s.iiir":::
s-Chaque étape se fait après Ia démonstration de ['enseignant en suivant [a fiche de construction z
(DVD-Rom et coffret).
Deux possrsrrrrÉs DE FABRtCATToN:
1. À pARTtR D'uNE FrurLLe pHotocoptÉe coupÉe nu ronmnt cnncÉ suR LAQUELLE LES porNTs DE pERçAGE ET LEs LIGNES
or oÉcoupncE soNT tNscRrrs. LEs ÉLÈVES N'our eu'À pERcER, DÉcouPER PUts ASSEMBLER.
2. À pARTtR D'uNE FEUTLLE o'ontcnmr, oÉJÀ cnnnÉr. LEs ÉLÈvEs nrpÈnerur LES pERçAGEs ET LEs LtGNES DE couPE
À fAtDE D'uN cnennrr nÉlrtsÉ À L'AtDE ou unrÉnrrr DVD.... LES ÉrÈves orur À rnlcrn, erncen, oÉcoueen euts
AssEMBLER. CETTE sEcoNDE soLUTIoN pERMET D'unLrsER DEs FEUTLLES D'oRtGAMt EN pLASTreuE rnÈs soupLe. Lrs
MouLrNETs soNT ArNst ulLtsABLEs DANs uN JARDTN PUtsQU'tLs nÉstsrrnr À rn pLutr.
164
ACTIViTÉ I NDiViDUELI-E
15 à 20 minutes
Crrre
..
.i.t;:_:irisi
ailes oes moulinets réalisées
lors de L'étape précédente
- des teJlres. des craies,
de l'encre ou de la peinture
- fiche de construction 2
ÉrnpE Esr FACULTAT vE ET PEUT Êrnr
cnnnÉ, Cere pEur Êrne L'occAStoN
rntre
tNDtFFÉREMMENT AVANT ou ApRÈs LE pERcAGE ET Ln
LES GRApHtsMEs DU tvloMENT
or nÉrruvesttn
oÉcoupr
ol
i::::
-<,-il i:::
> Décorez les ailes du moulinet, des deux côtés des ailes.
(DVD-Rom et coffret)
ÂTELiER DIRIGÉ
DSf\4:.CLA5SE
15 à 20 minutes
i;::
;:-r i i s
* t:.. t':
l:
=
i
r- Nous ovons
-1piqueàbrochette
r
-r bouchon
- 1 clou à tête plate
- I perle
aite de moulinet décorée
- fiche de construction 2
(DVD-Rom et coffret)
tout le motériel. Comment terminer notre moulinet ?
s Chaque étape de la feuilte de fabrication est décodée et verbalisée par les étèves, démontrée par
t'enseignant puis réalisée par Ies élèves:
- enfiler chaque angle des ailes du moulinet dans le clou,
- enfiler [e clou dans [e trou du milieu des aites,
- enfiler [a perle dans le clou,
- planter [e ctou dans le bouchon.
La oEnutÈnr Érnpe rsr LA PLUS DÉLrcArE ELLE pEUT AUSSr pREsENTER uN DANGER DU FA T DE L'AspEcr porNTU DES
PIQUEs À BRocHETTE ELLE N'Esr PAS oBLtGATotRE: LE MouLtNET psur ÊTnr urtrtsÉ urutqurueNT À pARTtR
DU BoucHoN.
CETTE ÉTAPE PEUT ÊTRE FACILtrÉE st L'ENSE ctt,qur n pnÉ-pencÉ
aoucHotl À r'atoe oE L'AIGUtLLE DE ptouAGE ou D'uN
CLoU, A FAIRE AVEC L,ENsEIGNANT, ÉLÈVE PAR ÉLÈVE.
rr
pique à brochette dans [e bouchon.
r'
CLA55E SNT[ÈRE
CTUR DE RÊCRË,CTION
5 à 10
minutes
> Les étèves utilisent leurs moulinets dans [a cour
i:{§a+r:+i
- les moutinets réalisés
lors de l'étape précédente
les obiets
L'ai
lrJ
É,
,lJJ
=
CLA55E ENT!ÈRE
COIN REGROUPEMËNT
20 minutes
Èila.ri::
-1
- r moulinet
feuilte cartonnée
r livre
à portée de main
È
i
lr.tiir.':-: 3 il ij ii ïir+
*" Les étèves ont joué dans [a cour avec un moulinet quand it y
:
avait du vent et ['ont observé tourner.
p De retour en classe, [e moutinet ne tourne plus.
OU
x
Comment foire tourner le moulinet sons le toucher
On peut souffler dessus !
s
Chacun essaie. Les é[èves constatent que ceta marche plus
?
ou moins bien seton ['angle de souffle.
l. A* ,*)fl."
^^'1^*t
i)n
0.
00 -Û{)
ù- lÆ^,,rure îlfu,lt iÿ.],P0'
?n
det
t-,n
hnbl.
Nouveau défi
> Comment foire tourner le moulinet sons soutfler? On peut courir
en tenont le moulinet. On peut secouer une feuille cortonnée ou un
livre devant le moulinet pour qu'il oille plus vite.
1;::::
*
, i:f-
i:-,Ii.i-
Laisser un temps pour Ia réflexion. Chaque idée est testée immédiatement
ÀTELIER DIR!GÉ
DE6À8ÉlÈvrs
20 minutes
itl*i*:
il:
élève:
=t Par
- r paitle
r teuitle cartonnée [ormat A5
*
Pour [e groupe:
- r balle de ping-pong
- des jeux de construction
style Kapla ou Lego
irrS:+ll.:ii*::';ir. is ::ii.:*iis*
+ L'enseignant construit un parcours avec des virages sur la table. ll matérialise I'arrivée et le départ
ll laisse à disposition les pailles et les leuiltes cartonnées et une balte de ping-pong.
Défi
> Déplocez lo bolle de ping-pong dons un circuit sons lo toucher et sans bouger lo toble
!
Questionnement
> Comment ollez-vous foire ? Foire du vent en soufflont comme
pour le moulinet, ogiter les mains, secouer le carton.
Tests
> Les étèves expérimentent ators: agiter les mains est peu
efficace, souffler dans une paitte est ptus précis, secouer
le carton est plus efficace mais moins précis.
Verbalisation
> Chacun exptique ce qu'it a fait et [a technique qu'it préfère.
> L'enseignant remplace le letme vent par les mots souffle eT courant d'air.
> Les étèves dessinent [eur test et dictent à ['enseignant les [égendes à apposer et les conctusions
j<i.:
s
766
=+
Si*ri*+
L'enseignant modifie [e parcours: deux étèves face à face s'échangent [a balle.
ATELIER SEMI-DtRIGE
DË6À8ÉrÈvrs
15
minutes
i.§::.+i:!i
:tites bouteilles remplies d'eau
-z
-2
petites bouteiltes
remplies de confettis
petites bouteilles rempLies
à moitié d'eau savonneuse
-z
§ L'enseignant a ptacê les diffêrents dispositifs face aux étèves qui nomment Ie matérieI devant
i-::: r:::;
{::
eux.
i'.
+ Soufflez dons les bouteilles. Surtout, n'aspirez pos son contenu. Que se posse-t-il
>. Essoyez de mettre les petits popiers dons le gobelet ovec lo poille.
?
gobelets
- r paille par élève
-de: perits bouts de papier
=
i;t;i;;..
font et testent. L'enseignant [eur demande juste de ne pas avaler le contenu des bouteitles.
!\:i *=1!:*lir:,=
* Quand je souffle dans I'eau, ça foit des bulles.
*- Quand je souffle dons l'eou sovonneuse, Ço fait de lo mousse.
* Quand je souffle sur les confettis, ils s'envolent.
+ Je peux attroper les petits papiers en ospiront avec la paille.
CLA55E ENTIERE
COIN REGROUPEMËNT
25 minutes
ù1;lêii*l
non visible en début de séance)
- r sèche-cheveux
-rpompeàvélo
-r gonfleur
-r soufltet
-r éventai[
- 1 ventilateur
- r foutard
-l moutinet
- 1 sachet en plastique
-r boule de polystyrène
Présentation de l'atelier
> Rappelez-moi comment on orrive à ïoire des couronts d'air ô I'intérieur, comme le vent dehors,
> On peut souffler, secouer une feuille cortonnée, ogiter les mains...
Questionnement
> Connoissez-vous des obiets à lo moison qui fobriquent des couronts d'oir?
> Les êlèves énumèrent ce qu'its connaissent.
> fenseignant peut dévoiter ce qu'iI a apporté en montrant au fur et à mesure t'oblet cité. lt peut
faire deviner les objets non mentionnés avec une devinette: lesersàgonflerlepneudesvélos...
Observations
> L'enseignant fait tester chaque objet sur [e foutard, [e sachet, [e moutinet, la boute de polystyrène.
Verbalisation
> Après quelques commentaires spontanés, il centre les observations des élèves sur la puissance du
sèche-cheveux et du ventilateur. La pompe à véto, te soufflet et [e gonfleur fonctionnent bien aussi
mais iI faut toujours recommencer [e geste. L'éventail fait penser à ta feuitle cartonnêe.
La matière L'ai
D ËM
i.CLASST
SALLE DE MOTRICITÉ
2() minutes
:':i:: i.: I i: i
- z sèche-cheveux
- 1 petit ventilateur à pile
- 2 rallonges eler triques
-zpompesàvéto
-r
-z
l:r:iÈ:r:-.
u Foites circuler la balle sons lo toucher à I'oide des objets.
i§;.:*:*;i:'ri:r:.
*'Par groupe, [es étèves déplacent ta batte sur [e parcours et vont prendre conscience que:
- [e sèche-cheveux et le ventitateur font avancer Ia batle rapidement à travers [e tunnel,
gonlleur
- dans les passages prêcis, ils sont compliqués à utiliser,
- si [a rallonge n'est pas assez longue, [e sèche-cheveux n'est plus utitisable,
- les autres objets ont Ieur intérêt à ces moments-là.
éventails
- des briques de motricité
-r ptan inctiné
l tunnel
ptusieurs battes de ping-pong
lDÉaLEMEN-. ot! prut oËooueLEo MATÉRtl
ÉeurpEMENTs oE r'Écore LE pERMETTENT.
rr
pApcoups poup opGANtstR uNF couRSE EN-pE DtJx Éeurprs. st res
L'enseignant prend des photos en vue de l'étape suivante. lI interroge ses élèves pour faire verbatiser ce qu'ils ont vêcu et ce dont ils ont pris conscrence.
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
20 minutes
i*.r!Ériri
- du papier affiche
cartes-images r9: objets pour
mettre ['air en mouvement
(DVD-Rom et cotfret)
v'i: r 1..: I i:.,-: il..:::
*
Les élèves observent les photos
s
s
L'enseignant a tracé un tableau sur ['affiche.
Les élèves y associent teur photo.
WwtrY
168
et les commentent (cartes-images 19 dans le DVD-Rom et te coffret).
i-tti1r:: i-..:t!+i:
A"*""np,n-.r^elL"L
d .10 0
d,o æ41il1,aÿPrL (n \ilP\)Ê,
r'r^\/l
.
np\,rnd)P )
0Lt rulDJ,rutprL
\-4q-elÀ
d,p
lrl
É,
.ul
t=
J
ATEI.IER D!RIGÉ
0E6À8Ér-Èvrs
ro minutes
.
Èil;tii*:':
§.i::s::r:i
: ooîte à toucher dans
laqueLle
glisser les mains et palper
ce qui s'y trouve sans [e voir
(Trucs et astuces page zo)
i::irl.:*
explique à quoi elle va servir.
;achets type sac de congélation:
-r rempli de sable,
- r rempli d'eau,
- r rempti d'air
::ut
i.:ri
§ fenseignant prêsente la boîte à toucher et
,>
i::
l'oi trois sochets remplis.
En les touchont l'un
oprès I'outre, vous devez deviner ce qu'il y o
dedons sons regorder.
=a+i
s
i:
*
sa-*ir-:
:i+:i=
Les élèves touchent successivement les trois
sachets sans s'aider de Ia vue mais en utitisant
le toucher pour s'approprier ['idée que [e sachet
contient de la matière.
i ii :i +s § l+r ::.:
Chacun propose son idêe.
§*-s:-:+
s
!
Vérification
> Comment sovoir ce qu'il y a dedons sons regarder ?
> L'enseignant propose de percer le sachet avec un petit trou pour que les contenus s'écoutent
doucement, de faire toucher, sentir et écouter ce qui en sort.
> Cette fois-ci, les élèves ont les yeux fermés. L'enseignant passe rapidement chez chacun pour
éviter qu'il n'y ait ptus d'air et d'eau dans les sachets.
(
I
i
i-
=
-:i::sl.:-:
s Dans le premier
s
sachet, on reconnaît facitement les grains de sable. Dans [e deuxième sachet, c'est
mouiIté. Dans [e troisième sachet, on sent et on entend un petit souffte qui chatouitte la main.
Les élèves peuvent alors regarder [es trois sachets et conclure : dons celui-ci il y a du sable, dans
ceLui-là ily a de l'eau, dans le dernier il y a de l'air!
La matière L'.
ATEL!ER EIRiGÉ
DÉ6À8Ér-Èvrs
z5 minutes
r\litt
-
1 sachet
r!+i
type congélation
-rpâteàfixer
- z pailles
-
1 grosse seflngue
-rpompeàvélo
- l aquarlurr
- oes papiers oécoupés
- des petites plumes
-r dispositifs poLr'mettre l'air
en mouvement
(voir Trucs et ostuces page r59)
Présentation de I'atelier
> L'ensembte du matérieI est disposé sur une tabte et présenté aux étèves (voir Trucs et astuces page
r59). L'enseignant exptique et montre comment se servir de chaque dispositif.
Consigne
ces quotre objets pour déplocer les petits bouts de popier et les plumes.
> Utilisez un dispositif pour faire décoller lo plume et un outre dispositif pour gonfler le bollon.
> Utilisez
Manipulations
> Les élèves expérimentent chaque dispositif.
Observations
> lts constatent qu'ils arrivent avec ces différents obiets à déptacer [es papiers et [a ptume, à gonfter
[e balton. lts essaient ptusieurs fois et affinent [eur maniputation pour mieux contrô[er [eur geste.
f
CLA55E ENTiÈRE
CTIru REGRÛUFËMENT
20 minutes
> Les élèves expliquent ce qu'ils ont fait et observé.
-
aucun
Analyses et conclusions
> Que se passe-t-il lorsqu'on oppuie sur le sachet, la bouteille, lorsque le ballon se dégonfle, lorsqu'on
octionne lo pompe, lo seringue ? lly o de l'air qui sort, on le sent avec les mains et on l'entend.
> Pourguoi est-ce que les petits bouts de popier et les plumes se déplacent et s'envolent? C'est I'air qui
les pousse. Quand j'appuie sur le sachet, lo bouteille, lo pompe et la seringue, je vide un peu d'air et il
chasse les plumes et les papiers.
> Les deux ateliers avec les bouteilles sectionnées sont ptus complexes à interpréter.
> Si certains ê[èves posent des questions pour comprendre pourquoi le batton se gonfle, c'est de
préférence ['enseignant qui exptique que ['eau chasse ['air de la bouteilte et entre dans le balton.
I
a
ACTIViTÉ INDIVIDUELLÊ
20 minutes
eorisigne
lUXatériet
*
par êlève:
- r feuilte
- des crayons ou des feutres
* Choisissez
un dispositif et dessinez l'expérience que vous ovez réolisée.
sr
Nù-
0 Àr. r.olV
CL,S55E ENTIÈRE
SALLE EE MOTR!CITÉ
20 minutes
§eir:riÈi
- r balton pour chaque élève
d'un groupe
r : -rmpe pour gonfLer les ballons
i§:3il:i.. i:1*i: *.r
Ë
Répartir Ia classe en quatre groupes.
".
+ Gonfler des batlons et Ies donner au premier groupe d'étèves sans nouer l'embout du batlon.
s lts vont manipuler ces battons matadroitement ou non, en [es tenant ou en [es lâchant, détibérément ou non.
+ La ctasse observe amusée et commente.
s L'enseignant regonfte la série de battons. l[ [es distribue au deuxième groupe, puis au troisième et
enfin au quatrième groupe: les êtèves vont reproduire au début Ies matadresses des premiers ou
au contraire tâcher de garder Ie contrôte du ballon pour le tenir et [e [âcher à un moment précis.
i.':-.:'".':.,: :.
s
- -.'.
Le batton se dégonfte et vole dans tous les sens: c'est l'air du ballon qui sort, je I'entends et je le sens.
La nratière L'air
OUVRAGES A$.!TOUR EU
VEN.'IT
.,rogqJl
,6-à
6à
6à
@@@
és-,
Vive [e vent
:j'',i :i:i1-.
L'oirragan
I
Pascale Bougeault
O L'école cles loisirs
Peter Schôssowi..:.
.i
}
i-..
§
:::
].:
Cet atbum itlustre la chanson
Vent f rois, vent du matin. Le
vent emporte tout sur son passage, sous [es yeux de ce petit
ours qui n'en croit pas ses yeux
et finit par s'envoler à son tour.
Aniorin Loucharrj O Édition5 ThierrV
iVr.agnier
.
2a1, 6 8,9o€
Ftaubert, un bonhomme en
papier, se promène. Le vent se
lève. Ftaubert perd une à une
toute les parties de son corps.
Le vent se catme et...
O La ioie de lire à ,o13 e o"8o€
Cet atbum sans texte montre
* 2oo9 o 12,7c€
Un ouragan terrible s'approche
un homme vêtu d'un imper et
d'une écharpe faire face au vent
et se [aisser emporter, si bien
qu'iI s'envole et concurrence Ies
de t'île de Lucette. ll s'ap-
avions.
Caca ho
pette Octave. Toute Ia familte
se rassemble et se calfeutre.
Mais où est passée la chienne.
u
ète
?
JEI.JX -ALJTÜUR MU §TUFFLË
:::'
1,.:, ,',::'r
l.::-::i,.il-i :rl
;'i : :::l
:-ia
I
i'i
Un jeu pour un à quatre joueurs. ll s'agit de
souffler sur une bille pour qu'eIte atteigne
les différents gâteaux du plateau de jeu.
Un jeu où iI laut maitriser son souffle et
exercer [a motricité des lèvres pour gagner.
@@@
@@
'.-ili!a§ al-.:i:i::
Cass Baraque
Un jeu de société pour deux à quatre
joueurs. Le but est de souffler habitement
sur Ies boutes de feu qui jaitlissent du cra-
.
,'-,,
.
-l
:' -:
-.
-- :.::
tère et de viser correctement afin de gagner
les fruits du dragon.
@@@
@@@
Les Btopens sont des feutres dans [esquels
* A pariie de 7,go€
De loties planches très Iudiques pour
travailler Ie souffle dans [a bonne humeurl
Les ptanches à s.ouffle
partir de z,9o€ pièce
Un objet dans lequeI on souffle pour maintenir [a balle en ['air.
Peter Schôssow
Un jeu de sociétê pour deux à trois joueurs
Chaque joueur essaie de construire sa
maison avant que le Ioup ne [a démotisse
en soufftant dessus.
Flow-EatI
nA
6§
@@
@ Hoptoys Ref. CASoz
on souffle.
Notions pour I'enseignant
Trucs et astuces
À chacun son ombre
l-es maîtres de I'ombre
Les ombres de [a cour
Mon thêâtre cl'ombres
Ouvrages et ieux autour des ombres et de la [umière
174
175
176
178
l8z
187
190
§
§
§
§
Qu'est-ce qu'une ombre
?
> Lorsqu'un objet est éclairé par une source lumineuse, certaines
zones situées derrière t'obiet, ne reçoivent pas de lumière et
constituent ['ombre de t'obiet.
Ombre propre et ombre portée
§,*:*r*e pr:*:s§r* *È §**y** s*c*sdsiè"e
La source lumineuse est primaire lorsqu'etle fabrique de
[a
-
mière (te soteit, des braises, un projecteur, une Lampe de poche,
ou secondaire lorsqu'etLe diffuse [a Iumière (ta Iune, les planète-'
d'autres objets dans une pièce...)
r" Lorsqu'un objet est éctairé, on distingue deux zones d'ombre.
.
L'ombre propre est la zone de t'obiet qui ne reçoit pas de [umière. C'est ta partie de t'obiet qui est située à l'opposé de [a
source [umineuse.
. L'ombre portée se situe sur une surface ctaire située derrière t'objet
(un écran, [e sot, un mur...) et qui ne reçoit pas de lumière. Cette
ombre a une forme qui reproduit les contours de t'objet éclairé.
Ainsi, pour observer une ombre portée, iI faut touiours trois étéments disposés dans [e même ordre.
r- [a source [umineuse.
z- t'obiet opaque.
3- [a surface claire.
*. llespace situé derrière t'objet et ne recevant pas de [umière est
appelé cône d'ombre ou zone d'ombre.
Un objet peut avoir pLusieurs ombres s'il reçoit de [a lumière c=
plusieurs sources [umineuses.
Quand un objet ne laisse passer aucune lumière, on dit qu'il est
oPaque.
'
'
Un vidéoprojecteur est une source Iumineuse facitement utitisabte dans [a ctasse. Un mur blanc ou uni et clair remptace un écran.
Vérifier simptement Ia présence d'une prise de courant à proximité et d'une raItonge éventuellement pour instatter votre projecteur.
Les [ampes de poche à LED sont de bonnes sources lumineuses car eItes diffusent moins [a lumière et permettent d'obtenir
des ombres plus nettes.
t/ atériel
.
. :oîte format A4 ou A3 avec couvercle amovibte.
-:s boîtes contenant cinq ramettes de feuitles
-
-rrr photocopieur sont idéales.
§
s
\
,
-. casteLet s'utilise en [e
,. tionnant en bout d'une
= de classe avec [a lampe
- [e spot en bout de [a
.: e de façon à ce que [e
-.Io de [a lampe éclaire
'ensemble du calque.
I
\
25 minutes
i§*:§i!e§.
- r écran
- 1 projecteur
r grand tapis ou r drap
Situation déclenchante
Les en[ants sont regroupés dans une salte que ['on peut assombrir et dans laquelle its pourront
déambuler: idêatement, la satle de motricité.
L'enseignant instalte ['écran, le nomme, allume le proiecteur, éteint [a lumière.
Les étèves réagissent : C'est noir... lly o de lo lumière...
pour faire paravent
Pour éviter un attroupement devant l'écran où on ne distinguerait ptus rien ['enseignant fait
asseoir sa ctasse et invite à chaque fois trois élèves à se déptacer dans la salte pendant quelques
instants. Les premiers qui volontairement ou non se placent entre [a source lumineuse et ['êcran
vont déctencher des réactions et inciter les suivants à laire apparaître une ombre.
Les enfants s'expriment au fur et à mesure : c'est moi ! On voit Adam, Emmo, on les reconnoît!
lls sont tout noirs!Ah, on ne Les voit pLus sur l'écron !
L'enseignant poursuit en donnant Ia consigne : Plocez-vous pourque I'on puisse voirvotre ombre.
Chaque enfant fabrique son ombre, certains timidement, d'autres ptus à l'aise vont s'observer
davantage, bouger.
Par moments, ['enseignant éteint Ia lumière : on ne peut plus faire d'ombres!
L'enseignant propose un ieu où un enfant crée son ombre et les autres doivent le reconnaître.
Un groupe d'enfants est caché derrière un paravent (tapis ou drap). Un enfant se lève et fait appa
raître son ombre. lautre groupe doit deviner le nom du copain grâce à son ombre.
PcerteuÉ rru oÉaur o'aruruÉE, cE,EU FAVoRtsE LA socrALlsATtoN ET LA coNsrRUcrloN DU GRoUPE cLASSE
a
a
176
d- ?^ ?rt"""àr,-.
.0 urü9ttÉ)
ML w
,11îrh,e,5.
DEMI.CLASSE
sALLE euE rloru
prur
OBSCURCIR
r5 minutes
Demander aux élèves de rappeter [es conclusions de la séance précédente.
*latêii*i
-
l
- r êcran
projecteur
marionnette
r
L'enseignant pose la question : Lo morionnette o-t-elle une ombre?
Les étèves répondent et ne sont pas forcément d'accord entre eux.
L'enseignant [eur demande comment vérifier. Les élèves proposent d'attumer [e projecteur. lls réinvestissent Ies conclusions de ['étape r.
CHERCHER L'oMBRE DE
LA MARtoNNETTE oBLrcE L'ENFANT À se oÉcrNrnEn Er À s'rurÉnrssrn À r'onaene D'uN oBIET AVEc
MOTIVATION.
Placez lo morionnette pour qu'on sache si elle o une ombre.
Par tâtonnements, les étèves portent la marionnette jusqu'à ce que son ombre apparaisse: [a ma-
rionnette a elle aussi une ombre. Puis lls cherchent des emplacements où on voit une ombre de
marionnette et d'autres où il n'y en a pas.
ü*neiusiqr'c
*t
lr§e§ ê<ritc e* *t'=*
Ia
n*#u
b,ono ?^r^r * r»0
"t
La matière Les ombres et la
[umière
1//
lrl
É,
.EI
F
=
DEMI.CLASSE
SALLE QUE t-'OtU peUr
OBSCURCIR
10 minutes
REPRENDRE DES S TUATIONS DE
L'enseignant
§vlatêri*[
lit
LA PS POUR RÉACTIVER LES ACQUIS.
l'album )eu d'ombres.
['album inducteur
L'enseignant questionne les élèves : Adom o un pull rouge, de quelle couleur sero son ombre?
Bien que toutes les ombres observêes aient toujours êté noires, [a question instaIte un doute.
fait apparaître son ombre.
L'hypothèse est validêe ou corrigée.
Prévoir de faire passer tout le monde pour installer dêfinitivement ['idée qu'une ombre est toujours
noire quettes que soient les couteurs des habits et pour satisfaire [e besoin égocentrique de chacun.
Chaque enfant donne sa réponse, l'étève concerné
_leu d'ombres
Hervé Tullet O Editions Phaidon
c 2613 c 9,95€
-
- r écran
r projecteur
aL.+§s{
Ë!{T!ÈRÈ
{*lr.l R˧§Gtir§Mil"lr
20 à25 minutes
L'enseignant propose à toute [a ctasse de jouer à
dit. Puis un enfant se place devant [e groupe,
choisit une posture, [e reste de la ctasse l'imite.
L'enselgnant propose ators de faire une activité simiIaire en utitisant [es ombres et énonce [a consigne:
foites opporoître sut l'écron une ombre identique à une
silhouette (DVD-Rom et coffret).
Jacques a
§
VoLoNTAtREMENT, L'ensErcrunut NE Dtr pAS « tMtrE LA PosruRE
DE LA stLHouETTE» pouR oBLtGER L'ÉLÈvE À sE oÉcrurnrn ru
compnnnut soN oMBRE pnolerÉE À Ln strHourrrE ET NoN soN coRPs À CETTE stLHouETTE.
fenfant trouve [a posture exacte, [e reste du groupe valide ou argumente en cas de désaccord.
È Ensuite, 2 étèves pourront reproduire [e même exercice avec une sithouette différente pour que
tout le monde arrive à passer sans que cela soit trop [ong.
ts
{
r
ÀT(
L!
[
Èi
F
"4:ir*
ni
{f
rl,1
Ë
*[6À-::ÉlÈ.rrs
25 à 35 minutes
jer.t
s- Les étèves
- memory D: ombres
(DVD-ROm et coffret)
- de la colle
photocopie par élève (documents
pages 18o et 181 ou DVD-Rom)
178
jouent au memory des ombres (DVD-Rom et coffret).
Traee éerite
F fenseignant présente Ie tabteau et [es étiquettes découpées à ptacer.
> Observe chaque ombre. Colle choque personnoge à côté de son ombre. Attention, certoins personnages n'ouront pos d'ombre
!
D EM I-CLASS E
SALLE qUE L'ON PEUT
OBSCURCIR
25 minutes
-l'album inducteur
Boucle d'or
& les trois ours
Les enfants décour,,rent l'album Boucle d'or et les trois ours. Cel album en noir et blanc et sans
texte retrace tout en finesse ta trame de l'histoire de Boucle d'or. Les élèves décrivent et verbalisent. L'enseignant insiste sur les trois tailles des ours.
Avant ['activité, sans [es étèves, ['enseignant a placé [e projecteur et ['êcran. lI a accroché avec du
scotch le gabarit de Petit Ours. II faut surtout anticiper l'endroit où se positionnera un élève pour
que son ombre corresponde au gabarit de Petit Ours. Cet endroit est matériatisé au sol avec du
papier de couleur scotché.
Un enfant se ptace sur ce repère, [es autres observent son ombre et constatent qu'elte a ta tailte de
Petit Ours.
Boucle d'or et les trois ours
RascaI
O Pastel. 2015 . 1o,5o€
-
r
prolecteur
_
-du
L'enseignant change de gabarit et scotche celui de Grand Ours.
DËtl: Essoyez de foire une ombre oussi gronde que Grond Ours.
1 ecran
ruban adhésif
-des langLetres oe papier
- 3 gabarits découpés dans
du papier léger, styte papier en
--.uleau de maternelte, en imitant
les dessins de Rascal:
- petit ours: r,zom
- moyen ours: r,6o m
- grand ours: r,8o m
Les enfants réfléchissent et font des propositions. lls peuvent individuettement tester teur idée à
l'écran. La réponse sera peut-être trouvée par hasard quand en se déptaçant devant [e projecteur,
certains enfants constateront que ['ombre s'agrandit ou rapetisse.
lndividuellement mais rapidement, chaque enfant se place pour fabriquer une ombre de la tailte de
Grand Ours.
Refaire le même défi mais avec I'ombre de Moyen Ours.
,. dÉd",.
ù\n À8.
d ..
yP*
La mâtière Les ombres et la tumière
179
Associer une ombre à son personnage.
€
CHACUN SON OMBRE!
Observe chaque ombre. Co[[e chaque personnage à côté de son ombre.
fT'II-..l
II]
Les ombres
Associer une ombre à son personnage.
et la lumière
CHACUN SON OMBRE!
Observe chaque ombre. Colle chaque personnage à côté de son ombre.
Attention, certains personnages n'auront pas d'ombre !
f
\
LIIII]
€
lrl
É,
rrtl
F
=
CLASSE ENTIÈRE
couR DE cÉcnÉlrroru
3o minutes
§vX*t$ri*È
l'album inducteur
L'enseignant tit t'atbum Le Lapin noir. Dans cette histoire, un Iapin est intrigué par son ombre.
Par une iournée ensoteitlêe, proposer aux élèves de se rendre dans [a cour de ['école pour voir si
nous aussi avons une ombre qui nous suit partout.
Chacun a une ombre. Pour ['instant, on ne s'intéresse pas encore aux autres ombres présentes
dans [a cour. L'enseignant concentre l'attention du groupe sur l'ombre corporette en demandant
de faire bouger différentes parties du corps tout en restant sur place pour constater: Maîtresse,
l'ombre fait lo même chose que moi !
Philippa Leathers
O Bayard jeunesse . 2a1).
12,9o€-
DÉFl nor Essayez de vous déborrosser de votre ombre.
Reeherche
> Laisser quelques minutes aux étèves pour chercher des sotutions. lls vont probabtement courir vite,
en accétérant, en changeant de direction. Certains parviendront à se défaire totalement
ou partiellement de [eur ombre en se ptaçant dans des zones ombragées de [a cour.
Les élèves s'expriment sur [es stratégies choisies pour parvenir à retever te défi.
pas réussi, pourtant j'ai couru très vite et j'ai même sauté derrière le petit banc.
Moi, quand i'étois caché dons lo maison, on ne voyait plus que I'ombre de mon pied qui dépossoit.
Là-bas, on ne voit pLus Les ombres.
Je n'ai
L'enseignant recentre les verbatisations pour faire émerger une conctusion.
. 9*rJr*,nouô b^ri,f
ttJr\L a/.Lm oüL o* \"Jdl,
,
fl.^r^.Lt
C'est Ie moment pour vérifier ce qui n'èst pas encore évident pour un enfant de cinq à six ans.
Que faut-il pour foire une ombre ? Pour foire une ombre, iL faut de La lumière.
Dons lo cour, qui foit lo lumière? Dons la cour, le soleil foit lo lumière.
Défi noz Essayez de décoller vos pieds de votre ombre.
L'enseignant taisse les étèves tâtonner et réfléchir.
Le défi parle des pieds et non des autres parties du corps. Toute situation où les deux pieds ne
sont plus en contact avec [eur ombre est bonne: assis sur les fesses pieds tevés, en appui sur le
bras... Néanmoins, on attend [a situation où ['élève constatera qu'en sautant l'ombre est entièrement détachée du corps.
. Q'-".1,
tBz
l.
?à*
b y^,
L,,
!"*
nn u..-'J*
ÿ^^
*r,
y.ao
15
minutes
,i"§at§rÈ*l
- r feuitle par étève
des crayons de couleur
{t*§ëti§!:
De retour en classe, les élèves rappellent les conclusions des deux défis
fenseignant propose de représenter ces conclusions par [e dessin.
i*-.\a ,'u1.A"
+
Le matin 15 minutes
Nsi§:!+t
- des craies de couleur
:esiiYÊfȧ
È Venir LE MATIN pour chercher les ombres de [a cour, des arbres, des bancs, des structures de leux.
*'Trocez le contour des ombres que vous voyez par terre !
!§€ÿv&Ë!s*
s fenseignant
demande ensuite à ta moitié de la classe de se répartir dans [a cour ensoteitlée.
L'autre moitié de Ia ctasse trace le contour de ['ombre d'un copain avec une craie de couleur, prend
une autre couteur pour indiquer ['emplacement des pieds et écrit son prénom.
La matière Les ombres et la iumière
18:
L'après-midi r5 minutes
atèri**l
- des craies de couteur
Au début de la séance, tes étèves ne se sont pas encore placés dans les emptacements du matin.
L'observation se fait à partir des étéments fixes de [a cour.
Les ombres ne sont plus dans les trocés, que s'est-il possé ?
Chacun retourne ensuite à son emplacement du matin et tà encore [es dessins du matin ne fonctionnent plus. Les élèves n'arrivent même pas à placer [eur ombre dans les tracés en changeant de
place ou de position.
Les étèves réfléchissent
et proposent une explication.
i
DU cycLE 3. LA struATtoN se pnÊrr À oE rn nÉrrextoN,
.
DU LANGAGE ET NoN A uNE coNSTRUcloN DE coNNAtssANCES eur N'EST pAS DE soN Âcr CerrE Étnpt Lt corurnoutt
LA cuRtostrÉ quE L'oN cHERcHE À suscttla
uNe nÉar rÉ pHys euE FACTLEMENT oBSERVABLE. c'est ùouvenrunr AU
^4oNDE,
ÉvroEtrtreur r'HyporHÈse coRREcrE coRRESpoND À uu ÉrÈvr
. Y*, . !t", drt l,uirrruTr,a oo,r,L ,oo?ro ^;r* *Yn
"JL"
|
184
a-Uy".
*"1r.
30 minutes
-1 grande feuitle aiustée
à la taille de [a tabte
par étève
- de [a pâte à fixer
-des crayons à papier
-: lampes de poche, idéalement
:.: torches (ta quatité du matérieI
::. important: si la salte n'est pas
suffisamment sombre et si Ies
l'aisceaux des lampes sont trop
-'fus et faibtes, cette étape sera
difficite à mener)
-
r ptaymobil
Écloirez votre personnoge ovec votre lompe
!
lts êctairent [eurs Ptaymobit disposés sur Ia tabte et observent
les ombres des jouets. Comme iI y a deux [ampes, il y aura plusieurs ombres pour chaque personnage. Les ombres se décuplent,
se croisent et s'entretacent, s'agrandissent et rapetissent.
lJenseignant laisse quelques minutes pour permettre à ses étèves
d'exptorer, de s'exprimer. Puis it fait éteindre toutes [es [ampes:
i[ n'y a ptus d'ombre!
Pourquoi les ombres bougent? Parce que les Lampes bougent !
LEs DÉFoRMATtoNs DES olvlBRES sELoN euE LA LAMpE s'AppRocHE ou s'Érotcle DU pLAyMoBtL NE soNT pAS ÉvoeuEEs
IC]: A TOUT TRAITER LA CLASSE RISQUE DE SE D/SPERSER DANS SE5 ANALYSES ET DE NE PLUS SUIVRE L,OB]ECTIF DE L,ÉTAPE
LES DtFFÉRENTES postloNs o'uNr omsnr sELoN LA posrrroN DE LA LAMpE.
Tracez le contour de I'ombre d'un Ploymobil.
Le tracê est difficite car en se penchant ['étève projette son ombre sur son travail.
C'est ['enseignant qui trace et l'élève qui tient la lampe.
Puis, à partir d'une autre lampe, ['enseignant recommence un second tracé pour le même Ptaymobit.
L'ENSETGNANT vETLLERA
À ce quE LEs DEUx orvanes À DEsstNER sotENT BtEN DtslNcrES.
Les étèves observent les deux ombres du Playmobit.
L'enseignant recentre sur [a probtématique: Pourquoiya-t-ildeuxombressurvotredessin?
Les êlèves apportent leurs rêponses pour arriver à la conclusion.
.
9*d
A U^î", ,]'.^'f d- l!.r-,
L:rrrJr,-
"r.r.^L
,|. ff
d-
ÿ.rLa matière r-es ombres et Ia lumière
18J
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
5 à 10 minutes
Questionnernent et analyse
LEs pLAvMoBtL posÉs sun LA TABLE, LA LAMpE DE pocHE eut ÉcrarBr À oes Enonotts otrrÉnrrurs soNT UNE MoDÉLtsATtoN DE LA struATtoN oe r'Étnpe 4 où rrs ÉrÈves orur rnncÉ res coNTouRs DE LEURs oMBRES À oEUx MoMENTS DE LA
JouRNÉE. tL s'AGtr Ict DE pERMETTRE nux ÉrÈves DE FATRE LE RAppRocHEMENT.
ÿoiXsȧr!el
dessin réalisé à l'étape
5
et revient sur [e prob[ème de ces ombres.
> Roppelez-vous: dons lo cour, qu'ovions-nous constoté ?
- Les ombres des orbres, des jeux et des copains avaient chongé de place.
- Oui et on n'avait pas compris pourquoi !
- Avec le trovoil sur les Ploymobil, pourquoi les ombres ont-elles changé de ploce ?
- Parce que tu os changé de ploce pour les éclairer lo seconde fois.
ts fenseignant montre les dessins des ombres de [a cour
- Dons la cour ce n'est pos moi qui vous écloirois
- Non, c'est le soleil
!
!
- Alors réfléchissons... Est-ce que quelqu'un ouroit une idée pour expliquer pourquoi les ombres
du motin ne sont pos celles de l'oprès midi
- Moi
j'oi vu le soleil, il n'est pos toujours
?
à la même ploce.
Ah bon?
c'est vroi, il bouge !
- Et lorsque lo lompe bouge gue se posse-t-il?
- ll y a une autre ombre qui apporaît!
- Alors quond le soleil chonge de ploce.,,
- L'ombre change de ploce !
-
- Oui,
Conclusion
Représentation et trace êcrite
LES OTIBRES OE LA
CONCLUSLOT\l
CNÙP'
:
Le »n\e,L .L-.X"
Àt f«s,eL fu6
D"t\t b du 8o- cn ar, "h-o^{er"t
tr^»L Àa $o-cz
L'r.ilon
l,'r^l^n nz
386
n* *ài*
!-
atlb -ùü;
.lrl
l-
=
J
{I}
î
§J
R§ü
F*
L§
ÈÈ
fu1
[1.*i
10 à 15 minutes
t*{ætér!el
- 1 castetet fabriqué
lenselgnant joue une saynète dans le castetet
avec Ies marionnettes qu'iI a fabriquées.
r série de marionnettes pour
LEs ÉrÈvrs NE DorvENT RrEN vorR DE L'ARRrÈRE
raconter une saynète choisie
CASTELET
DU
Avant de questionner sur [a technique, faire
reformuter ['histoire, Ies personnages et les
d
éco rs.
Que pouvez-vous dire sur lo foçon
dont est rocontée l'histoire ? Comment sont représentés les
personnoges? Ce sont des ombres.
fout-il pour ovoir une ombre ? De lo lumière,
un écron et un personnage.
Que
Nous ollons réoliser des morionnettes pout toconter les histoires lues dons lo classe avec le costelet.
5à
ro minutes
ffiatè:i*i
- 1 castetet
- 1 spot
ou
r
[ampe de poche
> L'enseignant dévoile [e castetet et [e nomme.
> Décrivez-moi ce costelet. C'est une boîte avec une fenêtre.
> Où se trouve l'écron ? C'est lo fenêtre, il y a un papier.
> Qu'est-ce qui donne lo lumière? Une lampe.
Ce
papier est oppelé un colque.
> Où la lumière doit-elle être înstollée? Derrière l'écran.
sais
> Les êtèves essaient les différentes positions possibles de [a lampe de poche du spot.
>Commentsovoirsilespositionsquevousessoyezsontlesbonnes? llfoutuneombre.
> Quel obietvo former I'ombre? Une morionnette.
> ll n'y o que les morionnettes pour foire des ombres? Non, n'importe quel objet, nos mains.
> Et où doit se trouver I'objet? Entre l'écran et lo lumière.
Les élèves essaient à nouveau avec [eurs mains comme objet donnant ['ombre et trouvent [a posi-
tion de la lampe de poche, du spot.
La matière Les ombres et la tumière
18/
§iELl§R *1:§iGÊ
==§À{:SlÈvss
z5 à
minutes
3o
L'enseignant montre d'abord Ia marionnette qui a une forme de triangte ou de n'importe quetle
forme géométrique, uniquement en situation dans Ie castetet.
Les étèves ne doivent pas voir la marionnette.
Que voyez-vous ? lJn triangle. Si c'étoit un triongle, vous pourilez
toucher I'objet, le pouvez-vous ? Non, c'est son ombre.
À votre ovis, comment est foite lo morionnette que i'oi dons les
moins? C'est un triangle.
Par élève;
- r triangle en papier cartonné
- au moins 1 baguette
-au moins r pailte coudée
-r paire de ciseaux
-
l
Pour Ie groupe:
marionnette de forme
Que dois-ie vous donner pour que vous vous en fossiez une ?
Généralement, les élèves demondent une feuille de papier noir.
Pour avoir une ombre, fout-il obligotoirement une forme noire ?
Non, toutes les ombres sont noires.
géo métriq ue
- 1 castetet
-de
- de la ficelte
- de t'adhésif
La pâte à modeler
- de la pâte à fixer
- des gommettes
- des bandes de carton
*
>
Voilà un triongle dons du popier cortonné blonc. Essayons pour voir si
Les étèves essaient. On voit Ieurs mains tenant [e triangle.
i'ai la même ombre qu'avont.
F Est-ce lo même chose que tout à I'heure ? te vous remontre,
F fenseignant montre [es deux ombres: cetle obtenue avec [a marionnette et celte du triangte tenue
par son autre main.
>
Non, avec lo marionnette on ne voit pas les mains.
Réssiutlon du problàrne
> Voilà des triongles et du motéile\. Essayer de trouver une solution pour pouvoir manipuler les morionnettes sons voir les moins.
*" Les étèves s'aident du castelet pour tester [eurs idées. Les sotutions les ptus courantes sont une
baguette scotchêe à ['arrière du triangte. Quetques-uns essaient avec une ficette scotchée ou agrafée.
Anrétioration des premières solutions
> Observez bien les morionnettes que vous ovez foites. Que voit-on?
On voit le triangle, on ne voit plus les mains mois on voit le bôton,
la ficelle.
F Remontrer l'ombre faite par [a marionnette de ['enseignant.
> Avec lo mienne, voit-on outre chose que le triongle ? Non. Pourtont
j'oi oussi une boguette dons la moin.
v À votre ovis, comment doit-il être sur le triongle pour gue I'on ne
voit pos son ombre,
> Génératement it y a un élève qui dit qu'it faut que l'ombre de
la baguette soit cachée par I'ombre du triangle. Si personne ne
trouve, rappeter les observations de [a cour: pour se débarrasser
de son ombre, on peut soi-même se cacher à I'ombre.
> Le problème est de frxer lo boguette dons cette position.
> Les élèves amêtiorent [eurs propositions.
> le vous montre lo solution que i'oi trouvée. Décrivez-moi mo morionnette. Sur le triangle, il y a une poille gui est agrofée et pliée. Dans
lo grande partie de la poille, ily o la boguette.
': c>:>
10 à 20 minutes
Nous allons jouer à roconter
Par élève:
La
r
silhouette d'un ou ptusieurs
oêrsonndge5 d'u.e histoire
- 1 baguette par personnage
paille coudée par personnage
- r paire de ciseaux
Pour le groupe:
- de l'adhésif
I'histoire de... Quelles marionnettes devons-nous fobriquer?
['histoire. L'enseignant répartit les personnages à réatiser.
Lorsqu'iI y a peu de personnages, chaque étève peut en réaliser ptusieurs, seton sa rapidité.
F Ptusieurs solutions pour [a reproducLes étèves énumèrent Ies personnages de
tion des personnages.
.
Utilisation de photocopies de t'histoire à découper et qui serviront de
gabarits.
Demander aux étèves de dessiner
eux-mêmes les personnages. ll faut
alors travailler sur la reconnaissance
des personnages.
> Réalisation des marionnettes.
Les étèves découpent [a silhouette de
[eur personnage, ils coltent une paitle
sur [eur forme puis fixent une baguette
dans [a paitle à t'aide d'adhésif.
.
"':_:_l'-l-,-T
$*t§riei
- 1 castetet instal[é
[es marionnettes fabriquées
Le castetet peut être utilisé en autonomie, les marionnettes étant rangées par histoire dans des
poch ettes.
Les histoires sont ainsi racontées, Ies
étèves souvent aussi métangent les
personnages et inventent de nouvetles
histoi res.
lI est aussi possible de faire répéter
les êlèves et de [eur demander quand
its sont prêts à faire une reprêsentation devant [a classe et/ou les
parents.
L'enseignant repêrera les moments
où les élèves utiliseront la variation
de distance pour agrandir ou réduire
['ombre projetée.
Cette découverte pourra être reprise
en regroupement pour que tous
puissent se ['approprier.
ll est possible de demander aux élèves de trouver une solution pour que ['on voie les yeux des
personnages ou [es fenêtres éctairées, en évidant les parties que ['on veut éclairer. ll est même
possible d'atter jusqu'à trouver la sotution pour que ces é[éments soient colorés à t'aide d'un
papier transtucide comme du papier vitrail.
La matière Les ombres et la lumière
18p
OUVRAGES AUTOUR DES OMBRES ET DE LA LUMIÈRE
I]
cc
c@
@@@
Jeu c'*:'nbres
Le lapin noir
Heivé TililÈi
,; ir.ii.l:,:;.. 1. " -,.11 e;.o.€
Un tivre cartonné évidé de
manière à pouvoir jouer avec
Philippa Leathers
@ Bayard jeunesse
fi,s§
.
üurile §si t+n trïbi*?
i-Ér:iis
'
i.ri:iiti
.-:
1i,1.1;, n r..-
e , r,9-:t
À chaque doubte page, une
ombre ou un reftet est mis en
valeur par une fenêtre. Un indice permet de deviner de quel
objet vient cette ombre.
Dans [a nuit noire
la.haêi:€jic
zot3
" tz,9a€
rli L'êcois d?s lci:i.s u zoo,
n
rz,fc€
Laurie Cohen et Hector Dexet
@ Frimousse Eds . 2014 . 14€
Lapin est intrigué. Partout où il
va, un grand lapin noir le suit.
Zoé boxe contre son ombre.
Un jour, son ombre s'arrête de
boxer et disparaît.
Tim se promène seuI dans [a
nuit avec sa lampe de poche.
iÀrst iGÈl
Itêst {üsl
,,Çà,
ijneLire rùuge
Le peiiT ih§ât:"e el'*n:!-.res
Ncn lhôêtve ii'*ffibr*s
Marle-Às'riid il:ll1'!,-14âitie
Èi ÀÉtcire ûui1bp;,-i:
Él Seilirrara iei:'.t:se Gibcuié+s
u À Fariii Ct:1.,;s5
Ri.har'.1
Une collection avec un Iivre,
Cette co[[ection propose
d'animer une histoire grâce
à une lampe de poche. l[ en
existe ptusieurs: Voyoge dans
l'espoce, Monstres de lo nuit.
les ombres.
e8'§
@@
lombre C* Icê
O L'éilr ve:; " 11ii] * -r:,it€
Un très beau livre dans [equeI
une souris et un loup se retrouvent au coucher du soleiI
pour jouer avec leurs ombres.
un petit théâtre, des figurines,
les décors et une [ampe. ll en
existe ptusieurs.
''G'l
i'(!\lr,
JEUX AUTOUR DES OMBRES ET DE LA LUMIERE
î-üP
r'ei:
\J,
r;èGrê
is!: iis-l
:ÿ
IJ
J** eies *TlrilrÉs
-ô S:-rin 11;iir
iei
51415214
* A i-,ar!,ii r.le ..:€
Un jeu de loto où i[ faut associer un sujet avec son ombre
chinoise. lI faut faire bien
attention car iI y a des pièges.
*rnbres d* s,:il
er:',ioriit Fùi!/ îei §1.:1ic.r-r
* ri saliil ie r;,€
Un ensembte de marionnettes
pour théâtre d'ombres. Plusieurs
versions existent : château, dinosaures, cirque, toits de Paris...
ir,tqt r G!
!
Lê fêls cies *mbres
i.§
j**
j"êi
ei'*:r:brË e* -fû
ÿliiiiiei (ra.ii O Kr;ui * Â pârr;.
d.
A.:Jiilr ÈÈ ::r.io€
Un jeu d'observation et de mémoire en 3D qui utitise le prin-
Un jeu de société coopératif.
Les nains se cachent dans les
cipe des ombres chinoises. Les
habitants de [a forêt dansent
ombres des arbres, mais [a
bougie se déplace.
É', i'la5a s
autour du feu.
18€
ts
Notions pour l'enseignant
192
193
Trucs et astuces
Comment tu t'appelles?
Les p'tits ingénieurs
Les p'tits architectes
It suffit de passer [e pont
De bas en haut
Ouvrages, jeux et vidéo autour de la construction
.
ljéquilibre
o La stabilité des structures
. La solidité des structures
. Les techniques de construction
. Les techniques d'assemblage
. Le contrepoids
194
196
198
200
204
zo6
Règles de base
Porte-à-faux
> Pour qu'une construction soit sotide, il faut que toutes les forces
qui y sont en action se compensent.
> Dans toute structure, les forces en action peuvent être des tensions (a), des compressions (b et c), des torsions (d) ou des
> Un porte-à-faux est un élément de la construction qui dépasse
d'un mur ou d'un pitier, comme les batcons par exemple.
> lts répondent aux règles de t'équitibre de levier (voir page z6o).
cisaillements (e).
> Etles viennent du poids de la construction, du poids des usagers,
personnes, véhicutes et/ou mobitier, des contraintes ctimatiques.
Polte-à-faux
Construction d'un bâtiment
> La structure peut être de deux sortes:
.
a
Stabitité
> Une construction sera d'autant plus stable que:
- sa surface d'appui sera plus grande,
À murs porteurs. Les briques
dont les dimensions suivent
un principe de proportionna-
litê sont assemb[ées
selon
différents appareitlages qui
font que les joints sont croi-
- son poids sera important,
- son centre de gravité sera bas.
sés pour que le poids
chaque brique soit
de
réparti
sur deux briques.
Sommet étroit
.
À ossature. La structure est
faite d'un cadre dont [a rigidité est assurée par des
triangulations. Les murs ne
sont que «les peaux» de
cette ossature, its ne sont
pas porteurs.
Base large
-
Les ponts
> ll existe trois sortes de
p o
nts.
Tabliêr
el
ie, ot p:te
/
Ce qui peut poser prob[ème
> Les difficuttés des êlèves seront de ['ordre de [a vision dans ['espace quand le travaiI s'appuiera sur des modètes en zD qu'il faudra
reproduire en 3D. llexercice inverse, qui consiste à représenter une construction 3D en zD, sera Iui aussi difficite.
> L'abstraction, demandée par un dessin en zD représentant un objet en 3D, proche de la modétisation est difficite pour des élèves
de maternelte. Demander aux élèves de dessiner teur production, ce qui les aidera à comprendre ['importance de [a précision et
d'une observation juste.
Par assemblage
mécanique
Meccano GS
Technico GS
Constribois
Les zD
GS
Le
jeu des p'tits clous MS-GS
Le coin ieux
de construction
Par empilement
Cubes PS
Kapta PS - MS - cS
o ll doit évoluer au cours du cycle,
dans [a comptexité du jeu mais
aussi dans ta difficulté
des constructions à réaliser.
. Prévoir un tapis de sol pour
amortir le bruit souvent inhérent
à [a manipulation de ces jeux.
Par magnétisme
Manético MS-GS
Smartmax MS-GS
Géomag GS
Par encastrement
Avec des rouleaux
Dupto
o Rassembter des rouleaux
de hauteurs et de largeurs
.
différentes,
Découper des plateformes
PS -
MS-GS
Lego GS
Ctipo GS
K'nex GS
Mobito P5-MS-GS
de dimensions diverses
dans des cartons
Avec deS Oailtes
o Réunir O"i pritf",
rigides.
et des rondlltes
de routeaux ou des
bouchons en plastique
percés avec
Les obiets Les oblets de construction
LE5 OBIETS DE CONSTRUCTTON
rrt
F
CO
lrl
6
o
UI
lrl
ATELIERS AUTONOMES
PUIS CLASSE ENTIÈRE
POUR LES BILANS
25 à 30 minutes
Matériel
* Pour te groupe:
- r jeu de construction constitué
d'éléments de diffêrentes couleurs,
tailles et/ou formes (Dupto, Lego,
Technico, Mobilo, P'tits clous,
Manetico)
Crttr
sÉqueruce peur ÊrnE meuÉe À cnneue rNTRoDUcroN D'uN NouvEAU IEU DE coNsrRucrtoN.
Manipulations [ibres
> Les élèves découvrent [e matérie[ et construisent
Iibrement des objets de leur choix.
Bilan
> L'enseignant [eur demande de nommer et de décrire leur
construction en [es incitant à utitiser le vocabulaire lié
à t'objet réalisé: aites, volant, roues, portes...
> l[ [eur demande d'exptiquer comment its ont procédê.
Les verbes d'action empiler, encastrer, emboîter el les
connecteurs spatiaux sont reformutés.
Prendre en photo les constructions et noter les exptications pour refaire la construction ptus tard
EN PS, LA DESTRUCTToN Esr souvENT DtFFtctLE. LE FAtr D'AVotR pRts EN pHoro ET NorÉ LES EXpLtcATtoNs FActLtrE
L'Acr oN. L EST AUSSr possrBLE D'TNSTAURER LE lv\usÉE D'uN louR DES coNSTRUcloNS eur pERMET or otrrÉnen La
DESTRUC-toN À LA FtN DL . n -o.touÉr.
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
15 à 20 minutes
Matériel
- les étéments du jeu classés
dans diffêrentes barquettes
-
r affiche
- les photos des différentes
pièces du ieu (DVD-Rom)
À fnccuetr, L'ENsETGNANT n oeunruoÉ À uu ecoupr o'ÉrÈvEs
rourES LEs etÈces roerurrqurs DANs DEs BAReUETTES.
DE cLAssER
res ÉrÉueurs
DU IEU ET DE RAssEMBLER
ldentification du prob[ème de vocabulaire
> Après ptusieurs bitans, choisir une rêatisation dans [aquelte it y a des étéments de même couleur
et de dimensions différentes et une explication n'indiquant pas Ia précision de tailte des élêments.
> le voudrois refoire la construction de ... le vous relis les notes que j'oi prises.
> L'enseignant désigne un élève qui essaie de refaire [a construction à t'écoute de [a [ecture des notes.
> L'élève est très vite confrontê au choix d'un élément ptutôt qu'un autre puisque [e seuI indice dont
iI dispose est cetui de ta couleur. Cela fait émerger [a nécessité de nommer chaque pièce du jeu.
Observation de l'inventaire
> Ce motin, des êlèves ont clossé les éléments du ieu. Qu'observez-vous?
> Les étèves auront pu effectuer un ctassement plus ou moins fin, sur un seuI critère ou sur les
deux: Ia tailte ou la couteur. Génératement, les étéments de formes spêciales sont regroupés.
> Seton ce classement, ['interrogation va devoir aboutir au fait qu'iI y a trois critères: [a taitte, la
couleur et [a forme. La dénomination des étéments devra préciser ces trois critères.
lnventaire final sous forme d'affichage collectif
> l[ est possibte de réatiser un inventaire de chaque .ieu sous forme d'affichage (photos dans te DVD-Rom).
MOBILO
CONSTRIBOIS
LES
LES LATTES
CUBES
LES
simples
ot
rô:!
ô4troû
LEs ÉLÉMENrs
Dt
L
oé ro!,
AlsoN
.:\ o."ut",
*
tE5 PIECES SPEC
.Nbe verf
p.vé r.!96
cô,é 5le!
le triongle
::*r
*
le r, o.q- e o-ro1oi
F
rES PtÈcES sPÈc ALES
,1 g,
794
PLAOUE'
-1, ,.pf
", À
::: ooubte, §
.. rripies à
ALES
.\
lo
têle :r
leg To-e,
ATELIERS AUTONOMES
PUIS CLASSE ENTIÈRE
POUR LE BILAN
25 à 30 minutes
Construction
> Comme dans l'étape r, les étèves construisent [ibrement.
Matériet
le jeu de construction
- l'affiche inventaire
Bilan
> Lors de la description de Ieur construction, ['enseignant insiste sur l'utilisation du vocabulaire
instatlê lors de l'étape z.
> lI est possible de faire référence à t'affichage coltectif de
l'i n ve ntai re.
ATELIER SEMI-DIRIGÉ
DE6À8Ér-ÈvEs
z5 à 3o minutes
Matériel
*
Pour te groupe:
le jeu de construction
- l'affiche inventaire
-
*
r
Par binôme:
boîte opaque
Construction individuelle
> Chaque étève choisit moins de huit pièces de jeu pour réaliser une construction simpLe.
Jeu en binôme
> Former des binômes et [eur lournir une boîte opaque.
> Un êtève par binôme ptace sa construction dans [a boîte et Ia décrit à son camarade, de manière
à
ce que celui-ci puisse ta reproduire.
> L'enseignant veitte à [a bonne utitisation du vocabulaire et fait préciser Ie vocabutaire spatial.
> À la fin de ta description, Ies deux constructions sont comparêes, les différences verbalisées et les
mauvaises interprétations reformutées.
> Les deux élèves inversent ensuite les rôles.
tes obiets
Les objets de constru.tlon
LE5 OBJETS DE CONSTRUCTION
ul
F
EI
@
o
UI
ul
J
ATELIER DIRIGE
DE4À6Ér-Èves
z5 à 3o minutes
Matériel
Pour te groupe:
*
- cartes-images 20:
modèles de construction
(DVD-Rom et coffret)
le matérieI de construction choisi
Consigne
> Vous choisissez une photo et vous construisez I'objet ou I'onimol représenté avec le motériel.
> Chaque étève choisit une photo et construit d'après [e modè[e.
Jeu de reconnaissance
> Les constructions sont disposées sur la tabte. fenseignant montre une des photos choisies.
> Quelle est lo construction qui à votre ovis a êté foite d'oprès ce modèle ?
> Comment ovez-vous reconnu cet objet ? À cause de la co uleu r, des pottes, du long cou, des roues...
> L'exercice est recommencé pour une ou deux constructions.
Jeu de devinette
> Décrire une construction et demander aux étèves de [a désigner. Par [a suite, c'est un élève qui
donne les indices.
ATELIERS AUTONOMES
DE6À8Ér-Èves
r5 à zo minutes
-
r
*
Matériel
Pour z élèves:
fiche de construction
* Pour te groupe:
le matérieI de construction choisi
tg6
L'ATEL|ER srnn pnoposÉ plustEURs Fots AVEC DES FtcHEs DE coNsrRUcrtoN DE pLUs EN pLUS coMpLEXES.
UN LtvRET REGRoupANT rrs uooÈres peur Êrnr pnoposÉ nux ÉLÈves coMME LTvRET DE sutvt DE L'ATELtER.
CHAeuE MoDÈLE EST pHoroGRApHrÉ Er assocrÉ À ors cnsrs LUt pERMETTANT oe s'Évlruen DU TypE: J'nr essnvÉ oe
FABRIeuER cr mooÈre, J'y suts ARRtvÉ, sEUL ou AVEc ArDE.
LA pLUPART DES JEUX DE coNsrRUcroNs soNT FouRNts AVEC DES FrcHEs rourEs FArrEs.
Consigne
> ll y a une fîche de construction pour deux élèves. Choque élève construit I'obiet de lo fiche.
> Quond vous ovez terminé, vous comporez vos fobricotions. Si elles sont pareilles, vous ovez sûrement
bien suivi la fiche tous les deux. Si elles sont différentes, vous essoyez de trouver oû vous ovez lu
différemment lo fiche. Vous ovez le droit de corriger votre objet.
ATELIERS AUTONOMES
DE6À8ÉlÈves
r5 à zo minutes
Matériel
Porr Ie groupe:
-le matériel de
constr.lction choisi
objet exemp[e fabriqué en zD
- r objet exemple
fabriqué en volume
*
fATELTER pEUT s'ENVtsAGER EN AclvtrÉ tNDtvtDUELLE, rru eruôrur ou EN GRoupE. lloeJer rnenreuÉ DEVRA ÊTRE EN 3D
POUR QUE LA FICHE DE CONsTRUCTION SOIT INDISPENSABLE: POUR UN OB]ET EN 2D, TRÈS SOUVENT LA PHOTO SUFFIT.
Consigne de [a construction
> Vous ollez inventer un objet qui devro être en volume et le construire avec le matériel.
> Un volume est un obiet qui o de l'épaisseur, Une feuille simple n'est pos un volume, une feuille enroulée devient un volume.
> L'enseignant montre des exemptes de fabrications 2D et 3D.
> Les étèves construisent selon leur imagination
ATELIER DIRIGÉ
DE4À6Ér-Èves
35 à 40 minutes
Matériet
Pour le groupe:
- [es constructions
*
-
r feuilte
- [e matérieI de construction
Questionnement
> ll fout mointenont êcrire lo fiche de construction de votre objet pour que vos comorades puissent le
fobriguer sans I'ovoir vu. Comment foire? llfaut prendre I'objet en photo.
> Celo suffit-îl à construire votre obiet? Non, il y a des côtés qu'on ne voit pos.
> Dons les fiches dêjà utilisées, quÿ ovoit-il? Une photo de l'objet fini, les éléments dont on avait besoin et les étapes pour fabriquer.
le fois les photos et vous dessinez le reste.
Rédaction de [a fiche de construction
> Chacun ou chaque groupe dessine. Des stratégies sont trouvées pour dessiner facitement les
étéments, [a plupart du temps par contournement. Souvent, les étèves expriment la nécessité de
démonter Ieur objet pour se rappeler les étapes de [a fabrication.
> Plutôt que dêmonter que pourriez-vous foire? Refaire un autre objet et noter au fur et à mesure.
> lls construisent un second obiet avec [e premier en modè[e et dessinent les êtapes.
> Certains peuvent demander à utitiser ['apparei[ photo pour faire comme les vraies fiches.
> D'autres peuvent demander à faire une dictée à t'adulte. L'enseignant veilte à [a bonne utitisation
des dénominations étabties en amont.
ATELIERS AUTONOMES
DE6À8Ér-Èves
t5 à zo minutes
*
Matériel
Pour te groupe:
le matériel de construction
- les fiches de construction
de l'étape précédente
Réinvestissement
> Les nouvetles fiches sont mises à ta disposition des élèves pour construction.
DIFFÉRENCIATION
/
TRANSVERSALITÉ
> ll est possibte de proposer uniquement des modèles zD, de demander Ie matêriel nécessaire et de
['ajouter à côté de [a photo de l'objet.
Les obiets Les obiets de construction
LE5 OBJETS DE CONSTRUCTION
râ
F
trl
ARCH
6
o
gravité
ut
EI
J
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
10 à 15 minutes
Matériel
- affiches A4: photographies
de tours (DVD-Rom et coftret)
Lancement du concours
>
Nous ollons foire un concours de tours. Choque groupe vo construire une tour, Le groupe qui ouro foit lo
plus houte sero le groupe gagnant.
> Demander aux élèves ce qu'est une tour, s'ils en ont déjà vues et ce qu'ils peuvent en dire. lts
peuvent observer que les tours sont souvent plus [arges à [a base qu'au sommet. Si cette observation n'est pas faite, ne pas [a susciter.
> Sovez-vous comment s'oppelle lo personne qui conçoit, invente, dessine les tours? Un architecte.
Documentation
>
J'oi offiché des photogrophies de tours. Vous pouvez les regarder avant de construire vos tours.
St LE MATÉRtEL Esr suFFtsANT pouR euE Tous LES GRoupEs putssENT
TRAVATLLER EN MÊME
TEMps, pAssER À L'ÉTApE 2.
Problème d'organisation
> Nous ovons un problème: nous n'ovons pos de motériel pour que tout le monde puisse fabriquer les
tours en même temps. Comment pouvons-nous faire ? ll faut mesurer les tours les unes oprès les
autres, prendre une photo de chaque tour, faire une morque sur le tobleau...
ATELIERS AUTONOMES
DE3À4Ér-ÈvEs
z5 à 3o minutes
Matêriel
- r jeu de construction
permettant de construire
des tours (Dupto, Clippo, Kapla)
- cartes-images 21:
tours (DVD-Rom et coffret)
Construction
> Les êtèves construisent une tour ensembte. lts peuvent
s'inspirer des photos de tours (cartes-images zr dans [e
DVD-Rom et Ie coffret).
Une fois la tour construite, elte est photographiée et mesurée seton [a solution de t'étape r. Prendre également des
photos zooms des sotutions particulièrement ingénieuses
pour gagner de Ia hauteur.
Dessin
> lI est possible de demander aux élèves de dessiner leur
tour une fois qu'ette est construite.
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
r5 à zo minutes
Matériel
- les tours ou leurs photos
- [es photos des astuces
de construction
- affiche A3: iltustration de tour
(DVD-Rom
à légender
et coffret)
LEs pHoros DE TourEs LES TouRs sorut nrrtcuÉes AU TABLEAU.
Comparaison
> Quelle touro gogné? Les élèves désignent la photo
ou lo tour lo plus houte.
> Pourquoi? C'est lo marque lo plus haute...
Observation
> Qu'est-ce qui o foît gogner cette êquipe?
> Les élèves observent les photos et tes zooms et indiquent
les différentes solutions pour gagner de [a hauteur: /ls ont
fait des trous et comme celo ils ont eu plus de briques pour
monter. Le bas est plus large que le haut, mois pos trop.
> Et gue pouvez-vous dire sur toutes les tours ? Pourquoi ovez-vous foit le bos plus lorge
?
Sinon la tour ne tenoit pas. Sur les photos des tours, le bas est toujours plus large que le haut.
> Légender t'affiche de [a tour sous [a dictée des élèves (DVD-Rom et coffret).
Lancement du nouveau défi
> Mointenont que vous connoÎssez les règles pour construire une tour très houte, vous ollez refoire des
tours en utilisont les techniques que nous venons de voir et peut-être déposser lo tour du groupe...
198
ATELIERS AUTONOMES
DE3À4Ér-ÈvEs
15 à
zo minutes
Matériet
-
r jeu de construction permettant de
Nouvelles constructions
> Des tours sont reconstruites. La hauteur de chaque tour est: comparée à [a hauteur de [a tour gagnante. Les tours plus hautes sont observées pour tro uver les techniques employées.
onstruire des tours (Dupto, Clippo, Kapta)
CLASSE ENTIÈRE
PUIS ATELIERS AUTONOMES
35 à 40 minutes
Matériel
- jeu à encastrement
(Dupto, Ctipo..J
êchelle de Richter (DVD-Rom)
Nouve[[e contrainte
> Vous sovez construire des tours houtes. Sont-elles solides ? Non, si on les bouscule elles se cossent.
> À quoi doit résister une tour? Au vent, à la pluie, ou feu, à un tremblement de terre...
> Oui, l'orchitecte pense à tout celo, il utilise des motériaux porticuliers qui résistent à I'eou et ou feu.
Mois nous, nous n'avons que des briques et nous ne pouvons pos construire ovec outre chose.
> le veux que vous fobriquiez des tours encore plus solides copobles de résister à un tremblement de tene.
> L'enseignant explique si nécessaire ce
qu'est un trembtement de terre à t'aide
de t'échette de Richter.
Démonstration
> Je vois soulever lo ploque sur loquelle vous
ollez construire et votre tour ne devro pas
s'effondrer.
> L'enseignant fait une démonstration de [a
maniputation simutant Ie tremblement de
terre à l'aide d'une échelte de Richter.
> Cette fois-ci l'équipe gognonte ne sero pos
forcément celle dont lo tour sera lo plus
houte mais celle qui sero lo plus houte et lo
plus solide.
Nous closserons d'obord les tours selon
leur houteur, la plus houte ouro quotre points si la closse compte quotre groupes, lo plus bosse un
point. Nous ferons olors les tremblements de terre et lo plus solide ouro quotre points, lo plus frogile
un point, Nous odditionnerons les points pour ovoir le gognont.
Construction
> Les équipes construisent leurs tours en testant [eur sotidité avant de les déclarer terminées.
> Au fur et à mesure du passage des équipes, hauteur et sotidité sont mesurées.
Si les ateliers se passent sur Ia semaine, prendre des photos.
Bitan
> Les scores de chaque équipe sont comparés et ['équipe gagnante est proctamée.
> Pourquoi cette tour a-t-elle gogné ? Quelle technique lui o permis d'être à lo fois houte et solide ?
> 0bservation des diffêrentes tours ou des photos et formulations: points de faibtesse et points forts.
DrFFÉRENCTATTON
/
TRANSVERSALTTÉ
> Autres constructions possibtes avec [a même démarche:
. un abri pour [es animaux, en utilisant des figurines de la classe,
. une maison avec une porte et des fenêtres, avec un étage (ptus difficile).
Les obiets Les oblets de construction
t/)
trJ
co
IL SUFFIT DE PASSER LE PONT
t,
Trouver une solution technique
o
lrJ
PRÉSENTER LE PRoBLÈME
(-,)
À nÉSouonE
Situation déclenchante
> L'enseignant Iit I'album lggy
Peck I'architecte et s'arrête une fois que la classe est bloquée sur I'î[e.
> Que doivent fobriquer les élèves? Un pont pour
quitter l'île.
> Nous ollons imoginer gue l'île est cette boîte à
choussures et que la rive est I'autre boîte,
> ll foudro que les ry élèves de lo closse et Mme Gorotoi puissent passer sur le pont mois oussi les petites
voitures du coin goroge,
Iggy Peck t'orchitecte
Andrea Beaty et David Roberts
L) 5drba dnp. 2oo9 . l\.50.
-zboîtesàchaussures
> De quoi allez-vous ovoit besoin? De bois, cartons,
briques Lego, Kopla, rouleaux, ficelles...
> Que font les orchitectes ovont de construire ?
des personnages de Ia classe
(playmobil ou autres)
- des petites voitures
lls
font des pLans.
DESSTNER SON PROjET
25 à 30 minutes
Dessin individuel
> Chaque élève dessine son pont.
Par élève:
- r feuilte
- 1 Crayon
Pour le groupe:
- affiche A3: pont à légender
(DVD-Rom et coffret)
les dessins des élèves du groupe
-I feuille
1 Crayon
> L'enseignant [égende les dessins ou note au tabteau les mots demandés par [es étèves.
> lI regroupe [es dessins qui utilisent des techniques proches: pont avec ou sans piles, pont avec
arches, pont suspendu, pont en Kapta, pont en briques Lego, pont en matérieI de récupération..
> lt désigne les groupes en mettant ensembte [es élèves qui ont des propositions simitaires.
Dessin du groupe
>
le vous demonde mointenont de dessiner un projet
pont en vous mettont d'occord entre vous. Chocun
explique ce qu'il o pensé puis vous dessinerez ce que
de
vous aurez décidé.
> Pour qu'on se comprenne bien, ie vous opprends les
mots qui désignent les différentes parties d'un pont.
> L'enseignant montre les parties nommées sur ['affiche du pont et [e [êgende (OVO-Rom et coffret).
> Chaque groupe dessine [e projet définitif.
It\
ot Al-.
CONSTRUIRE LE PONT DESSINE
35 à 40 minutes
Pour chaque groupe:
instatlation «îtes et rives»
- personnages et voitures
qui doivent passer Le pont
- le matériel nécessaire
au pont du groupe
Construction
> Chaque groupe réalise son pont et Ie teste avec [es personnages et les voitures.
> La construction peut être corrigée jusqu'à ce que le test soit probant.
> Une fois un pont terminé, ['enseignant interroge [e groupe pour ['explication de ses choix.
t
§
B
fif:
NTIE
COMPARER LES CONSTRUCTIONS
35 à 40
minutes
-l'atbum inducteur
Explications des constructions
> Voilô les ponts construits. Tous répondent
au problème de lo closse de Mme Goratoi.
Pourtont, ils sont tous différents. Choque
groupe vo venir expliquer comment il est
orrivé à cette solution.
> Chaque groupe exptique son proiet. fenseignant interroge sur [es étapes successtves.
tggy
irrt t'orchitecie
Andrea Beaty et David Roberts
O Sarbacane . 2oo9 . 15,5o€
- les ponts de chaque groupe
-1 affiche
- affiches A4: photographies de
ponts (DVD-Rom et coffret)
- cartes-images 22:
ponts (DVD-Rom et coffret)
- illustrations de ponts
(matérieI page 2o3 et DVD-Rom)
Structuration
> L'enseignant réatise une affiche.
D"
?^ J.o)ùp)^o{rô
^llÆ nsn-I, îslJ@. 0t
. U,* l'o,ü,
"Ur4I
. 0t
;
I
l-o4ü
o,,uo4Lô,
,é"!hb
"^-.
a-l-^À*
> Qu'avois-nous oipris
TourES cES soLUTtoNs
?
NE
sERoNT pns roncÉiuetr ulLtsÉES.
Comparaison avec de vrais ponts
> Voilà des photos de ponts. Quels sont ceux qui utilisent les mêmes solutions que vous ?
> Les élèves dêsignent [es ponts ressemblant aux leurs et les nomment.
> Proposer aux élèves de classer [es photos de ponts (cartes-images 22 dans [e DVD-Rom
et [e coifret) sous [es itlustrations de ponts correspondantes (matériel page 203 et DVD-Rom).
Lecture de [a fin de l'atbum
> Finolement, quel est le pont qui a été construit grôce à lggy Peck
> L'enseignant tit ta fin de l'histoire.
15 à 20
r photocopie
minutes
Par étève:
(document page 2o2
et DVD-Rom)
Pour la classe:
le document élève et Ies vignettes
agrandis au format A3
(document page 2o2 et DVD-Rom)
?
TRACE ÉCRITE INDIVUELLE
Présentation de t'activité
> Découpe les vignettes représentont des ponts et colle-les dons lo bonne colonne.
> Avant de distribuer [e document, ['enseignant demande à un élève de ptacer une vignette sur le do
cument agrandi fixé au tableau. ll interroge l'élève qui justifie son positionnement: je mets ce pont
dans [a colonne des ponts avec arches car iI y a trois arches.
Les obiets Les objets de construction
RECONNAîTRE LA STRUCTURE DES PONTS.
€
IL SUFFIT DE PASSER LE PONT
Découpe les ponts et colle-[es dans [a bonne colonne.
Pont poutre
f-r-r_l
Lll--l
Pont en arc
Pont suspendu
ILLUSTRATIONS DE PONTS
I
PONT POUTRE
IIIIIIIIIIIIIIIII
PONT EN ARC
PONT SUSPENDU
Les oblets Les objets de construction
(/)
lrJ
DE BAS EN HAUT
co
o
Fabriquer un engin élévateur
t,
lrl
DÉCOUVRIR LE DÉFI
15 à 20
minutes
l'album inducteur
Situation déclenchante
> Lire l'album La famille Souris dîne au cloir deiane jusqu'à [a page r7.
> Les souris sont fatiguées, il fout leur fobriquer un engin qui leur monte le bois.
>Connaissez-vousdesmochinesquiserventàmonterdesobjets,despersonnes?
Lesascenseurs,
les grues, le f unicuLaire, I'hélicoptère, l'escalator, la pelLeteuse...
> Montrer [es photos d'engins pouvant répondre au défi (cartes-images 23 dans [e DVD-Rom et
le
coffret). Les nommer et exptiquer brièvement Ieur fonctionnement.
>
Lo
fanille Souris dîne au cloir de lune
Kazuo wamuTa
O L'éco e des loisirs.1999. 5,60€
Pour [e groupe:
- cartes-images z3: engins de
levage (DVD-Rom et coffret)
o"'o'-*iiili:
Les
mochines que vous ollez fobriquer devront monter les bouts de bois dont les souris ont besoin.
Questionnement
> Les êtèves interrogent ['enseignant sur le défi : A-t-on le droit de toucher les boguettes?
> Oui, vous pouvez installer les boguettes dons l'engin et il est oussi possible de toucher les boguettes
pour les poser sur lo toble: vous serez lo souris qui est ou sol et lo souris qui est sur lo ploteforme.
coNcEPTtoN DEs DtSPOStTtFS DE FAçON tND|VIDUELLE
30 à 45 minutes
Par étève:
-r feuilte
- 1 Crayon
Représentation des idées
> Dessinez votre idée.
> Les élèves dessinent. Une fois [e dessin terminé, l'enseignant Ie lêgende sous [a dictée de t'élève.
ï. ^ ,1"^î.t',,1i",
FABRICATION DES ENGINS
t5 à 20 minutes
Pour Ie groupe:
Ie matérieI de construction
-ta table pour Les tests
-les baguettes
Constatations
> L'enseignant regroupe [es dessins des solutions représentant te même type d'engin et constitue
ainsi les groupes de travail.
> Les solutions impossibles à fabriquer sont é[iminées après discussion permettant aux élèves de
comprendre que [eur idée est trop complexe ou impossibte à fabriquer: robot, hêticoptère...
Fabrication
> Chaque groupe fabrique son engin et [e teste jusqu'à ce que Ie défi puisse être retevé.
L'enseignant prend en photo les différentes machines et [eurs évotutions.
204
PRÉPARATIoN DE LA PRÉSENTATIoN DU DÉFI
10 à 15 minutes
- L'engin construit
Ies photos prises pendant
Ia construction
Verbalisation
> L'enseignant interroge le groupe d'élèves sur les différentes étapes aboutissant à la sotution.
> Les photos prises pendant les fabrications peuvent aider [es élèves à se rappeter leurs essais.
PRÉSENTATION DU DÉFI
15 à 20
minutes
- les engins construits
lnstalIation
> Mise en place de ['instatlation permettant aux groupes de relever le défi.
Passage des groupes
> Chaque groupe re[ève le défi à ['aide de sa machine et explique à ['ensemble de Ia classe comment
il en est arrivé à cette solution.
STRUCTURATION ET TRACE ÉCRITE
15 à
20 minutes
Bitan
> Chaque groupe étant passé, les solutions sont Iistées sur une affiche.
- [es engins construits
-r
affiche
Trace écrite
Les obiets Les objets de construction
OUVRAGES AUTOUR DE LA CONSTRUCTION
@@
@@
Petit Franck architecte
@ Sarbacane
.
zoog
.
r5,5o
€
Frank Viva
O 5 conlirênrs
. zorj .
r,z.ro€
Depuis ses deux ans lggy est
passionné de construction.
@@@
@@
Construire une maison
Une nouvetle maison
Byron BarLon
O -'ecoLe d"< loisirs. r991. r1,20t
Un album simpte pour découvrir
les étapes de Ia construction
d'une maison.
O L'école des loisirs. zooo. rr,zo€
Un atbum pour expliquer [e
démênagement.
JEUX DE CONSTRUCTION ET VIDÉO
§,
@@
@@@
@@@
q9
Les p'tits ctous-
Duplo
Mobito
Technico
O Ulysse ref. zz4o3. A partir de
15,99€
O A partir de 55€
O A partir de 60€
Des pièces à encastrer dont te
nombre varie.
Des pièces déjà en votume
Une activité individuelle consis-
tant à former des personnages
à
assembler par encastrement.
bitité de constructions en zD
et 3D.
ou des objets à l'aide de
formes géométriques en les
clouant sur une plaque de Iiège.
§,
@@
@@@
qv
Co nstribois
O Nathan . A partir de
Créabtoc
Le site TV
jo€
La construction d'objets à l'aide de barres,
vis, êcrous, arbres et roues. Des fiches
techniques représentant ['objet terminê et
les pièces nécessaires sont disponibles.
O Ktein . A partir de 50€
Un jeu de construction constitué de vis et d'écrous. Possi-
. Diflusion OPPA-i\'lontessori . 59€
Un jeu de construction où la solidarité
entre [es briques permet [a sotidité de
O Jiji
l'ensemble.
http://www.lesite.tv/videotheq ue/o/51.oo17 oo-con:
trulre une maisùn
Une vidéo avec les différentes fonctions
d'une construction, puis Ia construction
elle-même.
en
T
I
Notions pour I'enseignant
zo8
209
Trucs et astuces
Une cuisine bien rangée
Les p'tits cuisiniers
270
Pince-mi et Pince-moi sont dans une cuisine
22A
Ouvrages, jeux et application
autour de la cuisine et de la mécanique
224
zt6
.
Les différents mouvements:
rotation et translation
. Les mécanismes permettant
tes transmissions et les transformations
de mouvement
. Le principe des leviers
o La fonction des objets
Les caractéristiques des mouvements
> Un mouvement se caractérise Par:
. sa nature: transtation, rotation, mouvement héticotdat.
.
son sens, sa direction, sa vitesse.
Les différents mécanismes
> Un mécanisme permet soit de transmettre [e mouvement et on parle de mécanisme de transmission, soit de transformer sa nature et
on parle alors de mécanisme de transformation.
> eu,it soit de transmission ou de transformation, le mécanisme peut modifier [e sens, [a direction ou [a vitesse du mouvement.
Les mécanismes de transmission [es ptus courants
Mêcanismes
de transmission
Le système
pou [ies-courroie
Les engrenages
Les roues de friction
Le système
pignons-chaîne
La poulie
Dyna mo
Vêto
Puits
Schéma
Exemples d'ob.iets
uti tisa nt
Remo nte- pe nte
ce mêcanisme
Batteur mécanique,
essoreuse à salade
Les mécanismes de transformation [es plus courants
Mécanismes
de transformation
Le treuil
Le système
bielle - m an ive [[e
Le système
pignon-crêmail[ère
Le système vis-écrou
Puits
Moteur, vieitLe locomotive
Toupie BeyBlade
Eta u
Schêma
Exemples d'objets
utilisant
ce mécanisme
Les leviers
> Les leviers sont utilisés soit pour amptifier une force, soit pour amplifier
un déplacement. Dans les ustensites de cuisine utitisés, c'est [a fonction amptification de [a force qui est mise en avant. Pour que te levier soit [e plus efficace
possibte, it faut que [e bras de levier soit [e ptus grand possibte et que la charge
soit le plus près possibte du pivot.
> Les pinces sont des leviers doubtes.
Ce qui peut poser problème
Peu de difficuttés dans ce chapitre si tes étèves ont à disposition les objets rée[s permettant de manipuler.
êȧ
'
Moutin à légumes
à manivelte
Panier à satade
Essoreuse à salade
à treuil
Presse-p
u
rée
à levier
Quets ustensiles
dans ces séances ?
Les ustensiles nécessaires aux séances de ce
chapitre, excepté [es essoreuses, ne sont
plus vraiment en vogue dans nos cuisines
modernes. lI y a pourtant un renouveau de
ce matérieI entièrement mécanique. lI est
donc possibte de les trouver au sein des
cuisines famiIates. Ces objets sont aussi
toujours en vente dans [a ptupart
des grandes surfaces
Fouet manueI
Fouet mé
Râpe multi-faces
râpes
I'T
F
CUISINE BIEN
ul
6
de
leur fonction
À I'nccuEttLa
semaine précédant
la séance
-r lo-et na-uel. r fouet
Matériel
nécanique
- 1essoreuse à manivetle
r essoreuse à treuiI
-rpanieràsalade
-r
-r
- 1 presse-puree
presse-purée à levier
-rmoutinà[égumes
râpe manuelle, r râpe à fromage
- r râpe à [égumes à manivetle
r émulsionneur, (fouet électrique
à piles non obtigatoire mais qui permet d'introduire Ia notîon d'énergie)
-
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROI.,'PEMENT
10 à 15 minutes
Matériel
- [es ustensiles
de l'étape précédente
- cartes-images z4: ustensiles
de cuisine (DVD-Rom et coffret)
- êtiquettes-mots agrandis à zoo"k
(matériel page 215 et DVD-Rom)
Manipulations
> La semaine précédant [a séance, ['enseignant
dispose dans Ie coin cuisine [es ustensiles qui
serviront à la séance.
> À t'accueit ou Iors de moments en autonomie,
les élèves [es manipulent et se Ies approprient.
LES RÂpEs pEUVENT posER pRoBLÈME. Les ÉrÈvEs
ESSAyENT oE cÂern rour cE eut sE TRouvE DANS LE
cotN cutstNE lr prut Êrpe ruÉcrssnrnr DE LEUp rNDteuER
eu'L NE FAUT pAS RÂpER LES oBjETs DE LA cutstNE.
Questionnement
> Qu'ovez-vous remorqué dons le coin cuisine? De nouveoux obiets.
> lntroduire Ie nom d'ustensites, outils spécifiques à [a cuisine.
> En connoissez-vous certoins? Sovez-vous à quoi îls servent et comment ils s'oppellent?
> Certains obiets sont connus des élèves. Leur photo, [eur nom et [eur fonction associant un verbe
d'action et ['aliment concerné sont affichés et écrits au tableau (cartes-images 24 dans [e DVD-Rom
et [e coffret.
> Pour les obiets inconnus, [es photos sont affichées et regroupées sous un point d'interrogation.
> S'it y a dissension sur un ustensile ou erreur sur [a fonction, ['enseignant dispose les photos de ces
ustensiles avec les ustensiles inconnus.
Présentation de ['activité
> Nous atlons reprendre tous les ustensiles en petits groupes, et en les essayant avec différents
aliments nous essaierons de comprendre à quoi its servent.
LEs FouETs NE posENT pns oe pnogrÈue. Ln nÂpe iUANUELLE Esr coNNUE, LA RÂpE À FRoMAGE ArNsr
euE LA RApE MoULTNETTE soNT pLUs RAREMENT coNNUEs. LES EssoREUsEs pEUVENT ÊTRE assoctÉes AU LAVAGE DE LA
5ALADE ou ETRE coMpLETEMENT tNcoNNUEs. LEs pnEssr-punÉE soNT RAREMENT coNNUs.
GÉNÉRALErvtENT,
g:.G
ATELIER DIRIGÉ
DE4À6Ér-Èvrs
zo à z5 minutes
,Vlatériet
- [es ustensiles
- r salade lavée
- 4 à 6 pommes de terre cuites
- 4 à 6 carottes épluchées
- l morceau de fromage
type emmenthaI
-4 à 6 assiettes ou barquettes
Rappet
> Montrer Ies différents ustensites ainsi que Ies aliments.
> Nous ollons essoyer de comprendre à quoi servent ces ustensiles.
Manipulations
> Les ingrédients sont au centre de [a tabte. Chaque élève essaie d'associer
un
ingrédient à un
ustensite. Les ustensiles connus sont génératement associés au bon aliment. Pour les ustensiles
inconnus, des associations sont testées. Tous les constats sont verbatisés.
PouR cERrArNs ENFANTs, rL Esr posstBLE DE LEs uflLtsER oe unrurÈne Éroruuaute, pouR oBTENtR pAR ExEMpLE DE LA
punÉr or SALADE. PouR D'AUTREs, tL EST posstBLE DE FArRE coNsrATrn que L'ot't N'ARRtvE pAs À ulLtsER TEL lJsrENstLE AVEc rEL ALTMENT: tL Esr tMposstBLE pAR EXEMp.E D'ÉcRAsER LES cARorrES cAR ELLES NE soNT pAs cutrES,
Synthèse des essais
> Chaque ustensile est montrê et les élèves les ayant testés indiquent ce qu'its ont réussi à faire.
Description des ustensiles
> Quels sont les éléments de cet ustensile ?
> lntroduire [e vocabutaire spécifique en Ies désignant sur ['oblet: panier, manivetle, poignée, râpe,
axe, ficelte.
> Que doit-on foire pourfaire fonctionnercet ustensile?
> Les étèves dêcrivent ['action à mener pour l'utitiser: pousser, tourner la manivelle, appuyer sur la
manive[[e, tirer sur Ia ficette... Là encore, les actions sont faites lorsqu'etles sont décrites.
> Pourquoi y o-t-il des trous? lls servent à faire s'écouler de l'eau. Ce sont des trous qui rôpent,
enlèvent un bout de l'aliment parce qu'il dépasse. lls laîssent posser l'oliment qui est écrasé.
Questionnement
> À votre ovis, comment s'oppelle cet ustensile ?
> Si les élèves ne trouvent pas, [eur indiquer le nom exact de ['ustensite.
ATELIER SEMI-DIRIGE
DE6À8Ér-ÈvEs
10 à 15 minutes
Matériet
*
Par étève:
- r feuiile A4
Dessin des élèves et dictée à ['adulte
> Dessine I'ustensile de ton choix. ll fout pouvoir le reconnaître.
> Les étèves choisissent un ustensile, le placent près d'eux et [e dessinent.
> lJenseignant écrit sous [eur dictée [e titre et ta légende du dessin. lt vatide ainsi [e vocabutaire.
-lCrayonapaprer
*
Pour te groupe:
- les ustensites
,*!*r ù ; ^r*3.
Les obiets Les objets mêcaniques
I
ATELIER DIRIGÉ
DE4À6Ér-Èvrs
zo à 3o minutes
*
Matèriel
Par élève:
- r assiette
- 1 fourchette
*
Pour le groupe:
- Ies ustensiles des recettes
- les ingrédients des recettes
- recettes 4, 5, 6,7 el 8
dont l'ustensiie principaI est caché
(DVD-Rom et coffret)
Présentation du matériel
> Mointenont que nous sovons nous seruit de ces nouveoux ustensiles, nous ollons nous en servir pour
réoliser des recettes ovec eux. le vous oi opporté quelques recettes simples.
> L'enseignant présente les quelques recettes et en lit les titres aux élèves tecettes 4, 5, 6, 7 et 8
dans le DVD-Rom et le coffret).
CHAeuE GRoupE pounnn nÉlrtsen uNE RECETTE
otrrÉnrlte.
Lecture d'une recette
> Auiourd'hui nous ollons réoliser lo recette... Décrivez-moi les différentes parties de cette recette.
> tl y a une partie ovec les ingrédients, une partie avec les ustensiles et une portie avec ce qu'il faut faire.
> lntroduire le vocabulaire nouveau: ingrédients, ustensites, déroutement.
@
Les
clrolle.
r,Fées
> De quels ingrédients ovons-nous besoin ?
> Les étèves décodent les iltustrations de [a recette et nomment [es ingrêdients nécessaires.
> De quels ustensiles ovons-nous besoin ?
> Les êtèves décodent tes itlustrations de [a recette et nomment les ustensites nécessaires.
> L'ustensile principat est caché sur Ia recette pour qu'its la complètent avec l'ustensite choisi.
> Que monque-t-il?
> lJenseignant questionne Les étèves sur tes ustensites vus dans les étapes précédentes.
> ll y o une ploce pour le dessin de I'ustensile mois ie ne sais pos lequel vous préférez utiliser.
Ce sero à vous de choisir entre les trois.
Règtes d'hygiène
> Quelle est lo première opérotion? 5e laver les marns.
> Faire êmerger [es autres règles d'hygiène.
Réalisation des recettes
> Les étèves réatisent chaque recette étape par étape en s'aidant des recettes. Au moment de t'utitisation de ['ustensite principat, ['enseignant Ies incite à essayer [es différents ustensiles proposés.
> Quel est I'ustensile que vous ovez préféré utiliser? Pourquoi ?
> Les élèves indiquent ['ustensile qu'its préfèrent et exptiquent [eur choix.
Dégustation et structuration
> Pendant que les étèves qui Ie souhaitent mangent te ptat préparê, ['enseignant les interroge sur [es
actions qu'its ont menées avec ['ustensile principat. C'est l'occasion d'évaluer si les verbes d'action
liés à ces opérations sont acquis et utitisés à bon escient.
> La dégustation peut être une occasion d'introduire du vocabutaire sur [es saveursi cettesoladeest
sovoureuse, elle croque sous les dents, la vinaigrette est bien assaisonnée, elle est salée, elle pique
un peu à cause du vinaigre...
,{?
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
1()
minutes
Matériel
- [es ustensiles
- cartes-images z4: ustensites
de cuisine (DVD-Rom et coffret)
- les étiquettes-mots
agrandies à 2oo%
(matériel page 215 et DVD-Rom)
Questionnement
> Maintenont que nous ovons trouvé à quoi servent tous les ustensiles, comment pouvons-nous
les closser? Ceux qui rôpent, ceux qui mélangent, ceux qui essorent, ceux qui écrosent.
Affichage
> Les quatre verbes sont affichés au tabteau: râper, mélanger, essorer, êcraser.
> Les photos sont montrées une à une. Le nom de ['ustensile est rappelé ainsi que l'action
qu'iI permet et les atiments concernés. La photo est placée sous [e verbe correspondant.
ÀCTIVITÉ INDIVIDUELLE
10 minutes
CETTE ÉTAPE PEUT SE FAIRE EN ATELIER AUToNoME EN PARALLÈLE AVEc L,ATELIER DIRIGÉ DE ÜÉTAPE 5
Matériel
r photocopie
* Par étève:
(document pages 214
et 215 ou DVD-Rom)
-r paire o" .:::iià
Trace écrite individuelte
> Colle les ustensiles qui vont ensemble dons lo même colonne.
ATELIER DIRIGÉ DE LANGAGE
DE6À8ÉlÈves
15 à
zo minutes
Matériel
les ustensiles
Devinette
> I'oi trouvé un outre clossement, je vous demonde
de le deviner.
Dons mon nouveou clossement, I'essoreuse à monivelle est dons lo même cotégorie que le moulin
à légumes. Quel est le critère que j'oi choisi?
> Les élèves manipulent les deux ustensites.
> Pour le foire fonctionner, on foit le même mouvement: on tourne.
Second classement
>
Quels sont les autres ustensiles que je pourrois
closser ovec eux ? Les élèves indiquent [es ustensiles en vérifiant en les maniputant que ['on
tourne bien une manivetle.
> Et les outres, qu'en foit-on ? ll y o ceux pour lesquels il faut tirer. ll y a ceux pour lesquels on foit un
mouvement de va et vient.
> Et le ponier à solade? ll faut baloncer le bras.
Questionnement sur [a chaîne de mouvement
> Nous venons de regorder les mouvements que nous devons faire. Que se posse-t-il dons I'ustensile
> Un élève manipule ['ustensite et verbalise ce qur se passe.
Pour l'essoreuse à solade à monivelle, on tourne la monivelle, cela fait tourner le panier à l'intérieur.
Pour I'essoreuse à treuil, on tire sur la ficelle, cela fait tourner le panier à l'intérieur.
Pour le batteur méconique, on foit tourner lo monivelle, cela fait tourner les roues dentées qui font
tourner les fouets. Pour les rôpes à fromage ou à légumes ou le moulin à légumes, on fait tourner lo
manivelle, cela fait tourner lo rôpe, la ploque trouée.
?
Les objets Les objets mécaniques
Classer des ustensiles selon le critère de [a fonction d'usage.
€
QUI FAIT QUOI ?
Découpe [es ustensites et co[[e-tes dans [a bonne colonne.
Découpe tes étiquettes-mots et colle-tes dans [a bonne cotonne.
Niveau t (MS) Fournir 8 illustrations d'ustensiles et cacher [es cases des niveaux supérieurs.
Niveau z (MS performants et GS) Fournir rz i[[ustrations d'ustensiles et cacher les càses du niveau
3.
Niveau 3 (GS performants) Fournir rz il[ustrations d'ustensiles et 8 êtiquettes-mots.
&
Les i[[ustrations d'ustensites
-r
-r-r_l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
_l
-l
I
I
l
I
l
I
I
I
_-L
__l
Les étiquettes-mots à découper
.TI
_ECxAIEL
r
_ESloRuL
ETI qU
-t
RAPER
ETTES-MOTS
l
Un série
nÂprn
ESSORER
nÂpr
PRESSE-PURÉE
ESSonrusr À sÀrnor-
l
M ELANG ER
l
d'étiquettes pour la classe
.I
t-
ECRASER
a
r
:
T-
I
_yEIAEEL
I
FOUET
l
LE5 OBJETS MÉCANIQUES
tâ
F
ul
CUISINI
É
o
et utiliser des outils
UI
ul
J
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
5
minutes
Matériel
* r carton dans [equei
sont regroupés:
-lessoreuseàsalade
a engrenages
-1 essoreuse à satade
-
-r
r
à treuiI
r
panier à satade
râpe à noix de muscade
- r râpe manuelle
-rrâpeàfromage
râpe à légumes à manivette
-rcouteauàdents
- 1 couteau de cuisine
- 1 couteau économe
- 1 couteau en ptastique
-1couteauàbeurre
-recette 9 (DVD-Rom et colfret)
*
Ia
["ttre
(DVD-Rom)
Présentation du projet
> Lors du regroupement, ['enseignant
arrive avec un cotis et une lettre pour
les étèves (DVD-Rom).
> Les étèves reÇoivent [a commande
d'une salade. Le cotis comporte Ia
recette de cuisine ainsi que des ustensiles de cuisine mélangés.
Lecture de [a lettre
> lenseignant présente [e colis et lit [a
lettre. Si nécessaire, iI explique [es
mots incompris.
> Le mot distrait peut être exptiquê: une
personne distraite rêve souvent, oubtie
des choses.
Questionnement
> Que nous demande cette lettre? De fobriquer une salade.
> Comment allons-nous faire ? ll faut lire lo recette et regarder ce qu'il y a dans le colis.
> Nous ollons regorder en otelier ce qu'il y o dons le colis,
ATELIER DIRIGÉ
DE4À6ÉLÈvrs
1()
minutes
Matériel
- [e matériel de l'étape précédente
Ouverture du colis
> Chaque obiet est sorti, dêsigné et sa fonction indiquée.
> Cette étape est rapide si [a séance lJne cuisine bien rangée a été menée.
> Si tes ustensites ne sont pas connus, ['enseignant interroge les étèves et [eur donne des indices
leur permettant d'émettre des hypothèses sur [a fonction de ['ustensite (voir étape 3 Une cuisine
bien rangée page zt).
> Tous [es couteaux sont regroupés près de l'enseignant pour des raisons de sécurité.
Manipulations
> Les autres ustensiles sont
manipu[és librement par
les étèves.
Consigne
> Closser les ustensiles selon
le critère «ô quoi ils
serVent ».
> C'est moi qui monipuleroi les
couteaux pour le moment.
le les mets moi-même ovec
le groupe d'obiets que vous
me désignez.
Classement
> Les ustensites sont regroupés en trois groupes: ceux
servant à râper, ceux pour
essorer, ceux pour couper.
276
,,1::
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
5 minutes
-le
Matêriel
- r alfiche et 1 feutre
matériel de ['éiape précédente
Stru ctu ration
> L'enseignant propose de rédiger en dictée à I'adutte une affiche indiquant [e contenu du cotis.
4." Jr^*"r",
o
nnnen ?*n
"!r"rr.
^
Questionnement
> Et maintenont que devons-nous faire? La salade.
> Comment foire ?
llfaut
Lire la recette.
CI-A55E ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
5 minutes
MatÉriel
. recette 9 (DVD-Rom et coffret)
Lecture de [a recette
> L'enseignant lit [a recette à l'ensemble de
la ctasse (recette 9 dans [e DVD-Rom et le
coffret). Si nécessaire, iI exptique les mots
incompris. Emmental et comté sont des
fromages. Une lamelle est une tranche fine
et Iongue. Éplucher ou peler se dit quand on
entève la peau d'un atiment.
> Pour l'ensemble petits dés, faire te parattète
avec les dés des jeux de société.
> Les roisinssecssont des grains de raisin
que ['on a séchés pour qu'ils se conservent
longtemps. Faire goûter un grain à chaque
é[ève volontaire.
La satade composée
Verbalisation des différentes actions
> ll faut essorer et découper la laitue en fines
lamelles.
> Peut-on utiliser la loitue directement ?
llva falloir la lover.
Que fait-on avec les corottes et le fromoge
ll faut rôper les corottes et le fromage.
> Rôpe-t-on directement les carottes?
Non, il fout les éplucher. ll faut éplucher
et couper les pommes en petits dés.
>
?
Questionnement
> Quel est I'ustensile qu'il vo folloir utiliser
pour chocune de ces octions ?
> Pour le sovoir, nous ollons les tester en otelier. Choque groupe est responsoble d'un ingrédient.
Les objèts Les objets mécaniqres
CLASSE ENTIÈRE
4ATELTERSDE4À8ÉLÈvrs
1 ATELTER pnn rrucnÉorerur
3o minutes
Lavage des mains
> Les atetiers doivent commencer par [a mise en évidence des conditions d'hygiène et de l'obtigation
de se [aver les mains avant de cuisiner.
MatérieI
*
Pour ['atetier pommes:
-:.àzpommes
- des couteaux
- des économes
des planches à découper
-r saladier
-tk Pour ['ateLier carottes:
Tests
>
>
>
>
Dans les atetiers pommes et carottes, [es différents couteaux sont testés pour ['épluchage.
Dans les atetiers carottes et fromage, les différentes râpes sont testées.
Dans les atetiers pommes et satades, [es différents couteaux sont testés pour [a découpe.
Dans ['atetier satade, [es différentes essoreuses sont testées après le lavage de [a salade.
-4à6carottes
-r
saladier
- des couteaux
- des économes
- des râpes
*
-
Pour l'atetier fromage:
morceau d'emmentaI
- des râpes
-r saladier
l
*
Pour I'atelier satade:
-r salade
- des essoreuses à salade
- des ciseaux
- I5dldUtet
Trace êcrite collective
>
En
fin de chaque atetier, rédaction de la trace écrite indiquant ['outil choisi par Ia classe.
^î^,,\ÿ
a
a
a
qa
)oLn
Y
G)0
. v,h
6D1
-)'oùt
rÀnæ o Ylb.rmane
a
lorvù 8.,,1, a"n
l]
a,rf"
e<l>rvÿ\e..
\,r,1æ
:ÿ,\lp.
t)O
lL EST posstBLE oe nÉnrtsen LA sALADE À r'nror ors tucnÉoteurs uttLtsÉs Lons ogs otrrÉneNrs ArELtERs. sE posE
ALORS LE PROBLEME DE LA CONSERVATION DES ALIMENTS: LE5 POMMES BRUNISSENT, LES CAROTTES SECHENT ET LA 54.
rnoe sE rLÉtntt. St LES ATELTERs 50NT Tous merÉs onrus LA MAT|NEE, tL Esr RECoMMANDE DE FArRE LE i\TELANGE EN FrN
oe
ET DE FATRE coûrrn rous rrs ÉrÈves DANS cE cAS. L'ÉTApE 6 op nÉLruvrsrtssruENT N'EXtsrE pAS
^ltnrtNÉg
3i§
CLA5SE ENTIÈRE
4 ATELTERS DE 4 À 8 Ér-ÈvEs
1 ereurrn pan rrueRÉorerur
3o à 4o minutes
MatérieI
- les ustensiles choisis
-4à6carottes
- 2 p0mmes
- 1 salade
-
l morceau de fromage
type emmenthal
-r saladier par atetier
recette 9 à colorie' (version noir
et btanc du DVD-Rom)
- des crayons de couleur
Organisation
PoUR ENCADRER LES ATELIERs, IL EST PoSSIBLE DE DEMANDER L,AIDE DE PARENTS
> Les groupes sont toujours responsabtes d'un ingrédient mais ils seront permutês pour que
étèves aient à utitiser des ustensites dont ils ne se sont pas encore servis.
Ies
È Les atetiers salade et fromage, si celui-ci est déià découpé, peuvent être autonomes.
> L'atelier carottes doit être dirigé [ors de ['êpluchage. ll faut une carotte par élève.
> L'atetier pommes doit être complètement dirigé, chaque élève coupant r/4 de pomme en petits dés.
> ll faut donc [ancer les deux ateliers autonomes, prévoir un travaiI en autonomie du groupe
pommes, comme le cotoriage des ingrêdients de la recette par exempte, commencer ['atelier
carottes puis quand l'êpluchage est terminé, s'occuper de l'atetier pommes.
Uti(isation des ustensiles
» Chaque groupe travaitte. L'enseignant vei[[e à ce que Ies étèves utilisent correctement Ies ustensiles
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
5 minutes
Matériel
[es ingrédients de ['étape
précédente
- des raisins secs
- de la vinaigrette
Assemblage de la salade
> L'enseignant mêlange devant tous [es étèves [es ingrédients récoltés dans [es ateliers précédents.
> ll monque quelque chose dons cette solade, qui s'en souvient ?
> Si personne ne se rappelte qu'il faut des raisins secs, revenir à [a recette et [a retire.
> De même pour [a vinaigrette. Utitiser de la vinaigrette toute faite ou [a faire avant [a séance.
> Lors de t'assembtage, l'enseignant fait reverbaliser aux êlèves Ies opérations qui ont été effectuées
et nommer les ustensites utitisés. ll est important aussi d'exprimer les difficultés rencontrées.
CLA55E ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
10 minutes
Matériel
- les ingrédients de l'étape
précédente
-
r grand saladier
- des couverts à salade
- [es raisins secs
-La vinaigrette
Distribution
> Les élèves sont instaltés aux tabtes,
['enseignant ou un élève leur sert de
la satade.
Dégustation
> Les étèves goûtent. L'enseignant tes
incite à dire ce qu'ils en pensent.
> Aimez-vous cette salode? Pourquoi?
Reconnoissez-vous tous les oliments ?
Est-ce solé ? Sucré ? Acide ? Amer ?
Que sentez-vous ? Tous les ingrédients
ont-îls le même croquant sous les
dents?
les objets
Les obiets mécaniques
tES OBJETS MECANIQUES
ln
F
ul
ET PINCEDANS UNE
o
o
ra
EI
J
Découvrir la notion de
La
À I'eccuErtsemaine précédant
la séance
Matériel
Différentes pinces:
*
Manipulations
> La semaine précédant [a séance, ['enseignant dispose dans Ie coin cuisine [es pinces de la séance.
> À t'accueit ou lors de moments en autonomie, les étèves [es manipulent et se les approprient.
-rpinceàdénoyauter
-lplnceasucre
-r
pince à cornichons
-r pince à épiter
- 1Ca55e-nOlX
-r pince à crustacés
- r presse-aiI
-rpinceàescargots
-r
;k
-rpinceàthé
pince à salade
Des objets à transvaser:
- marrons
. coquilles O'.t:.;*.ij
- noisettes...
ATELIER DIRIGÉ DE LAIVG,AGE
DE4À6ÉlÈvEs
15 à 20
minutes
fvlatêr!eI
* Pour z élèves:
2 boîtes de 6 æufs
-les pinces de l'étape précédente,
-6 pertes de grosseurs différentes,
de [a perle de rocaitle à La perle de
la grosseur d'une noix disposées
dans Ia boîte à compartiments
- 1 morceau de sucre
1n0lx
- 1 noisette
-
r cornichon
- r olive
-
r coquilte d'escargot
-quetques
*r,,,., o. roj,jXË
Défi
> Faites passer tous les objets de cette boîte dons son couvercle sons toucher directement les obiets,
Les
boîtes ne doivent pos bouger. Avez-vous des idées?
> lnciter les étèves à proposer des méthodes et à argumenter en quoi etles fonctionneraient.
> Étiminer les sotutions fantaisistes et faire essayer [es solutions réatistes et argumentées.
> Si aucun élève ne pense à utitiser les nouvelles pinces du coin cuisine, les mettre sur Ia voie:
dons le coin cuisine, îl y o de nouveoux obiets qui pourroient nous servir.
Manipulations
> Les étèves essaient les différentes pinces. lts verbatisent tes échecs et les exptiquent: jen'yarrive
pas lvec cette pince car la perle est trop grosse (trop petite).
> lts verbalisent les rêussites et [es exptiquent: jesuisarrivéàpincercetteperleaveclapince,elle
s'ouvre juste un peu plus que la grosseur de la perle et oprès Ço la serre.
Désignation
> Mettre tes objets réets sur [a tabte et inciter [es élèves à trouver [a fonction d'usage de chaque
pince. Une fois [eur usage trouvé, nommer les pinces.
Structuration
220
ATELIER DIRIGÉ
DE
10 À 15 ÉlÈvrs
ro à r5 minutes
*
Matêriel
par élève:
- r feuitle
-lCrayonapaprer
*
Pour le groupe:
-les pinces de ['étape
précédente numérotées à ['aide de
go m m ettes
Observation - questionnement
> Que pouvez-vous me dire sur toutes les pinces que nous ovons utilisées?
Elles ont toutes un endroit pour mettre les doigts, un endroit pour mettre I'objet.
> Montrer les branches des pinces et interroger les élèves à leur sulet.
> Et cela, comment I'oppelleriez-vous? Les bras.
On pourrait oppeler celo les bras de lo pince, mois on préfère dire les bronches.
Combien de bronches ont chocune de ces pinces ? Elles o nt toutes deux branches.
Que pouvez-vous dire sur ces deux bronches ? Elles sont reliées.
L'endroit oû elles sont reliées s'oppelle le pivot.
Consigne
> Répartir les étèves en deux groupes de manière à pouvoir échanger les dessins des deux groupes
Iors de l'êtape suivante.
> Choisissez une pince et dessinez-lo. Attention on doit lo reconnoître.
> Quond tout le monde ouro dessiné so pince, nous mélongerons les dessins et il foudro retrouver les
pinces qui ont été dessinées.
> Quond vous ovez terminé votre dessin, écrivez à I'arrière votre nom et le numéro de lo pince.
ATELIER DIRIGÉ
DE
10 À 15 ÉLÈvEs
5 à 10 minutes
Matériel
- les dessins de l'étape
précédente d'un autre groupe
--mérotés à ['aide de gommettes
I
nstailation
> Echanger Ies dessins de deux groupes et instatter Ies pinces correspondant aux dessins sur
chaque table.
Consigne
> Positionnez les pinces sur leur dessin,
Vêrification
> Vérifier en retournant Ies dessins que les pinces
appariées aux dessins sont Ies bonnes.
Règles d'un bon dessin d'observation
les pinces aient été reconnues ou non,
faire verbaliser [e pourquoi de [a reconnaissance ou de la non-reconnaissance: on ne voit
pos les branches. On voit bien que Les bronches sont reliées ou milieu et qu'il y o une cuillère et une
fourchette pour attraper Lo salade... C'est trop petit. On ne voit pas la forme de l'endroit où on pince
I'objet. On peut confondre la pince à sucre et La pince à cornichons si on ne dessine pas bien le bout de
ts Que
la pince,
fois l'ensemble des dessins vaIidés ou non, les dessins des é[èves du groupe sont
bués. Les élèves Ies amé[iorent au vu des remarques qu'its viennent de faire.
Une
Les obiets Les objets mécaniques
ATELIER DIRIGÉ DE LANGAGE
DE4À6ÉlÈvrs
ro
à
r5 minutes
Matériel
Les pinces des étapes
précédentes
- r appareil photo
Consigne
> Clossez les pinces.
Questionnement
> Que veut dire closset? Regrouper.
> Regrouper n'importe comment? Non, il fout que dans choque groupe les pinces oient un point commun.
Propositions des élèves
> Quel classement peut-on foire ?
Les critères proposés peuvent être la matière de [a pince, [a grosseur des obiets pincés, la dimension
des pinces, [eur fonction (attraper, tenir, écraser, casser).
Laisser faire ces ctassements, [es prendre en photo puis inciter à trouver d'autres critères.
ATELIER DIRIGÉ
DE4À6Ér-Èves
ro
à
*
Pour z étèves:
r5 minutes
Matériel
-r pirce à cor-ichons ou à:ucre
sur [aquet[e ont été cotlées 3 gommettes: 1 gommette rouge près du
pivot, l gommette orange au mitieu
de [a pince, l gommette verte au
bout des branches.
\§§
Manipulations
> Présenter une pince à sucre sur laquelte des gommettes ont êté positionnées.
l'oi collé trois gommettes sur les branches de lo pince à sucre.
Vous ollez pincer le morceau de sucre et le posser d'une boîte à l'outre en positionnont vos doigts
d'obord sur lo gommette rouge, puis la orange, puis lo verte.
> Les élèves manipulent.
-zboltesàceufs
- 1 morceau de sucre
*
Pour le groupe:
- les aul'es pinces
Questionnement et constat
> Que remarquez-vous? Quand on pince avec les doigts sur lo gommette verte, c'est plus focile de pincer
fort le sucre. En mettont les doigts sur la gommette rouge, on n'y arrive pas. Sur la gommette oronge,
on pince le sucre moins fort.
> Quelle est la ploce de lo gommette verte pot ropport ou pivot? Elle est loin du pivot.
> Constat: [a pince est ptus facile à maniputer si [es doigts sont [oin du pivot.
Elargissement
> Est-cevrai surtoutes les pinces?
> Vérification pour toutes les pinces.
Conclusion
. 9**
222
A^
y,',", b^L
?r"
û^ 4""- y"ilL,
,,0
8""t,
nollt.e >e»
W
?-\," d,,
ryu"l
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
5 à 10 minutes
r
MatérieI
- r affiche
- r photocopie de la pince
à cornichons (DVD-Rom)
feutre pour annoter [a pince
-les pinces des ateliers
Questionnement
> Qu'ovons-nous opprîs sur les pinces ?
Les différents éléments d'une pince: les deux
branches, le pivot, I'emplacement pour pincer
I'objet, l'emplacement pour tenir lo pince.
> Comment pourroit-on écrire celo sur l'offiche pour
que celo soit simple ô comprendre?
En foisant un dessin et en mettant les mots
dessus.
> Celo s'oppelle légenderun dessin.
> Et quond nous ovons trovoillé ovec lo pince à cornichons? llfaut tenir lo pince loin du pivot.
> Démonstration si nécessaire par un étève.
Rédaction de I'affiche
> Sous ta dictée des êlèves, l'enseignant annote
[a
pince et écrit [a conclusion.
PROLONGEMENT
> ll est possible d'organiser une chasse aux pinces. Les pinces n'existent pas seulement dans
[a cuisine. Les outils sont souvent des pinces. Les paires de ciseaux ne sont que des pinces
qui coupent.
> ll est possibte de proposer aux étèves une cottection de pinces de toutes sortes.
> À chaque nouvette pince amenée par [es êtèves, observation de [a pince, réinvestissement
du vocabutaire et de Ia position idéale pour une utilisation efficace.
Les objets Les objets mécaniques
OUVRAGES AUTOUR DE LA CUIS!NE ET DE LA MÉGAN!QUE
Dons
lo cuisine
@
6à 6à
Dans [a cuisine
Mon premier [ivre de cuisine
Claudine Furlano O Zoom éditions
.
zooz
.
3,9o
€
Un imagier des ustensiles de [a cuisine.
@ Le Batton
@@
t
2C.12 o
4,95€
Quinze recettes itlustrêes en quatre étapes
de façon simpte. Trois niveaux de difficutté.
J'apprends à cuisiner
Angela Will<es et Stephen Cartwright
@ Editions Usborne . 2oo8 . 9,7o €
Une quarantaine de recettes très bien
iltustrées. Un lexique des ustensites et du
vocabulaire, des astuces et des conseils.
-,
-
q, §v
@@
Marmitons en classe
La machine de IVlichel
Nete Soors O Sedrap
.
2613 o
@
La clinique des jouets
Yuichi Kasano O L'école des loisirs
Dorothée de Monfreid
55€
Seize recettes originales pour permettre
aux êtèves de se famitiariser avec la cuisine,
les quantitês et les règtes d'hygiène.
, zotr o tz,lo€
Le robot de Kenji est cassé. À ta ctinique
lnvité à la fête d'anniversaire d'Atice, Michet
lui fabrique une machine extraordinaire.
des jouets, il va retrouver une seconde vie
au milieu de nombreux autres jouets.
JEUX ET APPLICATION AUTOUR DES MÉCAruISMES
.,-r.tst
@@
@@
Lego Duplo
Mes premières machines
Lego Duplo
La mécanique
Duplo. À partir de 129,95€
Ce coffret permet d'exptorer
des principes mécaniques de
base tets que des engrenages,
des leviers, des pouties, des
roues et des axes
@ Lego Duplo
@ Lego
.
À partir de r55€
Ce coffret permet de concevoir
et réatiser des constructions où
les principaux mécanismes de
transmission et de transformation de mouvement seront mis
en ceuvre.
{6à
i:;s':
i:,:-: :'1.: i r,-.',--\.. : i :..
- .l :.--:..
-' I :.,::: - I :.
Geared for lpad
'.]:
,, ---
Un jeu pour dêcouvrir les principes de base de la transmission
du mouvement par engrenages.
La boîte «Toolbox» intègre
une chaîne qui permet de
comprendre aussi les prlncipes de [a transmission par
pi gno ns- ch ai ne.
r;à
Bryan Mitchet[
O Bryan l\4itchetl n 2,99€
Une application pour réali-
ser virtuellement des trains
d'engrenages en dêplaçant les
roues dentées du bon diamètre.
Notions pour l'enseignant
zz6
Trucs et astuces
227
Les gardiens de parking
Les p'tits garagistes
Les constructeurs de voitures
Défi Le défi des constructeurs
Ouvrages et jeux autour des véhicules
Les notions abordées
.
"
Le lexique de ta vciture
Un mÉcenisrne de base: la roue
zz8
234
46
240
242
Nti sp
r['nsei
na
> Une roue comporte plusieurs parties.
Jante
> Une roue peut être montée de deux façons différentes.
Roue libre sur axe fixe
'
Roue sotidaire de ['axe
À ta fabrication, ces deux montages imptiquent des diffi cuttés techniques différentes.
.
Si les trous sont d'un diamètre plus grand que ['axe, les roues
sont Iibres sur ['axe. lI faut Iimiter Ieur déplacement transversaI
.
Si les trous sont d'un diamètre ptus petit que I'axe, les
sont montées solidaires de ['axe, en force.
sur l'axe avec des perles, du scotch ou des pailles.
Ce qui peut poser probtèrne
> La notion de paraltétisme peut être difficite à visualiser et à verbaliser"
a:6
On peut utiliser tout objet circulaire.
Pour les essieux, ['axe peut être un cure-dent, une pique à brochette ou un touritton de deux ou trois mitlimètres de diamètre.
Pour les roues, les bouchons en liège sont à éviter car leur
perçage est difficile. La solution la plus simple est les bouchons
plastiques. lts comportent presque tous en [eur centre une petite
bosse ou une zone plus foncée, traces de leur mode de fabrica-
.
.
tion. C'est un repère facile pour réaliser [e trou de passage de
['axe des roues. Le perçage se fait à l'aide d'une vrilte, d'un clou ou
d'une perceuse-visseuse.
Pour éviter cela, i[ est possible d'utiliser
deux bouchons que ['on emmanche
['un dans l'autre.
Cet emmanchement peut
se faire de trois façons.
Les deux bouchons
sont de diamètres
très différents.
Coller [e petit
à t'aide d'un pistotet
à colle (basse température) à l'intérieur
-
On peut trouver
des roues toutes faites
chez Opitec.
Les obiets Les obiets roulants
LE5 OBJETS ROULAI{T5
UI
F
ul
o
o
UI
lrl
J
CLASSE ENTIERE
COIN REGROUPEMENT
10 à 15 minutes
to!=tàiiel
Ë r cotlection de véhicutes
mlniaiures comportant :
- do- . phir.lles de tourisme
-des véhicules de sport
- des véhicules utiLitaires
- des bus ou minibus
- des camions
- des tracteurs
- des motos
-des trottinettes, des vétos
§
*
Un nouveau coin garage est installé. ll est préférable que ce coin n'existe pas auparavant.
Si le coin est déjà en ptace, mettre en scène ['arrivêe d'un nouveau lot de véhicutes.
§ Les nouveaux véhicutes sont présentés à t'ensemble de [a ctasse.
*=ss:j*§-sTs§-:
s
L'enseignant interroge sur [a nature des objets présentés: qu'est-ce que c'est?
Des voitures, des camions, des motos...
§er§*iisaii*-
s
Des véhicules
de di[férentes matières :
- en bois
- en plastique
- en métal
-en tissu
- en carton
- en mousse
*
§iiu*ii*n dS:l**r**sl*
L'enseignant dirige une discussion permettant de nommer correctement chacun des véhicutes et
de faire verbatiser [e fait que ce sont des jouets qui représentent de vraies voitures. ll introduit [e
lerme véhicule.
ie *sisr':+
*
Pour découvrir tous ces nouveoux véhicules, ollez jouer ou coin goroge.
Des véhicules récents et anciens
ATËLIER AUTOTIOME
DE3À4Ér-Èves
15 à 20
minutes
Matériel
la collection d'objets routants
228
S*r*uv*rie,l i§er':iruiat:**
> Pendant un momeni de découverte des jouets, moment préatabte indispensable au travai[, chaque
étève manipule [es véhicules, les prend en mains, les fait router Iibrement.
(pà
@
""o,"rbre
lanvier>1uin
> décembre
ATELIER DIRIGÉ DE LANGAGE
DE4À6Êr-Èvrs
zo à 3o minutes
Matériel
la cotlection d'objets roulants
Consigne
>
Vous ollez ronger les nouveaux véhicules dons le coin garage. ll fout que les véhicules que l'on vo
mettre ensemble aient des points communs.
Propositions des élèves
> Chaque élève propose des ctassements différents: couteur, taitle, nombre de roues.
> Si aucun étève ne propose le classement par fonction (toisirs, sport, utilitaires) faire comparer une
voiture de sport avec une voiture utititaire. Utilise-t-on ces deux voitures de lo même façon?
> Si aucun étève ne propose [e classement par matêriaux, faire de même avec deux voitures
de matériaux différents. Ces deux véhicules sont-ils identiques?
Chaque classement est photographié en vue d'une affiche finale.
CLASSE ENTIERE
COIN REGROUPEMENT
10 à 15 minutes
Matériel
- les photos des ctassements
de ['étape précédente
- r affiche
Affichage
> Les photographies des ctassements sont affichées au tabteau.
Verbalisation
> Les étèves renomment les différents classements ayant été trouvés.
> L'enseignant écrit sous ta photographie [e nom du ctassement.
Chsix du classement
> Les étèves choisissent [e ctassement qu'its souhaitent utiliser pour [e con ga rage.
Trace écrite
Les obiets Les objets
roulants
=-::::
ATELIER DIRIGÉ
Émpt + cLAssER DEs vÉHtcuLEs sELoN uN cRIÈRE
PS.Ms
DE4À6Ét-Èves
r5 à zo minutes
Matêriet
des barquettes
::s étiquettes de ctassements
r"téi'leI page 237 et DVD-Rom)
- cartes-images z5:
véhicules (DVD-Rom et coffret)
Présentation du matêriel
> Des barquettes avec une étiquette indiquant [e critère de classement des véhicules sont proposées
(matérieI page 231 ou DVD-Rom).
> L'enseignant prend une carte-image de vêhicule (DVD-Rom et coffret) et demande à un étève de [a
décrire et de [a positionner dans Ia bonne barquette.
Consigne
> Clossez
ces photos de véhicules,
Ctassement
> Chaque étève prend une carte, nomme te véhicute et indique les différents critères possibles: c'esf
uncamion,ilohuitroues,ilsertàtronsporterdesonimoux. ll positionne [a carte dans [a barquette
qu'it pense être [a bonne. Les autres élèves peuvent ne pas être d'accord et proposer un autre
ctassement en argumentant.
D'AUTRES cRlrÈREs DE cLAssEMENT PEUVENT ÊTRE eruvtsncÉs.
- LE MoDE DE pRopuLstoN: MANUEL, A RESS6RT, À FRlcrloN, Érecrntque, RADIoGUIDÉ, rtLocutoÉ.
- LE RANGEMENT cHRoNoLoGreuE 5t LA coLLEcrloN coMPoRTE oEs vÉltcurrs ANclENs.
Validation
> L'enseignant vatide le ctassement du groupe.
ACTIVITÉ INDIVIDUELLE
r5 à zo minutes
fMatériel
- r photocopie par êlève
(document pages 232 eI 233
ou DVD-Rom)
Présentation de l'activité
> L'enseignant présente [e document étève.
> Découpe les imoges de véhicules et colle-les dons lo bonne cose.
DIFFÉRENCIATION
> Dans tes étapes 4 et 5, te nombre de véhicules peut être adapté au niveau des étèves. lt est possibte de demander ptusieurs classements successifs pour les étèves les plus performants.
230
ÉreuerrEs
DE cLASSEMENT
Au choix selon le classement
Utitisation: familiale, utititaire, urgence, tout terrain, sport, vacances
Nombre de roues
Époquer passé, présent, futur
S
(B'
Énergie: essence, électricité
Nombre de passagers: un passager, une famille, un groupe
Les obiets Les objets l.or1un15 li-§:§.
Classer les véhicules selon [e critère choisi.
CHACUN SON PARKI NG
Cotte les véhicules dans [e bon parking.
fà
Niveau r (PS) Ne donner que z parkings. Y coller les logos du critère de classement choisi (z ou roues). Donner les g
4
images de véhicules correspondants.
Niveau z (Ms) Donner [es 4 parkings. Y co[[er les [ogos du critère de classement choisi G,2,3,4 ou + de roues).
Donner les ro images de véhicules correspondants.
Niveau 3 (MS performants) Donner tes 4 parkings. Y co[[er les [ogos du critère de classement selon ce qui
est transporté (transport d'un passager, transport d'une famitte, transport en commun, transport de marchandises).
Donner les rz images correspondantes.
iàa
l-rTr.l
LI
tT-r-r-Tt
)
--t
-'
L\-\
ll=;l
l
ISTES
ur en nommer chaque partie
ln
IJJ
J
CLASSE ENTIERE
COIN REGROUPEMENT
10 minutes
Lo vieille guimborde
Phy is Root et Jill Barton
O Kaléidoscope . 2ao7. 72,7a€
Situation déctenchante
> L'enseignant tit l'atbum La vieille guimbarde.
Questionnement
> Qu'est-ce qu'une guimborde ? Une vieille voiture.
> Quel est le premier élément de lo voiture qui tombe en ponne ? Une roue.
> Que se posse-t-il? La roue est crevée, elle se dégonfle.
> Ensuite, qu'arrive-t-il à lo voiture ? Le plancher casse.
> Dons une voiture, on dit plutôt un chôssis. Et oprès? C'est le réservoir qui tombe.
> À quoi sert le réservoir? À mettre I'essence.
Pourquoi doit-on mettre de I'essence dons lo voiture? Pour faire fonctionner le moteur.
Toutes les voitures fonctionnent-elles ovec de I'essence? Non, il y a des voitures électriques.
> Quelle partie de lo voiture tombe en ponne en dernier? Le moteur.
À quoi sert le moteur? ll fait tourner les roues.
> Que foit-on quond une voiture tombe en ponne? On l'emmène chez le gorogiste.
> L'enseignant propose de jouer oux petits gorogistes pour comprendre comment est faite une voiture.
ACTIVITÉ INDIVIDUELLE
10 à 20 minutes
Matériel
*
Par étève;
- r [euilte
feutres ou crayons de couteur
Consigne
>
..
/
Dessine une voiture en essoyant de repiésenter
les
porties les plus importantes.
Activité
> Chaque élève dessine une voiture. L'enseignant
légende [e dessin en interrogeant chaque étève.
ATELIER DIRIGÉ
DE4À6Ét-Èvrs
t5 à zo minutes
Matériel
au moins une petite voiture
à démonter, plus si possibte
Constation
> À t'aide des dessins faits [ors de t'étape précédente, ['enseignant montre que [es é[éments
indiqués par les êtèves ne sont pas les mêmes.
Questionnement
> Comment peut-on savoir quels sont les éléments
d'une voiture? En demondant à un vendeur de
voiture, en demandant à un garogiste, en regordant dons une voiture.
Proposition du démontage
> I'oi Îci une petite voiture iouet qui comporte tous
les éléments importonts d'une vroie voiture.
Nous ollons la démonter et nommer toutes les
pièces démontées.
Démontage
> Les élèves à tour de rôte (ou l'enseignant si
l'utilisation du tournevis est trop complexe pour
tes élèves) démontent les différents étéments de
la petite voiture en [es nommant.
> La fonction de chaque élément peut aussi être
abordée.
Prendre une photo de chaque élément.
234
@@
septembre
>
juin
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
15
minutes
Matériei
- iflustrations des éléments
d'une voiture (DVD-Rom)
- des étiquettes pour Ia légende
(DVD-Ro m)
Structuration des sonnaissances
> Une fois [e démontage réalisé, légender
les différents éléments d'une voiture pour obtenir une
affiche.
Fossibilité de dictée à ['adutte
6h.0
> J)a b w
l)n,
ü
.0\yJt-[^,h.e.
)h,
u o:
frtrt]P
,*"^;^.*
0^
.AnÀ,lÿ},.
d,et-n: e,>»lætt:x:,
o4nL,ta nann»,
I
UNE rRACE Écnrre NorvrourLrE peur Êrnr couçue À pARTtR DES
ÉrÉmerurs DE L'AFFtcHE. ELLE NE pARTtclpERA pAS À L'oBlEclF DE
LA sÉANcE MAts pouRRA FA RE L'oBlET D'uN TRAVATL DE RrLoNNAtssANcE DE L'tNr lAr L DES NoMS oes
t s
nrrÉneuce
irÉull
À
tt
r'nrrrcur. Crttr nctrvrrÉ prur Êree L'oelEr o'uu
ATELTER EN
AUTONOMIE
ATELIER DIRIGÉ DE LANGAGE
DE4À6ÉLÈves
15
minutes
Matériet
- memory E: étéments
d'une voiture (DVD-Rom et coffret)
Érnee 5 NoMMER LEs DIFFÉRENTEs pARTlEs D'uNE votruRE
Memory des é[éments d'une voiture
> Le jeu se pratique comme un memory ctassique, mais chaque carte retournée doit être nommée
par l'élève. lt s'agit d'associer ['tlustration à ta photo.
> Les paires trouvées ne peuvent être gagnées que si ['étément est nommé correctement.
DIFFÉRENEIATION
> Le nombre de cartes du memory peut être différent selon [e niveau de [a ctasse: les éléments
principaux sont toujours présents mais les secondaires (rêtroviseurs, pare-brises, pare-chocs...)
peuvent être ou non entevés du leu.
Les obiets Les obiets routants
|n
F
ul
CONSTRUCTEURS DE VOITURES
6
o
maquette d'objet roulant
t^
lrl
J
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
5 à ro minutes
Matêriel
- aucun
Présentation du projet
> L'enseignant propose de fabriquer des petites voitures.
Questionnement
> Comment foire 7 Quels sont les éléments que nous ne devons pos oublier
?
Des roues, des essieux, une carrosserie, un chôssis, un moteur, un volant...
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8Ér-Èvrs
30 à 45 minutes
fl{atrÈriel
*'
Matériet de récupération:
- boîtes diverses
- bouchons
- objets en plastique
-liège
- tourillons
-piques à brochette
-pailtes
roues de chez Opitec ou autres
- perles
*
outits
-aiguilte de piquage'
- scotch
- cotle
- agrafeuse
- vritte
- clous
- marteau
- ctseaux
- SCte
CLASSE ENTIERE
COIN REGROUPEMENT
r5 à zo minutes
'
Présentation du matériel et des outils
> L'enseignant présente le matérieI de récupération qu'iI met à la
disposition des élèves ainsi que les outits.
Règles de sécurité
§ Les bjets à percer ne doivent pas être tenus entre les mains,
mai its doivent être soit scotchés avec du double face sur une
ptaque martyre en bois ou en ptastique soit enfoncés dans une
grosse boute de pâte à modeler.
;
I
eonsigne
> À t'oide du motériel que vous voulez, construisez une voiture.
Réalisation des êtèvcs
a. Les élèves vont se construire un véhicule avec ['aide de ['enseignant qui aidera au perçage des
boîtes en plastique ou en métal et à [a découpe des piques à brochette.
Constations
nc le véhicule ne peut pas router.
> Sur d'autres, ce sont les essieux qui sont fixes. Si les roues tournent, ceta n'est pas grave mais
souvent les essieux ne sont ni paratlètes ni à [a même hauteur du sot.
Træee
é*rite
+ Une affiche est rêalisée. Etle tiste tout ce qu'iI faut respecter lors de la fabrication pour que
le
véhicule puisse router.
. eo,-*
\,rüe roti),e,
u
?*u
'"*t-. t*+
>"0,,^
"'*»
der-
,
?^
,t
236
ebùpuî) ?-"
"oo;.r--
c,ùL\,oh -dLto, Q*o
, .t ;,Lt
dnue,r,f
,* t o d^"wnL
lh'c,^so,odenL 0"*
, r,rcu"ru-, L^t»
(ô
ianvier*luin
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8Ér-Èves
zo à 3o minutes
CHAqUE pRoBLÈME TECHNteuE FAtr L'oBlET o'ut nrrLreR otnrcÉ.
CnneuE ÉrÈve pARTtclpE À uru oes ATELIERs.
CHAQUE ATELIER sE TERMINE PAR LA RÉDACTIoN D,UNE AFFIcHE PERMETTANT À L'rNsrMeLe ors ÉrÈves DE pouvotR nÉsouone rous LEs
pnosLÈrvlrs rEcHNteuES nrtcorutnÉs.
> Pour chaque atelier, [a démarche est [a suivante.
Rappel du problème
> Les é[èves verbatisent [e problème qu'il faut résoudre.
Recherche de solutions
> Propositions des élèves.
> Les étèves testent les sotutions proposées.
*
Choix
> Le groupe choisit [a solution qui Iui semble la plus efficace.
Trace écrite
> Sous la dictée des élèves, ['enseignant rédige une affiche
permettant à tous les êlèves de mettre en æuvre [a solution
ch
oisie.
Atelier r
> Comment foire pour que les essieux soient porollèles
entre eux et perpendiculoires à lo longueur du chôssis
Atelier r
?
> Les êlèves diront bien droits. Traçage avec gabarit, calage
sur des rectangles de carton prédécoupés, calage avec des
boîtes d'attumettes...
Atelier z
> Comment foire pour percer les roues-bouchons bien ou centre
> Observer les bouchons et faire remarquer le point centraI
?
un peu ptus foncé, en pointe, dû au mode de fabrication
des bouchons.
Atelier 3
> Comment faire pour que les roues soient à lo même hauteur?
Là encore, utitiser des gabarits de traçage ou de perçage.
ATELTER
Atelier
2
Atelier
l
sennr-oinrcÉ
oE6À8ÉlÈvEs
30 à 45 minutes
*
Matériel
ldentique à celui de ['étape z
> Avec [e support des affiches, ['enseignant interroge [es étèves sur [es êléments à respecter pour
que le véhicute route correctement. lI s'enquiert de [a mise en ceuvre des sotutions choisies.
Consigne
> Construisez un nouveou vêhicule
en
corrigeont les erreurs gue vous ovez faites lo première fois.
Réalisations
> Chaque élève refait une voiture en corrigeant ses erreurs à t'aide des sotutions techniques trouvées.
Les obiets Les objets
roulants
::::::.=
ATELIER DIRIGE
30 à 45 minutes
*
Matériel
Par élève:
- le matériel de [a fiche
de construction 3
t Pour le groupe:
- gabarits (DVD-Rom)
- les outits de [a fiche
de construction
- fiche de construction 3
(DVD-Rom et coffret)
'
Érnpr qBls RÉALrsATloN D'uN vÉHtcuLE
EN sutvANT uNE FIcHE DE
coNsrRucrloN
M5'GS
Présentation
> L'enseignant amène une petite voiture en carton.
Questionnement
> Cette petite voiture respecte-t-elle toutes les règles gue nous ovons trouvées ?
Quelles sont les solutions techniques utÎlisées?
Les essieux sont libres et sont glissés à l'intêrieur d'une poille sous le chôssis, les 4 roues sont donc
à lo même hauteur. Les poilles sont scotchées de part et d'autre d'un rectongle de carton, les essieux
sont donc parallèles.
Présentation de ta feuille de fabrication
> En commentant tes photographies de ta feuille de fabrication, les étèves anticipent [es différentes
étapes de [a fabrication.
Réatisation
> Les étèves réatisent teur véhicute en suivant les différentes étapes des feuiltes de fabrication.
llenseignant est avec [e groupe qui réatise [e châssis. Les autres étèves, en autonomie, décorent
Ia
carroSse fle.
> L'assemblage carrosserie et châssis doit se faire en atelier dirigé.
{
lL Esr posstBLE D'uflLtsER DEs pHorocoptEs DU GABARtT DE LA cARRossERlE.
238
@ mars'1uin
CLASSE ENTIÈRE
SALLE DE MOTRICITÉ
30 à 45 minutes
Matériel
- les voitures fabriquées
lors de l'étape 5 ou 5 bis
Frésentation
> Maintenant que chacun a une voiture, I'enseignant propose la tenue d,une course.
Qu
estionnement
> Que nous faut-il foire pour orgoniser une course de voitures ?
ll nous fout une ligne de déport, une ligne d'orrivée, un drapeou de course, un trophée, une coupe.
> L'enseignant introduit les mots concurrents, courses éliminatoires, finale.
eou rse
ATELIER AUTONOME
4 À 6 Ér-Èvrs
10 à 15 minutes
Matér!el
- des Duplo techniques
ou du matérieI
de construction avec des roues
PROLONGEMËFIT
Construction de véhicules en matériel modulaire
> Si la ctasse ou ['école possède du matériel de
construction (type Lego, Meccano), iI est possibte
de construire des véhicutes avec pour consigne de
retrouver tous les éléments d'une voiture.
Les obiets Les obiets
roulants S§§
UI
ltJ
É
o
Concevoir un mode de propulsion sans contact
'r I z'
DÉCOUVR§R
10 à 15 minutes
r ficelle de la longueur
du tabteau
tE
(-)
DÉFi
Situation déclenchante
> Maintenant que nous avons des petites voitures ie vous propose un défi: ilvofolloirquevotre
voiture roule sur ou moins deux mètres sons que vous ne lo touchiez,
> Expliquer [es mots non compris: défi, mètre, ou motns.
> Exptiquer que deux mètres correspondent à peu près à la longueur du tabteau et découper une
ficelte de cette [ongueur qui servira d'étalon de [a classe.
Questionnement
> Avez-vous compris le défi 7
Quels sont les mots que vous ne connoissez pas?
Défi, mètres.
Questions des élèves
> Peut-on lo pousser, la lancer, lui donner de l'élan ? Non, vous lo poserez sur lo ligne de déport et vous
devrez lo lôcher.
> A-t-on le droit de modifier notre voiture ? Oui, vous pouvez oiouter des éléments qui doivent être
faciles à trouver en closse ou à lo moison.
> A-t-on le droit d'utiliser d'outres choses en plus de la voiture? Oui, mois là encore il faut gue ce soient
des obiets lociles à trouver et monipulobles sans donger.
{sl{eEPïiü§,r s˧ §À§PssiT!§5 $Ë FÀÇü$i §N§!V!SܧLLE
30 à 45 minutes
RecueiI des hypothèses
Par élève:
- r feuitte
- 1 Crayon
> L'enseignant demande aux élèves s'ils ont des idées.
> Propositions diverses.
Représentation des idées
> Dessinez-moi votre îdée.
> Les élèves dessinent. Une fois terminé, ['enseignant tégende [e dessin sous [a dictée de t'êlève.
6ù
1.!
JI "
ô
ha
û a II oaa
i:,*,.-..1.
G
CüN§TITUT§SN $˧ §R§UP§§ S§
15 à 20
minutes
r
feuilte
iL
{rnstât*ti*:'is
s
- r styto
TR
L'enseignant regroupe les desslns représentant des solutions proches: plan inclinê, souffler sur
Ia voiture avec ou sans aide de ventilateur ou autre, aimants, guidage par un fit, ballon, moteur,
té[écommande.
Èiir:rinali*n des solutie*s impossib{ss à réaliser
> Par la discussion, I'enseignant amène [es êtèves ayant imaginé des sotutions impossibtes ou trop
comptexes (moteur êtectrique, tétécommande...) à abandonner [eurs idées et à se rattier à un
groupe de solutions ptus réalistes.
fomm+nds du *etérlei nâeessairs ii lhaque group
> Chaque groupe constitué se met d'accord sur un dispositif. lI commande. en dictée à ['adulte, le
matériel nêcessaire à sa réatisation. Une même sotution peut être suivie par ptusieurs groupes.
â4$
FRÊSENTATIOI{ Du DÉFI
3o à 45 minutes
-l'étaton de la ctasse
-: voiture
- le matériel commandé
Iors de L'étape précédente
!nsialtati*n
> Mise en ptace de ['espace permettant aux groupes de passer et de retever te dêfi
Fassage des grouües
§ Chaque groupe passe et essaie de relever le défi.
Contrôle
> L'enseignant vérifie à t'aide du mètre étaton.
Questions
> L'enseignant et/ou les autres étèves demandent des exptications si nécessaire.
STRUCTTJRÀTIOii ET TRACE ËCR.ITE
15
minutes
Bi{an
> Chaque groupe étant passé, les solutions trouvêes sont Iistées au tableau.
- des photos prises
lors de l'étape précédente
Traee éerite
dp /:D r,Àt)æb h^rrÎ"Urt l"*]"",,rlouÀ,
"fj* r,"^J*
ttt
=ni,b,
otratnL
,t ,
thq
b-,i,"1o
0- .*,f,-*
ca,rnrta;',æ 0.
"-.-^".,
r*ÿ- ,l-r--,r-
9.,-,.- ,! b
0"-
nnt»
o,uornb.
a*ar-'N-,
,r-J
n-&-nbp
A-W
r--ÿ""
A- B.'a*U***.l
""^r,-^- "r,
TEXIQUE
Les obiets Les obiets roulants
OUVRAGES AUTOUR DES VÉHICULES
q
itu re
§
§
§
(,
@
@@@
Ma voitLtre
Vroum ! Vroum
B.\,ron gaitcn lcl L'écoie des
@
!
icisirs.2oo2.11,20€
Sam présente sa voiture. Les iltustrations
très graphiques et colorées de Byron
Barton rendent cet album documentaire
très vivant.
Un imagier des moyens de locomotion.
Chaque page présente un moyen de loco-
François Delebecque
Les voitures
Aurélie Sarrazin, Didier Balicevlc et Robert Barborini
motion sous [a forme d'une sithouette en
O l\4itan . 2014.11,9oeUne encyclopédie de l'automobite en quatre
chapitres: [a vie d'une voiture, sur [a route,
les modètes de voitures, [es sports auto-
ombre chinoise.
mobiles.
@@@
@@
@
La viei[[e guimbarde
Mes p'tits Docs: Ies voitures
Phyltis Root et
lill Barton
@ l(aleidoscope
. zoot. tz,7o€
It fait très chaud, papa emmène ses trois
enfants se rafraîchir au bord du lac à bord
d'une vieille guimbarde dont chaque étément tombe en panne ['un après ['autre.
5téphanie LedJ et Didier Balit evic
La vie d'une voiture itlustrée du bureau
d'études à [a casse. Les différents usages
Le garagiste
Pascaie de Bourgoing O Laliigram
" 2c04 " 7,5o€
Une journée de la vie d'André [e garagiste.
Toutes les facettes de ce mêtier sont abor-
dées: Ia réparation, ['entretlen, la vente.
des véhicutes sont abordés.
JEUX AUTOUR DES VÉHICULES
@
@@@
Puzzle en bois à boutons Véhicules
Magnéti'book - Bolides
@ Métissa & Doug Ref.
r9o5r.
À partir de 5,99€
Un puzzle à encastrement de huit pièces
en forme de différents véhicutes avec une
image sous chaque pièce.
O Janod ref. )05518 . À partir oe r5,99€
Un jeu individueI de cinquante magnets
pour reconstituer différents véhicules sur
un décor aimanté à t'aide de dix-huit cartes
servant de modèles.
@@
Puzzte vilie avec miniatures
. P' partir de 35,1o€
O Sevi ref 8z6:4
Un puzzte géant de cinquante-quatre pièces
pour construire et animer un grand circuit
avec miniatures en bois: huit véhicules,
cinq panneaux de signatisation et cinq
pe rso
n
nages.
E
Notions pour ['enseignant
244
Trucs et astuces
245
Accrochez-vous !
Les p'tits pêcheurs
,--iii lI avance tout seull
246
250
253
256
Ouvrages et jeux autour du magnétisme
258
Pôle position
Les notions abordées
" les propriétÉs des ainnants
.
Les caractÉristiques des nnatêriaux
attirés par les ainnants
"
.
Les pôles nragnétiques
fattraction à distance
{
La'ai
La puissance
> Un aimant
est
> Les aimants ont des puissances différentes. La force d'adhérence
d'un aimant dépend de [a surfacê'de contact, de son champ magnétique et de [a distance à taquelle it agit. Ptus un aimant est
gros, ptus iI est puissant.
rro-magnétique.
L'aimantation
> Un objet contenant du fer, du nickel ou du cobalt peut être aimanté par contact avec un aimant.
Les propriétés des aimants
La désaimantation
L'attraction
> Un aimant peut se désaimanter sous l'effet de [a chaleur ou d'un
> Les aimants interagissent avec toute matière contenant du fer,
du nickel ou du cobalt.
Les pô[es
> Les aimants sont formés de deux pôtes, appelés pôle sud et pôte
nord. Les pôles de mêmes noms se repoussent. Les pôtes de
noms contraires s'attirent.
ch
oc.
Quetles pièces de monnaie contiennent du fer
ou du nicke[?
> Les pièces de monnaie de t, z et 5 centimes contiennent de
l'acier et eltes sont donc attirêes par les aimants.
> Les pièces de r et 2 euros contiennent de l'acier et du nickel et
sont donc attirées par les aimants.
> Les pièces de ro, zo et 5o centimes sont un altiage de cuivre, zinc
et atuminium. Eltes ne sont pas attirées par les aimants.
nord géographique
Pôtè sud
Les caneftes et les aimanG
> Les canettes ne sont pas toutes dans le même attiage. En aluminium, etles ne sont pas magnétisables.
> Pour savoir si une canette est magnétisable, te ptus simple est
d'essayer avec un aimant. Mais si vous vous posez [a question et
n'avez pas
à disposition, seules les canettes possédant
d'a
[e pictogramm
seront attirées par les aimants.
11
> Une boussole est un aimant monté sur un axe. llaimant s'aligne
sur [e champ magnétique terrestre. Le pôte nord de [a boussole
est attiré par [e pôte sud du champ magnétique terrestre.
Ce
pôte sud correspond au pô[e nord géographique et par souci de
simptification est appelé pôle nord magnétique.
e* qu§ s§*È sssss ËssbËè §
s Èas ü'ch:iatie a;.riiç;1.
s i'utli!saiicn cjes i+rn-'1ss::is-ii§c:.rçs,:-l:i ôii::i.ri eii:ie
:i:tie
344
,.:u ne
criie
ij-i,
È11
i:-rgue è .l=i:.i]!i.
*l î'atii:"t.-u=,:ii i:+l *t;::i=æ,i*:. isi§eS.ùüfin:tt.ri:,it:ii:t:.
ilir ei-:ai:i
Les aimants
vont se différencier par leur puissance et leur forme.
Ii'j"t
ut*untt'
Les feuilles
&§tt
magnétiques
imprimables.
so-us IaPPet-
-iation
§'ao,n*."ialisés
suPerrnognet
de
§ces
Grr- sous ta marque NéodYme'
d'attracforce
ont une
qu'en séParer
Jü ,i*ntt
llfn
'- tl P,ittunte
est difficite et Peut
deui
Drovoquer des Pincements,
À réserver aux adul
;;i;
Pour alimenter un coin
objets magnêtiques
des .ietons de [oto ou bingo
magnêtiques avec ramasse
letons sont idéaux.
lts se trouvent au rayon petits
jeux des grandes surfaces
ou sur lnternet.
Autour de 4 €.
Les rubans
magnétiques
adhésifs.
ou
Comment assembler
un aimant à une autre matière ?
Pour les aimants en plaque, utitiser l'adhésif
double face. ll existe des ptaques adhésives.
Pour les autres aimants, aucune solution ne
sera satisfaisante: doubte face ou pistotet à
colte chaude seront des solutions accessibtes
aux élèves mais iI faut savoir qu'e[les ne
tiendront pas dans [e temps.
C'est pour cette raison que [a réatisation
des cannes à pêche du jeu proposé dans la
séance les petits pêcheurs, les aimants utitisés sont des aimants toriques assemblés par
un næud à [a ficetle de [a canne.
Tous ces aimants
peuvent s'acheter
su
en grande
Gê,
chez Hema ou sur
le site Opitec.
Les obiets Les obiets magnétiques
245
t1
F
ul
ACCROCNEZ-VOUS!
É
Découvrir que les aimants attirent
o
|n
ul
J
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
5 à 10 minutes
Matériel
4 à 6 aimants de cuisine
ÉrlpE r
DÉcRrRE ET NoMMER LA F'oN€TioN D'uN AIMANT
Questionnement
> Connoissez-vous cet obiet?
> L'enseignant montre un aimant de [a classe ou un aimant de cuisine. C'est un oimont.
quoi sert-il ? À décorer, à coller des feuilles sur le frigo, sur le tableau.
feuilles sont-elles vroiment collées? Non. Pourquoi ? Porce que quand on colle un obiet, on ne
peut pas le décoller. Avec un aimant on peut changer ce qu'on accroche sur le frigo.
> Donc, un oimont est un objet qui permet d'occrocher des feuilles sur un frigo, sur un tobleou.
Peut-il servir oÎlleurs? Les étèves énumèrent d'autres endroits.
> Comment sovoir si les oimonts peuventvroiment fixer les feuilles là où vous me dites? llfaut essayer.
>À
Les
DEMI-CLASSE
COIN REGROUPEMENT
t5
à
20 minutes
*
Matériet
Par élève:
- 1 aimant
- r feuilte
ÉrApr z mÉcruvntm LEs MATIÈRE§ ATTIRÉEs ou P{tôl PAR LES ÀlffiANTs
Consigne
> Je distribue à chocun un oimant et une feuilte. Vous devez trouver un endroit où vous pouvez occrocher
votre feuille ovec I'oimant. Vous n'avez pos le droit d'utilÎser le tableou. Quond vous ovez trouvé, vous
le laissez en ploce et vous revenez vous osseoir.
Chasse aux endroits possibles
> Les êlèves essaient de fixer ta feuitte en plusieurs endroits jusqu'à trouver un endroit sur [equel
l'aimant est attiré.
Bilan
> Chaque étève décrit les endroits qui n'ont pas fonctionné et l'endroit sur lequeI iI a pu fixer sa feuilte.
> Les interroger sur [es matières des objets.
) 1ur quelles motières ne fonctionne-t-il pos? Le bois, le verre, le plastique, le papier, le corton,
" la poterie, la moquette, le plôtre, le tissu...
> 1ur quelles motières fonctionne-t'il? Le métal, le fer.
À cr suor. Ln oÉsrctntror,r mÉtnr rsr ecceprÉr. 5r LE MoT
FER EST
ur
LtsÉ, Le
nrtErtn
PUISQUE ScIENTIFIQUEMENT lL
EsT PLUS CORRECT
> On dit gue les oimonts sont ottirés por le fer mois pos por les outres motérioux.
> Puisque I'oimant fonctionne sur le tobleou, est-il en fer ? On ne soit pos. Oui, il est en fer mois les
tobleoux sont recouverts d'une peinture ou d'un film sur lequel on peut écrire.
Trace Écrite col{eetive
. Ur," or,,--Lo,rl @n?r^r" d*b?g.ild" hLn [o{rÀ U" J4"^ Apn ,oT i{I
" ù
fl *"**oÀ orbi,r€Jno,h- u* Jaür*r matle,.e». d
tl
pLUs
pAssANT
RApIDE cAR rrs ÉrÈves AURoNT
EN sEcoND, r'ncTlvtrÉ sERA
PouR LE GRoupE
CAMARADEs. LA coNstGNE pEur Êtpe uoorrrÉe: TRouvEz DEs ENDRorrs otrrÉnetrs oe cEux
GROUPE POUR ACCROCHER VOTRE FEUILLE.
246
" û11
eÀr o'lttrh'e
vu
0
Y'e
0
V»
LEs EssAls DE LEURs
rnouvÉs
PAR LE PREMIER
'
(pà
@
ATELIER DIRIGÉE
DE6À8ÉlÈvrs
ro
à 15
minutes
tutèifi:*l
-1 aimant en
§
Ll
- z barquet[es
-pictogrammes aimant
et aimant barré (DVD-Rom)
Au rnoins ro objets métalliqtes:
-clou, vis, écrou
-punaise, épingte
- trombone
-boîte métatlique
mars
""pt"rore
>
juin
+
juin
Érner 3 TRIER DEs oBJETS AVEc DEs ATMANTS
Présentation de I'atelier et des pictogrammes
> Sur lo toble, j'ai disposé une série d'obiets. Vous ollez chocun en choisir deux: un qui sera attirê por un
aimont et un outre qui ne le sero pos. Vous plocez celui qui est ottiré por un oimont dons lo borquette
avec le pictogromme oimont et I'outre dons celle ovec le pictogramme aimant borré.
> Expliquer le pictogramme aimant en faisant circuter un aimant en U et en le positionnant sur [e
tableau par exempte pour montrer que c'est bien un aimant. Exptiquer que c'est souvent cet aimant
qui est choisi pour reprêsenter [es aimants car iI est facilement reconnaissabte.
Hypothèses
> Les étèves choisissent deux objets et [es ptacent dans [a bonne barquette. lts justifient [eurs choix.
- petite voiture métatlique
- paire de ciseaux métatlique
-règte métatlique
- cuillère métatIique
-capsute métallique
- fourchette
- attache-parisierne
- bolte de conserve
- cannette
- pièces de monnaie
§
Au moins to obiets
non méralliq.les:
- bouchons en plastique de
diftérentes tailtes et couteurs
-bouchon de liège
-leuille de papier
- feuille de carton
- carré de coton
- morceau de tissu
- morceau d'éponge
- cuitlère en bois
-cuiilère en plastique
- fourchette en ptastique
- règle en bois
-règle en plastique
- verre
- cannette
Vérification des hypothèses
> Chocun d'entre vous o foît des hypothèses. Vous pensez que I'obiet que vous ovez plocé dons la
borquette ovec le pictogromme oimont sera attiré par I'aimant et l'outre non. Vous ollez vérifier vos
hypothèses ovec un oimont,
> Distribution de différentes sortes d'aimants. Vérification de [eurs hypothèses par [es ê[èves.
-pièces de nonnaie
Bilan
> Les oblets sont regroupés dans deux barquettes selon qu'its ont ou pas été attirés par les aimants.
> Vos hypothèses étoient-elles iustes ? Vous êtes-vous trompé sur un obiet ? Pourquoi ? Je ne connoissais pos cette motière,
je croyois que c'étoit du fer.
Verbalisation
> Faire verbatiser à nouveau que [es oblets en fer sont attirés par les aimants et que toutes les
autres matières (bois, verre, tissu, cuir, papier, pâte à modeter...) ne sont pas attirées.
Les obiets Les objets magnétiques
D EM
I
-CLASSE
COIN REGROUPEMENT
10 à 15 minutes
rÈ1s:ët
-
1 cerceau
i*l
pour 4 étèves
§ Dans chaque cerceau:
au moins 16 objets ou poissons
métatliques
-au moins 8 objets ou poissons
non métattiques
i--i:ll§
ii
i-§§§-
è
** iÈ-:t
Ps
.
MS
Présentation du ieu
> Dans les cerceaux, positionner soit des poissons rêatisés dans différents matériaux (trucsetastuces page fii, soit des obiets divers dans différents matériaux.
> le vois distribuer à chocun d'entre vous une conne à pêche. Décrivez-moi cette conne à pêche. ll y o un
bôton, une ficelle et un aimont. On dÎt une boguette plutôt qu'un bôton.
> Distribuer les cannes à pêche.
> Chocun d'entre vous o une conne à pêche mognétique. Je vous demonde de pêcher le plus de poissons/
objets possÎbtes ovec votre canne. Choque poisson/obiet pêché vous roppofte un point.
Le gognont sera celui qui aura le plus grond nombre de points.
Pêche
> S'its ont bien compris le fait qu'un aimant n'attire que des objets métattiques, [es élèves devraient
n'essayer de pêcher que les obiets métatliques
Décompte des points
> Chaque étève dêcompte ses points pour savoir qui a gagné.
> Discussion permettant un travaiI de numération et sur [a notion de plus grand que.
> Comment ovez-vous foit? Comme les aimants n'attirent que le fer, on a d'abord essayé les obiets
en fer.
ACTIVITÉ INDIVIDUELLE
10 à 15 minutes
È
§sii:r;si
Par élève:
- 1 photocopie (document
page 249 ou DVD-Rom)
- 1 paire de ciseaux
- cotte
ir:r:S:S*§
> Découpe puis colle sur I'oimont les objets qui sont ottirés. Colle dons le ponier ceux qui ne sont pos
ottirés por I'oimont.
PouR LEs PS, res trrusrnnrtoNS PEUVENT ÊTRE PRÉDÉcouPEES
PRûL§ruGEitlET.IT
> Durant Ia séquence, it est possibte de mettre en place un coin sciences magnêtisme avec [e matérieI suivant: une boîte métattique ou non contenant des aimants et des petits objets métalliques
ou non. Mettre quetques bouteittes d'eau avec à ['intérieur de petits obiets de différentes matières
(métaltiques, plastiques, bois...) Ces bouteilles devront être fermées hermétiquement avec un adhésif. Les étèves pourront s'amuser à attirer Ies êléments métatliques au travers de [a bouteitle.
248
CLASSER LES OBJETS SELON LE CRITÈRE DU MAGNÉTISME.
€
ATTIRE OU NON ?
Découpe puïs colle sur ['aimant [es objets qui sont attirés.
Co[[e dans [e panier ceux qui ne sont pas attirés par ['aimant.
E
P
?
I
tn
F
lrJ
EURS
É
o
t le principe du magnétisme
ut
lrl
J
CLASSE ENTIERE
COIN REGROUPEMENT
Étnpe r sÉeRrRE
20 à25 minutes
\§:siS:isi
- r jeu de pêche magnétique
du commerce
- l aimant en U
-
r
-1 barquette
pictogramme aimant
(DVD-Rom)
- 1 gommette ou
r disque en plastique de la couleur
de L'éLément métaLlique
des Poisso^s
È
Dispersés dans [a classe:
- des clous
- des trombones
- des attaches parisienres
-des épingles
- des couverts métattiques
- des boltes métatliques
- des agrates
-des vis
- des écrous
- des petites voitures métatliques
- des ctés
- des ciseaux
[-tN
isus§
UN IEU DE pÊcHE MAGNÉTIQUE
n ÉrÉ pnoposÉ
LA sEl\4AlNE pnÉcÉoeNlr À L'AccuElL'
Questionnement
> llenseignant montre [e ieu de pêche.
> Comment ioue-t-on à ce nouveou ieu
? ll y o des
poissons et des cannes à pêche. ll faut ottraper les
poissons avec une canne à Pêche.
à pêche permet-elle d'ottroper les poissons ? ll y a un truc noir ou bout de la conne à
pêche qui colle à l'æil du Poisson.
> Le poisson est-il vroiment collé à lo conne ? Non. Pourquoi ? Porce que quond on colle un obiet on ne
peut pos le décoller. Là, on peut détacher le poisson de lo conne.
> On dit dans ce cos que l'élément noir ottire l'æil du poisson.
> Connoissez-vous d'autres objets qui fonctionnent de lo même foçon ? Oui, les oimants du tobleau.
> Comment lo conne
u,Évoque LES ArMANrs DU TABLEAU,
FArRE EN
soRrE QU'uNE cANNE DU IEU EN LA MANTPULANT sE
FrxE
:ilï:ili:,".
> eue se passe-t-il dans le jeu de pêche ? ll y o ou bout de lo canne un oimant qui attire les poissons.
> Quelle portie des poissons est ottirée por I'aimont de lo canne à pêche ? L'reil.
> Qu'a de spêcial cet æil? tl est rond, il est doré ou orgenté.
Les étèves décrivent ta partie métattique par sa forme et sa couteur. Sa matière n'est pas citêe.
> Tout ce qui est rond et doré est attiré par les oimonts?
Faire ta démonstration du contraire avec une gommette dorée par exempte.
> Pour trouver pourguoi l'@il est ottiré par les oimonts, ie vous propose un ieu.
Chasse aux obiets qui sont attirés par les aimants
> le vous distribue à chacun un aimont. Essoyez de romener un obiet ovec cet oimant, sans toucher I'obiet.
> par petits groupes, les élèves se dispersent à [a recherche d'objets attirés par les aimants.
Bitan
> posez tous les obiets gue vous ovez ramenés dons lo borquette avec le dessin de l'oimant,
> Expliquer en montrant un aimant en U, que c'est cet aimant qui est choisi pour représenter les
aimants car sa forme est reconnaissabte.
> Quel est le point commun de tous ces obiets? lls sont en fer, métat.
AccEpTER LEs DEUX TERMES, MAts uflLtsER DE pnÉrÉneruce LE Mor FER QUI Esr ScIENTIFIQUEMENT LE PLUs coRREcr
> Que peut-on dire desyeux des poissonsT lts sont en fer.
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
5à
ro minutes
1§=t+T:ri
§'
Pour la ctasse:
-r leu fabriqué par I'enseignant
sans [er sur les poissons
-fiches de construction 4 et 5
(DVD-Rom et coffret)
§ Par étève:
- 1 tirage de la planche
des poissons à décorer (DVD-Rom)
250
Étnpe z ilÉeouvntn LE PRûIËT
MS.Gs
Lancement du projet
>
Nous ollons réoliser des ieux de pêche. Chocun d'entre vous ouro son ieu.
> Que va-t-on devoir fabriquer? Des poissons, des connes, une boîte pour tout ronger.
> L'enseignant montre les fiches de construction et un exemplaire du jeu sans fer sur les poissons.
> Deux élèves instaltent le jeu et essaient de pêcher les poissons.
> Pourquoi n'y orrivent-ils pos? Les poissons n'ont pos d'yeux en fer.
@
@
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8Ér-Èvrs
zo à 3o minutes
:
ù§*t::ri+i
Par élève:
- le tirage du [ond et du couvercle
de la boîte (DVD-Rom)
- 1 paire de ci5eaJx
- des feutres ou crayons de couleur
-
-
r ptioir or
lanvier*1u
n
""o,"rore>jun
Étnee 3 FABRIQIJER LA EoîTË nu lgu
i-.*;ii:l'* $r, is *ei:* $* :::.:=sÈr*:ii*r:
> Les étèves décodent Ies iltustrations des différentes êtapes avec démonstration de ['enseignant.
PouR LE pLrAGE, FArRE TRAVATLLER res ÉrÈvEs EN BrNôME. UN ÉLÈvE
PLIAGE AVEC LE PtIO R.
ttrltt Ln nÈGLe,
LE sEcoND TRACE LA LrGNE DE
:" Bien indiquer qu'iI faut décorer avant de monter [a boîte.
* Pour vous aider, vous pouvez regorder la boîte terminée.
r
règle
r sty[o à bilLe usagé
- adhésif ou colte ou agrafeuse
selon la sotution choisie
§
Pour le groupe:
- r boîte modèle
- fiche de construction 4
(DVD-Rom et coffret)
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8ÉrÈvrs
15 à 20
§
minutes
tuisiri:is i
Par étève:
-r
paille
-2x4o centimètres de
ficelLe
-2
Érnee 3 Brs FAsRrquËR i-§s eANNËs À pÊcmu
Lecturc dc i* ÿi;he d* e*:-:stru*iirr-:
s Les élèves dêcodent Ies illustrations des différentes étapes avec démonstration de l'enseignant.
fÉTAPE UN PEU CoMPLEXE EST L,ENFILAGE DE LA BAGUETTE DANS LA PAILLE AVEC LA FLCELLE EN DOUBLE
s- Indiquer aux élèves que
c'est normal que ce soit un peu difficite pour que te montage tienne bien.
baguettes
2 aimants
x- Pour le groupe:
- fiche de construction 5
(DVD-Rom et coffret)
SI LES ÉLÈVEs
NE SAVENT PAs FAlRE DE NGUD, IL FAUDRA QUE L,ENSEIGNANT LEs FASSE oU QU,UN ATEL ER D,APPRENT]S
SAGE DES NGUDS SOIT MIS EN PLACE A UN AUTRE MOMENT
Les obiets Les objets magnétiques
I
ATELIER DIRIGÉ
DE4À6ÉlÈvrs
zo à 3o minutes
Ssi§tis{
§
Pour Ie groupe:
des prototypes de poissons déjà
découpés
- ro aiguilles
- ro trombones
- 10 attaches parisiennes
- ro rondeltes en fer
-de t'adhésif
-
3 à 4aiguiltes de piquage
ou ctous
- 3 à 4 sandwichs de carton
-colte
*
Par étève:
- 1 rectangle de papie' cartonné
par porSson
-
r
paire de ciseaux
- des feutres ou des crayons
de couteur
- r planche de poissons
(DVD- Ro m)
LES potssoNS pEUVENT ÊTRE oÉconÉs
pr oÉcoupÉs
EN
AUToNoMtE
nvnut cette
§appsi §s s:i**l§s."*
> Que monque-t-il à nos poissons pour pouvoit être pêchés ?
D
Étepe.
u fe r.
§rr-sii §ss -**i-ii**s
*
Avez-vous des idées pour ajouter du fer sur notre poisson ?
Si les élèves n'ont pas d'idêe, leur rappeler [a chasse aux obiets qui sont attirés par Ies aimants.
> Laisser Ies élèves proposer des solutions qui pourront être:
- scotcher un trombone, une rondelle, une aiguille ou un clou sous le poisson,
- faire deux poissons, les coller I'un contre l'0utre en cachant un trombone entre les deux,
- mettre une ottoche porisienne à lo pLace de l'æil.
ÿi_*iùiiis§_i
s
Les élèves réalisent les sotutions qu'its ont proposées.
PEUT sE posER rr pnoerÈI\^ e DU pERÇAGE pouR iitETTRE L'ATTACHE pARtstENNE. PRoposER L'urLrsATroN DE L'ATGUTLLE DE
ptquAGE ou DU cLou suR uN 5ANDWtcH DE cARToN (vorn Tnucs ET ASTUcEs pAGE 13).
Tests des solutions et choix
> Les poissons réalisés sont testés avec les cannes à pêche. Une solution est choisie.
Anticipation de [a fabrication'
> Mointenont que nous sovons comment nos poissons pouûont être pêchés, que devons-nous foire pour
fobriquer nos poissons? Découper les rectongles autour des poissons. Percer les yeux si nécessaire.
Positionner l'attache parisienne ou scotcher le trombone, l'aiguille, lo rondelle, le clou sous le poisson.
Coller le poisson sur
Ltn
rectangle de papier cartonné. Découper le contour du poisson.
> L'enseignant fait [a démonstration de chaque étape en fonction des verbatisations des élèves.
PENDANT
r'ncrrvrrÉ oes ÉrÈves,
L'ENsETGNANT pEUT ALLER vÉntÉen re TRAVATL DES AUTRES ATELTERs
Consigne
> Une fois votre ieu terminé, vous pouvez I'essoyer.
Quond vous ourez fini de jouer, vous rongerez
vos poissons et les deux connes à pêche dons
votre boîte.
252
t-i5 csiÈrs MAcfi EI!t:iËs
tn
F
ul
LE POSITION
E
o
|n
ltl
J
ATELIER AUTONOME
À
l'lccuet
i:::isii.tii,r-.;':
Matériel
le petit train magnétique
s
Un des coins jeux de la classe est remplacé par un coin petittroin
avec un train magnétique.
§s-il: t-:istis* s
s
Les êtèves assembtent, jouent avec Ie
train et le maniputent pen-
dant une semaine.
DEMI.CLASSE
COIN REGROUPEMENT
r5 minutes
Sei*ri=i
le petit train magnétique
- 2 attaches parisiennes
-z
- z clous
punaises de tapissier
- z aimants
-r affiche
Questionnement et hypothèses des élèves
> Comment ossemblez-vous le petit troin ? On approche deux wogons: ils sont soit attirés, soit repoussés.
> S'ils sont repoussés que fout-il foire ? ll suffit de retourner un des deux wagons.
> Quel élément du wogon permet d'occrocher les wogons entre eux? Le truc gris qui est des deux côtés
des wagons.
> Qu'est-ce que celo peut bien être? Une punaise, un clou, du fer, un aimant...
> Commentvêrifier? En prenant deux fois le même objet pour voir s'ils s'ottirent et se repoussent.
Manipulations
> Les étèves testent chacun à leur tour les différentes propositions. lI n'y a que des aimants qui
s'attirent dans un sens et se repoussent dans ['autre.
-
ATIENTIoN À NE PAS PRoPoSER nux ÉrÈvEs DEs AtMANTs rRop putssANTs AVEc LEseuELs tLs poURRAtENT sE ptNcER
Seconde investigation
> Comment être sûrs que
ce sont bien des oimonts? Que sovez-vous sur les oimonts? lls attirent le
métol, le fer. lls servent à accrocher des feuilles au tobleou.
> Comment vérifier que ce sont bien des oimonts qui sont oux extrémités des wogons? En essayont de
les accrocher ou tableau, en voyant s'ils attirent du fer.
> Les êtèves approchent [es wagons du tabteau et de différents obiets métattiques pour voir s'its
s'attirent ou non.
ConeIusion
. Â" û-,J oeb
. 9-, *,
n nnr
L,or.o4rô.
v
lu
,l ,* o dn» ù^ûrth
.o,,, .nî*
o,-..
A y-W"
d-r,
ylrr,
d^ f^
5otü?h.d
o!
\€
Les obiets Les objets magnétiques
CLASSE ENTIERE
COIN REGROUPEMENT
10 à 15 minutes
Matériel
r jeu de dominos magnétiques
réatisé par l'enseignant
Érner 3 DÉcouvRtR
LE pRoJET DE FABRtcATtoN
PréSentation du ieu
> Mointenant que nous sovons quel est le secret du troin, ie vous propose de fobriquer un iouet utilisont
le même principe.
> lJenseignant présente tejeu de dominos magnétiques et fait jouer [a classe en distribuant un
domino à chaque élève. Tous ne peuvent en avoir, ce qui donnera du sens à [a réalisation d'autres
dominos.
> Le doubte noir commence et vient poser son domino devant [e tabteau. Le jeu se joue ensuite
comme un leu de dominos mais it y a la contrainte supplémentaire que les deux dominos que l'on
apparie doivent s'attirer. Pour [e doubte noir, n'importe quel autre domino ayant une moitié noire
conviendra mais soit d'un côté soit de l'autre. lI y aura ainsi des dominos qui ne pourront s'apparier. Le domino arc-en-cieI joue [e rôte de ioker.
>
>
posse-t-il ? Au bout des bouchons il y a des aimonts. Soit ils s'attirent,
comme dons le troin.
Nous ollons fobriquer un outre ieu pour que tout le monde puisse jouer.
Que se
soit
ils se repoussent
Liste des é[éments nécessaires
> De quoi ovons-nous besoin pour fobriquer ce ieu ?
> Les élèves listent [es différents étêments du jeu. L'enseignant, à chaque élément nommê, montre
t'étément, écrit [e mot au tableau et fixe l'étément à côté du mot.
254
ATELIER DIRIGÉ
DE4À6Ér-Èvrs
40 à 45 minutes
§{:t§risi
- 16 bouchons en liège
- 3: cLors longs de tapissier
32 aimants toriques de r8 mm
de diamètre
- scotch de 5 couleurs
- gommettes rondes
- ctseaux
- marteau
-pistolet à colLe
- fiche de construction 6
(DVD-Rom et coffret)
@
Émpe +
FABRTQUER EN
sur\rANT UNE FrcHE DE coNsrRucnoN
Lecture de la fiche de construction
> L'enseignant met en évidence les différentes parties de [a fiche (DVD-Rom et coffret). Les étèves
ve rbalisent.
Fabrication êtape par étape
> Chaque groupe prend en charge [a réatisation d'une étape.
LES
cLous
DE
TAp ssrER sE TRouvENr DANs LES GRANDES suRFAcEs DE BRtcoLAGE (ENvrnor
5€
rES 50 iLous)
fabriquons de5 dominor masnéilquesl
PROLOi{GEMENT
> Des ieux de construction utilisant le même principe peuvent être mis en ieux [ibres pendant et
après la séance.
> Possibititê de réaliser un petit train magnétique en utilisant Ies châssis des petites voitures (voir
page 238) en remptaçant Ia carrosserie par des boîtes de récupération dans lesquettes seront fixés
Ies aimants à t'aide d'adhésif doubte face.
Les obiets Les objets magnétiques *:i=§\
(,
F
EI
IL AVANCE TOUT SEUL!
É
o
Trouver un mode de propulsion
U
Bâ{GqJv§8R L§ *ÉFI
10 à 15 minutes
- 1 boîte de ramettes évidée
sur les 4 cotés
- r labyrinthe plastifié fixé
sur [a boîte (DVD-Rom)
- 1 personnage
Pour crêer des labyrinthes
Le logicie[ [ibre Labygen est un
générateur de [abyrinthes paramétrabte qui permet de créer des
tabyrinthes de comptexité progressive, de les sauvegarder sous forme
d'images et de les imprimer. Auteur
Christian Vinent de ['académie
de Poitiers.
Situation déclenchante
> I'oi trouvé un ieu dons lo classe moÎs il mongue
des éléments. le vous mets ou défi de le réporer.
Description du leu
> Décrivez-moi le jeu. ll y a une boîte. Dessus il y a
un lobyrinthe et un personnoge.
> Le personnage peut être un jouet de la ctasse,
un pion d'un des ieux de [a ctasse, un personnage découpé dans du papier cartonné et cotlé
sur un bouchon plastique ou même un simpte
bouch o n.
> le connois lo règle de ce ieu: il faut que le personnoge posse d'un côté du lobyrinthe ô l'outre
mois le ioueur n'o pos le droit de toucher le
personna9e.
§*e:tit*::**:s*i
* Avez-vouscomprisledéfi? Lepersonnogedoitpasserd'uncôtéàl'autredulabyrinthesonsLetoucher.
l*Nt§FTl*l{ §sS *!§Fe,§lÏlr§ *§
30 à 45 minutes
§Àǧl§
tsùlvê§UÈlt=
Recueil des hypothèses
> L'enseignant demande aux étèves s'ils ont des idées. Les é[èves font différentes propositions.
Pour Ia classe:
-r affiche
Par élève:
- r feuitle
- des crayons de couleur
Représentation des idées
> Dessinez votre idée.
> Les étèves dessinent. Une fois [e dessin terminé, ['enseignant le [égende sous la dictée de t'étève.
LES soLUTtoNS LES pLUs souvENT pnoposÉrs soNT LE souFFLE, LE vENTtLATEUR, UNE FtcELLE, UNE TELECoMMANDE, uN
MorEUR, LEs ATMANTS . Souvrlr, tLS ouBLtENT eu'L NE FAUT pAS eu'uN ATMANT MAts eu'tL FAUT AUSST uN ÉLÉMENT
IVIETATLIQUE.
Constatations
> L'enseignant regroupe les dessins montrant des solutions proches: souffle, ventilateur, ficelle, aimant...
Élimination des solutions impossibte à réaliser
> Par Ia discussion, ['enseignant amène les étèves ayant imaginé des solutions impossibles ou trop
complexes à abandonner [eurs idées et à se rallier à un groupe de solutions ptus réalistes.
Commande du matérie[ nêcessaire à chaque groupe
> Chaque groupe constitué se met d'accord sur un dispositif et commande en dictée à t'adutte
te
matérieI nécessaire à sa réatisation. Une même sotution peut être suivie par plusieurs groupes.
256
§TLËV§§ L=
30 à 40
minutes
matériel
ÈN
§*+UF[
sariBui*Èi**s
s
Ie
sÈï:
Les étèves sont regroupés selon Ia solution technique choisie.
commandé s chaque
groupe rêatise les solutions imaginées. ll est souvent nécessaire de faire ptusieurs essais
par chaque groupe
LES SOLUTIONS AUTRES QUE MAGNÉIIQUES SoNI ÉLIMINÉES AU FUR ET A MESURE CAR IL EST MPoSSIBLE DE iÀ R:
CHEMINER LE PERSONNAGE DANS LE LABYRINTHE DE FAÇON PRECISE.
PLUStEURS soLUTtoNS [,tAGNÉTteuEs soNT posstBLES: ATMANT + ELEMENTs METALLteUES. ATMANTS EN ulL sANT
PRINCIPE DE REPULSION.
i--r§g-:1;;3;3n,,
ris ir: *r:-i:srisi:+-
*- r!*i
> L'enseignant interroge [e groupe sur [es différents essais effectués et sur ['exptication de [a solution finale. Le point de départ de l'interrogation peut être Ie dessin initia[.
..=
fenseignant peut écrire le texte de Ia présentation sous Ia dictée des étèves.
Èi.::c ii.r,'
i< i;
>.;.;,:,"-:; :.
s
Les ê[èves répètent Ieur présentation.
s
Ceta peut donner une présentation de ce type, à plusieurs voix: Notrepremièreidéeétoitdesouffler sur le personnoge comme nous avons dessiné. Nous ovons essayé mais iltombait à chaque fois
et nous n'arrivions pas à le diriger dans le labyrinthe. En jouant à la pêche mognétique, nous ovons
pensé aux aimants. Mais un oimont seul ne foisoit pas bouger le personnage. On o olors pensé oux
attaches parisiennes qui sont sur les poissons. Nous avons scotché une attache sur le personnoge et
là avec l'oimont nous arrivons à le diriger. Mais c'est difficile cor l'attache est attirée por I'aimant et
s'attache à l'aimant donc on touche Le personnage et nous n'ovons pas le droit. 5i on met l'oimont sous
la boîte, ceLo morche aussi et là on ne touche pas le personnoge.
ÿR§§IN:'ÀT:L}S §lJ Ù§§:
4x10 minutes
- les jeux [abriqués
lors
des étapes précédentes
A PRÉVOIR SUR UNE SEMAINE CHAQUE GRoUPE PREsENTE SA SoLUTIoN A LA CLASSE SUR UN TEMPS DE
Fassage des groupes et questions
> Chaque groupe fait sa prêsentation orale, une dêmonstration du
REGRoUPEMENT
d
> TravaiI sur le repérage dans ['espace avec [e labyrinthe du jeu
Les obiets Les objets magnétiques
OUVRAGES AUTOUR DU MAGNETISME
(9U9§y
6à éà
@@@
tr^"---;
, c! trG!tu
jrsé Pai:'ondo O Éditions ciu Rcuergue o 2oc5 . 11 €
Fernand attire toutes sortes d'objets en
fer avec son aimant: des épinards, un fer
à chevat, une armure... Mais pour séduire
Jen n ifer, pas besoin d'aima nt
Boucle d'or et les trois ours
Lucie Brune[[ière @ Milan
Joue avec les contes
. 2014. 13,9o€
Lucie Bruneltière @ Mitan
.
2013
.
76,50
€
Les vingt-cinq aimants permettent
Les soixante aimants des personnages et
de raconter ['histoire connue de tous.
décors permettent de raconter plusieurs
contes connus mais aussi d'en créer de
nouveaux en les mélangeant.
!
JEUX AUTOUR DU MAGNETISME
Puzzle magnétique
@ MéLissa & Doug ret. 13278
.
A partrr de g,g8€
Un puzzte avec dix animaux de
[a mer à attraper à l'aide d'une
canne à pêche magnétique.
Enm#
Jeu de pêche magnétique
@ Goula ref.
@@@
@@@
@@@
@@
53412. A partir de 10€
jeu de pêche est constitué
d'une base de jeu, de deux
cannes à pêche et de douze
Ce
Train magnétique Litlabo
O lkea. A partir de 12,99€
Des raits et un train en bois
dont les wagons s'accrochent
grâce à des aimants.
poissons aimantés.
6s) 6à
6à
\_-/ \_-/ \_-/
§,
Funny Magnet Robots
Megnetico
Smartmax Réf. SMX3or
À partir de zz€
À ta façon d'un pête-mête,
ce jeu magnétique comporte
quatre robots en trois parties
magnétiques à décomposer,
métanger, reconstituer à t'infini.
triques de couleur aimantées
et vingt-quatre cartes modètes
4
@@@
@ Janod.
Géoformes
O Dleco . À partir de 3o€
Un coffret en bois contenant
quarante-deux [ormes géomé-
O (lein . À partir de 4o€
La reproduction à t'aide de
modètes ou ['invention de
constructions à l'aide des étéments seton un mode d'assem.
blage magnétique.
@@
Magformers 30 pièces
Des bâtons et des boules
. À partir de 4o€
Des formes géométriques
magnétiques pour construire
des objets.
évldêes et aimantées pour
construire des votumes.
Coffret de z5 pièces
.
À partir de 3S€
@ lMagformer
LES OBJETS
Le obj et
en équ llbre
:-dtÈ-Efi-IjrFr.-
Notions pour l'enseignant
z6o
Trucs et astuces
z6t
Les culbutos
Les p'tits Catder
264
Questions d'équitibres
267
Ouvrages, ieux et balances autour de l'équilibre
270
z6z
--
.l-es équiiibres stahle et instabte
.
.
.
Le centre de gravité
Le pivot
Le lest
Centre de grav§trê
Stable ou instabte
> Tout corps possède un centre de gravité. C'est en ce point que
> Un élément est dit en équitibre stable quand, une perturbation
l'ayant dêséquitibré, it retrouve automatiquement sa position ini-
s'apptique te poids.
> Pour un corps homogène, [e centre de gravité se trouve en son
centre. Pour un corps hétérogène, le centre de gravité se trouve
déptacé vers la partie [a ptus lourde.
cENTRE DE
cnlvrrÉ os euELeuES
Cercle
tia le.
> Quand t'étément ne revient pas dans [a position initiate, on parle
d'équitibre instable.
HGURES
Triangle
Rectangle
\.-tl
G: centre
du cercte
?
a
/
Éeurr-rsnr srnsLr
G: intersection
G: intersection
des diagonates
des médianes
Éeurr-rsne
TNSTABLE
> Pour qu'un sotide soit en équilibre stable, i[ faut que [a verticate
passant par son centre de gravité tombe
à
['intérieur de sa base
de sustentation.
posÉ À
pur
suR
posÉ sun LE cotN D'uNE TABLE
UNE TABLE
La verticale
(direction du fil à plomb)
passe par
G.
En bleu [e polygone
NE TOMBE PAS
de sustentation:
la surface d'appui
BASCULE ET TOMBE
G: intersection
des médianes
Ëquitibre de leviers
Qu'est-ce qu'un équilibre
?
> Un corps est dit en équitibre quand les forces qui s'exercent
lui se compensent.
> Dans [e cas des mobiles ou des balances, t'équitibre se fait entre
deux forces s'exerçant de part et d'autre d'un pivot.
> lJéquilibre dépend des masses des deux objets suspendus ou
posés sur [a balance et de leur distance au pivot.
Ml
M2
Plaleau
Fléau
Ftéau
Plateau
,
> À ta position d'équilibre, les fléaux ou bras de leviers sont horizontaux et Mrxdr = Mzxdz.
260
difficulté est l'ossemblage des suspensions au mobile.
lo ficelle
à la baguette.
Lo
llfaut assembler I'objet suspendu à la ficette puis
Liaison fiee{Le-ob!et
À moins que les étèves
aient appris à faire des
næuds, il est plus simple
d'utiliser une des techniques suivantes permettant d'assembler un objet
à de la ficelle sans avoir à
faire de næud.
Un morceau de carton
ou de plastique ondulê
dont [es gaufres sont
un peu plus petites
que [e diamètre
de [a baguette.
Un morceau de mousse
Liaison fiee[[e-baguette
Pour que ce soient les élèves qui
équitibrent les branches, il faut
que les suspensions puissent être
déplacées sur les baguettes et
tiennent en ptace même quand [a
baguette penche d'un côté. pour
cela, il faut un étément de liaison
entre [a baguette et la suspension. Cet élément va pouvoir
coutisser sur la baguette mais
rester en position même quand
la baguette est penchée.
ou de plastique soupte,
type intercalaire de
ctasseur ou pochette
souple, percé de z
trous, its sont
du diamètre de ta
Le perçage destiné à la
baguette doit être de
diamètre très inférieur
à celui de [a baguette
pour permettre
[e coulissage dur.
Fabriquer [a bascule
d'un tout petit
coup de main
Matériel: bouchons, carton
ondulé, pique à brochette,
écrou, autoagrippant,
adhésif doubte face.
comment réaliser [es personnages pour gue I'histoire puisse être rejor:ée?
mass
c
basculer
La
moins
batance
léphant doit être égate à t'addition de celles des autres personnages
qui elle doit avoir une masse suffisamment signifiante pour fàire
y arriver, utitiser des boulons, des rondeltes, des trombones et une
Les obiets Les objets en
équilibre
_SS-i
CULBUTOS
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
15 à 20 minutes
Matériel
l'aIbum inducteur
Zignongnon
P5.MS.Gs
Situation déclenchante
> L'enseignant tit l'album Zignongnon, explique ['inversion
des syttabes oui el non et fait trouver les mots originels.
Les étèves reformulent ['histoire.
Questionnement et proposition d'ob!ets
> Quelle est lo forme de Zignongnon ? Marche-t-il ?
ll o une forme d'æuf. Non, il se bolonce.
> L'enseignant propose une boîte contenant des obiets
tous basés sur le principe du cutbuto.
> Quels sont les points communs de ces objets? lls se balancent.
lls ont tous une base ronde. lls se remettent debout tout seul. lls ressemblent à des æufs.
> Ce sont des culbutos. On dit gu'ils ont une position d'équilibre stoble. lls y reviennent touiours sons
qu'on les touche.
olivie" Douzou et I rédérique Beitrand
@
Editions du Rouergue.2013.10€
des objets culbuto (brosse à dents,
minuteur, louet, cuiltère...)
ATELIER DIRIGE
DE4À6Ér-Èves
z5 à 3o minutes
Par eleve:
-
r boîte
ronde
:
Pour le groupe:
- r culbuto
- des boîtes rondes
et des boîtes «pavé»
- des battes de ping-pong
- des cailloux
- du sabte
-des billes
-des perles
- de [a pâte à fixer
Lancement du projet
>
le vous propose de vous fobriquer chocun un zignongon.
ÉTnpt z cGNfEvtfR
uÈ"8
culæùJss
Manipulations et questionnement
> Dans un premier temps, tes étèves ont à [eur disposition les obiets cutbutos et [es manipulent.
> Je vous oi opporté des obiets. Quels sont ceux qui ont Io bonne forme pour devenir des culbutos?
Ceux qui ont au moins un côté rond.
Tri des boîtes
> Les êlèves trient les objets présentant une face arrondie.
> Si ie mets en mouvement les obiets que vous ovez triés, font-ils comme le culbuto? Non, ils ne re'
viennent pos tout seul comme ou début.
> Maniputer les oblets cutbutos en faisant remarquer qu'ils sont plus [ourds du côté arrondi.
> Comment faire pour que nos objets soient lourds comme les culbutos? On peut les remplir de cailloux,
de sable, de perles...
-rpistoletàcolte
basse température
- de t'adhésit
Essais
> Les étèves remplissent [eur ob.iet avec [e matériel qu'ils ont imaginé. lls sont alors confrontés
>
>
>
>
>
Manipulations
> Les élèves .jouent avec [eur boîte culbuto.
a62
au
probtème de ta quantitê à mettre. lts commencent par remptir complètement [e contenant qui ators
ne se batance pas du tout.
Une fois ce constat verbalisé, les étèves retirent une partie de [eur [est. Leurs objets cette fois-ci
bougent mais ne reviennent pas à [eur position d'origine.
Que se posse-t-il mointenant? ll bouge mais il ne se balance pas.
Pourquoi? ll faudrait que le poids ne bouge pas dans lo boîte.
Comment foire pour que ça ne bouge pos? En fixant avec de la colle, de lo pôte à fixer....
Les élèves fixent [eur lest avec le matêrieI mis à Ieur disposition.
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
r5 à zo minutes
Matériel
*
Pour [a ctasse:
des prototypes réatisés [ors
de l'étape précédente
Érner 3 ÂNsËesrËs LA FAEsleAmGilÈ
Choix du matériel
> Mointenont que nous ovons trouvé comment foire pour que nos objets se boloncent comme les culbutos, nous ollons foire de beaux culbutos. Nous allons d'obord écrire tout ce que nous ollons devoir
foîre. D'obord ce que nous devons ovoir.
> Les élèves listent [e matérieI nêcessaire.
> Quel est le lest le plus simple à utiliser? Les billes et la pôte à fixer.
Anticipation de la fabrication
> Les élèves dictent les différentes étapes.
> Comment rendre nos boîtes jolies ? On peut les peindre, coller des dessins dessus...
CLASSE ENTIÈRE
ACTIVITÉ INDIVIDUELLE
15 à
ETAPE
20 minutes
4 Fê*§§*§§§
il1.§
fuLSù§S
PouR FAC|L|TER LA MtsE EN cuvRE, rL rsr pnÉrÉnnere euE Tous rEs ÉrÈves nrrNr rs mÊue cEr.ine oe eoirE
LA PE NTURE EST LE cHotx DE LA cLASSE, crttr Érnpr esr rn pnemtÈnr À nÉertsrn. LE cHotx DU DEsstN pERÀtEr
DE FoNcrloNNER EN cLASsE, LES UNS DESStNENT LEUR pERSoNNAGE pENDANT euE LES AUTRES RÉALtsENT rrun goitE
5
*
Matériel
Par étève:
- 1 boîte
..
Les étèves réatisent leur culbuto en suivant la fiche de construction 7 (DVD-Rom et coffret).
- bittes
à colle ou pâte à fixer
- peintures ou feuilles
CLASSE ENTIÈRE
ACTIVITÉ INDIVIDUELLE
15 à
zo minutes
;t
Matériel
par élève:
- son cutbuto
- r feuille
*
Pour [e groupe:
- r affiche
Émer 5 sÉ{*àRu tiru (èJl*il}§r}
Consigne
>
I'oi dessiné surl'offiche I'intérieur
CULBUTO
du culbuto. Que monque-t-il? Lo bille, le
coillou.
>
ll
sert à quoi ? À rendre le culbuto lourd en
bas.
> Celo s'oppelle le lest. Pourquoi faut-il du
lest? Pour que le culbuto revienne toujours
dons so position d'équilibre.
> Mointenont que nou sovons comment foire
un culbuto, comment peut-on le décrire
?
. \)-"
** J,tnJ
^til^n* "nr,
Eoù/r hj>
"",n4 *'
*4..
9o^^
*
|
ont-
,/nL
-
t.e, ?ntlnru,en,
,. Uo eù --n---lou+o,ota, onaa+Àt".
*-*
Verbes: balancer, [ester, ouvrir, fermer, remplir, décorer.
Noms: cutbuto, équilibre, [est.
Adjectifs : stabte, instabte.
Les objets Les objets en
équitibre §S§
ln
F
lrl
P'TITS CALDER
É
o
tâ
lrJ
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
5à
ro minutes
Matériel
r mobite
Étepr r *-Sis5§i
s.N s=:i§
M5.GS
Situation déclenchante
> Pour les ctasses ayant [a chance de pouvoir organiser une sortie dans un musée d'art contemporain, les mobiles de Calder, Mirô, Munari sont des æuvres souvent présentes.
> Pour les autres, un mobite du commerce ou réalisê par ['enseignant est instalté dans [a ctasse.
Description
> L'enseignant montre [e mobile.
> Décrivez cet obiet. ll est suspendu. ll y o des objets, des formes, des personnoges... qui pendent. ll y o
des bôtons, des ficelles. ll bouge.
> Cet objet s'oppelle un mobile, justement porce qu'il bouge, qu'il est mobile.
> Les bôtons s'appellent des tiges. Comment sont-elles? Elles sont bien droites.
> Elles sont horizontales. Regordez une tige et décrivez-la. ll y a une ftcelle ou milieu et un obiet
suspendu de chaque côté de la tige.
> L'ensemble (la tige, les deux suspensions et les frcelles) s'oppelle une bronche du mobile.
Lancement du proiet
>
Nous allons réoliser plusieurs mobiles pour décorer la closse. Chocun d'entre vous fero so bronche.
? une tige, de lo ficelle, deux obiets à suspendre.
> Que fout-il pour choque élève
ATELIER DIRIGE
DE6À8Ér-ÈvEs
zo à z5 minutes
*
Matériel
Par élève:
- z éléments intermédiaires
en mousse
- z brins de ficetle
r tige avec pivot fixé au centre
-1 patron des suspensions
(DVD-Rom)
',
diflérents, suffisamment pour que
tous les élèves puissent réaliser
leurs z suspensions
264
Réalisation des suspensions
> L'enseignant présente un modèle de branche individuelte puis montre comment assembter
la première perte sans avoir à faire de næud (voir Trucs et astuces page z6r).
> Chaque étève rêalise ses deux suspensions.
llyenounelourdeetunelégère.
> Observez lo bronche modèle. Que remorquez-vous? Chaque ficelle est attochée avec des agrofes
>Quepouvez-vousmediresurcesdeuxsuspensions?
à un
corré et c'est le carré qui est sur la branche.
> Chaque étève agrafe ses suspensions.
Pour le groupe:
-des pertes de 3 diamètres
-r
Étlpt z §*§r.ss=R Lil§ *ssru{:ÉsË*§ tN*§s§*unll{s
branche modèle
o
rrs ÉrÈves putssENT sENTtR euE L'Éeutrtenr DEs BRANcHES vn oÉpetone DE LA MAssE DES suspENstoNS ET
DE LEUR DISTANCE AU PIVOT, IL FAUT QUE LES DEUX SUSPENSIONS AIENT DEs MASSES TRES DIFFERENTES.
PouR euE
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8ÉlÈvrs
Ém
e
ro à 15 minutes
Matériel
- [es suspensions
1
de ['étape précédente
tige avec pivot fixê au cintre
r 3 S§-:
Cerre
t :
:- :.=
x:
*
:-
s
S
tÈ
È.§x
§:.§
sS
Érnpe pEUT AVotR LtEU À LA
i ts L:
surrE
ss I t. $
DE
rn
s
t LI sS
pnÉcÉorrurE.
Éguilibrage de la branche
L'enseignant distribue à chaque étève une tige sur laquelle [e pivot est fixe et au centre de [a tige.
> Voîlà votre bronche. Le corré ou milieu de la tige est oppelé pivot. Vous glissez vos 2 suspensions de
choque côté du pivot por les trous des corrés et vous tenez I'ensemble por lo ficelle du pivot.
> Les étèves assembtent leurs éléments
> Comment sont vos bronches ? P e n c h é e s.
> Elles sont penchées n'importe comment? Non, elles penchent du côté des suspensions lourdes.
> Comment les rendre horizontoles? En bougeant les suspensions, en ojoutant des perles.
> ll n'est pos possible de rajouter des perles. Vous allez donc essayer en bougeont les corrés.
> C'est plus facile quond on est deux. Mettez-vous por deux et commencez por équilibrer une bronche.
> Les élèves en binômes font coutisser les suspensions, d'abord au hasard puis en observant qu'en
déptaçant Ies suspensions ils peuvent augmenter ['inctinaison ou [a réduire, its arrivent à t'équi[ibre par tâtonnement.
Verbalisation
> Une fois que Ia moitié des branches est équilibrée, e[[es sont suspendues au tabteau à t'aide d'aimants ou sur une ficelle avec des pinces à tinge.
>
branches? Les suspensions lourdes sont près du pivot, les
légères loin du pivot.
> Équilibrez les secondes bronches mois en bougeont tout de suite les suspensions dons le bon sens.
D
EM I.CLASSE
ACTIVITÉ EN BINôME
r5 à zo minutes
*
Matériet
Par étève:
sa branche individuelle
* Par binôme:
- r tige intermédiaire
Que pouvez-vous dire sur ces premières
Érnpr + §§è§-:sss Lss sRsrueÈiss §$:Tssè4$$tÂssrs
Équilibrage des branches intermédiaires
> Je vous distribue une tige plus grande qui vo servir à faire une
bronche intermédioire pour réunir deux bronches individuelles.
Vous devez équilibrer cette bronche
> Les êlèves insèrent leur branche individuelle de chaque côté de
la tige intermédiaire. L'un des deux tient la ficelte de [a branche
intermédiaire, l'autre déplace tes branches individuettes.
Observation des résultats
> Une fois les branches équitibrées, elles sont suspendues au
ta
b
leau.
> Que remorquez-vous ? Y o-t-il une branche plus proche du pivot que I'outre? Non, elles sont poreilles.
> Oui, elles sont à lo même distonce. Comment le vérifier ? Avec une règle ou une ficelle.
> Cette vérification permet de constater que [es deux branches sont équidistantes du pivot.
> Pourquoi? Les deux branches sont aussi [ourdes ['une que ['autre.
> Commentsovez-vouscelo? ll y a les mêmes perles de chaque côté.
> Donc si les suspensions sont toutes les deux aussi lourdes, elles sont ô la même distance du pivot
pour que la bronche soit à l'équilibre.
Les obiets Les obiets en
équitibre 2
ATELIER DIRIGÉ DE LANGAGE
DE 8 ÉLÈVES
5 à ro minutes
*
r
Matériel
Pour te groupe:
tige principale fixée au plafond
- les z tiges inlermédiaires
du groupe
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
15 à 20 minutes
Matériet
r
affiche
ÉrapE s Équruremrq
Ë"È
rdo*u-fi §'{JN GRGLIpH
Présentation de t'activité
> C'est moi qui vois équilibrer le mobile finol. J'oi
occroché ou plofond la tige principole. le voÎs
mettre une tige intermédioire de chague côté et
c'est vous qui allez me dire ce que ie dois foire.
> L'enseignant équitibre [e mobile en suivant Ies
indications données par les étèves. L'enseignant
insiste sur l'utitisation du vocabutaire spécifique
et sur [a prêcision des consignes : tu dois approcher la branche de ... et... du pivot par exemple.
Érnpe e RÈnrGËR rËs RÈGLHS D'ÊqilüLIBRH s'{JN ffiütsiLË
MS.Gs
Trace écrite collective
> 5i nous devons refoire un mobile ou expliquer à
quelqu'un comment foire que devons-nous dire ?
. 0o a, ,-"
,1, * * ,lrar*
^,"!rtln.
Q*n^rlnn. W^^; ?"4^.ÿL enL cn nv*,té.e
;,fI
o r.me, l)re üq
m tuÿuôl et o-e es-rt,
a
,t" Lo.€ d.L
dL 1, ,ol.
.R.q,r",.o.€
J*^
Jr*" 'r|.^*rÀrJ^^"rÀ^^ ,lrr
A
'[.P^o.0*.^.1.ool
^;"lL
.0
.0
ed, f'DhJ,\{}rüale.
9"^A*, "f,-y-y
à ""*:*n.ù-* -
rÿ yb,
it?L
cfrt
CDh
"^[
."î*"ôüëA.g\.e
l*îWu^^ÀV'c/A.
,""
a
dr l].Mjô{, ln
(onl
a".in-
b,îïbf.r,u
U
00
l.
mDbIP, elXp,a» tfl\L
du j.b
a
f".ff\o
0
Y,ù
f
!i
:
I
.;
I
i
Verbes: équitibrer, déplacer, coutisser, assembter, agrafer, pencher, vérifier.
Noms: inclinaison, distance, pivot.
Adiectifs: horizonta[, lourd, léger.
Adverbes: près, loin.
36S
ln
F
UESTIONS D'ÉQUILIBRES
lr|
É
Comprendre le principe de l'équilibre
d'une balance
o
ln
lII
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
15 à 20 minutes
Matériel
['album inducteur
Étlpg r sÉ{$uvmtR
t-"oB}E'§'
«sAseuLE,:
Situation déclenchante
> L'enseignant tit t'album Un tout petit coup de moin eT explique les mots incompris.
> Les élèves reformutent ['histoire.
Présentation de I'activité
Ur
tout petit
> Je vous ai préporé une maquette de bascule (voir Trucs et astuces page z6l et les personnoges de I'histoire. Vous ollez pouvoir rejouer lhistoire et vérifier si ce qui s'y passe se vérifre avec les moguettes.
.
coqP
de mam
""-itË:
Un tout petit coup de moin
Aî1 -o1Pê-t et I Ynn lMunsinge'
@ Kaléidoscope
.7997.
5,6a€
- 1 maquette de bascute
- [es personnages de l'album avec
les lests nécessaires pour arriver
à la bascùte uniquement
à ['arrivée du co[éoptère (DVD-Rom)
ATELIER DIRIGÉ DE LANGAGE
Étnpe z Mû§*§-Ésüft !-À §lTiJ"&§tGN $Ë L'ALBUfin
DE6À8Ér-Èvrs
r5 à zo minutes
:.
i
Matériel
identique à L'étape précédente
l'histoire de I'album ovec lo moquette et les pe$onnages plastifiés.
fait nommer Ies diffêrents personnages et Ies positions
de chacun sur [a bascute. lI lnsiste sur Ies connecteurs temporets ainsl que Ie vocabulaire spatiat.
- Une fois [e Iivre terminé, its s'amusent à faire basculer [a maquette en retirant et en remettant
Vous ollez rejouer
Les é[èves rejouent l'histoire. fenseignant
le coléoptère.
rrs aurces ÉrÈves pEUVENT louER EN AUToNoMtE A
uorroN o'Éeurrrenr (vorn encr 270) ou DEssTNER UNE DES srruATroNS DE L'ALBUM
PENDANT cET ATELTER otntcÉ,
DTFFERENTS JEUX TRAVATLLANT LA
Les obiets Les objets en équitibre
ATELIER DIRIGÉ DE LANGAGE
DE6À8Ét-Èvrs
r5 à zo minutes
Matériel
'lk Pour te groupe:
-
r batance RobervaI
les personnages tarés
Érnpg
r rsr"lsÈüss t= §*t ss sssss
r-.§ss {È
ssi.§
Hypothèses
> Comment expliquez-vous ce qui se posse dons I'histoire
? Quand
tous les onimaux sont ensemble, ils
sont assez lourds pour soulever l'éléphant.
lnvestigation
> Comment le vérifier? ll faut les peser. Que faut-il pour peser? Une balonce.
L'urrrrsnrroru DE LA BALANCE ÉLEcrRoNteuE pose
rr
pnoeLÈ^tE DE LA LEcruRE DEs GRANDS NoMBRES.
> Voilà une balance.
En ovez-vous déjà vu une? Non, oui. Où? Dans le coin cuisine, au marché...
> L'un d'entre vous peut-il essoyer d'expliquer comment on utilise cette balonce ?
> L'explication du fonctionnement a lieu en même temps que [a démonstration.
. Au départ les deux plateaux de lo balonce sont à lo même houteur.
o Quand on met quelque chose sur un plateau, ce ploteau descend. Pour faire revenir la balance à
l'horizontale, il faut mettre autre chose sur l'outre plateau.
o Quond les deux plateoux sont à nouveau à la même hauteur, cela veut dire qu'il y a le même poids
des deux côtés de lo bolance.
> Redites-moi ce que nous devons foire ? ll faut mettre l'éléphant d'un côté de la balonce, les outres
personnoges sans le coléoptère de l'outre côté, lo balance doit être horizontale. Quond on oioute le
coléoptère, la bolonce doit pencher du côté des entmoux.
> Les élèves comparent te poids des personnages.
LA BALANcE ET LES PERSoNNAGES
COMPARAISON.
À
l'nccurt
EN AUTONOMIE
10 à 15 minutes
*
r
36§
Matériet
Au coin cusine:
balance Roberval
sorut LnlssÉs À LA DrsposrroN ors ÉrÈves pouR euE cHAcuN putssE
Émer 4 {*:§FÀRss sÈs §,§sssÊs sÈ'Èe
uȧ=
REPRoDUTRE LA
§slÀN{§
Manipulations
> La balance est instattée dans le coin cuisine et les élèves jouent à créer des équilibres avec des
objets du coin cuisine.
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8Ér-Èves
15 à
*
-
r
Émpr s sèsa:{s i.\ss
a}s5i.§-§
t}s }.:iJS i-Si:is èt§
;:l-Lss
i:}§sti
zo minutes
Matériel
Pour le groupe:
batance Roberval
-6 objets de masses différentes
> Vous ollez ronger ces objets du plus léger ou plus lourd. Comment allez-vous foire ? tl faut les peser.
> Les étèves mettent des objets de part et d'autre de [a batance sans stratégie.
>Pouvez-vousrongerlesobjets? Non,ilfoutqu'onlescomporeunporun.Ondoitd'obordtrouverle
plus lourd: c'est celui qui foit pencher la balonce de son côté à choque fois.
Tests
> Les élèves trouvent t'oblet te ptus lourd, renouveltent la démarche pour trouver te deuxième objet
le plus lourd et ainsi de suite.
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8ÉlÈves
z5 à 3o minutes
*
*
r
Matériel
par élève:
- r feuille
- 1 Crayon
Pour te groupe:
balance Roberval
Émpr o ssr:LssÈÈ *§s t-:s;ùss sit-:s Li:::§*s
SUR LA BALANcE, uN oBlEr
eut
N'EX
a-\tJ saiÈ-s
srE eu'EN uN
lsùi:ss i§..='i:§= .§ss{ :§iL\§*l§:
sEUL ExEMpLAtRE DANS LA cLAssE
esr
Gs
posÉ
Consigne
> Vous ollez trouver un objet plus lourd que celui qui est sur lo bolance. Avont, vous ollez dessiner comment devront être les ploteaux de lo balance quond vous y ourez déposé votre objet.
Travait individuet
> Les étèves dessinent et cherchent un objet qu'ils pensent être plus [ourd que celui sur la balance.
>Chaque étève teste son objet. Si cetui-ci répond à la consigne, it dicte à I'enseignant: 1e... est ptus
lourd que [e.... parce que son ptateau est ptus bas que l'autre.
>Si t'oblet ne répond pas à [a consigne, il verbalise Ie fait que I'obiet est ptus téger que t'obiet en
ptace car iI ne fait pas bascuter Ia batance de son côté. lI va chercher un autre objet.
Seconde consigne
> Mointenont, trouvez un objet plus léger que celui
qui est sur lo bolance. Avont, dessinez lo bolonce.
> Dêmarche identique à l'exercice précédent.
Troisième consigne
> Trouvez un obiet ou un groupe d'objets qui pèse
la même chose que I'obiet en place. Dessinez
d'obord lo bolance.
:.'Tous ces êquilibres peuvent être travailtés en EPS lors de parcours mettant en æuvre
des:a::-
=.
Verbes: bascuter, peser, ranger, pencher.
Noms: batance, plateau, ftéau, aiguille.
Adjectifs : lourd, [éger.
Adverbes: ptus, moins, aussi.
Les obiets Les objets en
équitibre
26p
OUVRAGES AUTOUR DE L'ÉQUILIBRE
@@@
@@
@@
Zignongn on
La petite galerie
Un
0tivier Douzou et Frédérique Bertrand
O Éditions du Rouergue. zor3. ro€
de Calder
de main
Yûichi Kimura O Didier Jeunesse
Ann Tompert et Lynn Munsinger
@ l(atéidoscope c 1997 t 5,6o€
Le [apin et Ie renard se re-
C'est l'histoire d'un culbuto
qui inverse les oui et les non.
lI est donc migoui et a comme
doudou un nonstiti.
Patricia Geis
o
Palette
. 20C9. 20€
Ce livre pop-up reproduit les
ceuvres les ptus emblématiques
de Catder, entre autres des
mobiles.
@
tout petit coup
Bascute
.
2OO5
.
72,7A€
L'éléphant veut.iouer à la
bascute. Tous ses amis essaient
de faire contrepoids.
trouvent sur une planche en
équitibre. Si ['un bouge, tous
@@
@@
les deux tomberont.
JEUX AUTOUR DE L'ÉQUILIBRE
@@@
@@
Les chaises à ranger
Culbuto Tobbtes Néo
Océan déchainé
Bascute grenoui[[e
O Goki et Pirouette Editions.35€
@ Fat Brain
@
Hape. A partir de 15,5o€
Un jeu d'équilibre en bois de
bambou. Poser [e plus grand
nombre de trésors possibte sur
Rêf. zot9876
w
ww. p iro u ette-
e d
itio n s.f
r
Vingt-quatre chaises en bois
peint dans un coffret de
rangement et soixante cartes
modètes à reproduire.
.29,95€
.louer seuI ou en groupe à réali-
ser la tour de coquiltes [a plus
haute possibte.
le pont sans faire chavirer
[e
batea u.
O Smatl foot company
. A partir de 6 €
Un jeu d'adresse et de patience
en bois pour placer les rondins
aux bons endroits sans faire
tomber les autres.
BALANCES
@
@@
Balance RobervaI jouet
Ba[ance à ptateaux
Super balance à ftéau
O Goki
O Nathan.2l€
@ Cetda & 456s o
Simpte à utitiser. Met en évidence [a notion
d'êquitibre entre Ies deux plateaux.
Utilisation facite. Charge maximum zkg.
.
À partir de 4o€
L'idéal est de trouver une vraie balance
Roberval dans une école étêmentaire ou
un [aboratoire de physique du collège du
quartier.
@@
3o,zo€
LES OBJETS
Notions pour I'enseignant
Trucs et astuces
272
273
Y a-t-il un fil dans t'objet?
Les p'tits dépanneurs
Le chemin de l'électricité
Défi Mon clown voit rouge
274
276
279
Ouvrages, ieux et vidêos autour de ['électricité
28,6
Les notions abordées
284
Qu'est-ce que le courant électrique?
Quels sont les dangers de l'électricité
> Le courant électrique correspond à la circulation d'électrons dans
L'é[ectrocution
un matériau. Les électrons sont les charges négatives des atomes
et constituent [a plus petite entité de [a matière.
Que faut-il pour avoir du courant?
?
> Le corps humain est conducteur, i[ peut donc être traversé par
un courant étectrique. Si t'intensité dépasse 3omA, i[ y a risque
d'étectrocutio n.
C'est pourquoi un des enjeux de ce chapitre est d'associer ['étec-
> Que le matériau soit conducteur. Pour qu'un matériau soit
conducteur, il faut que dans sa constitution des électrons soient
libres et donc puissent circuler entre les atomes. Génératement,
tricité du secteur à [a notion de danger.
Quand on utitise des piles, le courant ne dépasse généralement
les métaux sont conducteurs. À l'inverse, un matériau dont ta
constitution ne contient pas d'étectrons libres ne permet pas [a
circulation d'étectrons. lI est appe[é isolant. Les matières plastiques sont généralement isolantes.
> Qu'iI fasse partie d'un circuit (boucle) dans lequel doit se trouver obtigatoirement un générateur (soit une pite, soit [e secteur)
et un récepteur (composant permettant de transformer l'énergie
électrique en une autre forme d'énergie: mécanique, rayonnante
ou thermique). Les différents éléments de ce circuit sont reliés
par des fils électriques. Le fi[ électrique est un fi[ métatlique donc
conducteur gainé par du ptastique isolant. Pour que [e courant
puisse circuler, ce circuit doit être fermé: il est constitué par une
> Le second risque électrique est celui de l'échauffement des fits
quand it y a un court-circuit. Un court-circuit est une boucte de
circuit sans récepteur. Dans les manipulations, cette situation
peut arriver (un étève qui relie les deux bornes de [a pite avec
un fil, des trombones permettant de retier des fits aux lamettes
de ta pite se touchent..). La pite peut alors devenir très chaude.
Si ette est confinée dans une boîte et qu'e[[e touche des papiers
fins, type papier de soie, ces derniers peuvent s'enflammer. lI ne
faut donc iamais mettre de papiers fins à proximité d'une pite.
boucte ininterrompue de matériaux conducteurs.
> Qu'il y ait une différence de potentiel entre les deux bornes du
générateur. Cette différence de potentiel est appelée tension et
se mesure en votts. Ilanalogie ta ptus simpte à comprendre est
pas o,2mA. lI n'y a donc aucun danger.
Le court circuit
Vocabulaire de la lampe
ampoule de verre
cetle de ['eau: une rivière ne s'écoute que s'iI y a une différence
de niveau entre l'amont et ['avat, [a différence de potentiel est
['équivalent de la différence de niveau. Quand une pile est usée,
c'est qu'i[ n'y a plus de différence de potentiel entre les deux
gaz inerte
filament de tungstène
bornes de [a pile.
Quelles lois régissent l'électricité
.
.
?
L'intensité d'un courant étectrique correspond au débit d'étectrons dans [e circuit. Ette dépend de [a tension aux bornes du
générateur et de [a résistance (grandeur mesurant [a conductivité de t'obiet) des récepteurs composant te circuit. C'est ta toi
d'Ohm: U=Rl.
support isolant en verre
La puissance est [a quantité d'énergie utitisée en un temps don-
culot
né. Ette se mesure en watts seton Ia formute P=Ul.
plot
272
Ampoule,
lampe
ou led?
La douilte E1o est [a plus courante
et [a plus économique.
Les pinces à dénuder du commerce sont
régtabtes en fonction du diamètre du fit.
Ce régtage est [e ptus souvent ['oblet
d'une vis que les étèves dévissent
facitement. Nous vous conseitlons donc
d'utitiser t'outit te ptus simpte: la pince à
dénuder automatique qui ne nécessite pas
de régtage.
Le terme scientifique pour ce qui est communément
appe[ê ampoute est lampe. llampoute ne désigne que
['ampoule de verre contenant [e fitament.
Les lampes à incandescence possèdent un filament de
tungstène qui est chauffê à btanc lors du passage de
t'électricité et qui émet de [a lumière.
Ces [ampes E1o sont simptes d'utitisation et les étèves
peuvent comprendre que lorsque [e fitament est cassé, [e
circuit est ouveft car [e phénomène est visible.
Elles sont de plus en ptus remptacées par des DEL,
diodes étectroluminescentes, moins consommatrices
d'énergie, mais [e phénomène [eur permettant d'êclairer
n'est pas visibte. De plus, eltes sont polarisées, c'est-àdire qu'elles ne s'altument que si elles sont connectêes
dans [e bon sens.
Les interrupteurs du commerce ne permettent pas de visualiser [e circuit ouvert
ou fermé. lI est très simpte de fabriquer un
interrupteur moison qui permet aux étèves
de bien voir que [e circuit est ouvert ou
fermé à l'aide d'attaches parisiennes et
d'un morceau de carton.
\-\
Pour les montages, les fits étectriques à
pinces crocodiles permettent des liaisons
simptes. Le problème est que les pinces
sont très souvent difficites à ouvrir pour
des élèves de maternette.
Pour [es fabrications, [e fil é[ectrique
monobrin est ptus facite à dénuder. Lorsqu'on utilise du multibrin, au moment du
dénudage, les élèves coupent la ptupart
des fits périphériques et souvent [e fi[ se
coupe au moment de [a liaison avec les
étéments du circuit.
Quelles pites choisir?
Les piles plates sont les ptus simples à utiliser
pour [a facilité du branchement des fils sur
[eurs [ame[[es.
ll existe sur le marché deux types de pites:
les salines et les alcalines.
Les piles alcalines sont plus chères car e[les
durent ptus tongtemps mais elles sont aussi à
['origine de courts-circuits plus destructifs car
ptus intenses et ptus [ongs.
Les piles satines sont donc conseillées.
Les obiets Les objets électriques
UI
Y A-T.IL UN FIL DANS IOBJET?
F
ul
@
Différencier les objets mécaniques
des objets électriques
o
t1
ul
J
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
2(, minutes
- des oblets non électriques:
'o -et. tail.e-crayo-. bolgie.
oalleJr 1écanique ..
'
des oblets étectriques à pile:
lampe de poche, fouet
émulsionneur à piles...
- des obiets étectriques
suT
secteur: fouet électrique, [ampe
sur secteur...
Érlpe r DÉcouvRln
ET PosER LE PRoBIÈME
Situation déclenchante
> llenseignant propose aux étèves un ensembte d'objets.
Questionnement
> L'enseignant dirige une discussion permettant de nommer correctement chacun des objets et de
faire verbatiser [eurs fonctions. Certains objets sont connus des élèves, d'autres se prêtent à des
éch
an
ges.
> Vous ne connoissez pos cet obiet ? À votre ovis, à quoi peut-îl servir
?
Au bout, il y a le même truc que dans le botteur.
> Tu veux dire qu'il y o oussi des louets ? Alors c'est aussi un botteur?
> Quelle diffêren ce e ntre ces deux botteurs ? P o u r ce I u i - là, i I fa u t to u r n e r la
p o ig n
é
e'
Consigne
> ll vo folloir closser ces objets. Vous devrez regroupet les obiets qui ont des points communs.
ATELIER DIRIGÉ
DE4À6ÉlÈves
Étlpe z TRouvER
LEs cR[ÈREs PERMETTANT
uil
cI-ASSEMENT DEs oBJETS
20 à 30 minutes
Matériel
Ia collection d'objets
Pendant un moment de découverte des objets, moment préalable indispensable au travail, chaque
étève manipute tes objets, les prend en main, les fait fonctionner. Prévoir un espace de travail
suffisamment proche d'une prise de courant pour pouvoir tester [es appareils fonctionnant sur Ie
secteur.
obiets? lls doivent se ressembler.
Les étèves vont proposer Ie classement par couleur, par taille. Par des questionnements, iI est
Comment pouvons-nous closser ces
possibte d'arriver à des classements par matière, par fonction, par énergie.
Que fout-it pour faire fonctionner ces obiets? Tourner la manivelle, appuyer sur le bouton de I'interrupteur, brancher le fil dans la prise...
Le critère de classement n'étant pas donné, tous Ies ctassements sont recevabtes.
Prendre en photo chaque classement proposé: par matière, par taille, par fonction...
Une fois arrivé au ctassement objets étectriques/objets non électriques, faire remarquer que les
objets étectriques sont dangereux et qu'it ne faut jamais Ies utitiser seuts, surtout ceux se branchant
sur secteur.
274
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
10 à 15 minutes
Matêriel
Énet 3 BrrAN
ET TRAcE
ÉcR[E couEclvE
Rédaction d'une affiche
> Une fois tous les é[èves passés à ['atelier dirigé, on peut rêdiger une trace écrite en dictée à
['ad
- les photos des objets utilisés
u
lte.
Iors du classement
OU
- cartes-images z6:
objets non électriques / à pite /
(DVD-Rom
sur secteur
et coffret)
- r feuitle format raisin
pour l'affiche
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
5 à 10 minutes
Matériel
- cartes-images z6:
objets non é[ectriques / à pite /
sur secteur (DVD-Rom et coffret)
L'enseignant utitise tes /hotos des
coffret).
'Émer 4 coNt'lAîTRE LEs usAGEs
DE
fbj.,, por
t,affiche
rÉLEcrRlc[É
> L'enseignant ne garde que les photographies des oblets étectriques à piles ou secteur.
> Tous ces obiets fonctionnent ovec de l'électricité, mois cette électricité, à quoi sert-elle ?
À chouffer /à écloirer /à foire tourner /à faire bouger/à entendre de lo'muiique /à entendre des sons.
Analogie
> Pour bouger, donser, porleL grandir, de guoi ovez-vous besoin ? De manger.
Que se passe-t-il quond vous mongez ? Celo nous donne de l'énergie.
> Eh bien l'électricité, c'est l'énergie dont ont besoin les obiets électriques pour fonctionner.
>
ATELIER AUTONOME
10 à 15 minutes
Matériel
- memory F: objets êlectriques /
objets non étectriques
Éner 5 RÉrNVEsnssEMENT
> Proposer un jeu de memory des obiets étectriques et non électriques.
> Différencier en augmentant ou en diminuant [e nombre de paires proposées.
(DVD-Rom et coffret)
> Réaliser ['imagier des oblets
à pites que les élèves amènent de [a maison. Prendre des photos.
Dictêe à I'adulte du nom, de [a fonction avec indication du type d'interrupteur.
verbes: tourner, chauffer, éclairer, émettre des sons, mé[anger, allumer, éteindre.
Noms: [ampe, pite, fil électrique, prise étectrique, batteur, bouton marche/arrêt, interrupteur, énergie.
Les obiets Les objets
étectriques §§§
ln
F
lrl
E
LES P'TITS DEPANNEURS
(n
Comprendre le rôle du générateur
o
lrJ
ATELIER DIRIGÉ DE LANGAGE
DE4À6ÉlÈvrs
zo minutes
Matériel
*
Des objets à pites:
- [ampe de poche
Étlpt r
MS.GS
coMpRENDRE tE RôLE DE TINTERRUPTEUR
Situation déclenchante
> Les élèves ont à leur disposition des objets fonctionnant à t'aide de piles et pour lesquels la mise
en route nécessite une action sur un interrupteur. L'enseignant demande: Connoissez-vouscetobjet?
> Chaque objet est désigné, manipu[é, nommé et sa fonction est indiquée.
- jouets
- radio
- appareil photo
- téléphone
Questionnement
> Que devez-vous faire pour que I'objet fonctionne? Appuyer sur le bouton, tourner le bouton.
Manipulations et verbalisation
> Les diffêrents obiets sont manipulés.
> Pour chacun d'entre eux, dictée à t'adulte de phrases du type:
. ?o,^ oilr-"'-.- U ?-t"r* .* *-ÿ*, J W oqtur\ph ut 0;r*»u+re-r,.
. ?-a
ü 0.J *'lr|l
8" ,^
A?**"-*
^ f;.-!.
Vr*1,,."*, M ffiY
7-*
^^à*
k. on.e
,";*
^
c ?utn
0o
U
.Jn.
-Àr*
ÿ,"
,0
cy-n
t2 0""rr
t
n.ru^u*
v>utræ,
U
OI
Otrt.
A
^%.r^rrI
?r"^-^^
ï-
^,,,.-!,.1*,,na
e.ul uou» ?^A--"r"rt^*
r^
phÀtographiés.
Les objets sont phô
*
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
10 minutes
Matériel
- [es traces écrites
de ['êtape précêdente
- [es photos des objets manipulés
Iors de ['étape précedente
276
Étnpr z
ETLAN ET TRACE ÉcRtrE
coLLEcnvE
> Les traces écrites peuvent être regroupées sous forme d'affiche avec les photographies des objets
et plus particulièrement de ['endroit où se trouve ['interrupteur.
@@
ATELIER DIRIGÉ DE LANGAGE
DE 4 À 6 Ér-Èvrs
ro minutes
*
Matériel
Des objets à pites:
- lampe de poche
Énpr r
janvier>juin
coÀipRENDRE LE RôLE DEs plLEs
Réinvestissement
> Les mêmes obiets que précédemment sont disposês sur [a table. L'enseignant demande aux élèves
de les mettre en route en verbalisant ce qu'ils fonl: Pourallumerlalampe, jedoisappuyersur
L'i nterrupteur.
- jouets
- radio
- appareil photo, téléphone.
*
Des outits permettant
l'ouverture des compartiments
à piles: généralement
des tournevis cruciformes.
Dans certains objets, la pile aura
été retirée. Dans d'autres,
elle devra être usée.
Problème
> Certains obfets ont été votontairement mis en panne par l'enseignant: piles enlevées ou usées.
> Les élèves constatent que des objets ne fonctionnent pas. pourquoi?
Émission d'hypothèses
> ll est cassé. On n'a pas oppuyé sur le bouton morche/arrêt.
La vérification est faite dès que cette hypothèse est posée.
> ll manque les piles. Les piles sont finies / Elles sont usées.
> Si la séance Ya-t'il un fil dansl'obiet? a été faite, it est possible d'obtenir des réponses type: iln,y
a pas d'énergie.
Choix de I'investigation
> Comment sovoir? llfaut regorder s'ily a des piLes.
lnvestigations
> Les compartiments à piles sont recherchés puis ouverts.
> ll n'y a pas de piles, il faut en mettre.
> ll y a des piles ! Elles doivent être usées.
> Comment vérifier? ll faut en mettre des neuves.
> Oui, mois lesquelles ?
tes obiets
Les objets êlectriques
ATELIER DIRIGÉ
DE4À6Ér-Èvrs
Érnee 4 DÉPANNER LEs APPARETIS
CerrE Érnpe peur Êrne nÉnrrsÉr À rn surre oe
zo à 3o minutes
r'Étlpr pnÉcÉoerrr.
Dépannage des appareils sans pile
-les objets à piles
de l'étape précédente
- des piles neuves
de diftérents formats
> Reprise de chaque appareil ne fonctionnant pas et vêrification de [a présence d'une pite et de son
instatlation correcte.
>
Les êtèves essaient les piles [eur sembtant correspondre au boîtier lusqu'à
trouver [es bonnes.
des outils permettant l'ouverture
des compartiments à piles:
génératemert des tou'nevis
cruciformes
Dépannage des appareils avec pile montée à I'envers
> Peut-on la mettre n'importe comment?
> L'enseignant fait observer [es signes + et - sur t'appareit et sur la pile.
> lnstallation correcte de la pile, fermeture de ['appareiI et vérification après action sur ['interrupteur.
Dépannage des appareils dont la pile est usée
> lI reste alors quetques appareils qu'il n'est pas possible de faire fonctionner.
> Dons cet opporeil, il y o bien une pile, elle est bien instollée dons le bon sens, nous ovons bien appuyé
sur le bouton morche/orrêt et pourtont l'opporeil ne fonctionne pos. Que se posse-t-il?
Peut-être que la pile est frnie.
> Commentvérifier? llfout chonger la pile.
> Changement de ta pite, choix de la pile neuve du bon format en comparant les pites à disposition
avec Ia pite de t'appareit. Vérification du bon fonctionnement de t'appareit.
CLASSE ENTIERE
COIN REGROUPEMENT
5 minutes
Matériel
-
Étnpg q BrLAN ET TRAcE ÉcR[E coLtEcnvE
r affiche
Verbes: a[[umer, mettre en route, appuyer, pousser, éclairer, rouler, actionner.
Noms: interrupteur, pile, bouton, +, -, sens.
Adjectifs : neuve, usée.
2P8
I
6a
i
.il ?r."I"r,.n*
--r,,,r*ffù#tr'nfffiffi*
o^i€{
o-e^
,1,
t/l
F
lrl
6
LE CHEMIN DE I]ELECTRICITE
(n
Reproduire un circuit fermé
o
ltl
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
5 à 10 minutes
r
Matériel
[ampe de poche
Étnpr r DÉcouvplR
UNE
tAMpE DE pocnE
Situation déclenchante
> Lors du regroupement, l'enseignant arrive avec une [ampe
de poche et l'allume.
Questionnement
> ll interroge [es élèves.
Que se posse t-il? La lumière s'ollume.
Pourquoi? Parce que tu os appuyé sur le bouton.
La lompe s'est ollumée cor j'oi octîonné I'interrupteur.
r
ATTENT oN: CHotstR UNE LAMpE DE pocHE, eut UNE Fots ouvERTE, A soN ctRcu ELEcrRteuE FNTIFRFMFNT DI] MFMF
côTÉ. CERTAtNES LAMpES DE pocHE oNT LEUR LAMpE soLtDAtRE ou nÉrLrctrun. LEUR ctRcutr ELECTRIQUE EST DONC EN
DEUX PART ES ET D FFICILE A COMPRENDRE UNE FOIS LA LAMPE OUVERTE.
CLASSE ENTIERE
ACTIVITÉ INDIVIDUELLE
15 à
20 minutes
Matériel
Étapt z
FoRMULER DEs HyporHÈsEs suR LEs
couposANTs D'uNE LAMpE
DE
pocHE
Gs
Consigne
> Dessinez ce ou'il y o ô I'intérieur de lo lompe de poche et gui permet à lo lampe de s'écloirer.
Pour certains, iI faudra repréciser le mot
intérieur. L'enseignant [égende Ies dessins en dictée
à t'ad u tte.
æ
\---l
i
^.,4\-
,'>
*
Ër
wyL
CLASSE ENTIÈRE
COIN REGROUPEMENT
1()
minutes
Matériel
[es dessins les plus représentatifs
de l'étape précédente
- 3 ou 4 [ampes de poche
-t,,
f-
Émer 3 coNFRoNTER LEs HYPoTHÈsEs
Constatations
> Afficher Ies dessins Ies ptus représentatifs. Faire constater qu'il
y a plusieurs propositions. Les pLus courantes sont:
- piles / fils / tampes, piles seutes, lampes seules, bougie, feu, êclairs.
Questionnement
> Comment sovoir? En ouvrant lo lompe.
Observation
> Après ouverture des [ampes et circulation des [ampes dans [a
ctasse, rédaction d'une trace écrite du type:
. 9*o ?o, ?o^no dn nnJn
aæ»yre»"l^à^1.
oq.,
^,yoti
,t
.- y,L, ,"r.,
U.,'fn-,
Les ÉrÈvrs DtRoNT AMpouLE. LEUR rNDreuER euE fAMpouLE cE N'Esr euE
LA
PETITE BULLE DE VERRE. TENSEMBLE S,APPELLE UNE LAMPE. UTILISER cE TERME
PAR LA SUITE EN DIFFERENcIANT BIEN LAMPE ET L,oBJET LAMPE DE PocHE.
Présentation de l'activité dirigée suivante
> Nous ollons essayer de foire une moquette de lompe de poche pour comprendre comment elle fonctionne.
Les obiets Les objets
électriques
2/ÿ
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8ÉlÈves
3o minutes
*
Érnrr 4 REcoNsrRUlRE LE clRcutr
Au
DÉBUT oe
D'UNE LAMeE DE pocHE: pltE-tAMpE
r'ncrrvrrÉ, rE mnrÉnrer N'EsT
pAS vtsrBLE DES ELEVES
Matériel
Par étève:
- r pite
- r [ampe
* Pour te groupe:
3 ou 4 Iampes de poche
Faire reverbaliser [a consigne et expliquer si besoin [es mots incompris. Le terme maquette s'il
n'est pas utilisé régLrtièrement devra être explicitê : nous ollons foire un circuit électrique
qui reproduit celui de lo lompe de poche.
De quoi ovons-nous besoin ? D'une pile.
Distribution des piles.
D'une ampoule.
Celo s'oppelle une lompe.
Distribution des Iampes.
Dès que les élèves ont à leur disposition une pile et une lampe, ils les maniputent et génératement il y en a toujours un qul par hasard positionne [a lampe sur les lamettes de façon à ce qu'elle
s'a Itu m e.
SouvENr uN ÉLÈvE pLACE LEs DEUX LAMELLEs suR LE cuLor er cnÉe nrus uN couRT'crRcurr L'ÉLÈvE s'EXcLAME
«ÇA BRÛLE» L,ENsEIGNANT FAIT VERBALISER QUE cE N,EST PAS LA BONNE PoSIT oN PUISQUE LA LAMPE NE S,ALLUME
ET tNTRoDUtr sANS pLUS D'EXpLtcATtoN LE
PAS
Mor «couRT-ctRCUtr»
Essoyez d'ollumer la lampe,
Les étèves manipulent. Dès que certains y arrivent, leur demander d'expliquer aux autres ce qu'il
faut faire pour être sûr d'y arriver.
La verbalisation est difficile car Ies élèves n'ont pas Ie vocabutaire nécessaire.
Dessin d'observation
> Dessine lo lompe et lo pile pour que lo lompe s'ollume.
Validation et correction des dessins
> Les ê[èves essaient de reproduire l'installation dessinée par un camarade.
> Les inexactitudes sont verbatisêes et Ies dessins corrigês.
lntroduction du vocabulaire
> À l'aide d'un dessin au tabteau, introduire [e vocabutaire suivant:
- [amelles de ta pite,
- ptot. lt est possibte de se contenter de: 1e dessous de lo lompe.
- culot. ll est possible de se contenter de: le tour de lo lampe.
Verbalisation
> Une fois qu'ils ont tous réussi à a[[umer [eur [ampe, faire verbaliser que pour attumer la [ampe avec
ta pite, it faut que le plot touche une lametle et que [e cutot touche I'autre [ametle.
LE
3§§
unrÉnrrr
N'EST pAS vrsrBLE DEs ÉLÈvES AU
oÉeut oe L'ncrlvrrÉ.
Gà
ATELIER DIRIGÉ
DE6À8Ér-Èvrs
Émpe
zo minutes
r
janvier>juin
REcoNsrRUlRE [E clRcurr D'uNE LAMpE DE pocHE: DoulLtE ET Flrs
Crttr Étapr pEur
ÊrnE EFFECTUÉE DANS LA FouLÉE
or rn pcÉcÉorlttE
DANS cE
cns rÀ. pnssen
DTRECTEMENT
À L'ÉTApE
«INTRODUCTION DE LA DOUILLE».
*
-z
Matériel
Par êtève:
- r pite
Qu'ovons-nous foit? Allumer une lompe.
Comment? ll faut que le plot touche une lomelle et que
- r lampe
- r douitte
fils pinces crocodites
Le culot touche I'outre lomelle.
Après distribution du matériel, chague étève aItume à nouveau sa lampe.
* Pour te groupe:
3 ou 4 [ampes de poche
Vous devez tenir lo lompe pour qu'elle s'ollume, Est-ce le cos dons lo lompe de poche? Non.
Regordez bien dons lo lompe de poche où se trouve lo lompe. Peut-on enlever lo lompe ?
Les êlèves essayent de
sortir [a lampe, dévissent et montrent l'étément qui supporte la lampe.
Celo s'appelle une douille.
Distribution d'une douilte à chacun. Les élèves vissent les lampes dans les douitles.
Essoyez d'ollumer vos lompes mointenont.
Comment dire mointenont ? Comment ollumer lo lompe quond elle est vissée dans la douille ?
llfout qu'une des pattes de la douilLe touche une lamelle et que l'autre patte touche I'autre lamelle.
Observations
>
Vous êtes toujours obligés de tenir lo lompe et lo
douille.
> L'enseignant incite les étèves à bien regarder I'intérieur de la [ampe de poche.
> Les élèves remarquent Ies élêments métatliques qui relient Ies Iametles à ta douitte.
> Nous n'ovons pos de pièces métalliques. Nous utilisons des fils électriques qui se terminent par des
pinces métolliques qui nous permettent de les occrocher oux lomelles et oux pottes de la douille.
> Distribution de deux fits par êlève.
Consigne
> Allumez votre lompe, loin de la pile grôce aux fils électriques.
CERTATNS
ÉrÈves orvBorur Êrnr etoÉs pouR ouvRtR LEs ptNCEs cRocoDtLEs
Les obiets Les objets étectriques
Érnpr e REcoNsrRUlRE tE ctRculr D'uNE LAMPE
20 minutes
Matériel
*
Par étève:
-
-r
r
r pile
lampe
r douille
fil pince crocodile
- 1 interrupteur maison
* Par groupe'
3 ou 4 [ampes de poche
AU DÉBUT oe
r'lcrtvttÉ,
DE
PocHE: II'ITERRUPTEUR
G5
Le unrÉnter N'Esr PAs vtstsre oes ÉrÈves.
rduction de I'interrupteur
Comment éteindre votre lompe ? ll faut débroncher un fi1.
Est-ce oinsi dons la lampe de poche? Non, il faut pousser I'interrupteur.
Regordez bien ce qui se posse quond on pousse I'interrupteur,
lly a deux pièces métalliques qui ne se touchent plus.
Est-ce que lo pièce métollique quÎ port de lo douille vo directement à lo pile ?
Non, elle va à l'interrupteur puis ily en a une outre qui va à la lamelle de lo pile.
le vous donne un troisième fi|, foites comme dans lo lompe de poche.
Les élèves introduisent [e troisième fi[ et a[[ument et éteignent [es [ampes.
* lresrposstBLED'tNTRoDUtREL'oBJETtNTERRUpTEUR.DANSLnsÉnrucepnÉsrrurÉe.SEULELANorloND'lN'IERRUPTEUR
Ë rsr neonoÉe ET sA FoNcloN D'ouvERTURE ET DE FERMETURE DU ctRcurr. L'TNTERRUPTEUR PERMET DE ne pns nvotn À
§ ,orara* AUX Fr s MArs D'AVorR uNE lcrtoru mÉcaruteuE coMME DANS uN vRAt TNTERRUPTEUR.
10 à 15 minutes
*
Matériel
Par étève:
photocopie (document page 283
ou DVD-Rom)
-lcrayonapapler
-
*
Pour la classe
au tabteau'
r circuit reconstitué
Refaire Ie circuit au tableau sous [a dictée des étèves avec [es composants réels et le [égender.
Que remarquez-vous? Celo forme une boucle.
On dit que c'est un circuit électrique. Pour que lo lumière s'ollume,
il fout que lo boucle soit fermêe.
e écrite individuelle
Chaque élève redessine le circuit réatisé en s'aidant du circuit du tabteau.
Les tégendes peuvent être dictées à l'adulte, ce qui permet une évatuation individuelte de l'acquisi
tion du vocabulaire. On peut aussi colter des étiquettes-mots en se référant au modète du tabteau.
Verbes: relier, visser, allumer, éteindre.
Noms: pite, [ampe, lampe de poche, doui[[e, fil électrique, pince crocodile, métal, boucte, circuit, interrupteur.
aR:
DESSINER UN CIRCUIT SIMPLE.
€
MON CIRCUIT ÉI=CTRIQUE
Dessine et tégende [e circuit é[ectrique que tu as construit.
Étiquettes-mots à découper mais qui, en étant agrandis, pourront servir aussi
faire des étiquettes pour [e tableau.
f--1tt
UNE
l.1f
PILE
UNE LAMPE
ft
UNE DOUILLE
,uN FI ILEITRIQUE_] , UI ryTSryPlEqR,
l
à
tt
l-
lr,l
MON CLOWN VCIT ROUGE
E
o
n
a
DÉCOUVRIR LE DÉFI
10 à 15
minutes
- le texte du défi
-fiche de construction 8
(DVD-Rom et cottret)
Situation déclenchante
> Au courrier ce motin, il y ovoit une lettre pour la closse. Je vous lo lis.
Bonjour,
ie vous
envoie lo frche de construction d'un clown dont le nez s'ollume quond il pose ses m0ins sur son chopeou l,lolheureusement
certornesinformotronssonteffocéesetj'oiperduloderniàrepoge
que §on nez s'ollume quond il pose ses morns sur son chopeou?
J'oi besoin du clown pour
le
Pouvez-vousmefobrrquermonclownettrouverunesolutronpour
Bon irovorl ù toute lo closse
Questionnement
> llenseignant demande aux étèves s'its ont compris le défi et [eur explique les mots inconnus.
> ll [eur demande de reformuler avec [eurs propres mots en quoi consiste [e défi.
> lI montre ensuite la fiche de construction et [eur demande de nommer [e matérieI et les outils en
formutant des hypothèses sur [eurs utitités. S'ils n'ont pas d'idée, i[ [eur exptique.
tr§
z5 à 3o minutes
À r'ntoE ou luarÉcrrr ÉLECTRteuE LrsrÉ, LES AUTRES GRoupES pEUVENT ESsAYER
DE
TRouvER LE clRCUlr ELEcTRIQUE
DU
CLOWN EN AUTONOM E, OU DECORER LA SILHOUETTE DU CLOWN.
Par groupe:
- la fiche de construction 8
- r pile
- 3 fits étectriques
- z fils de fer
- du papier d'a[uminium
-r douilte
, l-mna
a,u,,,PL
- 2 morceaux de pailte
- r sithouette de ctown
-r
(DVD-Rom)
aiguitle de piquage
- r paire de ciseaux
-r
pince à dénuder
- de ['adhésif
15 à
Réalisation
>Chaque étape est décodée. Les étèves réalisent les étapes [es unes après les autres. Seule I'êtape
de la découpe de [a bouteille est rêalisée par ['enseignant.
Questionnement à t'étape du dénudage
>Pourquoî fout-ilfoirecedénudoge? Pourqu'onpuisseaccrocherlesfilsàlapile.
> Démontrer qu'it est possible d'enrouler les fi[s même s'its ne sont pas dénudés. Réaliser un circuit
simpte sans dénuder les fits. Faire constater que ta [ampe ne s'aItume pas ators qu'avec des fits
dénudês elle s'atlume.
> ll fout dénuder pour que le métal touche le métal, sinon la lampe ne brille pos.
Mise en évidence du problèrne
> Où en sommes-nous ? Nous avons terminé toutes les étapes de lo fiche.
> Que fout-il foire mointenont? Trouver comment faire pour que le nez s'allume quand les moins
touchent le chopeou.
E
20 minutes
Dessin des élèves
Par étève:
-
r
-le clown
28,4
> Dessinez lo solution que vous imoginez.
feuitle de papier
- 1 Crayon
Par groupe:
réatisé à t'étape
précédente
»
).
'n^y*
30 à 40 minutes
Par élève:
-1 chapeau
Par groupe:
- le clown réalisé précédemment
- 1 circuit étectrique test
Pour l'enseignant:
-r apparei[ photo
Tests et choix d'une solution
>Chaque élève prêsente au groupe [a solution qu'iI a imaginêe. Certaines solutions peuvent être
éliminées si par [e diatogue les élèves se rendent compte qu'elles ne vont pas fonctionner.
> Les solutions restantes sont testées à t'aide des chapeaux tests.
> Le groupe choisit [a sotution qui Iui semble [a plus fiable et la plus simpte à fabriquer.
: L'enseignant prend des photos des différentes propositions.
Finition du clown du groupe
> La solution choisie est apptiquée au chapeau du clown du groupe.
Préparation de [a présentation du défi
>À t'aide des propositions abandonnées, l'enseignant aide tes étèves à reverbaliser toutes les étapes
qu'ils ont parcourues pour arriver à [eur sotution. Les échecs et impasses ne sont pas oubliés.
4
OU 5
x1O minutes
- le clown de chaque groupe
les photos prises [ors des étapes
hr^.ÂÀ^nteS
PILLLUL
15
minutes
des photos prises [ors de [a
présentation peuvent être utiles
A PRÉVoIR SUR UNE SEMAINE, cHAQUE GRoUPE
PRESENTE SA
SoLUTIoN A LA cLASSE sUR UN TEMPS DE REGRoUPEMENT.
lnstallation et passage des groupes
> Mettre en place l'espace permettant aux groupes de passer et de relever [e défi.
>Chaque groupe passe, fait sa prêsentation orale et une démonstration du défi relevé, en n'oubliant
pas de parler des impasses et des difficultés rencontrées.
>5i nécessaire, ['enseignant et/ou les autres élèves demandent des exptications.
Bilan et trace écrite
>Chaque groupe étant passé, les sotutions trouvées sont listées au tabteau.
nrÿæ \p,5
1nl
lh/.mI!,mp},
m)^):- ù-tù
5.ofu cû,o^eoa^ TrôLÀ,
ü **ü o *1"^
ono".
u
o/1-eo4rô
:
W
0
Les obiets Les obiets
étectriques
28J
OUVRAGES, JEUX ET VIDÉOS AUTOUR DE L'ÉLECTRICITÉ
@@
@
U'r'k, Ie cochon électrique
Louise de New Yorl<
Le serpent électrique
Karin Serres et Titl Charlier
o Rouergue . 2077. 72,20€
Jean Poderos et Gaia Guarino
Daniel Pennac et Aldo Ciccolini
@ Galimard jeunesse . zoor . 6,ro
Touché par [a foudre, Ulk devient un générateur électrique. Tout le monde ['utilise à
tous les usages courants de ['étectricitê.
. 2073. zz€
Panne générale d'électricité dans [e quartier new yorkais de Louise, qui part à la
recherche du responsabte.
@
@
Clic ['énergie
J'éteins [a Iumière
pour économiser ['énergie
O Editions courtes et [ongues
Nuria et Empa Jimenes @ Mediaspaut. 2o10
.
10,2o€
un
Une petite histoire de l'énergie puis
constat de ['utitisation prédominante de
l'énergie étectrique. Comment la fabriquet-on, quetles conséquences sur l'environnement et comment ne pas [a gaspitter?
Le
€
fit étectrique devient serpent et indique
à [a petite héroine de ['histoire tous les
usages de t'étectricité.
@@@
Jean-René Gombert et loëtle Dreidemy
@ félan vert . 2006. 72,20€
Electro à ['écote
rér.3t452
. À partir de 16,90 €
Avec le stylo, l'enfant répond aux questions
@ Nathan
sur ['êcole.
Des doubles-pages introduites par une
question sur ['énergie suivies de zooms
donnant les explications.
6à
§ÿ
e, §,
Théo et Léa,
une iournée à [a maison
Les Domosores
Le lièvre et [a tortue
L'étectricité
htt p://ww w.lesd
http://www. lesite.tv/videotheque/
http:i/www.tesite.tv/videotheque/
hl I p://www conso.net/5ecurite
domestique FR/index jeu.htmt
Un jeu en ligne permettant de
trouver dans une maison toutes
les situations dangereuses, pas
uniquement les risques dus
t'êtectricité.
286
@@
à
om
oso res.fr
Un jeu en ligne permettant de
trouver dans une maison toutes
les situations dangereuses, pas
uniquement les risques dus à
['é
lectricité.
o
678. oo16. oo - le- liev re-et- la-to rtu e
Une vidéo sur la notion d'éner-
gie et l'intérêt des énergies
renouvetabtes. À tétécharger
avec un abonnement au site
Lesite.tv.
@
oZ53.oo18.oo
-
[e
lect ricite
D'où vient et à quoi sert ['étectricité? Vidéo ponctuée d'une
comptine sur les dangers ê[ectriques. À tétécharger avec un
abonnement au site Lesite.tv.
a o e à ou its our [a classe
outils cités ci-dessous ne sont pas tous utilisés dans les constructions proposées dans l'ouvrage mais peuvent être utiles.
Les
TRACER / PLTER
Pour qui
Désignation
?
/
Utitisation
Photo
Fournisseur
Référence
Prix zor5
PITEC
509055
2,59€
OPITEC
366t 46
2,29€
OPITEC
166+6t
3,19€
OPITEC
3o65o8
3,49€
OPITEC
3o8131
7,50€
OPITEC
5o9240
r,69€ [a pièce
5€ [es ro
PLIOIR
L
teves
Enseignant
Prê-plier le papier cartonné. Peut être remplacé par une
aiguille à tricoter métallique ou un stylo bille dont on retire le
réservoir d'encre.
POINTE À TRACER
Permet de tracer sur le plastique ou [e bois
O
RÉGLET
Enseignant
Facilite [e tracê avec son o en bout du réglet et son bout
d'éq uerre.
DÉCoUPER
SCIE À ARCHET
Elèves
Sans danger. Pour bois et carton. Fixer ['élément à scier avec
de l'adhésit doubte-face sur une ptaque martyre.
PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE ET SANS RÉGLAGE
Lleves
lI faudra aider les élèves car l'écartement de la pince est un
peu grand pour leurs mains.
Attention aux pinces dont [e réglage se fait à ['aide d'une vis,
les élèves les dérèglent sans arrêt.
PERCER
POrNçONS
É
tèves
Percer papiers et cartons façon coupon à détacher. Positionner
OPPA
l'é[ément à percer ou découper sur un sandwich de carton.
E
lève s
VRILLE
C0
L;r
OPITEC
334064
3,79€
Pour poinçonner papiers, cartons, ptastiques souples.
A utiliser avec plaque martyre et marteau.
OPITEC
36964
8,99€
/ PLANCHE À OÉCOUPTN
Protège [a table pour les opérations de poinçonnage
et de sciage. Ne désaffûte pas les arêtes tranchantes.
IKEA
Legitim
7,49€
OPITEC
343044
2,gg€
ro5oo8
7,59€
Pour le bois.
SET D'EMPORTE.PIÈCES
tteves
PLAQUE MARTYRE
É
tèves
Elèves
MARTEAU, PANNE DE
looc
Toujours vérifier que [a panne est bien sotidaire du manche.
PERFORATRICE
Elèves
L
teves
Choisir une perforatrice permettant de transpercer plusieurs
feuiltes. Cela permettra de percer [a mousse et [e papier cartonné. ll existe des perforatrices longs bras et des perforatrices avec des motifs de formats et de formes très variées.
PERCEUSE
/
]PC
Créati ons
VTSSEUSE /DÉV|SSEUSE
Permet [e perçage de carton et des bois tendres.
I
KEA
F
ixia
24,99€
ASSEMBLER
É
lèves
Étèves
É
tèves
PISTOLET À COI.I-E BASSE TEMPÉRATURE
Assemble tout ou presque. Seul le bossetempérot&re est utilisable en classe car [a coLLe n'est chauffée qu'à rooo et non à
zooo dans le cas des pistolets habituels.
PINCE À GILLETTER
Sert à poinçonner et à æilletter papier, carton, tissu, cuir...
SERRE.JOINT
Pour la fixation ou le pressage des é[éments à co[[er.
O
PITEC
3oo487
28,9o€
340337
7,99€
304595
t,65€
OPITEC
ou grandes
s u
rfaces
OPITEC
ou grandes
s u
rfa ces
Les obiets Les obiets
électriques
28/
Liste des fournisseurs
SITE
ADRESSE
FOURNI5SEURS
OPITEC H0BBYF X France
Opitec
8 rue Paul Cézanne.93360 NEU LtY
Outils, matériaux, consommables
www opitec.com
PLAISANCE
ADU IS
Aduis DO-lT
Outils, matériaux, consommabtes
r6 rue de
ZiegeLau.6Tloo
ta
www aduis fr
STRASB0URG
TECHNOLOGIE SERV CES
.4zjjo SAINT GALMltR
Technotogie Services
l\4atières plastiques
ww
Zl du cavé
w.te ch
soclÉTÉ A4
o
5 avenue de l'Atlantique 9r94o LES ULlS
A4 Technologie
l\,,1atières p la stiq ues
. 16 rue de l'Etang
. 95977 ROISSY CDG
RAJA
Raja
Paris Nord 2
BoîtÊs et embaLlages
gies e rvices. f r
n o Io
www a4.fr
Cedex
lkea
www.ikea.com
leux, boîtes...
IPC CRÉAIIONS
PC Créatlons
I
Parc d'activités Entre Dore et Allier
63r9o
'
www.jpccreations com
LEZOUX
RADIS ET CAPUCINE
BP 5o116 ' 4980o IRÉLAZÉ Cedex 03
Radis et Capucine
lardinage
www radisetcapucine.com
4z rue des Perreyeux -
Petits élevages
age d'escargots, de papittons, de phasmes
!e
.
Atlée des frênes-BP 5o
J!reautlque et Ioisirs et créallons
SÉBASTIEN NOGUE
. 27760 LES BAUX-DE-BRETEUIL
www.petits-elevages tr
9 rue du Nouilton
..
DIDACTIK . PIERRON ÉOUCNTIOU
CS 8o6o9 REMELFING o 572o6 SARREGUENIINES Cedex
Pierron éducation
l\ atériel pour [es étevages
WESCO
www.pierron fr
WESCO SA
Bacs à eau, circuits et obiets de transvasement /
lardinage / Monde animal / lVlonde végétal
Route de Chotet CS 8o184
ASCO.CELDA
ww w.we s co
'
ASCO.CETDA
Corps humain / luatière / Le monde du vivant
Les animaux / Les végétaux
r5 rue du Dauphiné-CS /4018.69969
www.oppa-montessorl net
9 rue de la Ciaye.45ooo 0RLEANS
leux, outils...
Ir
sh o p.
www celda f
C0RBAS CEDEX
OPPA IllONTESSORI
OPPA I\IONTESSORI
-e
79141 CERIZAY
lndex des ouvrages cités
i
pol
s
À
q!l
À
qui est ce nid?
ou à plumes?
111
124,1)4
est ce nid?
134
À qui est cet æut?
Agathe
79, 86
22, 46
Arbres
712
Atchoum
77
Au it, Ludol
16
!s
Augustine ne rentre p
dans ses bottes 46
14
Avant aplès
Axlnamu
111
Ba thazar
à touchel
86
86
Construire une maison
Couleurs de Pittau
et Gervais
224
Dans la nult nolre
190
goûts et des odeurs
46
Deux manchots sur un glaçon
156
Dis,
t!
16
dors?
Dix petites graines
110
DrôLe
d'engin pour Valentin
Drôles de peaux!
E5pèce
de corni.hon
Ferme [es yeux
Fernand
75, 86
du potôger
serpent é ectrique
Le
voyage de l'escargot
111
1)4
et mol
86
Mon premier [ivre de.uisine
224
lMon papa ma maman
110
lllon premler livre de yoga
286
lvlon théâtre d'ombres
85
l\4onsieur S.arlatine
28,46
194
17
111
Non, je n'al jamais mangé ça
le veux grnndirl
46
Les deux malsons
156
oh I les joties petites bêtes
112
Où va I'eau?
156
le!
d'ombres
q8,
rya
258
L'heure rouge
194
L'histoire du bonbon
101
L'ombre de Zoé
790
L'ouragan
172
La clinique des io!ets
156
La FamiLLe Souris dîne
au clair de lune
244
La fe rme
111
La ferme Wakou
111
La lête de la tomate
110
La lorêt
172
La grenouille qui avait
une grande bouche
La grosse laim
de P'tit Bonhomme
86
106,1ro
La machlne de l\4ichel
224
La petite galerie de Calder
270
Le bateau de I\4onsieur
Zorg ouglou
Le garagiste
Le lapin noir
110
172
234, 242
142, l46,I5b
)L)
1E2, 19o
110
I
Les Petits Cæurs
aussi vont chez le docteur
17
Pâte à sel
1)4
s.iences Nature[[es
85
Petit Francl( ar.hitecte
za6
Les
Les trois
petits.ochons
1)a, 1)4
Les voitu res
242
Llll se brosse les dents
286
Lucas et Lola aiment les bébês animaux
À,,1a
première boîte à outlls
l\4a
voiture
Petil, petit, petlt
Quand
i
86
Quand j'étais petit
14
Quand je serai grand
242
Quelle est ton ombre?
Qui a mangé?
86
Qui des trois
l\4aridoc: les animaux de la lerme
111
Ramène ta fraise
lMes maisons
74
134
du monde
P'tits DOCS: le brlcolage
14
Toujours
134
les maisons du monde
lMes
P'tits DOCS: les voitures
lMes
petites bêtes à toucher
242
156
lMes premières découvertes
Mes premières déaouvertes:'escargot
lMes
premlères dé.ouvertes: la forêt
premières découvertes
À
es oremièTes découvertes:
lMp. pr" n è1".
oêio,.êr'er'
Me> P-Prie e' o" oL\e"'"
Un oup dans e potager
Un peu perdu
le
u
ê
lJne vle merveilleuse
ê Po
E5
\!o
E5
110
tout petit coup de main
Va-t'en, grand monstre vertL
156
286
Une nouvelle maison
pour la lamilLe Souris
85
14
16
94, 101,110
74,86
111
:
^,4es
la
vle des animaux
rien?
Urk. le cochon é[ectrique
Un
112
112
17
lMes
110
156
85
Tom ne veut pas dormir
DOC5:
méchant?
Rien qu'une petite grippel
17
P'tits
46
190
Raymond rêve
P'tlts DOC5: chez le docteur
i\rles
46
85
est e Plus
l\,4es
lvles P'tits DOCS: le pain
14
156
pleut
224
ivlaxldoc: qui mange quoi?
86
I
Qu'yatillà-dedans?
lMaxidoc: de l'æuF à la Poule
l\larmitons en classe
La lamille Souris
et la mare aux libelluLes
La vieille guimbarde
46
r6
Le premier jour de ma vie
Le
:
l\rlinlatures en pâte à sel
Le pigeon a besoin
d'un bon baln I
Le secret
premières dé.ouvertes
les animaux de la terme
lv4es
Le zoo sans animaux
La promenade de Flaubert
254
85
190
Le petit théâtre d'ombres
76
74
712
Le petit poisson rouge
mon bain
14
111
l
110
le ne veux pts prendre
La petite poule rousse
Dokéo, ie.omprends
aomment ça marahe
I
78, E6
Dans Ia cuislne
Des
288
41, 46
41,46
D'où viennent [es bébés
anlmaux?
110
224
l'apprends à cuisiner
lack et le haricot magique
134
134
Couleurs de Hervé Tullel
l'ai grandi ici
134
258
Chacun sa malson
22, 46
L'arbre en bois
et
C'est 'heure de manger
2ao. 2a6
Kldidoc D'où ça vient?
Boucle d'or & les trols ours
es trois o!rs
où?
1)4
179
Bo!cle d'or
lggy Peck l'archite.te
ll est
85
274
Bon appétit I
i!,\onsieur Lapln
Bon appétit les animalx
Gerbl
134
l
es
loue avea les conte5
et les matières
Bascule
Gare au gaspi
Vent lrais
172
Vive le ventl
Voilà la pluie
172
I
Vrouml Vrouml
Zignongon
112
156
242
262, 27a
Ce document SCIENCES À
VVng
du présent dossier de 288 pages et du DVD-Rom correspondant.
l[ n'est complet qu'avec ces deux composantes.
MATERNELLE se compose
INSTALI.ATION ET IÂNCEMENT
Ce DVD-Rom est compatible Windows/Mac,
Vous pouvez retrouver dans le répertoire \Ressources\ de ce DVD-Rom les planches
Version
à imprimer (.pdf).
PC
Depuis le «Poste de travai[>r, faites un ctic-droit sur le disque «SDL-Rom» puis choisissez «Explorer>r.
Doubte-cliquez sur [e fichier «pourPC.exe».
Version Mac
Double-cliquez sur le disque «SDL-Rom» apparu sur votre bureau. Puis double-ctiquez sur Ie fichier «PourMac».
En cas de problèmes lors de l'exêcution, consultez le fichier «Lisezmoi.txt» sur [e disque.
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au o3 88 79 76 37.
Envoi gratuit du catatogue annueI des éditions ACC:S
sur simple demande auprès de
AccÈs Éditions
13 rue du Château d'Angletene
67300 SCHILTIGHEIt
Té1.03 æ7997 67
Fax 03 88 79 09 85
www.acces-editions.com
scrENcEs À vrvnr
MATERilELLI
O ACCÈS Édition:
13 rue
du':1ï::
SiiiT'ff;
Auteurs
Dominique Lagrauk
Nicolas Brad
Dominique Legol
LdrtncE
Léa Sdrneider
lllustrations
Yannick Lefrançot
Emmanue[[e Di Martinc
Couverfrie
Christian Voh:
Conception graphîqæ
Accès Editiorr
lmprimé en Allernagne
Dépôt légaL mai zo:.;
z" édition: novembre zm;
ISBN : 978-z-9o9295-ot -l
et l'encre utilisés pour I'impressior
de cet ouvrage respectent l'environnemmt
Le papier
Sciences à vivre maternelle
lsBN 978-2-909295-07-7
AccÈs Éditions
13 rue du Château d'Angleterre
673oo Schiltigheim
Té1. o3 88 tg 9t 6t
ililil
il]lilt l] ll ilIilil|
I
I
lll
60€