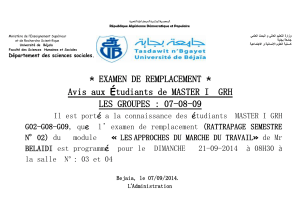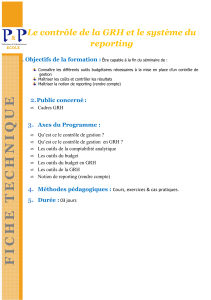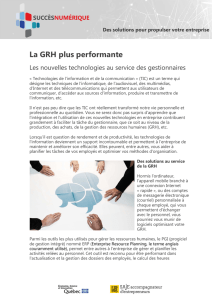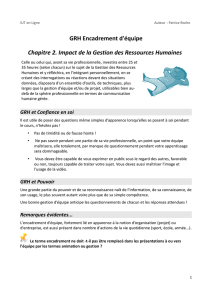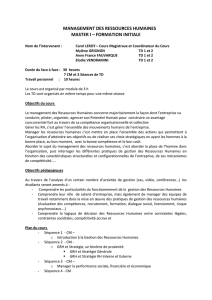1
INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT ET
DE TECHNOLOGIE-St Salomon
Autorisation N° 010/MESRS/CAB/DC/SGM/DPP/DGES/DEPES/SA
N° IFU : 3202113332263
En face du marché Godomey-hwlacomey, Abomey-Calavi, République du Bénin
Master in Business Administration 2
********
COURS DE
SUIVI &EVALUATION DES
PROJETS
********
Chargé du Cours : Appollinaire Yaovi HOUESSOU

2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cours animé par Appollinaire Yaovi HOUESSOU, spécialiste en MP et en GRH, Docteur en Sociologie
de Développement. Tél : 97 77 72 60. Email : [email protected]
I. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue du cours, l’auditeur doit :
Comprendre ce que sont le suivi et l’évaluation dans le cycle de vie du projet
Pouvoir établir les complémentarités et les différences entre le suivi et
l’évaluation
Pouvoir mettre en œuvre une démarche de suivi- évaluation.
II. METHODE PEDAGOGIQUE
- Cours magistral ;
- Etudes de cas
-Durée du cours : 20 heures
III. CONTENU DU COURS
CHAPITRE 1 : LE SUIVI DANS LE CYCLE DE PROJET
A.- Définition du Suivi
B.- Rôles du suivi
C.- Caractéristiques
D.- Utilité du suivi
CHAPITRE 2 : L’EVALUATION DANS LE CYCLE DU PROJET
A.- Définition
B.- Les différents types d’évaluation
C.- L’objet de l’évaluation
CHAPITRE 3 : ELABORATION D’UN SYSTEME DE SUIVI EVALUATION
A.- Le suivi et l’évaluation : complémentarités et différences
B.- Définition du système de suivi-évaluation
C.- Les différentes étapes de l’élaboration d’un système de suivi-évaluation
D.- La démarche de l’évaluation
E.- Les fonctions de l’évaluation
F.- Les étapes d’une évaluation
F.1. Avant l’évaluation

3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cours animé par Appollinaire Yaovi HOUESSOU, spécialiste en MP et en GRH, Docteur en Sociologie
de Développement. Tél : 97 77 72 60. Email : [email protected]
F.2. Pendant la réalisation de l’évaluation
F.3 La structuration d’un système de suivi-évaluation
F.4 Le processus d'évaluation de projet
F.5 Caractéristiques et contenu du rapport d'évaluation
CHAPITRE 4 : CONSTRUIRE UNE DEMARCHE DE SUIVI-EVALUATION : LES
DISPOSITIFS ET LES OUTILS DE SUIVI-EVALUATION
A) Les dispositifs du Suivi-évaluation
B) Les outils de suivi-évaluation
C) Les indicateurs de Suivi-évaluation
D) Le Cadre Logique comme outil de suivi-évaluation
Annexe : Terminologie de Suivi Evaluation

4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cours animé par Appollinaire Yaovi HOUESSOU, spécialiste en MP et en GRH, Docteur en Sociologie
de Développement. Tél : 97 77 72 60. Email : [email protected]
INTRODUCTION
Le suivi-évaluation est une activité importante de la gestion de projet en ce sens qu’il
permet de mesurer les résultats et les effets et cela est hautement souhaitable tant
pour les partenaires, les bénéficiaires que pour les techniciens chargé de la gestion
quotidienne du projet. C’est la raison pour laquelle on n’accordera jamais trop
d’importance au suivi-évaluation.
Compte tenu des moyens et ressources toujours limités pour réaliser un
projet, l’accent est en effet de plus en plus mis sur le suivi et l’évaluation afin de
garantir autant que possible l’atteinte des objectifs du projet en termes de résultats et
effets et d’impact tant par les responsables du projet, les bénéficiaires que par les
financeurs institutionnels. D’où le regain d’importance pour le suivi et l’évaluation
dans la gestion des projets. Ces dernières années même, certains partenaires ont
mis à l’honneur la gestion de projet axée sur les résultats (GAR) qui est une façon on
ne peut plus claire de souligner le résultat comme étant la raison d’être du projet.
CHAPITRE 1 :
LE SUIVI DANS LE CYCLE DE PROJET
A.- Définition du Suivi
Le suivi est une collecte et une analyse régulière d’informations dans le but de
faciliter en temps utile la prise de décision, d’assurer la transparence et de servir de
base à l’évaluation et à la capitalisation de l’expérience.
C’est une fonction permanente qui utilise la collecte méthodique de données afin de
fournir aux responsables et aux acteurs à la base d’un projet en cours d’exécution,
des indications sur l’état d’avancement et la progression vers les objectifs retenus.
Le suivi fournit les données nécessaires par des mécanismes formels, c’est-à-dire le
relevé d’indicateurs sélectionnés et la collecte de données sur des critères de
performance, ou informels c’est-à-dire le recueil et l’échange d’impressions tirées
d’entretiens avec les acteurs et d’observations sur le terrain. Le suivi est centré sur le
recueil régulier d’informations et la vérification à intervalles rapprochés des progrès
réalisés sur le court terme, complétés par l’analyse des implications de ces progrès.
Dans la pratique, le suivi et l’évaluation se recoupent dans un processus méthodique
de réflexion et de capitalisation participative. Par exemple, si un suivi régulier révèle
que les choses ne se déroulent pas comme prévu, il est possible d’entreprendre une
évaluation plus approfondie de tel ou tel aspect pour en comprendre les raisons et
déterminer les actions à entreprendre.

5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cours animé par Appollinaire Yaovi HOUESSOU, spécialiste en MP et en GRH, Docteur en Sociologie
de Développement. Tél : 97 77 72 60. Email : [email protected]
Lors de la mise en œuvre d’une action ou d’un projet, le suivi :
- est une activité systématique (quotidienne, hebdomadaire, …) ;
- compare l’évolution du projet aux prévisions afin d’identifier des mesures
correctives nécessaires ;
- intervient à tous les niveaux de la mise en œuvre (administrative, financière ou
opérationnelle) ;
- utilise les rapports formels et des communications informelles (causeries…) ;
- met l’accent sur les ressources, activités, résultats et différents sujets de suivi.
B.- Rôles du suivi
Dans le cadre de la conduite de projet, le suivi est un instrument :
- de contrôle : il induit la possibilité d’un pilotage attentif dans la mesure où il
s’attache à vérifier que les données recueillies correspondent aux prévisions ;
- de gestion avisée : les informations recueillies et traitées doivent stimuler
l’analyse des acteurs impliqués dans l’action. Le suivi permet de prendre des
mesures pratiques, d’apporter des corrections à la mise en œuvre d’une action et
des réajustements ;
- de veille permanente pour détecter les anomalies éventuelles qui surviendraient
par rapport aux prévisions du projet afin de réagir de manière appropriée ;
- de préparation des temps d’évaluation qui interviendront aux stades
importants de mise en œuvre d’un projet ou la fin de celui-ci, et il en facilitera
l’approbation, la mesure des effets et l’impact.
C.- Caractéristiques
Le suivi doit être un dispositif :
Léger : il ne doit pas exiger ni beaucoup de temps, ni beaucoup d’argent ;
Ciblé : déterminer clairement les informations qu’il faut connaître et suivre et choisir
quelques indicateurs pour les exprimer ;
Concerté : il faut le plus grand nombre d’acteurs participent au suivi et le
comprennent.
Il faut combiner le quantitatif et le qualitatif, les informations quantitatives et
qualitatives se complétant.
D.- Utilité du suivi
Le suivi sert à adapter le projet circonstances évolutives de son environnement :
En repérant les anomalies en cours d’exécution. Le suivi est alors un moyen
de contrôle des réalisations par rapport aux prévisions ;
En apportant les corrections à la gestion de l’action et des réajustements
techniques nécessaires.
Le suivi : une démarche à prendre en compte tout au long du projet
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
1
/
36
100%