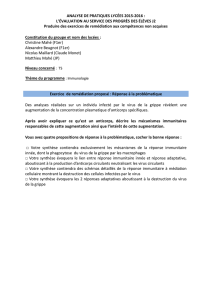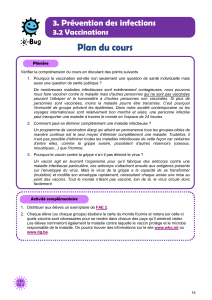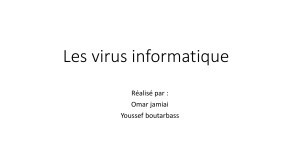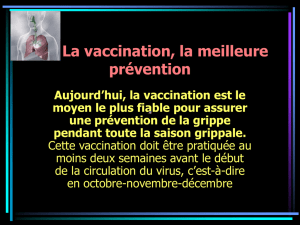La grippe saisonnie
`re
Seasonal flu
A. Vabret
a,
*, J. Dina
a
, D. Cuvillon-Nimal
b
, E. Nguyen
a
, S. Gouarin
a
, J. Petitjean
a
, J. Brouard
b
, F. Freymuth
a
a
Laboratoire de virologie, CHU de Caen, avenue Georges-Cle
´menceau, 14033 Caen, France
b
Service de pe
´diatrie, CHU de Caen, avenue de la Co
ˆte-de-Nacre, 14000 Caen, France
1. Introduction
Les virus influenza A et B sont les agents habituels de la grippe
saisonnie
`re. Le virus influenza C est beaucoup plus rare [1].La
grippe est une infection respiratoire fre
´quente, tre
`s contagieuse,
Pathologie Biologie 58 (2010) e51–e57
INFO ARTICLE
Historique de l’article :
Rec¸ u le 22 janvier 2010
Accepte
´le 26 janvier 2010
Disponible sur Internet le 19 mars 2010
Mots cle
´s:
Virus influenza
He
´magglutinine
Neuraminidase
Variabilite
´
E
´pide
´mie
Infection respiratoire
Immunofluorescence
Tests rapides
RT-PCR
Keywords:
Influenza virus
Hemagglutinin
Neuraminidase
Variability
Epidemic
Respiratory infection
Immunofluorescence
Rapid test
RT-PCR
RE
´SUME
´
La grippe saisonnie
`re est due aux virus influenza A et B. Il s’agit de virus enveloppe
´s dont le ge
´nome est
constitue
´de sept a
`huit fragments d’ARN. Les diffe
´rents sous-types sont de
´termine
´s par la nature des
deux glycoprote
´ines de surface HA et NA. La grippe saisonnie
`re est une maladie e
´pide
´mique et hivernale
dans les zones a
`climat tempe
´re
´. Son e
´pide
´miologie est lie
´ea
`la grande variabilite
´du virus au cours du
temps, ne
´cessitant la mise en place d’un syste
`me d’alerte de
´tectant chaque anne
´e les variants circulants
dominant et de
´terminant la composition vaccinale. Les sympto
ˆmes cliniques de la grippe ne sont pas
suffisamment spe
´cifiques pour permettre le diagnostic sans examen virologique. Cela est particulie
`re-
ment vrai en pe
´riode non e
´pide
´mique, chez les sujets de plus de 65 ans et chez les enfants de moins de
cinq ans. L’enfant repre
´sente une cible privile
´gie
´e des infections a
`virus influenza. Le recours a
`
l’hospitalisation est d’autant plus e
´leve
´que l’enfant est jeune. Chez le nourrisson, l’infection peut e
ˆtre
paucisymptomatique et s’accompagner de manifestations non respiratoires (le
´thargie, convulsions,
malaises). Le diagnostic virologique de la grippe est justifie
´chez tous les sujets hospitalise
´s pour un
syndrome respiratoire compatible avec une infection a
`virus influenza. Il existe plusieurs outils
permettant une recherche directe du virus dans les se
´cre
´tions respiratoires : isolement du virus en
culture, de
´tection d’antige
`nes, de
´tection mole
´culaire de l’ARN. Le choix de la me
´thode se fait selon les
caracte
´ristiques du test : sensibilite
´, spe
´cificite
´, rapidite
´et simplicite
´de re
´alisation, cou
ˆt.
ß2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits re
´serve
´s.
ABSTRACT
Seasonal flu is caused by influenza viruses A and B. These enveloped viruses have a genome made up of
seven or eight RNA fragments. The different subtypes are determined by the nature of the two surface
glycoproteins HA and NA. Seasonal flu is an epidemic wintertime illness occurring in temperate climate
zones. Its epidemiology is linked to the great variability of the virus in time, necessitating an alert system
that detects dominating circulating variants each year and that determines the vaccination composition.
Clinical flu symptoms are not sufficiently specific to allow for diagnosis with virological tests. This is
especially true during non-epidemic periods as well as in subjects older than 65 and younger than five.
Children are especially vulnerable to influenza virus infections. Hospitalization occurs more frequently,
the younger the child. In children younger than two years, the infection can be pauci-symptomatic and is
sometimes detected from non-respiratory symptoms such as lethargy, convulsions, and dizziness. In all
cases of respiratory syndrome compatible with influenza virus infection in hospitalized subjects,
virological flu diagnosis is of utmost interest. Several tools are available to allow for direct viral detection
in respiratory specimens: cell culture isolation, antigenic detection, RNA molecular detection. Choice of
method is based on the characteristics of the test: sensibility, specificity, speed and ease of realization,
and cost.
ß2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : [email protected] (A. Vabret).
0369-8114/$ – see front matter ß2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits re
´serve
´s.
doi:10.1016/j.patbio.2010.01.009

qui peut e
ˆtre grave et entraı
ˆner l’hospitalisation des patients. Cet
article pre
´sente les e
´le
´ments du fil conducteur qui peut conduire a
`
un diagnostic de grippe saisonnie
`re : l’e
´pide
´miologie et la
transmission de l’infection, la symptomatologie chez l’adulte et
l’enfant, et l’identification par le diagnostic virologique. Le
traitement de la grippe et les vaccins anti-grippaux ne seront
pas traite
´s dans ce manuscrit.
2. E
´pide
´miologie
La grippe se manifeste sous trois formes : sporadique, quelques
cas dans la population ; e
´pide
´mique, avec des cas plus nombreux,
s’e
´tendant rapidement et se propageant dans une re
´gion ; et
pande
´mique, lorsque l’extension de l’infection est rapide et
ge
´ne
´ralise
´ea
`l’ensemble de la plane
`te. La grippe dite
« saisonnie
`re » est une infection e
´pide
´mique, fre
´quente, en ge
´ne
´ral
annuelle et hivernale dans les zones a
`climat tempe
´re
´.Enge
´ne
´ral,
on observe d’abord des cas sporadiques qui e
´voluent vers une
circulation e
´pide
´mique. Ainsi, chez les patients hospitalise
´sau
CHU de Caen, les 1770 virus influenza isole
´s entre 2000 et
2006 repre
´sentent 33 % des 5356 virus respiratoires de
´tecte
´s
pendant cette pe
´riode, presque autant que le virus respiratoire
syncytial (1819, soit 33,9 %) et plus que les rhinovirus (1118 soit
20,8 %). La grippe est une maladie franchement hivernale : dans
cette e
´tude, 49 % des virus influenza A et B sont isole
´s en janvier et
fe
´vrier, contre 25 % en novembre et de
´cembre, et 26 % en mars et
avril (Fig. 1). L’aspect e
´pide
´mique est une caracte
´ristique majeure
de la grippe. L’e
´pide
´mie associe le plus souvent les deux types A et
B de virus. Les infections a
`virus influenza A sont les plus
fre
´quentes : 1525 cas (76,7 %) au cours des huit dernie
`res
e
´pide
´mies au CHU de Caen. Les infections a
`virus influenza B sont
moins fre
´quentes : 463 cas (23,2 %), et tre
`s rarement majoritaires
(hiver 2005–2006) ; de plus, elles sont souvent de
´cale
´es de
plusieurs semaines en fin d’e
´pide
´mie (Fig. 2). Les e
´pide
´mies sont
d’importance variable. Le nombre moyen de grippes de
´tecte
´es
chaque hiver au CHU de Caen est de 248,5, mais il varie de 175 a
`
406 cas (2,3) d’une anne
´ea
`l’autre. La variation est plus nette
pour les infections a
`virus influenza A, qui fluctuent entre 67 et
405 cas par hiver (moyenne : 190,6 cas), tandis que les infections a
`
virus influenza B varient entre 0 et 144 cas (moyenne : 57,8 cas).
La grippe saisonnie
`re est une affection tre
`s contagieuse. La
transmission de personne a
`personne des virus influenza se fait
surtout par les ae
´rosols a
`grosses particules e
´mis lors des
e
´ternuements ou de la toux [2]. La contamination ne
´cessite que
les individus soient a
`proximite
´(moins d’un me
`tre) les uns des
autres, car ces gouttelettes ne restent pas en suspension dans l’air.
Elles se
´dimentent sur les surfaces et les objets, cre
´ant ainsi une
autre source possible de transmission. La transmission ae
´rienne
des virus influenza, par des ae
´rosols de petites particules
(<0,5 m
m
) qui resteraient en suspension dans l’air pendant de
longues pe
´riodes n’est pas vraiment documente
´e[3,4]. Les adultes
e
´liminent du virus par voie ae
´rienne, de 24 heures avant le de
´but
des sympto
ˆmes (la dure
´e moyenne d’incubation est de deux jours)
jusqu’a
`cinq a
`dix jours apre
`slede
´but de la maladie [5]. Cependant,
dans des infections humaines expe
´rimentales, on observe que le
titre infectieux des se
´cre
´tions respiratoires chute notablement de
`s
les trois a
`cinq premiers jours de la maladie [6,7]. La transmission
du virus grippal de sujet a
`sujet est donc surtout marque
´e au tout
de
´but de la maladie. Chez les jeunes enfants, la transmission du
virus est plus importante car ils e
´liminent le virus plus to
ˆt et plus
longtemps que les adultes [8]. Les patients immunode
´prime
´s
peuvent e
´videmment excre
´ter du virus pendant de longues
pe
´riodes.
3. Le virus et sa variabilite
´
Les virus grippaux sont des virus enveloppe
´s dont le ge
´nome est
constitue
´d’ARN segmente
´en sept ou huit fragments. Ces virus
appartiennent a
`la famille des Orthomyxoviridae, et il en existe
trois genres ou types nomme
´s influenzavirus A, B, et C,
d’importance de
´croissante. Pour les virus influenza A, le ge
´nome
comporte trois segments codant les prote
´ines du complexe de
re
´plication (PB2, PB1, et PA), le quatrie
`me fragment code
l’he
´magglutinine HA, le cinquie
`me code la nucle
´oprote
´ine ou
NP, le sixie
`me la neuraminidase ou NA, le septie
`me code les
prote
´ines M1 et M2 (prote
´ine de matrice et prote
´ine du canal a
`
ions), et enfin le huitie
`me fragment code les prote
´ines non
structurales NS1 et NS2 (Fig. 3). Selon la nature des glycoprote
´ines
de surface HA et NA, le type influenza A est divise
´en sous-types
se
´rologiques HxNy. Il existe 16 sous-types de HA (H1 a
`H16) et neuf
sous-types de NA (N1 a
`N9). La nomenclature utilise
´e pour
nommer les souches virales comprend les e
´le
´ments suivants,
toujours dans le me
ˆme ordre : type / lieu d’isolement / nume
´ro
d’enregistrement/ anne
´e d’isolement / HxNy. (exemple : A /
Brisbane / 59 / 2007 H1N1, la souche vaccinale de la saison 2008/
2009). Le re
´servoir des virus influenza A est aviaire, et c’est chez les
oiseaux aquatiques sauvages que l’on observe le plus grand
nombre de sous-types de virus de grippe A. Chez l’homme, n’ont
circule
´que des virus influenza A portant a
`leur surface les espe
`ces
mole
´culaires H1, H2, H3, et ponctuellement H5, H9, et les
neuraminidases N1 et N2 [9].Me
ˆme si l’ensemble des prote
´ines
structurales et non structurales est indispensable a
`la re
´ussite de la
multiplication du virus dans la cellule, la prote
´ine de surface HA
reve
ˆt une importance particulie
`re, en jouant un ro
ˆle primordial
dans les premie
`res phases du cycle de multiplication (entre
´edu
virus dans la cellule), et aussi en portant les principaux sites
antige
´niques de neutralisation.
Les proble
`mes les plus complexes de l’e
´pide
´miologie de la
grippe sont lie
´sa
`la variabilite
´du virus influenza. Ces virus varient
au cours du temps, de telle sorte que l’organisme n’est pas capable
de les reconnaı
ˆtre et donc de se de
´fendre. Ces variations sont de
deux ordres. Il peut s’agir de variations mineures dans la se
´quence
de la prote
´ine HA, qualifie
´es de « glissements », et explique
´es par un
degre
´important d’he
´te
´roge
´ne
´ite
´existant en permanence dans la
population virale se multipliant dans l’organisme infecte
´. Les virus
grippaux chez l’homme e
´voluent rapidement, en subissant une
pression de se
´lection positive (immunose
´lection) de type darwi-
nien. Certains auteurs qualifient d’espe
`ces « fugitives » les virus de
grippe A humains, car ils sont oblige
´s d’e
´voluer rapidement pour
re
´infecter la population humaine de fac¸on e
´pide
´mique la saison
hivernale ulte
´rieure. Il peut s’agir d’un changement plus complet
Fig. 1. Distribution saisonnie
`re des virus respiratoires. CHU de Caen.
En ordonne
´es : nombre de virus cumule
´s sur une pe
´riode de deux mois chez les
patients hospitalise
´s. En abscisses : septembre et octobre, novembre et de
´cembre,
janvier et fe
´vrier, mars et avril, de 2000 a
`2006.
A. Vabret et al. / Pathologie Biologie 58 (2010) e51–e57
e52

de la prote
´ine HA, appele
´« cassure », correspondant a
`un
remplacement d’un virus par un autre virus, tout diffe
´rent dans
ses caracte
`res immunologiques. En ge
´ne
´ral, ces nouveaux virus se
manifestent sous forme d’une pande
´mie [9].
Cette diversite
´et ce grand potentiel e
´volutif a implique
´le
de
´veloppement de re
´seaux de surveillance permettant de de
´celer
l’apparition de ces nouveaux virus. Ces re
´seaux d’alerte sont
locaux, re
´gionaux, nationaux, internationaux, et coordonne
´sau
final par l’OMS. Cette organisation permet l’adaptation annuelle de
la composition vaccinale. Depuis 2004, il existe e
´galement une
surveillance de la sensibilite
´des virus grippaux aux antiviraux
actuellement disponibles (oseltamivir et zanamivir). Ces deux
mole
´cules constituent les stocks nationaux de traitements anti-
grippaux, indispensables en cas de pande
´mie. Ce re
´seau a mis en
e
´vidence la circulation de virus grippal A re
´sistant a
`l’oseltamivir
lors de l’e
´pide
´mie saisonnie
`re 2007–2008 en Europe. Lors de cette
e
´pide
´mie, le virus grippal A dominant e
´tait le virus influenza A
H1N1, ce sous-type repre
´sentait par exemple en France 95 % des
de
´tections de virus grippal A de la semaine 40 de l’anne
´e 2007 a
`la
semaine 20 de l’anne
´e 2008 (du 1
er
octobre 2007 au 11 mai 2008).
Il est a
`noter que, pendant les dix saisons e
´pide
´miques ante
´rieures
en Europe, le virus influenza A sous-type H3N2 a e
´te
´dominant lors
de neuf saisons, et le virus influenza A H1N1 dominant uniquement
lors de la saison 2000–2001. En Europe, cette re
´sistance a e
´te
´
confirme
´e dans la plupart des pays europe
´ens, mais a
`des taux tre
`s
variables, allant de 2 % des souches grippales circulantes (Italie,
Espagne) a
`40 % en Belgique et en France, et plus de 60 % en
Norve
`ge. La circulation de ce variant re
´sistant s’est poursuivie dans
l’he
´misphe
`re sud pendant la saison 2008, repre
´sentant jusqu’a
`
100 % des souches circulantes en Afrique du Sud et en Australie, et a
`
peine 5 % au Japon, alors que ce pays est le plus important
prescripteur d’oseltamivir. Cette re
´sistance est lie
´ea
`une mutation
dans la prote
´ine neuraminidase (prote
´ine cible de l’oseltamivir),
situe
´ea
`la position 275 (ou 274 dans deux cas), et entraı
ˆnant le
remplacement d’une Histidine par une Tyrosine (mutation H275Y).
Cette mutation affecte la liaison de l’oseltamivir, mais non celle du
zanamivir. L’apparition de cette re
´sistance a e
´te
´spontane
´e et n’est
pas le re
´sultat d’une pression de se
´lection par l’utilisation
d’oseltamivir chez les patients infecte
´s ; les souches mutantes
ont une capacite
´de re
´plication conserve
´e (probablement lie
´ea
`une
meilleure balance fonctionnelle entre les prote
´ines HA et NA
H275Y qu’entre les prote
´ines HA et NA non mute
´e), elles ont co-
circule
´avec les souches non mute
´es, sensibles a
`l’oseltamivir ;
enfin, elles peuvent se transmettre facilement. L’analyse des
donne
´es montre l’absence de corre
´lation avec des formes cliniques
plus graves [10,11].Me
ˆme s’il s’agit d’une curiosite
´e
´pide
´miolo-
gique, l’e
´mergence spontane
´e de ce mutant re
´sistant contrarie le
dogme des souches virales dite « sauvages » naturellement
sensibles a
`la mole
´cule antivirale jamais rencontre
´e. Elle renforce
la ne
´cessite
´d’une surveillance de la sensibilite
´des souches aux
antiviraux disponibles et la ne
´cessite
´de disposer de substances
permettant une e
´ventuelle multithe
´rapie.
4. Symptomatologie de la grippe
4.1. La grippe de l’adulte
La grippe saisonnie
`re est habituellement caracte
´rise
´e par
l’apparition brutale de la fie
`vre, de ce
´phale
´es, de myalgies, d’une
toux se
`che, de maux de gorge et d’une rhinite [12]. La grippe non
complique
´esere
´sout spontane
´ment en trois a
`sept jours, bien
qu’une toux et une asthe
´nie puissent persister plus de deux
semaines. En pe
´riode non e
´pide
´mique, la symptomatologie de la
grippe n’est pas suffisamment spe
´cifique pour que la clinique
suffise au diagnostic. D’autres virus respiratoires, en particulier les
rhinovirus, certains virus parainfluenza, ade
´novirus ou corona-
virus, donnent des signes cliniques comparables a
`ceux d’une
Fig. 2. E
´pide
´mies a
`virus influenza. CHU de Caen.
En ordonne
´es : nombre d’infections a
`virus influenza A et B chez les patients hospitalise
´s. En abscisses : e
´pide
´mies hivernales de 2000 a
`2008.
Fig. 3. Repre
´sentation sche
´matique du virus influenza A. (internet http://
farm1.static.flickr.com)
Les huit segments d’ARN ge
´nomique sont e
´troitement lie
´sa
`la nucle
´oprote
´ine NP et
codent quatre prote
´ines structurales HA, NA, (M1 et M2), NP et quatre prote
´ines non
structurales PB1, PB2, PA, et (NS1et NS2).
A. Vabret et al. / Pathologie Biologie 58 (2010) e51–e57
e53

infection a
`virus influenza. Ainsi, chez des patients de 18 ans et
plus, consultant a
`l’ho
ˆpital pour une infection respiratoire aigue
¨,
une e
´tude hollandaise montre qu’un diagnostic clinique de grippe a
e
´te
´pose
´chez seulement 44 % des sujets infecte
´s par un virus
influenza [13]. En revanche, en pleine e
´pide
´mie, une simple
identification clinique de grippe base
´e sur l’apparition brutale
d’une toux et de la fie
`vre a une valeur pre
´dictive positive de 79 % a
`
88 % chez les adolescents et les adultes [14,15]. Le diagnostic
clinique de la grippe est plus difficile chez les personnes a
ˆge
´es.
Dans une population de patients infecte
´s et non hospitalise
´sde
plus de 60 ans, la valeur pre
´dictive positive de la pre
´sence de fie
`vre,
de toux et d’un de
´but brutal ne de
´passe pas 30 % [16]. Chez des
sujets de plus de 65 ans, porteurs de pathologies chroniques et
hospitalise
´s, cette valeur atteint 53 % sur les crite
`res de fie
`vre, de
toux et d’une maladie de moins de sept jours [17].
Les complications de la grippe sont classiques : infections
bacte
´riennes secondaires (pneumonie, sinusite, bronchite, etc.),
aggravation d’une pathologie pre
´existante (cardiopathies, bronch-
opneumopathie chronique obstructive ou BPCO, etc.), pneumonie a
`
virus influenza. Une large enque
ˆte cas-te
´moins faite en Grande-
Bretagne montre que les sujets atteints de grippe ont 3,4 fois plus
de risque de faire une complication respiratoire que les te
´moins ;
ce risque est majore
´pour les pneumonies : RR = 19,3, et les
bronchites : RR = 6,1 [18].
4.2. La grippe de l’enfant
L’enfant repre
´sente une cible privile
´gie
´e des infections a
`virus
influenza. Il est tre
`s expose
´car il a les premiers contacts avec les
virus de cette famille, et le mode de vie en collectivite
´des cre
`ches
et e
´coles facilite la contamination. Une e
´tude franc¸aise montre que
le taux d’attaque de grippe saisonnie
`re le plus e
´leve
´est observe
´
chez les enfants d’a
ˆge scolaire [19]. En Finlande, il a e
´te
´montre
´que
le taux d’attaque de la grippe saisonnie
`re pouvait atteindre 30 %
des enfants entre cinq et 14 ans, et aux E
´tats-Unis, les plus forts
taux d’hospitalisations pour grippe sont observe
´s chez les enfants
de moins de quatre ans et les sujets de plus de 65 ans [20,21]. Les
e
´pide
´mies de grippe de
´butent toujours dans les collectivite
´s
d’enfants. De
´ja
`en 1958, une e
´tude e
´cossaise montrait que les
premiers patients hospitalise
´s au cours des e
´pide
´mies e
´taient des
enfants et des adolescents [22]. La grippe est une cause majeure de
recours a
`l’hospitalisation. Une e
´tude re
´cente re
´alise
´e chez des
enfants de moins de trois ans consultant aux urgences pe
´diatriques
de Lyon en pleine e
´pide
´mie de grippe montre que 45 % des
630 enfants inclus sont infecte
´s par un virus influenza : 33 % chez
les 0–11 mois, 56 % chez les 12–23 mois, et 59 % chez les 24–
35 mois [23]. Le nombre d’hospitalisations pour grippe est d’autant
plus e
´leve
´que l’enfant est plus jeune. Il est de 104 et 50 pour
10 000 chez les nourrissons de moins de six mois et de six a
`
12 mois, et de 19, neuf et quatre pour 10 000 chez les enfants d’un a
`
trois ans, trois a
`cinq ans et cinq a
`15 ans, respectivement [24].
La grippe de l’enfant de plus de cinq ans est assez proche de celle
de l’adulte. Elle de
´bute brutalement avec une forte fie
`vre, des
frissons, un mal de gorge, une asthe
´nie, des courbatures et des
ce
´phale
´es ; les manifestations respiratoires sont rapidement
marque
´es : signes d’irritation laryngotrache
´ale, bronchique,
conjonctivale ; la fie
`vre et les douleurs durent trois a
`quatre jours
[25]. Deux points sont a
`souligner. Le premier concerne la grippe
du nourrisson. Elle peut e
ˆtre paucisymptomatique, s’accompagner
de le
´thargie, ou e
ˆtre traduite par des manifestations respiratoires
ressemblant a
`celles dues a
`d’autres virus respiratoires qui
circulent a
`la me
ˆme pe
´riode (virus respiratoire syncytial, virus
parainfluenza, rhinovirus) : rhinopharyngite, bronchiolite, laryn-
gite, pneumonie, otite moyenne aigue
¨. Le second concerne les
manifestations non respiratoires. Elles sont fre
´quentes chez le
nourrisson. Dans l’e
´tude lyonnaise, 28 % des enfants infecte
´s ont
consulte
´pour des sympto
ˆmes initiaux non respiratoires : fie
`vre
isole
´e (22 %), syndrome digestif fe
´brile (15 %), malaise grave du
nourrisson (1 %) [23]. En outre, 5 % des enfants ont pre
´sente
´des
convulsions fe
´briles, ce qui avait e
´te
´de
´ja
`bien souligne
´dans une
e
´tude caennaise [26].
Les complications de la grippe sont multiples ; on peut observer
une pneumonie a
`virus influenza, l’aggravation d’une pathologique
pre
´existante (cardiopathies, asthme...), une infection bacte
´rienne
secondaire (pneumonie, sinusite, otite), la facilitation d’une
seconde infection virale (ade
´novirus, herpe
`s) ou bacte
´rienne
[27]. Une e
´tude re
´cente souligne la fre
´quence des infections
invasives a
`pneumocoque quelques semaines apre
`s le pic hivernal
de grippes et de bronchiolites [28]. La mortalite
´due a
`la grippe est
conside
´re
´e comme faible chez l’enfant. Une estimation portant sur
11 e
´pide
´mies de grippe en Grande-Bretagne fait e
´tat de 78 de
´ce
`s
d’enfants d’un mois a
`14 ans lie
´sa
`la grippe [29]. Les formes dites
malignes sont extre
ˆmement rares ; elles peuvent se traduire par un
de
´ce
`s brutal dans un tableau d’alve
´olite he
´morragique majeure ou
de myocardite [30,31].
5. Identification d’une infection a
`virus influenza
L’identification d’une infection a
`virus influenza A ou B est
particulie
`rement utile en pe
´riodes pre
´- ou post-e
´pide
´mique. Elle
est indispensable chez tous les sujets hospitalise
´s pour un
syndrome respiratoire compatible avec une infection par un virus
influenza . Elle est justifie
´e si l’on recourt a
`un traitement antiviral
spe
´cifique, et elle s’impose en cas d’e
´chec the
´rapeutique.
Parmi les outils disponibles pour identifier une infection a
`virus
influenza chez un patient, la se
´rologie a un inte
´re
ˆt tre
`s secondaire.
Les re
´sultats de l’e
´tude de deux se
´rums successifs seront, en effet,
obtenus trop tardivement pour e
ˆtre utiles au diagnostic. Il existe de
nombreux outils permettant une recherche directe du virus ou de
ses constituants dans les secre
´tions respiratoires : isolement du
virus en culture, de
´tection d’antige
`nes par IF ou EIA, recherche
d’ARN par RT-PCR.
5.1. L’isolement en culture
L’isolement des virus influenza en culture sur œuf de poule
embryonne
´ou sur des cellules de mammife
`res cultive
´es in vitro
reste encore aujourd’hui la me
´thode de re
´fe
´rence de l’identifica-
tion des virus influenza. Le syste
`me cellulaire qui est le plus
largement employe
´dans les laboratoires de diagnostic est
repre
´sente
´par les cellules re
´nales de chien MDCK (Madin-Darby
canine kidney). C’est une ligne
´e continue de cellules e
´pithe
´liales
polarise
´es, posse
´dant des re
´cepteurs spe
´cifiques des virus influ-
enza (de type sialique), qui les rendent sensibles a
`l’infection par la
majorite
´des virus influenza A, B et C [32]. Les deux e
´le
´ments qui
vont conditionner l’efficacite
´de ce syste
`me pour l’isolement des
virus influenza sont l’utilisation de la trypsine, qui active par
clivage enzymatique l’he
´magglutinine virale et rend les particules
infectieuses et, a
`l’inoculation, la centrifugation des e
´chantillons
sur les cultures, qui accroı
ˆt le rendement de la culture [33].
La culture est un syste
`me d’amplification virale puissant,
capable, en the
´orie, de donner un re
´sultat positif a
`partir d’un seul
virus pre
´sent dans l’e
´chantillon. Il a l’avantage de procurer des
quantite
´s importantes de virus, ce qui peut permettre, par
exemple, d’e
´tudier plus finement leur variabilite
´antige
´nique et
ge
´ne
´tique, ou leur profil de sensibilite
´a
`un antiviral. Lorsque ces
souches sont obtenues en culture sur œuf, elles peuvent
e
´ventuellement e
ˆtre retenues dans la composition du vaccin
antigrippal. Les inconve
´nients de la culture sont nombreux, et
limitent son efficacite
´et son utilisation syste
´matique pour le
diagnostic. Elle impose des structures de laboratoire, des
logistiques et compe
´tences propres a
`la culture de cellules. La
A. Vabret et al. / Pathologie Biologie 58 (2010) e51–e57
e54

thermolabilite
´du virus, lie
´ea
`son enveloppe lipidique et a
`son
ge
´nome ARN, ge
´ne
`re des conditions particulie
`res de recueil (milieu
de transport protecteur) et de transport (rapide) des secre
´tions
respiratoires au laboratoire. Par ailleurs, celles-ci sont naturelle-
ment contamine
´es par les bacte
´ries pre
´sentes dans la cavite
´nasale.
Elles peuvent aussi contenir des inhibiteurs de la croissance virale
(interfe
´rons, anticorps, mucines), qui rendront les cultures
inutilisables (lorsque la contamination bacte
´rienne est irre
´duc-
tible), ou faussement ne
´gatives. Ainsi, il a e
´te
´montre
´que des
interfe
´rons sont de
´tectables dans les secre
´tions et le sang des
patients atteints de grippes, me
ˆme banales et non complique
´es ;
leurs niveaux maxima sont atteints un jour apre
`s le pic de
l’excre
´tion virale, et ils diminuent paralle
`lement a
`la chute du titre
viral [34]. Enfin, le dernier point qui ge
ˆne l’utilisation de la culture
pour le diagnostic de la grippe est le de
´lai de re
´ponse. Les re
´sultats
de la culture ne sont en ge
´ne
´ral pas disponibles avant quatre a
`six
jours, et un de
´lai supple
´mentaire de quelques jours est souvent
ne
´cessaire pour identifier plus finement le se
´rotype viral. Ainsi,
l’isolement en culture des virus influenza n’est pas re
´alisable dans
un laboratoire de biologie polyvalente. Il n’est pas adapte
´au
diagnostic rapide. Il repre
´sente un outil spe
´cialise
´,re
´serve
´aux
laboratoires de virologie, mais ne
´anmoins indispensable au suivi
de la variabilite
´des virus influenza et a
`la strate
´gie vaccinale.
5.2. Les techniques immunologiques de diagnostic rapide
Les laboratoires non spe
´cialise
´s peuvent faire aise
´ment le
diagnostic virologique de la grippe gra
ˆce aux techniques immu-
nologiques directes. La recherche d’antige
`nes viraux intracellu-
laires par immunofluorescence (IF) sur l’e
´chantillon respiratoire ou
d’antige
`nes grippaux extraits des pre
´le
`vements par me
´thode
immunoenzymatique (EIA) permet d’identifier en une a
`deux
heures une infection a
`virus influenza A ou B. La me
´thodologie est
simple, rapide et en ge
´ne
´ral globalement peu cou
ˆteuse.
5.2.1. Immunofluorescence
Pour l’IF, les cellules d’une aspiration (ou d’un lavage ou d’un
e
´couvillonnage) nasale ou trache
´obronchique sont, apre
`s lavage,
de
´pose
´es sur une lame microscopique et fixe
´es dans l’ace
´tone.
Des anticorps monoclonaux (disponibles commercialement)
permettent de marquer les prote
´ines virales. On choisit celles
qui sont abondamment exprime
´es dans les cellules infecte
´es, et
qui ne risquent pas de subir de variations antige
´niques :
prote
´ines NP ou M1 par exemple. La lecture de la lame d’IF se
fait soit directement lorsque les anticorps monoclonaux (de
souris) antivirus influenza sont eux-me
ˆmes marque
´sa
`l’aide d’un
fluorochrome, soit indirectement a
`l’aide d’anticorps fluores-
cents anti-immunoglobulines de souris. Bien que la sensibilite
´de
l’IF indirecte soit en the
´orie plus grande, celle-ci de
´pend surtout
du type et de la qualite
´des anticorps monoclonaux de de
´tection
ou de re
´ve
´lation utilise
´s. Des donne
´es de
´ja
`anciennes de la
litte
´rature ne montrent pas en fait de diffe
´rences significatives
entre les deux approches, et l’IF directe est me
ˆme parfois plus
sensiblequelatechniqueindirecte:65%versus45%[35].
Compare
´ea
`l’isolement en cultures de cellules, la sensibilite
´de
l’IF varie selon les e
´tudes de 65 % a
`100 % pour la de
´tection des
virusdelagrippehivernale[32–34].Lamajorite
´de ces e
´tudes
montre qu’une faible fraction des e
´chantillons sont culture-
positifs et IF-ne
´gatifs. Plusieurs raisons peuvent e
ˆtre e
´voque
´es
pour expliquer cette discordance. Les e
´pitopes reconnus par les
anticorps monoclonaux antivirus influenza peuvent e
ˆtre mas-
que
´s ou peu exprime
´s sur certaines souches virales. Plus
vraisemblablement, l’absence de cellules infecte
´es visibles en
IF tient soit a
`leur destruction rapide par l’infection elle-me
ˆme,
tre
`s cytolytique, ou en raison d’un mauvais conditionnement des
e
´chantillons, soit a
`leur recueil tardif, a
`un stade ou
`ne persistent
que de rares cellules infecte
´es ou virus.
5.2.2. Tests immunoenzymatiques
Des tests EIA « maison » ont e
´te
´de
´veloppe
´s par plusieurs
laboratoires de virologie pour la recherche des virus influenza. Le
plus souvent, la technique est la me
ˆme, et les diffe
´rences portent
sur la pre
´paration de l’antige
`ne et le type d’anticorps. Les antige
`nes
viraux extraits des pre
´le
`vements sont capte
´s par un anticorps
monoclonal dans les puits d’une plaque de microtitration, et leur
de
´tection se fait par un test EIA classique [33,36]. Leur sensibilite
´
compare
´ea
`l’isolement en culture varie de 50 a
`90 % selon les
auteurs [37]. Les tests EIA sur membrane repre
´sentent une variante
technique inte
´ressante [38]. Plusieurs de ces tests sont actuelle-
ment commercialise
´s en France pour la de
´tection des virus
influenza A et B de la grippe saisonnie
`re. Leur sensibilite
´est a
`
peu pre
`se
´quivalente a
`celle de l’IF. Le caracte
`re unitaire des tests
EIA, leurs avantages de rapidite
´et de facilite
´d’exe
´cution
compensent largement la sensibilite
´moyenne observe
´e dans
certaines e
´tudes et le cou
ˆt relativement e
´leve
´des re
´actifs. Ces tests
sont peu performants sur les pre
´le
`vements de gorge par rapport
aux pre
´le
`vements nasopharynge
´s, et l’intensite
´de la positivite
´du
test n’est pas directement lie
´e au titre infectieux de l’e
´chantillon,
mais elle est de
´pendante de la quantite
´de cellules infecte
´es de
l’e
´chantillon : 20 cellules infecte
´es suffisent pour de
´clencher la
positivite
´[39]. Cette technologie repre
´sente incontestablement
l’outil le mieux adapte
´au diagnostic de la grippe en me
´decine
ambulatoire.
5.3. Les me
´thodes de virologie mole
´culaire
Les premie
`res applications des techniques de PCR a
`la de
´tection
des virus influenza A ou B remontent aux anne
´es 1991–1992 avec
les travaux de Yamada et al., Zhang et Evans, Claas et al. et Donofrio
et al. [40–43]. Le typage des virus influenza A, gra
ˆce a
`l’identifica-
tion mole
´culaire de leurs he
´magglutines ou neuraminidases a
e
´galement e
´te
´propose
´a
`cette e
´poque [41,44]. La sensibilite
´de la
me
´thode de
´crite par Yamada et al. atteint 1,3 a
`6 UFP (unite
´s
formant plages) de virus influenza A, et l’e
´tude de 23 pre
´le
`vements
de gorge montre une concordance totale entre les re
´sultats de la
culture et de la PCR : 17 e
´chantillons sont positifs et six sont
ne
´gatifs par les deux me
´thodes. Zhang et Evans e
´tudient la
sensibilite
´et la spe
´cificite
´d’une se
´rie d’amorces permettant soit la
de
´tection des virus influenza A ou B (ge
`ne de la prote
´ine de matrice
M) ou C (ge
`ne de l’he
´magglutine), soit l’identification des
he
´magglutines H1, H2, H3 et des neuraminidases N1 ou N2, mais
aucun essai clinique n’est re
´alise
´. L’utilisation de cette PCR niche
´e
dans le diagnostic virologique de la grippe est pre
´sente
´e dans une
autre e
´tude [45]. Dans celle-ci, la sensibilite
´analytique de cette RT-
PCR niche
´e en culture est de 1 a
`5 UFP de virus influenza A H1N1, A
H3N2 ou B. Sur 619 pre
´le
`vements respiratoires analyse
´s pendant
l’hiver 1995–1996, 246 (39,7 %) sont positifs par RT-PCR, tandis
que 200 (32,3 %) contiennent un virus influenza en culture. La
sensibilite
´supe
´rieure de la technique mole
´culaire sur la culture est
encore plus nette en pleine e
´pide
´mie grippale ou
`57,5 % des
e
´chantillons sont positifs en RT-PCR contre 38,9 % en culture. La
technique rapporte
´e par Donofrio et al. a e
´te
´utilise
´e dans plusieurs
e
´tudes. Ces auteurs rapportent les re
´sultats obtenus sur une petite
se
´rie de pre
´le
`vements respiratoires et ne notent pas de diffe
´rence
de sensibilite
´entre la culture : 14 positifs sur 33, et la RT-PCR :
15 positifs [43]. Atmar et al. retrouvent la me
ˆme correspondance
entre les re
´sultats de la culture et de la RT-PCR : 20 e
´chantillons
sont trouve
´s positifs sur les 72 par les deux approches [46]. Dans
une e
´tude sur l’infection expe
´rimentale de volontaires humains
par un virus influenza, Cherian et al. observent que cette technique
A. Vabret et al. / Pathologie Biologie 58 (2010) e51–e57
e55
 6
6
 7
7
1
/
7
100%