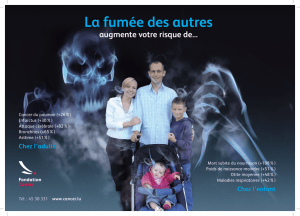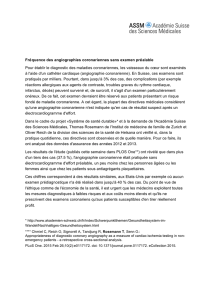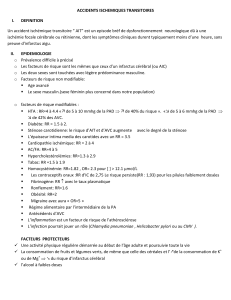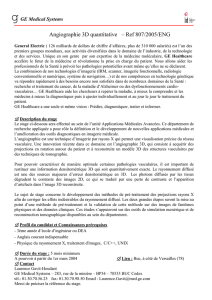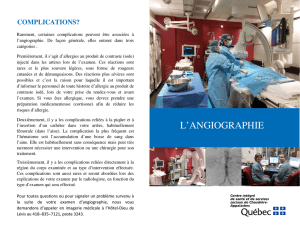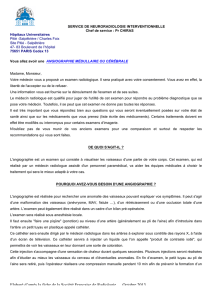Angiographie cérébrale : Complications et étude sur 450 examens
Telechargé par
inoussadaouda

ARTICLE ORIGINAL
ANGIOGRAPHIE CÉRÉBRALE : ÉTUDE DES COMPLICATIONS
SUR 450 EXAMENS CONSÉCUTIFS
D Berteloot (1), X Leclerc (1), D Leys (2), R Krivosic (3) et JP Pruvo (1)
ABSTRACT Cerebral angiography: review of complications in 450 consecutive examinations
Purpose : To evaluate all types of complications, both minor and major, associated with modern cerebral angiography.
Materials and Methods : A prospective study of 450 consecutive cerebral angiographic procedures is reported.
Results : One patient (0,2%) died from a cholesterol embolus. In seven patients (1,6%), thromboembolic events occured
within 24 hours after the procedure, leading to transient ischemic symptoms in six and permanent hemiplegia in one. Two
patients suffered from acute renal failure (0,4%). Transient cardiac arrythmias were observed in three patients without
consequence on the clinical outcome. Most complications of angiography occurred in patients referred from the neurology
department for work-up of stroke syndrome.
Conclusion : Our results show that morbidity and mortality rates related to the angiographic procedure did not decrease in
spite of major improvement of angiographic materiel. Atherosclerosis is the main risk factor for complication. Most of the
complications could be avoided by appropriate selection of indications and by using non-invasive techniques such as magnetic
resonance angiography or helical CT angiography.
Key words: Cerebral angiography. Complications.
J Radiol 1999;80:843–8
RE
´SUME
´But : Évaluer précisément l’ensemble des complications de l’angiographie cérébrale.
Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude prospective incluant 429 patients consécutifs (450 angiographies).
Résultats : Un patient (0,2 %) est décédé d’une embolie de cholestérol. Des accidents neurologiques survenaient chez sept
patients (1,6 %) dans les 24 heures suivant l’examen : un patient présentait une hémiplégie permanente, les autres
complications neurologiques étaient rapidement régressives. On notait 2 insuffisances rénales aiguës (0,4 %) et 3 troubles du
rythme cardiaque sans conséquence. La plupart des complications survenait chez les patients du service de neurologie
explorés pour bilan d’infarctus.
Conclusion : Nos résultats montrent que les progrès techniques récents ont peu modifié la morbidité et la mortalité de
l’angiographie cérébrale. La plupart de ces complications pourrait être évitée par une bonne sélection des indications et le
recours aux techniques d’imagerie vasculaire non invasives (angiographie par résonance magnétique ou angioscanographie
spiralée).
Mots-clés : Angiographie cérébrale. Complications.
INTRODUCTION
L’angiographie cérébrale est l’examen
de référence en neuroradiologie vascu-
laire : elle demeure le seul examen per-
mettant une étude complète des vais-
seaux cervico-encéphaliques depuis la
crosse aortique jusqu’aux branches in-
tracrâniennes corticales les plus dista-
les. Il s’agit cependant d’une technique
invasive comportant un risque d’acci-
dents neurologiques liés au cathété-
risme artériel. La mortalité de cet exa-
men est estimée entre 0 (1-4) et 0,07 %
(5) selon les études, avec une morbidité
neurologique variant entre 0,4 (6) et
2,6 % (5). Des complications générales
à type d’insuffisance rénale (0,07 %) (5)
ou cardiaques (0,3 %) (1) peuvent éga-
lement survenir.
Malgré l’amélioration constante des
techniques d’angiographie au cours des
dix dernières années (imagerie numéri-
sée, matériel de cathétérisme de plus en
plus fin, progrès des produits de
contraste), les accidents artériographi-
ques persistent (7), alors que l’imagerie
vasculaire non invasive (écho-Doppler
couleur et surtout angio-IRM) s’améliore
continuellement et rivalise maintenant
avec l’angiographie conventionnelle
dans certaines indications comme, par
exemple, l’étude des bifurcations caroti-
diennes (8).
Il est donc important de réévaluer
aujourd’hui les complications de l’angio-
graphie conventionnelle. En effet, si la
nature des accidents est bien connue, le
taux d’incidents varie de0à28%selon
les études (9), démontrant la faible re-
productibilité d’une équipe à l’autre.
D’autre part, les études récentes de-
viennent rares et s’attachent surtout à
l’étude des accidents neurologiques, né-
gligeant les complications locales ou
rénales.
Le but de ce travail est de rapporter les
résultats d’une étude prospective, réali-
sée dans le service de Neuroradiologie
du CHRU de Lille, recensant l’ensemble
des accidents neurologiques, systémi-
ques et locaux compliquant 450 exa-
mens consécutifs.
MATÉRIELS ET MÉTHODES
Patients
Cette étude prospective est basée sur le
suivi de 450 angiographies cérébrales
(1) Service de Neuroradiologie, (2) Service de Neu-
rologie B, (3) Département d’Anesthésie Réanima-
tion Chirurgicale 1, CHRU de Lille, Hôpital R Salen-
gro, Boulevard J Leclercq, 59037 Lille Cedex.
Correspondance : D Berteloot
Abréviations
IRM : imagerie par résonance magnétique
OAD : oblique antérieur droit
OAG : oblique antérieur gauche
TDM : tomodensitométrie
J Radiol 1999; 80 : 843-848
© Editions françaises de radiologie, Paris, 1999.
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2017 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

diagnostiques consécutives réalisées
chez 429 patients (253 hommes et 176
femmes), du 1
er
décembre 1995 au 30
mai 1996. L’âge moyen était de 46 ans
(7 à 80 ans). Tous les examens étaient
réalisés dans le même service de Neu-
roradiologie. Deux tiers des patients
étaient adressés par le service de neu-
rologie spécialisé dans la pathologie
vasculaire, un tiers par le service de
neurochirurgie du même hôpital. L’arté-
riographie était indiquée le plus souvent
pour bilan d’ischémie (229 fois, soit
50,5 %)
(tableau I)
. Chez 127 patients
(28 %), elle était réalisée dans le cadre
d’un bilan préopératoire afin de docu-
menter et quantifier précisément une
sténose carotide ou vertébrale. Chez
102 patients (22 %), l’angiographie était
réalisée pour le bilan d’un infarctus du
sujet jeune (<à 45 ans), pour suspicion
de dissection des artères cervicales ou
d’angéite intracrânienne. Enfin, chez
118 patients (26 %), l’examen recher-
chait un anévrisme intracrânien respon-
sable d’une hémorragie méningée.
Technique
Avant chaque angiographie, un examen
clinique, une consultation d’anesthésie
et des examens paracliniques adaptés
étaient systématiquement réalisés. Tou-
tes les angiographies étaient réalisées
sous anesthésie. La technique utilisée
était le plus souvent une neurolept-
analgésie sans intubation, excepté chez
14 patients hospitalisés en réanimation
pour lesquels une anesthésie générale
avec intubation trachéale et ventilation
artificielle était indiquée. Les angiogra-
phies ont été réalisées par un neurora-
diologue senior aidé d’un interne sur
une table d’angiographie numérisée
(Philips Integris V3000) selon la techni-
que de Seldinger fémoral. Chez un pa-
tient, l’échec du cathétérisme sélectif
par voie fémorale nécessitait une ponc-
tion directe de l’artère carotide au cou.
Des cathéters 4F, un guide hydrophile et
un produit de contraste non ionique
étaient utilisés à chaque fois. La quan-
tité totale de produit de contraste injecté
variait de 20 à 350 ml selon l’examen
(moyenne : 186 ml).
Un bilan d’ischémie comportait une
étude systématique de la crosse aorti-
que en OAD et OAG permettant l’ana-
lyse des sténoses ostiales. Celle-ci était
complétée par des injections sélectives
carotide, vertébrale ou sous-clavière
(guidées par les signes cliniques ou la
topographie de l’infarctus en TDM ou en
IRM), permettant une bonne analyse du
trajet cervical et du temps intracrânien.
Dans les autres indications, seule une
opacification sélective des troncs supra-
aortiques était réalisée. Chez 37 pa-
tients, l’étude se limitait au cathétérisme
et à l’injection sélective d’un seul vais-
seau, mais, le plus souvent, trois axes
artériels étaient étudiés sélectivement.
L’examen était réalisé entre 20 et 90 mn
(moyenne : 49 mn).
Les volumes de produit de contraste
ainsi que les débits d’injection utilisés en
fonction de l’axe artériel exploré sont
indiqués dans le
tableau II
.
Analyse des complications
Nous définissions comme complication
de l’angiographie cérébrale toute altéra-
tion de l’état de santé apparue pendant
ou dans les 24 heures suivant l’examen
et imputable à celui-ci. Les accidents
survenus au-delà étaient également re-
tenus comme complication quand la re-
lation de cause à effet était évidente.
Durant l’artériographie, la surveillance
clinique du patient était assurée par un
médecin et un infirmier anesthésiste,
avec monitoring cardiaque et tensionnel
permanent. Les complications perangio-
graphiques et postangiographiques im-
médiates étaient évaluées à partir d’une
fiche de surveillance remplie par le ra-
diologue. Les paramètres recueillis dans
cette fiche incluaient des informations
concernant l’examen et son déroule-
ment (indication et nature de l’examen,
type et quantité de produit de contraste
utilisé, durée de l’examen, temps de
compression artérielle, difficultés ren-
contrées, complications immédiates)
ainsi que des éléments cliniques re-
cueillis en concertation avec le clinicien,
4 à 8 heures après l’examen, détermi-
nant la présence de complications loca-
les (point de ponction, pouls périphéri-
ques) ou générales (tension artérielle,
fréquence cardiaque, examen neurolo-
gique, fonction respiratoire, manifesta-
tions allergiques, diurèse).
Une étude complémentaire des dossiers
cliniques était ensuite effectuée pour ne
pas méconnaître certaines complica-
tions différées de l’angiographie. Elle
permettait le suivi clinique de chaque
patient pendant une durée minimale de
36 heures après l’examen et d’apprécier
précisément la toxicité des produits de
contraste à partir de critères biologi-
ques.
Classification
Les complications ont été séparées en
trois grandes catégories :
Tableau I :
Indications des 450 angiographies.
Table I :
Indications for 450 angiograms.
Indication des examens Nombre (%)
Accident ischémique transitoire 63 (14)
Infarctus 166 (37)
Hémorragie méningée 118 (26)
Hématome lobaire 47 (10)
Contrôle de MAV 32 (8)
Tumeurs 14 (3)
Thrombophlébite 5 (1)
Hémorragie ventriculaire 5 (1)
Autres 10 (2,2)
MAV : Malformation artério-veineuse.
Tableau II :
Volume et débit de produit de contraste injecté en fonction de l’axe artériel
cathétérisé.
Table II :
Standard injection rates and volumes of contrast medium according to the catheter-
ized artery.
Crosse Ao ACC AV ASC ACI ACE
Volume (ml) 40 14 à 16 6 à 8 10 à 12 10 à 12 9
Débit (ml/s) 20 7 à 8 3 à 4 5 à 6 5 à 6 3
Ao :Aortique
ACC : Artère carotide commune
AV : Artère vertébrale
ASC : Artère sous-clavière
ACI : Artère carotide interne
ACE : Artère carotide externe
844
D Berteloot et al. : Angiographie cérébrale : étude des complications sur 450 examens consécutifs
J Radiol 1999; 80
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2017 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

—neurologiques : définies par l’appa-
rition, la récidive ou l’aggravation d’un
signe ou d’un symptôme neurologique
constatées durant ou dans les 24 heu-
res suivant l’artériographie. Ces acci-
dents étaient dits transitoires s’ils étaient
résolus complètement en moins de 24
heures, constitués dans le cas
contraire ;
—systémiques : complications géné-
rales autres que neurologiques : cardio-
vasculaires (troubles du rythme cardia-
que, crise d’angor, ischémie aiguë ou
subaiguë de membre inférieur) ou réna-
les. Les néphropathies secondaires à
l’administration de produits de contraste
iodés étaient définies selon les critères
recommandés par Rudnick puis Porter
(10) : élévation de la créatininémie de
plus de 10 mg/l lorsque la créatinine de
base était anormale ; élévation de la
créatininémie d’au moins 20 % quand la
créatinine déterminée avant l’examen
était normale. Ces variations devaient
être constatées dans les 72 heures sui-
vant la procédure, la responsabilité des
produits de contraste étant retenue
après exclusion de toute autre étiologie ;
—locales : complications situées au
point de ponction et liées à l’utilisation
de matériel de cathétérisme (hémato-
mes, faux anévrismes, dissection ou
thrombose artérielles).
RÉSULTATS
Complications neurologiques
(tableau III)
Des accidents neurologiques étaient ob-
servés chez sept patients (4 femmes, 3
hommes, de 26 à 73 ans ; moyenne : 49
ans), soit pour 1,6 % des examens.
Chez trois patients (0,7 %), ces compli-
cations étaient transitoires. Ces exa-
mens duraient en moyenne 51 mn, avec
une dose moyenne de produit de
contraste utilisée de 188 ml. Chez cinq
patients, l’accident neurologique surve-
nait plusieurs heures après la fin de
l’examen, chez deux patients il survenait
pendant l’artériographie. Chez cinq pa-
tients, cette complication constituait la
majoration ou l’extension d’un déficit
préexistant à l’examen. Le déficit neuro-
logique était complètement résolutif en
moins de trois jours chez 5 patients.
Chez une femme de 49 ans explorée
pour infarctus hémorragique, une hémi-
parésie survenue au décours de l’arté-
riographie récupérait en 4 semaines.
Enfin, chez un homme de 44 ans pré-
sentant une hémorragie intraventricu-
laire, le bilan angiographique s’est com-
pliqué, 12 heures après la fin de l’exa-
men, d’un infarctus cérébral avec
hémiplégie droite permanente.
Complications systémiques
Des complications rénales étaient ob-
servées chez 4 patients (0,9 %). Pour
deux d’entre eux, il s’agissait de pertur-
bations biologiques isolées, spontané-
ment résolutives. Deux patients souf-
fraient d’insuffisance rénale chronique et
présentaient une décompensation aiguë
dans les suites de l’angiographie. Chez
une patiente de 69 ans présentant une
glomérulonéphrite chronique, une dé-
compensation rénale aiguë est surve-
nue avec aggravation des troubles de
conscience nécessitant le maintien de la
sédation et de la ventilation pendant
deux semaines. Cette patiente avait
reçu 180 ml de produit de contraste pour
un bilan d’hémorragie méningée. Le re-
tour à la fonction rénale de base était
obtenu en 15 jours sans dialyse.
Chez un autre patient, âgé de 60 ans,
polyvasculaire, hospitalisé pour bilan
d’infarctus sylvien, une insuffisance ré-
nale aiguë s’est révélée le lendemain de
l’examen par un œdème aigu du pou-
mon. Cette complication était liée à une
embolie de cristaux de cholestérol dia-
gnostiquée cliniquement devant l’asso-
ciation de phénomènes ischémiques
des orteils, d’un livedo reticularis et
d’emboles de cholestérol visibles au
fond d’œil. Malgré les séances d’hémo-
dialyse, l’évolution s’est faite vers une
insuffisance rénale terminale avec dé-
cès du patient trois mois après la réali-
sation de l’examen.
Trois patients (0,7 %) explorés pour bi-
lan d’ischémie ont présenté des troubles
du rythme cardiaque pendant l’examen
(tableau IV)
. Ceux-ci se produisaient
toujours sur cardiopathie sous-jacente.
Ces troubles du rythme étaient rapide-
ment résolutifs et n’avaient pour consé-
quence que l’interruption de l’examen à
chaque fois. Les complications vasculai-
res périphériques se résumaient à un
cas d’ischémie subaiguë des orteils ob-
servé chez le patient décédé d’une em-
bolie de cristaux de cholestérol. Ce pa-
tient de 60 ans était à haut risque pour
ce type de complication puisque tabagi-
que, hypertendu, diabétique, insuffisant
rénal chronique, souffrant d’une dyslipi-
démie mixte et d’une artérite des mem-
bres inférieurs. Les troubles trophiques
des orteils évoluaient sur un mode chro-
nique jusqu’au décès du patient par
insuffisance rénale.
Des réactions allergoïdes au produit de
contraste iodé étaient notées chez deux
patients (0,45 %), sous forme d’éruption
urticarienne. Pour l’un de ces deux ma-
lades, une préparation anti-allergique
associant antihistaminiques et corticoï-
des avait été instaurée de façon préven-
tive du fait d’un terrain atopique.
Les complications locales étaient repré-
sentées par 3 hématomes extensifs
d’évolution rapidement favorable. Au-
cune autre complication locale n’a été
observée.
DISCUSSION
L’incidence des complications de l’an-
giographie cérébrale est très variable
selon les études avec des taux variant
de0à28%(9). Les diverses séries
publiées sont difficilement comparables,
car la notion de complication est appré-
ciée différemment selon les auteurs.
Ainsi, les vertiges et les céphalées ne
sont pas toujours répertoriés et sont
pour certains auteurs classés dans les
complications neurologiques, alors que
pour d’autres, ces signes sont classés
dans les complications systémiques (1).
Les méthodes d’évaluation sont égale-
ment différentes : la plupart des auteurs,
Olivecrona (6), Mani (11), Earnest (5),
Grzyska (3), Heiserman (4), étudient les
accidents artériographiques uniquement
dans les 24 heures suivant l’examen.
Dion (1) les étudie sur une période sup-
plémentaire de 24 à 72 heures et montre
que d’authentiques complications sur-
Tableau III :
Complications neurologiques.
Table III :
Neurological complications.
Sexe Âge Clinique Artériographie Accident Évolution
F 26 AIT Normale Paresthésies <1h
F 49 Infarctus Normale Hémiparésie 6 h
F 73 AIT Athéromatose modérée Aphasie 12 h
H 38 Infarctus Normale Convulsions 72 h
H 62 H. méningée Anévrisme et athéromatose Hémiplégie 36 h
H 44 H. ventriculaire Normale Hémiplégie Permanente
F 49 Infarctus Angéite Hémiparésie 1 mois
AIT : Accident ischémique transitoire
H : Hémorragie
D Berteloot et al. : Angiographie cérébrale : étude des complications sur 450 examens consécutifs
845
J Radiol 1999; 80
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2017 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

viennent dans un délai supérieur à 24
heures avec un taux d’accidents neuro-
logiques s’élevant de 1,3 à 3,1 %. Les
techniques angiographiques expliquent
également l’hétérogénéité de ces diffé-
rents travaux : Waugh et Sacharias (2)
étudient les bifurcations carotidiennes
dans 69 % des cas uniquement par opa-
cification de la crosse aortique, alors
qu’Earnest (5) ne la réalise que dans
4 % de ses bilans d’ischémie. La taille
des cathéters (11), la nature des pro-
duits de contraste, l’utilisation de techni-
ques conventionnelles ou numérisées
(2) peuvent également modifier la mor-
bidité. Enfin, l’expérience du radiologue
est un paramètre important à discuter.
Heiserman (4) ne retrouve pas de corré-
lation entre la survenue de complica-
tions neurologiques et l’expérience du
radiologue, alors que d’autres équipes
(12, 13) constatent une moindre morbi-
dité avec des opérateurs plus expéri-
mentés.
Tous ces facteurs sont autant de varia-
bles expliquant l’hétérogénéité de ces
différentes études dont les résultats doi-
vent toujours être comparés avec pru-
dence.
Un patient dans notre étude est décédé
à la suite d’une embolie de cristaux de
cholestérol. Cette complication rare est
la principale cause de mortalité de l’arté-
riographie cérébrale
(tableau V)
. Elle
s’explique par l’embolie de cristaux de
cholestérol à partir d’une volumineuse
plaque d’athérome lorsque celle-ci est
« mise à nu ». Cette circonstance est
favorisée par les traitements anticoagu-
lants ou fibrinolytiques, ou les microtrau-
matismes liés au cathétérisme (14).
Plus rarement, l’embolie de cholestérol
est spontanée. Son expression est sou-
vent polyviscérale (14-17) : insuffisance
rénale, ischémie mésentérique, isché-
mie ou douleurs des membres infé-
rieurs, déficits neurologiques centraux
(amaurose), manifestations cutanées (li-
vedo reticularis) avec une mortalité éva-
luée entre 68 (15) et 81 % (16) dans les
formes aiguës. Son incidence au dé-
cours de l’angiographie est vraisembla-
blement sous-estimée et varie entre
0,08 et 0,8 % (17). Dans la plupart des
cas, son caractère subaigu explique les
difficultés du diagnostic. Le caractère
aigu ou suraigu de la clinique peut être
confondu avec une réaction allergique à
une drogue (notamment à l’iode) admi-
nistrée avant ou pendant le cathété-
risme (15). Le seul patient ayant pré-
senté cette complication dans notre
étude rassemblait tous les facteurs de
risque : homme âgé, tabagique, insuffi-
sant rénal, athérosclérose sévère et
prise d’anticoagulants. L’amélioration
technique de l’angiographie ne permet
pas de diminuer l’incidence de ce type
de complication qui dépend directement
du terrain du patient. Le recours aux
techniques d’imagerie vasculaire non in-
vasives prend donc tout son intérêt chez
ces sujets à haut risque.
Les accidents neurologiques liés à l’an-
giographie cérébrale ont très souvent
été étudiés
(tableau VI)
. Nous obser-
vons dans notre étude des taux d’acci-
dents ischémiques transitoires et consti-
tués respectivement de 0,7 et 0,9 %. Un
déficit neurologique permanent était
noté (0,2 %). Le taux total de complica-
tions neurologiques dans notre étude
(1,6 %) est supérieur aux 0,4 % de la
série d’Olivecrona (6), recueillie entre
1970 et 1974 à une époque où les
conditions techniques de l’angiographie
étaient plus difficiles. Ce taux d’acci-
dents est d’ailleurs le plus faible rap-
porté ces 25 dernières années. Le ca-
ractère rétrospectif de cette étude expli-
que en partie ces résultats : les
accidents mineurs comme une aphasie
ou des paresthésies transitoires sont
souvent minimisés, alors que seuls les
accidents les plus sévères sont réperto-
riés dans les dossiers du patient. On
peut formuler la même remarque pour
l’étude de Mani (11). Dans une étude
prospective de 1990, Grzyska, Freitag
et Zeumer (3) rapportent également un
faible taux de complications neurologi-
ques (0,55 %). Dans ce travail, cepen-
dant, seuls étaient retenus les accidents
neurologiques « inattendus », ce qui
sans doute a conduit à exclure certaines
complications (4). Waugh et Sacharias
(2) rapportent 0,9 % d’accidents neuro-
logiques. Mais l’étude des troncs supra-
aortiques se limitait dans 22 % des cas
à la réalisation d’une gerbe aortique
jugée suffisante pour l’étude des bifurca-
tions carotidiennes. En revanche, nos
résultats se rapprochent de ceux de
Dion (1,3 %) (1) ou d’Heiserman (1 %)
(4) dont la méthodologie est voisine de
la nôtre. Enfin, si la morbidité neurologi-
que est variable, le taux de déficits neu-
rologiques permanents apparaît relati-
vement constant d’une étude à l’autre
(entre 0,1 % (1, 2, 4, 11) et 0,2 % (6)) et
est comparable à nos résultats. Toutes
les études (1, 4, 5, 18) ont montré un
risque accru de complications neurologi-
ques chez les patients explorés pour
bilan d’infarctus ou d’accident ischémi-
que transitoire. C’était le cas de la plu-
part des patients présentant une compli-
cation neurologique dans notre étude.
Dans cette population à risque, la surve-
nue d’accidents neurologiques au dé-
cours de l’angiographie est cependant
Tableau IV :
Complications cardiaques.
Table IV :
Cardiac complications.
Patient Indication Facteurs de risque Complication Cardiopathie Artériographie
H/47 AIT HTA AC/FA Cardiopathie
dilatée Interrompue
H/53 Infarctus ? Bigéminisme
ventriculaire Coronarite
sévère Thrombose de
la vertébrale
droite
H/43 Infarctus Tabac, HTA Tachycardie
sinusale Coronarite
sévère Sténose à 95 %
de la CIG
AIT : Accident ischémique transitoire
HTA : Hypertension artérielle
AC/FA : Arythmie complète par fibrillation auriculaire
CIG : Carotide interne gauche
Tableau V :
Mortalité de l’angiographie cérébrale dans les études antérieures.
Table V :
Cerebral angiography related mortality in prior studies.
Auteur Année n Mortalité (%) Cause du décès
Olivecrona 1970-1974 5531 0,02 Embolie de cholestérol
Mani 1969-1975 5000 0,02 Infarctus en fosse postérieure
Earnest 1980-1981 1517 0,07 Embolie de cholestérol
Dion 1983-1984 1002 0
Grzyska 1990 1095 0
Waugh 1988-1990 922 0
Heiserman 1992-1993 1000 0
846
D Berteloot et al. : Angiographie cérébrale : étude des complications sur 450 examens consécutifs
J Radiol 1999; 80
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2017 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

d’interprétation difficile. En effet, un acci-
dent survenant plusieurs heures après
la fin de l’examen peut tout aussi bien
traduire une complication artériographi-
que qu’une nouvelle manifestation de la
pathologie sous-jacente (19). On com-
prend donc toute la difficulté à évaluer
précisément l’incidence des accidents
neurologiques, surtout dans ce sous-
groupe de patients explorés pour bilan
d’ischémie. Il est également admis que
les patients présentant une athérosclé-
rose évoluée constituent une population
à risque de complications neurologi-
ques, puisque des emboles de plaque
d’athérome peuvent survenir au cours
de l’examen en raison des microtrauma-
tismes répétés liés à la manipulation du
guide ou du cathéter (1). Dans notre
étude, le seul patient ayant présenté un
déficit neurologique pendant l’examen
était hypertendu, tabagique, dyslipidé-
mique ; des lésions athéromateuses sé-
vères étaient identifiées en angiogra-
phie. Enfin, ce travail confirme la possi-
bilité d’accidents ischémiques de
survenue différée après l’angiographie
(1). Un infarctus sylvien gauche s’est
produit 12 heures après la fin de l’exa-
men chez un patient sans déficit
préexistant, sans trouble du rythme car-
diaque et sans lésion vasculaire à l’arté-
riographie. Ce type d’accident s’expli-
querait par des phénomènes d’activa-
tion plaquettaire liés au produit de
contraste. De multiples facteurs peuvent
donc être à l’origine d’accidents neurolo-
giques : un spasme artériel peut se pro-
duire (20), les produits de contraste peu-
vent intervenir par une modification mor-
phologique des globules rouges ou de la
viscosité sanguine (1), par un effet toxi-
que sur l’endothélium vasculaire (21) ou
une neurotoxicité directe (1, 21). Les
facteurs mécaniques (emboles, dissec-
tion, thrombose) n’expliquent pas l’en-
semble des accidents neurologiques qui
peuvent donc se produire malgré des
conditions techniques optimales (4).
La fréquence des insuffisances rénales
aiguës compliquant l’angiographie céré-
brale est difficile à apprécier à partir des
données de la littérature, car la majorité
des travaux consacrés aux complica-
tions de l’artériographie cérébrale n’étu-
die pas les complications rénales.
D’autre part, quand ces complications
sont étudiées, les données biologiques
sont recueillies de façon rétrospective et
donc incomplète. Sur 692 patients, Dion
(1) ne relevait aucun cas d’insuffisance
rénale. Earnest (5) rapporte un seul cas
d’insuffisance rénale aiguë pour 1517
examens, liée à une embolie de cristaux
de cholestérol (0,07 %). Malgré l’utilisa-
tion d’un produit de contraste non ioni-
que, nous constatons deux cas d’insuffi-
sance rénale aiguë (0,4 %). Bien que
peu rapporté dans la littérature, ce type
de complication n’est donc pas excep-
tionnel. L’insuffisance rénale préexis-
tante reste le principal facteur de risque
(22, 23).
Les complications cardiaques rappor-
tées dans la littérature sont essentielle-
ment des crises d’angor : un cas pour
Dion (0,3 %) (1), 6 cas pour Waugh et
Sacharias (0,25 %) (2). Dans notre
étude, nous n’avons constaté aucune
crise d’angor. En revanche, des troubles
du rythme cardiaque sont apparus deux
fois chez des patients coronariens avec
des lésions sténosantes sévères à l’an-
giographie cérébrale. Ces données
confirment l’association entre athéros-
clérose et risque de complication cardia-
que.
Enfin, les complications locales étaient
bénignes dans notre série, représentées
essentiellement par des hématomes
non compliqués. L’étude de la littérature
montre clairement la diminution du taux
de complications locales parallèlement
à la diminution du calibre des cathéters.
Certains accidents, comme les injec-
tions intramurales ou périvasculaires
décrites dans les anciennes publications
(6), ne sont plus rencontrés aujourd’hui.
L’absence d’hématome compliqué, de
dissection ou de thrombose artérielle
peut s’expliquer par l’utilisation de ca-
théters 4F, plus petits que ceux utilisés
dans les autres études.
CONCLUSION
Cette étude prospective retrouve globa-
lement les mêmes accidents que ceux
déjà décrits dans la littérature. Si la
plupart d’entre eux sont bénins, on dé-
plore cependant une hémiplégie défini-
tive et un décès secondaire à une embo-
lie de cholestérol, soit 0,4 % de compli-
cations graves. Les progrès techniques
ne permettent donc pas d’éviter ce type
de complication dont la survenue dé-
pend avant tout d’un facteur de risque :
l’athérosclérose.
Chez les patients à haut risque, on peut
donc espérer diminuer les accidents en
limitant les indications de l’angiographie
cérébrale et ceci grâce au développe-
ment de l’imagerie vasculaire non inva-
sive.
Dans les cas où l’angiographie demeure
indispensable, seule une équipe entraî-
née travaillant dans des conditions tech-
niques optimales et en collaboration
étroite avec les cliniciens permet de
réduire les risques de cet examen.
Références
1. Dion JE, Gates PC, Fox A J, Barnett
HJM, Blom RJ. Clinical events following
neuroangiography : a prospective study.
Stroke 1987;18:997-1004.
2. Waugh JR, Sacharias N. Arteriographic
complications in the DSA era. Radiology
1992;182:243-6.
3. Grzyska U, Freitag J, Zeumer H. Selec-
tive intraarterial DSA : complication rate
and control of risk factors. Neuroradiol
1990;32:296-9.
4. Heiserman JE, Dean BL, Hodak JAet al.
Neurologic complications of cerebral an-
giography. AJNR 1994;15:1401-7.
5. Earnest F, Forbes G, Sandok BA et al.
Complications of cerebral angiography :
prospective assessment of the risk. AJR
1984;142:247-53.
6. Olivecrona H. Complications of cerebral
angiography. Neuroradiol 1977;14:175-
81.
7. Le Roux PD, Elliott JP, Eskridge JM,
Cohen W, Winn HR. Risks and benefits
of diagnostic angiography after aneu-
rysm surgery : a retrospective analysis
of 597 studies. Neurosurgery 1998;42:
1248-54.
8. Erdoes LS, Marek JM, Mills JL et al. The
relative contributions of carotid duplex
scaning, magnetic resonance angiogra-
phy, and cerebral arteriography to clini-
cal decisionmaking : a prospective study
in patients with carotid occlusive dis-
ease. J Vasc Surg 1996;23:950-6.
9. Hankey JG, Warlow CP, Sellar RJ. Cere-
bral angiographic risk in mild cere-
brovascular disease. Stroke 1990;21:
209-22.
Tableau VI :
Complications neurologiques dans les études antérieures.
Table VI :
Neurological complications in prior studies.
Auteur Année n Déficit
<
24h Déficit
>
24h Total
n (%) n (%) n (%)
Olivecrona 1970-1974 5531 11 (0,2) 11 (0,2) 22 (0,4)
Mani 1969-1975 5000 35 (0,7) 6 (0,12) 41 (0,8)
Earnest 1980-1981 1517 33 (2,2) 6 (0,4) 39 (2,6)
Dion 1983-1984 1002 12 (1,2) 1 (0,1) 13 (1,3)
Grzyska 1990 1095 5 (0,45) 1 (0,09) 6 (0,54)
Waugh 1988-1990 922 6 (0,6) 3 (0,3) 9 (0,9)
Heiserman 1992-1993 1000 5 (0,5) 5 (0,5) 10 (1)
D Berteloot et al. : Angiographie cérébrale : étude des complications sur 450 examens consécutifs
847
J Radiol 1999; 80
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2017 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
 6
6
1
/
6
100%