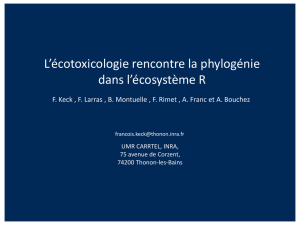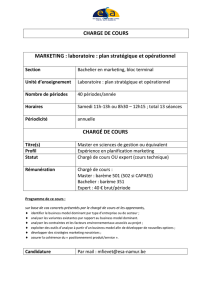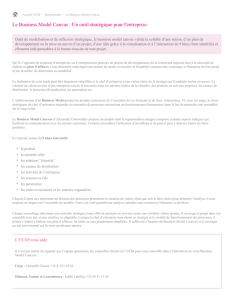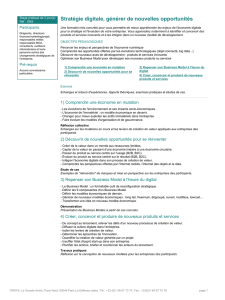Business Model et Transition Énergétique : Impacts Producteur/Client
Telechargé par
Worship AddiKtion

UN NOUVEAU BUSINESS MODEL POUR RÉUSSIR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Quels impacts sur les relations producteur/client ?
Michel Felix, Laëtitia Garcia
Direction et Gestion | « La Revue des Sciences de Gestion »
2019/1 N° 295 | pages 11 à 19
ISSN 1160-7742
ISBN 9782916490649
Article disponible en ligne à l'adresse :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2019-1-page-11.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Direction et Gestion.
© Direction et Gestion. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la
licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage
dans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
© Direction et Gestion | Téléchargé le 19/08/2021 sur www.cairn.info via Université de Lorraine (IP: 193.50.135.4)
© Direction et Gestion | Téléchargé le 19/08/2021 sur www.cairn.info via Université de Lorraine (IP: 193.50.135.4)

La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 295 – stratégie
janvier-février 2019
11
Dossier I
Innovations et marketing
Un nouveau
Business Model
pour réussir
la transition énergétique :
quels impacts sur les relations producteur/client ?
par Michel Felix et Laëtitia Garcia
Michel FELIX
Professeur des Universités en Sciences
de Gestion, LSMRC (Laboratoire MERCUR)
Université de Lille – SKEMA Business School
France
Laëtitia GARCIA
Maître de Conférences en Sciences de Gestion
Laboratoire CRDP… EA n° 4487 – Équipe René
Demogue, Université de Lille
France
www.LaRSG.fr
Le secteur de l’énergie, confronté à une crise environne-
mentale de plus en plus ouverte, connaît une profonde
remise en cause de son modèle d’affaires. Face à cette
crise, bon nombre de producteurs d’énergie doivent à la fois
conduire sur le long terme une vaste mutation des énergies
carbonées vers des énergies vertes et apporter de nouvelles
réponses aux attentes des usagers. À partir de ce constat, cet
article se propose d’étudier, sur le marché des particuliers,
comment rompre avec le modèle d’affaires classique pour
prendre en charge et accompagner cette mutation sectorielle.
Trois propositions pour un nouveau
Business Model
seront
discutées en réponse à plusieurs risques majeurs issus de
cette crise. Ces différents risques seront présentés dans une
première partie.
Dans le domaine de l’énergie, le
Business Model
classique
repose sur la vente de produits liant le revenu de l’entreprise
à une quantité à vendre. Le revenu des fournisseurs est alors
directement dépendant du volume de consommation. Il est clair
que ces fournisseurs n’ont en principe aucun intérêt à encou-
rager la baisse de consommation, même si leur stratégie de
fidélisation et de création de valeur par leurs systèmes d’infor-
mation (Porter, Heppelmann 2014) les conduit à aider leurs
clients à réaliser des économies d’énergie. En conséquence,
pour les producteurs d’énergie, tout
Business Model
fondé sur
une rationalisation généralisée des usages ne conduit qu’à une
destruction de valeur pour la partie fourniture de cette industrie.
Les propositions d’un nouveau
Business Model
, seront
présentées dans une seconde partie. La première consiste à
repenser la relation producteur-client. La seconde, à remplacer
la vente d’un bien par celle d’un résultat, la troisième, à accom-
pagner le changement au cours d’une nécessaire transition. La
mise en œuvre de cette stratégie impliquera une reconfiguration
des différentes parties prenantes de l’ensemble du secteur.
© Direction et Gestion | Téléchargé le 19/08/2021 sur www.cairn.info via Université de Lorraine (IP: 193.50.135.4)
© Direction et Gestion | Téléchargé le 19/08/2021 sur www.cairn.info via Université de Lorraine (IP: 193.50.135.4)

La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 295 – stratégie
12
Dossier I
Innovations et marketing
janvier-février 2019 www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion.htm
Enfin, une dernière partie présentera les impacts majeurs
de ce nouveau
Business Model
sur l’ensemble des parties
prenantes, acteurs de la transition, et sur la nature et l’orga-
nisation de leurs pratiques.
1. Crise environnementale :
quels risques pour le particulier
consommateur d’énergie ?
Parmi tous les risques perçus de la crise, on retiendra trois
risques spécifiques qui sollicitent tout particulièrement la
capacité de réponse du
Business Model
et le caractère durable
de sa compétitivité. Ces risques sont : le risque de réchauf-
fement climatique, le risque d’obsolescence technologique et
économique, et enfin, le risque d’intangibilité, lié à la difficulté
pour le client à se représenter de façon concrète les solutions
à mettre en œuvre pour faire face aux deux risques précédents.
1.1. Le risque de réchauffement climatique
Les différents rapports du Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (GIEC)1 établissent clairement
l’influence de l’homme sur le système climatique. Le rapport
de 20142 montre que la concentration du dioxyde de carbone
a augmenté de 40 % depuis l’époque préindustrielle et que
cette augmentation est due principalement à l’utilisation de
combustibles fossiles. Celui de 20183 préconise, pour limiter
le changement climatique, de réduire les émissions mondiales
de gaz à effet de serre d’environ 45 % en 2030 par rapport à
2010 et d’atteindre des émissions nettes nulles vers 2050.
Un rapport de recherche (Z. Babutsidze et
al
., 2018) sur la
perception par la population française du changement climatique
(octobre 2018) indique que 90 % des personnes interrogées
pensent que l’activité humaine est entièrement ou au moins
partiellement responsable du changement climatique.
De plus, selon un sondage BVA réalisé dans le cadre de
l’Observatoire de la vie quotidienne des Français (mars 2018)
4
,
les Français se montrent très majoritairement favorables à des
sources d’électricité renouvelables telles que l’énergie solaire
(90 %), hydroélectrique (89 %) et éolienne (84 %). E. Lafaye et
al
. (2013) établissent dans une étude sur les comportements
des ménages que la possibilité de contrôler chez soi sa
consommation est, pour les Français, une étape essentielle
pour diminuer leur empreinte carbone.
1. https://www.climat.be/fr-be/changements-climatiques/les-rapports-du-giec
2. 5e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), novembre 2014
3. Rapport spécial du GIEC sur les conséquences du réchauffement planétaire
de 1,5 °C, octobre 2018
4. http://www.bva.fr/fr/sondages/observatoire_de_la_vie_quotidienne_des_
francais
Les consommateurs d’énergie verte ont été pendant
longtemps confinés a un segment bien particulier de clientèle
(I.H. Rowlands et
al.
2003). Toutefois, la production et la
distribution des offres d’énergie renouvelable se développent
rapidement5. Cette tendance dans la société à une prise de
conscience de plus en plus forte des défis environnementaux
(U. Awan, 2011) devrait privilégier les offres à forte promesse
environnementale. Ces mutations importantes de l’opinion
publique vont particulièrement contribuer à s’interroger sur la
viabilité à long terme du
Business Model
liant les quantités
vendues au revenu.
1.2. Le risque d’obsolescence
technologique et économique
Le risque d’obsolescence par innovation technologique est
afférent à l’installation d’un équipement de production d’énergie
verte chez le particulier. Il s’agit d’un risque d’obsolescence
rapide d’une installation chez le particulier au profit d’une autre
plus performante, comme par exemple l’arrivée sur le marché
de panneaux solaires dotés de cellules ultra-sensibles.
Le risque d’obsolescence économique peut être lié au traite-
ment d’externalités négatives. L’externalité se définit comme
un résultat obtenu sans qu’il soit directement recherché par un
objectif. Une externalité peut être positive ou négative, selon
l’appréciation du résultat. Les panneaux solaires, massivement
fabriqués en Chine, offrent un exemple typique des risques
d’obsolescence économique sous l’effet de trois externalités
négatives : une externalité liée au caractère polluant de l’extrac-
tion d’un de ses composants (terres rares), une externalité
sociale (les conditions de travail en Chine), une externalité
économique (l’arrivée massive des panneaux solaires chinois
à bas coût sur les marchés européen et américain, détruisant
des emplois dédiés dans ces pays). Certaines de ces exter-
nalités négatives liées à la production de panneaux solaires
chinois pourraient disparaître et entraîner son obsolescence,
suite par exemple au renforcement d’une filière européenne
de production.
1.3. Le risque d’intangibilité
Les risques climatiques et d’obsolescence peuvent entraîner
un risque d’intangibilité, créant pour les particuliers des freins
à la transition énergétique.
La perception du risque climatique par les particuliers les
incite à modifier leur consommation d’énergie en passant des
énergies carbonées aux énergies vertes. Ce risque d’intangibi-
lité est présent dès lors que les ménages ont à choisir entre
énergie verte ou celle fournie conventionnellement par leur
5. Renewable Energy Policy Network for the 21st century REN21, Renewables
Global Status Report 2012, p. 75, http://www.ren21.net/status-of-renewables/
global-status-report
© Direction et Gestion | Téléchargé le 19/08/2021 sur www.cairn.info via Université de Lorraine (IP: 193.50.135.4)
© Direction et Gestion | Téléchargé le 19/08/2021 sur www.cairn.info via Université de Lorraine (IP: 193.50.135.4)

La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 295 – stratégie
13
Dossier I
Innovations et marketing
janvier-février 2019
www.LaRSG.fr
fournisseur. Avec l’offre verte, l’énergie peut être livrée par le
réseau. Dans ce cas, le fournisseur s’engage à produire ou à
acheter tout ou partie des besoins de consommation du client
auprès de centres de production d’énergie appropriés (sans
émission de CO
2
, par exemple). La facture du client mentionne
alors la quantité de CO2 ainsi « épargnée ». En conséquence,
le succès commercial des énergies vertes dépend du degré
de confiance des clients en leur fournisseur (R. Wiser et
al
.,
2004). Or, cette confiance doit se construire à partir d’une
expérience limitée, tout au plus en lisant sur la facture la
quantité de CO
2
épargnée. Les clients n’ont en effet aucun
moyen de contrôler l’origine de l’électricité consommée : d’un
point de vue physique, les électrons qui parcourent les réseaux
sont totalement indifférenciés et il n’est donc pas possible
d’attribuer clairement les moyens de production correspondant
à l’énergie livrée chez le client.
Cette forte intangibilité rend difficile le contrôle de l’origine
verte, ou non, de l’énergie consommée. Les clients qui sont
prêts à payer pour obtenir de l’énergie verte doivent fonder leur
choix sur des substituts (T. Levitt, 1981 ; L.L. Berry et T. Clark,
1986) que le producteur/distributeur doit rendre crédibles
(facture, certificat, label). Au-delà de cette solution imparfaite, la
tangibilisation passe alors par l’équipement du client ou par les
informations contrôlables qu’on lui délivre à partir du matériel
de distribution ou de production implanté chez lui. De ce fait,
l’accès à l’information de traçabilité devient particulièrement
stratégique, même si elle ne peut être qu’en partie satisfaite
par les opérateurs (A. Paladino et A. Pandit, 2012). On peut
s’attendre à ce que l’offre d’équipements et d’outils de contrôle
destinée au client ait un impact organisationnel sur les métiers
et les systèmes d’informations des producteurs/distributeurs.
Les risques d’obsolescence technologique et économique
comportent, eux aussi, un risque d’intangibilité. Quand par
exemple un particulier décide d’installer un équipement de
production d’énergie verte, sa décision d’investissement est
soumise à trois attributs d’intangibilité décrits par V.A. Zeithaml
(1981) : un attribut d’examen (difficulté à déterminer les critères
de choix permettant de retenir une solution technique plutôt
qu’une autre), un attribut d’expérience (difficulté à se repré-
senter clairement toutes les contraintes d’usage), et enfin un
attribut de crédibilité (difficulté à fonder sa confiance envers
les opérateurs dans un marché de démarrage).
Ainsi, le
Business Model
classique peine à pallier les risques
qui précèdent. L’objectif du nouveau
Business Model
est
précisément de trouver les solutions managériales, juridiques
et organisationnelles qui réduiraient voire supprimeraient ces
risques afin de permettre au client de mieux appréhender la
proposition d’offre du producteur dans tous ses détails, à
mieux se représenter les relations complexes producteur/
client quand il s’agit d’installer, de suivre, voire de remplacer
du matériel chez le client, et enfin, à mieux percevoir le rôle
que tiendra le producteur dans l’optimisation à long terme des
usages du client.
2. Un nouveau
Business Model
sur le secteur de l’énergie :
quelles propositions ?
La première proposition consiste à repenser la relation
producteur-client comme une combinaison de ressources, en
suivant une logique d’interfaces sur le long terme (le cycle de
co-conception, co-production).
La seconde, à introduire la notion de service orienté résultat,
en adoptant une logique contractuelle spécifique (un modèle
contractuel hybride).
Enfin, la troisième, à accompagner le changement au
cours d’une nécessaire transition en sollicitant des initiatives
publiques et en exploitant les externalités positives de ce
nouveau
Business Model
. La mise en œuvre de cette stratégie
impliquera une reconfiguration des différentes parties prenantes
de l’ensemble du secteur.
2.1. Première proposition : repenser
la relation producteur-client
Afin de limiter les risques d’obsolescence et d’intangibilité,
cette première proposition de réponse du
Business Model
redéfinit la relation des parties prenantes (producteur/client) en
termes de ressources à mobiliser et à combiner. Les ressources
des producteurs sont immatérielles ou cognitives, matérielles
et nominales, telles que les employés, les savoir-faire, les
immobilisations, les bases de données… (B. Edvardsson et J.
Olsson, 1996 ; S. Fließ et M. Kleinaltenkamp, 2004).
Les ressources apportées par les clients, dans le cas d’un
équipement en énergie renouvelable sont multiples : elles
peuvent être matérielles (comme le bâti, le lieu de l’installation,
l’équipement existant qui sera à changer ou à modifier), immaté-
rielles (contrats en cours, données du client (consommation,
endettement, fiscalité…)), financières (trésorerie disponible,
épargne mobilisable en vue du projet), ou encore cognitives
(capacité à interpréter et à évaluer).
La combinaison des ressources de ces deux parties prenantes
peut produire ses effets sous la forme d’une co-conception et
d’une transformation à l’issue d’une co-production. Sur la base
de ce qui précède, le
Business Model
proposé apportera une
réponse globale, décomposable en un cycle temporel défini
comme suit : (avant, pendant et après l’équipement) :
•
avant l’équipement, dans la phase de prise de décision
du client, le producteur devra partager en toute transpa-
rence avec son client un ensemble d’informations sur le
couple technologie pro-environnementale/risque d’obso-
lescence, l’aidant à préparer un choix argumenté et
stabilisé. À ce stade, le
Business Model
devra proposer
une offre riche en valeurs potentielles pour le client. Ces
© Direction et Gestion | Téléchargé le 19/08/2021 sur www.cairn.info via Université de Lorraine (IP: 193.50.135.4)
© Direction et Gestion | Téléchargé le 19/08/2021 sur www.cairn.info via Université de Lorraine (IP: 193.50.135.4)

La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 295 – stratégie14
Dossier I
Innovations et marketing
janvier-février 2019 www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion.htm
valeurs sont définies comme exprimant la capacité du
producteur à faire connaître concrètement toutes les
ressources qu’il peut mettre à la disposition du client
(K.J. Mayer et
al
., 2003 ; S. Moeller, 2008) ;
•
pendant l’équipement, au moment de l’installation,
commence la phase de transformation. L’objectif de
cette phase consiste à amener le client à choisir les
solutions les plus flexibles et les plus évolutives en
termes d’aménagement du bâti et d’équipement. Par
exemple, lors de l’installation d’une chaudière à gaz,
le fournisseur proposera au client qu’un espace suffi-
sant et facile d’accès soit prévu afin de faciliter son
remplacement par une chaudière à biomasse. De même,
lors de l’installation de panneaux photovoltaïques
sur la toiture d’une maison, le fournisseur proposera
une installation qui facilitera leur remplacement sans
provoquer de dommages sur la toiture, et en ayant
notamment recours à des panneaux de dimension
standard facilement remplaçables. Dans la phase de
transformation, le client agit comme un co-producteur
(S.L. Vargo et R.F. Lush, 2006 ; R.F. Lush et
al
., 2007)
en intégrant ses propres ressources (bâti, toiture…).
Le rôle de ce nouveau
Business Model
est de faciliter
cette co-production permettant ainsi de créer de la valeur
d’échange pour le client (J.A. Constantin et R.F. Lush,
1994). Cette valeur résulte de l’ensemble des moyens
mis en œuvre pour faciliter et optimiser la combinaison
des ressources conduisant à la transformation. Une fois
l’équipement installé, le client bénéficie des usages
prévus par l’offre, créant ainsi des valeurs d’usage (E.
Gummesson, 1995 ; N. Mizik et R. Jacobson, 2003) ;
•
enfin, le cycle se clôt par l’envoi régulier d’informations
sur les évolutions techniques et sur d’éventuelles
nouvelles externalités attachées à chaque technologie.
La figure 1 propose une représentation schématique du
cycle de la relation client.
Figure 1. Cycle de la relation producteur-client
2.2. Deuxième proposition : introduire
la notion de service orienté résultat grâce
à un modèle contractuel hybride
L’économie de la fonctionnalité apparaît comme une réponse
particulièrement appropriée aux risques environnementaux.
L’objectif économique de la fonctionnalité est de proposer
la plus grande valeur d’usage sur la plus longue période
possible, tout en consommant la plus petite quantité de
ressources et d’énergie (W.R. Stahel, 1997). En référence
avec les systèmes de services éco-efficients, l’économie de la
fonctionnalité combine un système de produits et de services
pour fournir l’usage attendu de manière à réduire son impact
sur l’environnement (M.J. Goedkoop et
al
.1999). Ces systèmes
sont habituellement classés en trois catégories distinctes (K.
Hockerts, 1999 ; A. Tukker et U. Tischner, 2004 ; T.S. Baines et
al
. 2007) : les services orientés produit, les services orientés
usage et les services orientés résultats.
Dans le cadre de la production d’énergie verte, la proposition
de
Business Model
s’appuiera, après examen critique, sur la
définition des services orientés résultat. Ce choix est justifié
par le fait que les services orientés produit sont adaptés aux
opérations de maintenance ou de conseil pour un équipement
donné. Ils sont cependant inadaptés pour traiter les problèmes
d’obsolescence technologique qui exigent plus que des services
autour d’un équipement. De même, les services orientés usage
peinent à offrir une réponse adaptée. En effet, dans les services
orientés usage, c’est l’usage de l’équipement et non l’équipe-
ment lui-même qui serait facturé sans transfert de propriété.
A. Tukker et U. Tischner (2004) montrent tout l’intérêt d’une
telle solution. Dans l’orientation usage, le partage des risques
d’obsolescence pourrait être négocié entre les clients et les
producteurs. Toutefois, les intérêts des parties, dans ce cas
précis, divergent fortement. Les producteurs chercheraient à
amortir le matériel loué sur la plus longue période possible,
alors que les clients souhaiteraient rester à la pointe des
technologies pro-environnementales. Si des solutions peuvent
être recherchées (limitations contractuelles des changements
de technologies, coûts d’installation et de remplacement des
équipements à la charge du client sans transfert de propriété…),
il reste un problème majeur qui confirme le caractère inadapté
des services orientés usage en ce domaine. Ce problème est
celui de la nature du contrat et de l’obligation juridique qu’il
contient de son renouvellement à chaque changement d’équi-
pement. Cette contrainte obscurcit toute vision à long terme
pour les deux parties (risque d’infidélité à chaque renouvelle-
ment, incertitude sur les conditions du nouveau contrat…). À
la suite du constat d’inadaptation de ces deux orientations
de service, la proposition de
Business Model
s’appuiera sur
la définition des services orientés résultat. Néanmoins cette
proposition devra s’accompagner d’innovations pour contourner
des difficultés spécifiques liées aux indicateurs de résultats
dans le secteur de l’énergie.
© Direction et Gestion | Téléchargé le 19/08/2021 sur www.cairn.info via Université de Lorraine (IP: 193.50.135.4)
© Direction et Gestion | Téléchargé le 19/08/2021 sur www.cairn.info via Université de Lorraine (IP: 193.50.135.4)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%