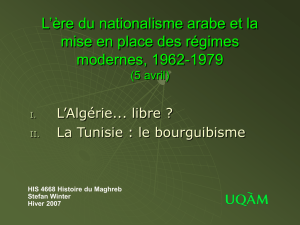Gilbert Grandguillaume
École des hautes études en sciences
sociales,
Paris
LA FRANCOPHONIE EN ALGÉRIE
L'Algérie est un grand pays francophone et pourtant elle ne fait pas partie de la Francophonie. Pour comprendre ce
paradoxe, il faut réaliser que la langue française en Algérie est l'objet d'une forte ambivalence, qui présente des aspects
sociaux, culturels, politiques et identitaires. L'Algérie a été constituée par la France qui lui a en même temps nié toute
identité propre
:
«L'Algérie, c'est la France», a-t-on longtemps répété. La langue française est ainsi au cœur d'un nœud
complexe. Il faut donc exposer ces problèmes, examiner la situation actuelle et s'interroger sur les perspectives ouvertes.
Les problèmes liés à la francophonie en Algérie
Le paysage linguistique de l'Algérie est multilingue. Citons d'abord l'arabe, langue du Coran et de l'islam. Dénommé
arabe classique, seule langue arabe écrite, considéré comme sacré et affecté aujourd'hui à des usages profanes, il
s'est
trouvé
en position difficile durant la colonisation. En effet, la langue française prit sa place dans l'enseignement et pour les usages
officiels. L'ouverture au monde moderne se fit par le français. Par ailleurs, la langue maternelle est représentée par des
parlers arabes et par des parlers berbères dans certaines régions telles que la Kabylie.
Bref,
en 1962, tout le pays fonctionnait
en français
:
enseignement, administration, environnement, secteur économique. Du fait de l'extension de l'enseignement
avec
l'indépendance, la langue française
s'est
beaucoup plus implantée en Algérie qu'elle ne l'avait fait durant
la
colonisation.
Toutefois, le gouvernement algérien voulait réaliser la
«
face culturelle de l'indépendance
»
en mettant
à
la place de la langue
française la langue arabe, non pas la langue parlée, mais la langue arabe standard issue de l'arabe coranique
:
ce fut l'objet
de la politique linguistique d'arabisation1. En dépit de résistances diverses, cette opération fut menée à son terme dans les
années 1980 jusqu'à la production de bacheliers en arabe. Le français a continué à être enseigné comme langue étrangère
à partir de la quatrième année de l'enseignement primaire, mais sa place a été réduite
:
le tableau suivant donne une idée
de cette évolution en ce qui concerne le nombre de maîtres dans l'enseignement primaire selon la langue qu'ils utilisent.
HERMES
40,
2004 75

Gilbert Grandguillaume
Effectifs des enseignants du primaire
Année
1962-1963
1972-1973
1982-1983
1992-1993
2001-2002
Total enseignants
12696
47459
99648
153479
169993
De langue arabe
3342
31437
76982
134359
147570
De langue française
9354
16022
22666
19120
22423
Source
:
ministère de l'Éducation nationale, Alger.
En ce qui concerne l'enseignement supérieur, son arabisation fut largement entamée, notamment dans les sciences
humaines, mais le secteur économique (et en partie administratif) a continué à être géré en français (ou, à la rigueur, en
anglais).
Cette politique d'arabisation
s'est
déroulée de façon conflictuelle, à la différence de ce qui
s'est
passé en Tunisie et au
Maroc, où une option de bilinguisme franco-arabe a été généralement assumée. Ce bilinguisme fut pratiqué dans les
premières années de l'indépendance, mais le conflit qui opposait deux couches de la société a visé à éliminer la langue
française. Les enjeux en étaient idéologiques, mais aussi économiques
:
il s'agissait pour les arabisants de prendre les places
occupées par les francisants, au besoin en créant chez eux une mauvaise conscience fondée sur le lien langue
française/France/colonisateur. Ainsi, cette politique
s'est
imposée dans un climat d'hypocrisie sociale (la langue française
demeurant la langue de la réussite réservée à l'élite) et a conduit à une faillite du système d'enseignement, constatée tant
par les personnalités politiques (présidents
Boudiaf,
Bouteflika) que par des commissions de réforme de l'enseignement
(révélant, par exemple, le taux important d'échecs à l'examen du baccalauréat). De plus, cette politique d'arabisation
s'est
trouvée discréditée à partir des années 1980 par le lien qu'elle a entretenu avec le mouvement islamiste qui a utilisé les
enseignants arabisants pour sa propagation. Elle l'a été enfin par le fait que ses promoteurs se sont opposés non seulement
à la langue française, mais aussi aux langues parlées2, arabes et surtout berbères, ce qui a engendré, de la part des Kabyles
principalement, une opposition déterminée à cette politique.
Au mépris de considérations pédagogiques, l'arabisation a été l'instrument d'un clan politique
;
elle a été un moyen
de conquête d'une partie du pouvoir. Elle était en même temps utilisée par le régime en place qui recherchait une légitimité
dans la référence à l'islam et dans l'hostilité à la France. Or ce même pouvoir, considéré dans les années 1980 comme
autoritaire et corrompu, avait utilisé la langue française pour la gestion du pays
:
de ce fait, celle-ci avait pris aux yeux des
masses une connotation oppressive. Mais comme
elle
bénéficiait, par
ailleurs,
d'une image positive d'ouverture
à la
modernité
et de libération des tabous traditionnels, elle
s'est
trouvée au cœur d'une ambivalence, objet d'attachement et de rejet, sur
le modèle de la relation à la France.
L'état de la francophonie en Algérie
Aujourd'hui, la langue française tient en réalité une grande place en Algérie. Elle est enseignée à partir de la quatrième
année du primaire. Il est question de le faire dès la deuxième année et de reprendre la formation d'enseignants de français,
négligée depuis les années 1980. Elle a sa place dans le secondaire, comme langue étrangère, et dans le supérieur, surtout
76 HERMÈS
40,
2004

La Francophonie en Algérie
dans les matières scientifiques. Elle est pratiquée dans de nombreuses écoles privées (autrefois interdites). Elle est toujours
considérée comme la clé nécessaire pour poursuivre des études (notamment à l'étranger) ou pour trouver un emploi3. Sa
connaissance est liée pour les jeunes à l'espoir d'émigrer. Elle est présente dans les foyers par la télévision
;
les quotidiens
publient en effet les programmes de la télévision française, de telle sorte qu'une fraction importante de l'opinion algérienne
vit à l'unisson de la vie publique en France. Une bonne proportion de la presse, privée ou publique, est publiée en français.
Quant au secteur économique, il ne fonctionne qu'en français ou en anglais. La loi de généralisation de la langue arabe,
adoptée en décembre 1996, n'a été suivie d'aucune application. Ainsi,
à
la différence des années 1980, il n'y
a
plus en Algérie
d'impératif politique susceptible d'exclure la langue française ou d'en interdire l'emploi.
Outre sa présence directe, le français est présent en Algérie dans le langage quotidien par son association aux autres
langues parlées, dans le cadre de ce qu'on appelle l'alternance codique selon laquelle une phrase peut comprendre une
alternance d'algérien, de français et de berbère. Le français est devenu une réserve pour les langues algériennes
:
arabes ou
berbères, elles prennent des mots français auxquels elles donnent une forme locale
:
téléphonit-lu («je lui ai téléphoné»),
entend-on couramment. C'est donc une nouvelle façon de parler qui se crée en Algérie, à laquelle le français est associé,
de même qu'il l'est à la création artistique d'auteurs, de chanteurs ou de comédiens, qui ont recours à trois langues
d'expression
:
le français, l'arabe et le berbère. Une enquête récente de D. Caubet sur la création artistique4 donne la parole
à certains d'entre eux.
Des perspectives ouvertes
Lors du IXe sommet de la Francophonie, à Beyrouth, en octobre 2002, le président Bouteflika a prononcé devant les
chefs d'État et de gouvernement un important discours exprimant l'ouverture de l'Algérie au monde extérieur. Il
y
participait
en tant qu'invité personnel du président libanais. De fait, cette démarche ne
s'est
pas doublée d'une adhésion officielle à
laquelle l'opinion algérienne n'est pas préparée. Dans le même temps, une commission de réforme de l'enseignement a
travaillé durant une année (2001-2002). Son rapport n'a pas été rendu public, mais il
s'est
avéré qu'une partie importante
de ses travaux a été dominée par l'opposition entre partisans et adversaires du français, dans le cadre d'une rénovation de
la pédagogie et d'une modernisation de la structure d'enseignement.
Les conflits qui ont suivi ces travaux ont révélé la sensibilité d'une bonne partie de l'opinion à la question linguistique
et ont témoigné d'un attachement profond à la langue arabe pour diverses raisons. Pour certains, l'échec de l'enseignement
est lié à la part trop grande réservée au français dans le milieu social. De plus, l'attachement à la religion, à une forme de
vie traditionnelle, la conscience de l'hypocrisie sociale qui entoure la question du français, la méfiance vis-à-vis d'un
débridement des mœurs sous l'influence occidentale font qu'existe un large courant d'opinion attaché à la langue arabe,
qui empêche le pouvoir de décider de certains changements, comme des mesures pour l'accroissement de la part du français
dans les programmes et, encore plus, l'adhésion à la Francophonie. Toutefois, il existe aussi - et en partie chez les mêmes -
un fort courant moderniste qui estime que la revalorisation de l'enseignement nécessite de donner une part plus grande au
français (voire à l'anglais).
Ceci conduit à s'interroger sérieusement sur la place des langues en Algérie. Il est certain que l'arabisation, même mal
conduite, répondait réellement à un souhait de la population d'être rattachée par cette langue à l'islam et au monde arabe.
Or cette conscience existe toujours, réactivée quotidiennement par les événements de Palestine et d'Irak. C'est pourquoi
les circonstances actuelles, qui pourraient conduire à donner une part trop belle au français, et ceci d'autant plus facilement
qu'une large part de l'opinion le souhaite, doivent être considérées avec une grande prudence. En fait, l'Algérie a besoin
HERMÈS
40,
2004 77

Gilbert Grandguillaume
des deux langues de culture, le français et l'arabe, pour des objectifs différents, complémentaires, mais potentiellement
antagonistes. Aussi la meilleure solution à envisager dans le cadre de la Francophonie serait-elle d'aider l'Algérie à mettre
en place un véritable bilinguisme, hors de l'opposition actuelle qui réserve le français au moderne et l'arabe à la tradition.
Car
c'est
une promotion des deux langues qui est nécessaire, dans une coopération pédagogique qui aiderait l'arabe à se
moderniser et le français à être assimilé.
C'est
seulement à cette condition que la perspective de diversité culturelle pourrait
témoigner de sa sincérité, alors qu'une victoire trop facile du français sur l'arabe,
à la
faveur des déboires subis par
la
politique
d'arabisation, pourrait réserver des lendemains amers.
Un colloque tenu à l'Institut du monde arabe5, organisé par le ministère des Affaires étrangères (qui vient de mettre
en place, en coopération avec l'Algérie, un important programme de formation de professeurs de français), a semblé
admettre cette perspective, mais sa mise en œuvre ne pourra se faire que si la Francophonie n'est plus perçue comme un
nouvel impérialisme linguistique, mais comme un cadre qui veut laisser leur chance à toutes les langues, à plus forte raison
à une langue comme l'arabe qui plonge ses racines dans une longue histoire culturelle, dans laquelle l'Algérie reconnaît une
part de son identité.
NOTES
1.
Pour cette question, voir mon ouvrage
Arabisation
et
politique linguistique
au
Maghreb,
Maisonneuve et Larose, Paris, 1983, et, pour le suivi
récent, ma contribution «Les enjeux de la question des langues en Algérie», in BISTOLFI R. (dir.), Les
Langues
de la
Méditerranée,
Paris,
L'Harmattan,
2003,
p. 141-165.
2.
Voir à ce sujet
BENRABAH
M.,
Langue
et
pouvoir
en
Algérie.
Histoire
d'un
traumatisme
linguistique,
Paris, Séguier, 1999.
3.
C'est
ce que révèle l'étude intitulée «Perception et pratique des langues étrangères dans le système éducatif en Algérie»,
Revue
du
CENEAP
(Centre national d'études et d'analyses pour la planification), n° 18, Alger, 2000.
4. CAUBET
D.,
Les
Mots
du
bled.
Création contemporaine
en
langue
maternelle,
Paris, L'Harmattan, 2004.
5.
Colloque «Français-arabe, arabe-français
:
construire ensemble dans une perspective plurilingue», Institut du monde arabe, 13-14 novembre
2003,
Paris.
78 HERMÈS
40,
2004
1
/
4
100%