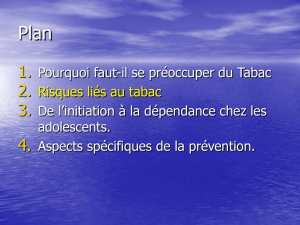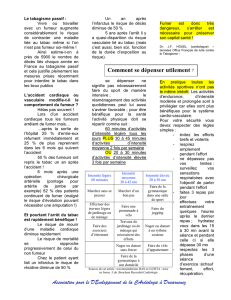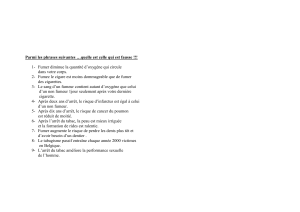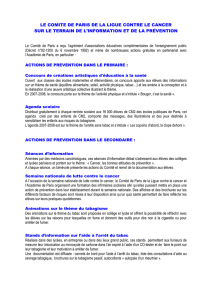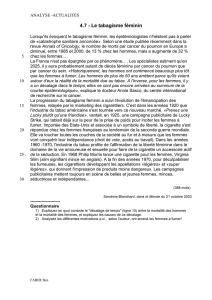This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached
copy is furnished to the author for internal non-commercial research
and education use, including for instruction at the author's
institution and sharing with colleagues.
Other uses, including reproduction and distribution, or selling or
licensing copies, or posting to personal, institutional or third party
websites are prohibited.
In most cases authors are permitted to post their version of the
article (e.g. in Word or Tex form) to their personal website or
institutional repository. Authors requiring further information
regarding Elsevier's archiving and manuscript policies are
encouraged to visit:
http://www.elsevier.com/authorsrights

© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
http://dx.doi.org/10.1016/j.sger.2016.11.007 SOiNS GÉRONTOLOGIE - no123 - janvier/février 2017
32
Les addictions chez les personnes âgées
dossier
Vieillesse et tabac
Fumer n’est plus à la mode. Si, il y a cinquante
ans, dans la jeunesse des aînés d’aujourd’hui,
l’image du fumeur était valorisée, l’inverse prédo-
mine aujourd’hui. Il suffi t de repenser aux modes
de présentation des présidents de la République
française depuis un siècle pour résumer cela.
Alors que dans l’après Seconde Guerre mondiale,
la virilité, l’affi rmation de l’homme puis la libéra-
tion et l’émancipation de la femme se sont cristal-
lisés dans l’image du fumeur ou de la fumeuse, le
fumeur est devenu au fi l des décennies un dépen-
dant, un “addicté”, voire un paria de nos jours.
Ilen est de même pour les personnes âgées, dont
les représentations en train de fumer se font de
plus en plus rares, virant à l’ironie en suggérant
une supposée vigueur maintenue ou un signe
(erroné) de jeunesse conservée. Lespersonnes
âgées fument-elles encore? Du tabac essentiel-
lement, mais que devient la place du cannabis,
dont le vieillissement des baby-boomers a fait
annoncer l’explosion de l’usage parmi les aînés?
Lesdangers du tabac sont-ils toujours nécessaires
à prendre en compte? Vaut-il toujours la peine
d’arrêter de fumer quand on est vieux, alors que
la mort s’approche?
FUMER AU GRAND ÂGE
Si dans les années 1950, 69% des hommes et
6% des femmes entre 60 et 75ans fumaient, ils
n’étaient respectivement plus que 19% mais 9%
en 2001. En 2010, on comptait 10% des hommes
et 6% des femmes fumant régulièrement dans les
mêmes tranches d’âges (et respectivement 5% et
4% de 75 à 85ans).
z
Au fil des décennies de la vie, la part des
fumeurs décroît régulièrement,
chez les
hommes et chez les femmes, après 30ans[1].
Dans le même temps, les aînés fument de
moins en moins depuis le milieu du XXesiècle.
Cependant, les fumeurs âgés ne disparaissent
pas, même si la réduction spontanée ou l’arrêt du
tabagisme avec l’avancée en âge, comme des auto-
guérisons, écartent cette question des priorités de
santé publique[2], comme toutes les addictions
du sujet âgé.
Plus de trois quarts des aînés fumeurs ont
commencé à fumer avant l’âge de 25ans[3],
lorsque le tabac et son usage était valorisé à bien
des égards. Mais il existe aussi des fumeurs âgés
tardifs qui ont commencé en raison de la surve-
nue d’événements négatifs et stressants (deuil,
isolement social, rupture conjugale, retraite, par
exemple)[4].
z
La prise en compte des impacts négatifs
du tabagisme a transformé la place du tabac
dans notre société.
Le tabagisme est une des
principales causes de décès des aînés, et les dom-
mages dus au tabac persistent quel que soit l’âge:
diminution du goût et de l’odorat, sans oublier
la pathologie cancéreuse et cardio-pulmonaire
induite[3]. Malgré cela, les motifs de poursuite
et de maintien du tabagisme chez les sujets âgés
demeurent, entre raisons positives (habitude,
stratégie soignante
z Les aînés d’aujourd’hui ont vu s’inverser l’image du fumeur depuis un demi-siècle, passant de
la valorisation à l’opprobre z Le tabagisme, même s’il décline avec l’âge, ne disparaît pas dans la
vieillesse z Les risques et les dommages du tabac existent à tout âge, même avancé z D’une question
individuelle, le choix de fumer devient un problème collectif en Ehpad z Le sevrage tabagique amène
toujours des bénéfi ces, même après 80ans.
© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
© 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved
Old age and smoking. Elderly people today have seen a radical change in the image of smokers
over the last half century. While once it was approved, it is now demonised. Although smoking declines
with age, there are still many elderly smokers. The risks and harm of smoking remain, even in old age.
An individual choice to start with, smoking becomes a collective issue in a nursing home. Stopping
smoking always brings benefi ts, even after the age of 80.
PASCAL MENECIERa,b,*
Médecin addictologue, gériatre,
docteur en psychologie
ALBA MOSCATOc
Psychologue clinicienne,
docteur en psychologie
LYDIA FERNANDEZb
Professeur en psychologie
de la santé et du vieillissement
aCentre hospitalier de Mâcon,
boulevard Louis-Escande,
71018Mâcon cedex, France
bInstitut de psychologie,
Université Lyon 2,
5 avenue Pierre-Mendès-
France, Campus Porte des
Alpes, 69500 Bron, France
cLaboratoire de
psychopathologie et processus
de santé, Institut universitaire
Paris Descartes – Sorbonne
Paris-Cité, 71avenue Édouard-
Vaillant, 92774Boulogne-
Billancourt cedex, France.
*Auteur correspondant.
Adresse e-mail :
(P. Menecier).
Mots clés – santé; sevrage; société; sujet âgé; tabagisme
Keywords – elderly person; health; smoking; society; withdrawal
Author's Personal Copy

SOiNS GÉRONTOLOGIE - no123 - janvier/février 2017 33
Les addictions chez les personnes âgées
dossier
recherche de plaisir, de relaxation, réduction des
tensions, recherche d’excitation…) et motiva-
tions négatives (dépendance et passivité, inassou-
vissement des besoins, isolement, quête d’image
de soi positive…)[3].
z
Quant au cannabis, apanage des jeunes
adultes d’aujourd’hui, dont plus de la moitié
a déjà expérimenté le produit,
les aînés n’en
consomment qu’assez exceptionnellement.
La littérature rapporte quelques observations
anecdotiques, à l’image des descriptions du
mésusage d’alcool de sujets âgés, il y a trois ou
quatre décennies. Si un accroissement de la
fréquence de consommation du cannabis la
vie durant a été objectivé en milieu urbain en
Angleterre dans les premières années de la
vieillesse[5], parmi les aînés rencontrés en géron-
tologie comme dans les établissements d’héberge-
ment pour personne âgée dépendante (Ehpad),
la réalité de ces situations demeure ponctuelle.
Il semble exister un désintérêt des plus de 60ans
pour le cannabis[6]. Seul l’avenir dira si cette
question prend de l’ampleur dans la vieillesse,
sans pouvoir en préciser a priori ni le délai ni
l’importance.
LES BIENFAITS DU SEVRAGE TABAGIQUE
Même si la majorité des fumeurs s’arrête
seuls, sans intervention de professionnels de
santé, d’autres ont besoin d’aide et de soutien.
Ilconvient avant tout d’éviter toute attitude
d’âgisme envers les fumeurs, en envisageant
l’âge à partir duquel il ne vaudrait plus la peine
de s’arrêter de fumer…
z
En effet ,le sevrage tabagique est bénéfi que
à tout âge
[7]. Il accroît l’espérance de vie, après
60ans comme après 80ans[7]. Surtout, il est
bénéfi que en prévention secondaire des affec-
tions cardio-vasculaires, tout comme il améliore
la qualité de vie, dans la vieillesse[8]. Il n’existe
pas plus de difficultés à arrêter la consomma-
tion de tabac chez les aînés que chez des adultes
plus jeunes [7], et il y a même plus de chances
de réussite du sevrage tabagique après 60 ans
qu’avant[9].
z
Par ailleurs, les moyens pharmacologiques
d’aide au sevrage tabagique
n’ont pas de spécifi -
cités gériatriques, pour les substituts nicotiniques,
qui gardent toute leur place[4]. Quant aux autres
médicaments, bupropion à demi- posologie
(Zyban®) ou varénicline (Champix®), ils ont une
place restreinte en raison de précautions d’em-
ploi majorées.
z
Quant à la cigarette électronique,
avec toutes
ses incertitudes d’emploi ou de rapport bénéfi ce-
risque, très peu d’éléments à son sujet concer-
nent les aînés. Il semble rationnellement possible
de retenir que son emploi est préférable au fait
de fumer du tabac (en termes de réduction des
risques et des dommages encourus), même si
l’idéal reste l’objectif d’arrêter de fumer comme
de vapoter.
DÉMARCHES DE SOIN
NON MÉDICAMENTEUSES
Certaines études soulignent qu’un nombre non
négligeable de personnes de plus de 65ans qui
fument, souhaite renoncer à la cigarette[10] mais
contrairement aux jeunes, ils sont moins suscep-
tibles d’être aidés par des professionnels de santé
pour renoncer au tabac[11].
z
En association aux offres médicamenteuses,
les soutiens thérapeutiques ont toute leur
place.
De la simple relation d’aide aux soutiens
psychologiques par des médias (relaxation théra-
peutique, art-thérapie, photo-langage) ne man-
quent pas d’intérêts auprès de cette population
et paradoxalement sont peu proposés. Les psy-
chothérapies peuvent être également effi cientes
(thérapies cognitivo-comportementales, psycha-
nalytiques, psychodynamiques, systémiques…)
mais à condition que l’accompagnement puisse
répondre à certaines modalités de base comme
une relation suffi samment empathique envers
l’âgé et un questionnement sur son positionne-
ment professionnel lié aux effets de la vieillesse.
z
Outre ces modalités, la conduite tabagique
de l’âgé s’inscrit dans un triptyque biolo-
gique, sociologique et psychologique
où la
consommation est marquée d’une complexité
plurifactorielle résultant d’interactions entre
différents facteurs biologiques, génétiques, psy-
chologiques, environnementaux qui marquent
la nature de l’activité en elle-même. Aussi, un
seul modèle théorique de compréhension et
d’accompagnement thérapeutique ne peut en
aucun cas prendre en compte et répondre à cette
complexité. Aussi, l’aide qui pourra être proposée
devra s’articuler dans une approche intégrative
(complémentarité de plusieurs intervenants et
de leurs différentes approches théoriques, thé-
rapeutiques ou savoir-faire) tout en s’adaptant
aux différents temps d’accompagnement et ceci,
en fonction de l’objectif poursuivi par l’âgé mais
aussi, au regard de ses capacités physiques, cogni-
tives et psychiques conservées.
RÉFÉRENCES
[1] BeckF, GuignardR,
RichardJB, WilquinJL, Peretti-
WatelP. Baromètre santé 2010.
Saint-Denis: Inpes; 2010. http://
inpes.santepubliquefrance.
fr/Barometres/barometre-
sante-2010/index.asp
[2] FernandezL, Finkelstein-
RossiJ, BernoussiA. Le tabagisme
des séniors. In: FernandezL.
Lesaddictions du sujet âgé. Paris:
Éditions In Press; 2009. p. 27-42.
[3] FernandezL, Finkelstein-RossiJ.
Approche clinique et sociale du
tabagisme chez les sujets âgés:
genèse, contexte, développement
et prise en charge. Psychologie
française. 2010; 55: 309-323.
[4] MenecierP, FernandezL.
Particularité des pratiques
addictives dans la vieillesse. La
Presse médicale. 2012;41(12):1226-
1232.
[5] FahmyV, HatchSL, HotopfM,
StewartR. Prevalence of illicit drug
use in people aged 50years and
over from two surveys. AgeAgeing.
2012;41(4):553-6.
[6] HachetP. Qui sont les “vieux” qui
fument des “joints”. In: Fernandez
L. Les addictions du sujet âgé. Paris:
Éditions In Press; 2009. p.93-101.
[7] ThomasD. Faut-il arrêter le
tabac quand on est âgé? Oui!
Lesevrage tabagique est bénéfi que
à tout âge. La Presse médicale.
2013;42:1019-1027.
[8] SalveA, LeclercqS, PonavoyE,
TrojakB, Chauvet-GelinierJC,
VandelP et al. Conduites addictives
du sujet âgé. EMC, Psychiatrie.
2011;37-530-A-30.
[9] CroizetA, PerriotJ, MersonF,
Aublet-CuvelierB. Sevrage
tabagique de fumeurs âgés. Revue
des maladies respiratoires. 2016;
33(3):241-47.
[10] DonzéJ, Ruffi euxC, CornuzJ.
Determinants of smoking and
cessation in older women. Age and
Aging. 2007;36:53-57.
[11] TaitR, HulseG, WaterreusA,
FlickerL, LautenschlagerN,
JamrozikK et al. Effectiveness of
a smoking cessation intervention
in older adults. Addiction.
2006;102:148-55.
[12] Anesm. Recommandations de
bonnes pratiques professionnelles,
Qualité de vie en Ehpad (volet 2),
Organisation du cadre de vie
et de la vie quotidienne. 2011.
www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/
pdf/Anesm_04_QDV2_CS4_
web090911pdf-2.pdf
Author's Personal Copy

SOiNS GÉRONTOLOGIE - no123 - janvier/février 2017
34
Les addictions chez les personnes âgées
dossier
z
Ainsi, tout en gardant à l’esprit que le profes-
sionnel doit s’adapter aux modalités du vieillis-
sement et de la personne âgée,
la mobilisation
du conjoint (s’il existe) et du réseau social de la
personne (famille, amis, relations personnelles et
professionnelles) est nécessaire dans cet accom-
pagnement. En effet, dans cette classe d’âge, le
soutien social perçu (la satisfaction et l’insatisfac-
tion du sujet vis-à-vis de la disponibilité de cette
aide) est prédictif de la réussite thérapeutique
tout en diminuant les rechutes et en favorisant
des traitements à moins long terme[3-14].
FUMER EN EHPAD
Quittant son domicile personnel pour entrer
en Ehpad, les aînés voient leurs conditions de
vie et leurs libertés se modifier, au premier rang
desquelles, celle de fumer! Entre la chambre (subs-
titut de domicile), où les possibilités de fumer sont
souvent réduites au nom de la sécurité incendie, les
locaux communs, où prévaut l’interdiction de fumer
dans les lieux publics, et les diffi cultés à se mouvoir,
réduisant les possibilités d’aller dehors pour fumer,
le tabagisme est rare et contraint en Ehpad.
z
Au nom de la prévention incendie et du déve-
loppement d’une culture sécuritaire
dans les
institutions gériatriques, l’interdiction de fumer
dans les chambres peut sembler excessive ou
abusive[12]. En revanche, l’impossibilité de
fumer dans les lieux communs (et publics) est
aujourd’hui acquise, et ne peut être remise en
question, en référence aux risques avérés du taba-
gisme passif. Reste à fumer hors des bâtiments, et
pour cela il faut déjà pouvoir s’y rendre, ce qui
n’est plus le cas en unité de vie sécurisée. Entre
liberté individuelle et risque collectif, les déci-
sions sont complexes, ne pouvant simplement se
résoudre par le règlement intérieur et le contrat
de séjour, comme une nouvelle loi différant de la
loi commune à tous.
z
Ensuite, il faut pouvoir gérer son tabac et
son briquet ou ses allumettes,
ce qui n’est pas
toujours permis à certains aînés, pour les mêmes
raisons de craintes d’incendie. Alors les soignants
se voient attribuer la tâche de garder les cigarettes
et le briquet pour les remettre à heures précises,
dans un programme intuitivement convenu, et
parfois selon les gratifications ou non du rési-
dent… Il n’est pas certain que cela soit de leur
compétence, pas plus que d’accompagner pour
fumer ou allumer la cigarette d’un aîné moins
valide(ce qui peut confi ner à la permissivité ou à
l’incitation à fumer).
z
Surtout la pharmacie à usage intérieur du
service n’est pas le meilleur lieu de stockage
du tabac,
même si c’est commun dans bien des
services, faisant indirectement référence à de
supposés effets psychothérapeutiques du tabac,
hérités d’idées passéistes et erronées. Ainsi, sou-
haiter continuer de fumer en Ehpad relève de la
gageure, même si cela n’est pas recommandé.
TABAC ET ALZHEIMER
Alors qu’il est maintenant admis que la nicotine
ne protège ni ne prévient la maladie d’Alzheimer
ni aucune autre pathologie apparentée, contrai-
rement à ce qui était énoncé jusqu’à il y a dixans,
fumer expose à une baisse des capacités cognitives
chez les plus de 65ans, et le déclin cognitif est plus
rapide chez les fumeurs de plus de 75ans que
chez les non-fumeurs[3].
z
La maladie d’Alzheimer ou une pathologie
apparentée ne fait pas abandonner la prise
du produit,
mais cette conduite peut mener la
personne à des tentatives de réminiscences ou
de maintien d’une image de soi. Ainsi, parmi les
hypothèses du tabagisme, et au-delà de la dimen-
sion addictive, il a pu être envisagé que fumer
permettrait de réduire momentanément le côté
incontrôlable de l’environnement par l’intro-
duction d’une sensation familière de déjà vu,
de maintenir un sentiment d’identité et de per-
ception de soi, de favoriser un plaisir résiduel de
fonctionnement, par réminiscence. Pour autant,
il ne faudrait surtout pas inverser le propos en
envisageant des ateliers réminiscences autour du
tabac! Bien d’autres médias existent et sont déjà
expérimentés sans les dangers associés au tabac.
CONCLUSION
Aucun argument ne peut justifi er de se désinté-
resser du tabagisme du sujet âgé, sans s’exposer
à une discrimination liée à l’âge. Pourtant, les
résistances sont nombreuses avant que d’aborder
cette question, au prix de négliger la qualité de
vie et la santé des aînés.
Au nom d’un supposé dernier plaisir de l’exis-
tence que certains garderaient, il convient de ne
pas négliger les risques pour la santé et la qualité de
vie avant même de considérer la réduction de l’es-
pérance de vie. Considérer le tabagisme du sujet
âgé ne doit pas simplement promouvoir l’inter-
diction de fumer, quel que soit le lieu de vie. Enfi n
fumer n’est pas un gage de jeunesse conservée, et
il n’est jamais trop tard pour s’arrêter de fumer.
n
Déclaration de liens d’intérêts
Les auteurs déclarent ne pas
avoir de liens d’intérêts.
[13] AltintasE, GalloujK,
GuerrienA. Soutien social,
dépression et estime de soi
chez les personnes âgées:
résultats d’une analyse en cluster.
Annales médico-psychologiques.
2012;170 (4):256-62.
[14] HarwoodT, BeutlerLE.
Assessment of clients in
pretreatment planning.
In:Butcher JN. Oxford handbook
of personality assessment.
New York: Oxford University
Press; 2009. p.643-66.
RÉFÉRENCES
Author's Personal Copy
1
/
4
100%