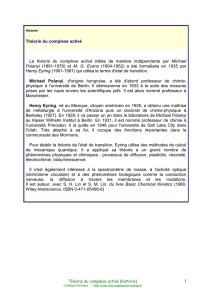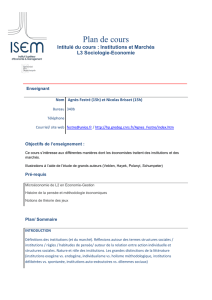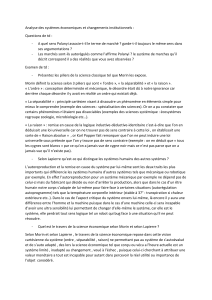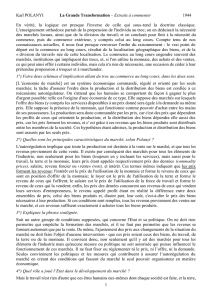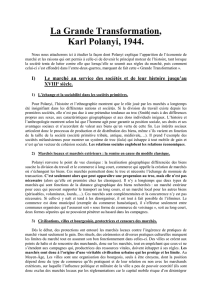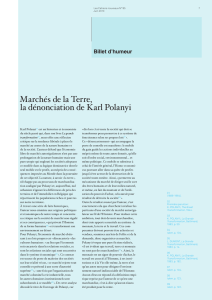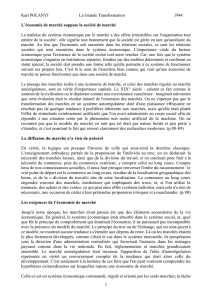« La grande transformation »
K. Polanyi, Edition Tel Gallimard,1983
Résumé :
Première partie : Le système international
1) La paix de cent ans
L’auteur introduit son travail sur l’hypothèse que l’organisation économique et sociale du monde au
XIXème siècle repose sur quatre grandes institutions : l’étalon or, le système de l’équilibre des puissances,
le marché autorégulateur et l’Etat libéral. Il précise qu’il est possible de classer ces institutions de deux
manières différentes puisque deux sont politiques et deux autres sont économiques, mais aussi, deux
concernent l’échelon national et deux autres l’échelon international. Il stipule par ailleurs que l’institution
centrale qui fait office de clé de voute à l’organisation du monde au XIXème est le marché autorégulateur.
Ainsi, ce dernier justifie l’organisation d’un Etat libéral au niveau national. Par ailleurs, l’instauration d’un
étalon or et d’un système d’équilibre des puissances au niveau international ne traduisent que la
transcription d’une organisation marchande libérale nationale vers l’international. K. Polanyi précise que
sur le plan méthodologique expliquer les transformations du monde sur la base d’une institution seule
présente par essence des limites théoriques dont il a conscience. De plus, il considère que l’idée d’un
marché autorégulateur est utopique et que chercher les conditions de sa réalisation débouche
nécessairement sur la désorganisation des structures sociales (dilemme auquel ont été confrontées les
économies de marché). Enfin, il précise que la grande transformation désigne la destruction de ce modèle,
à la suite des deux grands conflits mondiaux.
L’auteur fait par ailleurs le constat que contrairement aux deux siècles précédents le XIXème siècle
est un siècle de paix relative. Il y eu quelques conflits entre les puissances européennes mais ces derniers
étaient de courte durée, du fait notamment pour la guerre franco-prussienne de 1870, de la capacité des
nations à payer des tributs conséquents sans que cela affecte pour autant l’économie nationale. Ceci
s’explique par l’équilibre des puissances entre Etats indépendants. Toutefois, il souligne que cet état
géopolitique tend habituellement à déboucher sur des stratégies d’alliances et de revers qui donnent
généralement lieu à de nombreux conflits armées, comme ce fut le cas pour les différentes cités de la
Grèce antique ou encore pour les républiques du nord de l’Italie au XVIème siècle. Or selon K. Polanyi, cet
état de paix est rendu possible du fait que les banquiers et les industriels préfèrent la paix à la liberté et
l’ensemble des conflits localisés à travers le globe sont courts car ils ne visent qu’à instaurer la paix propice
aux affaires. Il nomme ainsi cette période la « paix de cent ans ».
Puis, K. Polanyi constate qu’au cours des siècles précédents la stabilité politique et la paix étaient
rendus possible du fait de l’influence religieuse d’une part et assurée d’autre part par le soutien armé des
princes d’Europe organisés en dynasties. L‘organisation politique européenne de l’époque, la Sainte-
Alliance, n’a toutefois pas réussi à entretenir la paix aussi efficacement que ne l’a fait le XVIIIème le
« Concert européen » et cela est d’autant plus surprenant que l’influence de l’église était bien moins

prégnante et que les rivalités étaient telles qu’elles donnaient lieu à des complots politiques ou des
trahisons diplomatiques. Le lien qui permit de préserver la paix fut la finance internationale. La banque
Rothschild illustre cette finance internationale, dont la fidélité de ses membres vient entièrement à la
firme, qui intervient à travers le monde entier et qui finance les guerres, les politiques publiques etc. des
différents Etats du monde. Ils illustrent ainsi la dimension cosmopolite et capitaliste de la finance
internationale. Ainsi la paix n’était pas assurée du fait de leurs bon vouloir mais elle l’était car, tout conflit
d’importance entre les grandes puissances aurait nuit à leurs affaires. Toutefois, chaque système financier
national constituait un « microcosme » dont l’organisation et les relations internes étaient pour autant
bien spécifiques. Ainsi, le pouvoir de la finance nationale, aussi cosmopolite soit-il, restait quoi qu’il en soit
quelque peu dépendant à ses attaches nationales. Dès lors le pouvoir politique l’emportait alors sur les
intérêts financiers, ce que K. Polanyi illustre à l’aide différents faits historiques concernant notamment les
relations franco-allemandes (à travers notamment le cas des investissements et transferts financiers après
la guerre de 1870 ou encore celui de la crise marocaine en 1905) et germano-britannique (affaire du
Bagdadbhan) précédents la grande guerre. La haute finance jouait donc un rôle de modérateur et
conditionnait la paix en influençant via le contrôle des investissements, l’accès aux crédits les différentes
forces européennes. La participation à l’ordre international reposait, par ailleurs, aussi deux éléments
décisifs à la puissance d’un Etat-nation : le constitutionalisme et la maîtrise de son budget qui passait par
la maitrise du change vis-à-vis de l’étalon-or. Or la city, haut lieu de la finance internationale, détenait ici,
via la surveillance du cours des monnaies nationales un moyen de pression certains sur la constitution des
budgets nationaux. En définitive, la paix réussit à être maintenue dès lors que l’équilibre des puissances le
permettait. Les rivalités coloniales et les jeux d’alliances qui donnèrent naissance à la triple entente
(Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie) d’une part et à la triple alliance d’autre part (France, Angleterre,
Russie) mirent fin à cet équilibre et mirent en face à face deux puissances belliqueuses qui débouche sur
la grande déflagration que fut la première guerre mondiale.
2) Années vingt conservatrices, années trente révolutionnaires.
La dissolution du système économique mondiale et la chute de l’étalon-or qui commence au tout
début du XXème siècle sont à l’origine de la transformation radicale des sociétés. La première guerre
mondiale et l’ensemble des conflits et révolutions qui l’ont suivies sont des rémanences de l’organisation
économique et politique du XIXème siècle et n’ont fait que précipiter la chute du système et de ses
institutions. Après-guerre, le désarmement des pays de la triple alliance a empêché un retour à l’équilibre
des puissances, condition nécessaire, on l’a vu, avec l’interdépendance né du système économique
mondial, à la préservation de la paix en Europe. La seule solution selon K. Polanyi aurait été la mise en
place d’institutions supranationales ; solution anachronique toutefois selon lui.
La décennie qui suivit la grande guerre fut selon K. Polanyi conservatrice au sens où elle n’avait pour
seul objectif que de rétablir des systèmes économiques et politiques, semblables à ceux du XIXème et inspiré
des idéaux des révolutions anglaise, française et américaine. Selon lui, même la Russie de Lénine et Trotski
s’inscrivait dans cette dynamique. Le véritable basculement eu lieu au début des années lorsque
l’Angleterre abandonna l’étalon-or et que la Russie mis en place les premiers plans quinquennaux. La fin
de ces systèmes se concrétisa au niveau national par une grande instabilité monétaire ayant généralement
pour cause des facteurs extérieurs et qui fit, au niveau national, de la question monétaire, la question

politique centrale : « le bouleversement social qui ébranla la confiance dans la stabilité inhérente à l’agent
monétaire fit aussi voler en éclat, l’idée naïve que pouvait exister une souveraineté financière dans une
économie interdépendante. » En effet, la stabilité monétaire et la parité avec l’étalon or impliqua
rapidement pour les pays occidentaux de devoir mettre en œuvre des mesures protectionnistes. Ainsi,
alors que, par la préservation de l’étalon-or, les nations occidentales cherchaient à préserver un système
international capitaliste et libre-échangiste, ils en venaient finalement à mener une politique qui les
conduisaient vers l’autarcie. C’est avec le krach de 1929 que les Etats-Unis, qui malgré les pressions
inflationnistes sur son sol, cherchaient à soutenir (par proximité et sous influence britannique) la livre
sterling, que la fin du système financier international reposant sur l’étalon-or pris fin. Cet abandon de
l’étalon-or signa la fin des grandes institutions politiques qui veillait à la paix mondiale (notamment la SDN)
et à l’influence politique qu’exerçait les représentants de la finance international (Rothschild et Morgan).
La fin de ce système précipita une transformation des institutions ; transformations qui prirent des visages
différents selon les pays occidentaux (fascisme allemand ou italien, socialisme russe, New Deal américain).
Enfin, l’auteur stipule que ces institutions, l’Etat libéral, l’étalon-or et l’équilibre des puissances n’avait
pour seul objectif que l’instauration des conditions d’un marché autorégulateur. L’ensemble du système
repose donc sur un fondement économique dont la caractéristique est que celui-ci établit comme
motivation première des hommes : la réalisation du gain, du profit. Or, pour soutenir sa thèse, K. Polanyi
se propose de revenir aux origines institutionnelles du capitalisme libéral c’est-à-dire l’Angleterre de la
révolution industrielle au XIXème siècle.
Deuxième partie : Grandeur et décadence de l’économie de marché
I. « Satanic Mill », ou la fabrique du diable
3) « Habitation contre amélioration »
L’auteur cherche à montre que le capitalisme n’a jamais été efficace dans son appréciation du
changement et ce car le capitalisme ne tient compte que de la dimension économique. Il s’appuie sur
l’avènement des enclosures au XVème siècle en Angleterre. En effet, la confiscation souvent par la violence
des terres au paysan par les puissants a débouché, dans un premier temps, sur des révolutions. Puis, sur
la dépopulation d’une partie des campagnes anglaises d’une part, et sur la disparition de la culture au
profit de l’élevage d’autre part. Ces phénomènes poussèrent les autorités à des politiques visant à limiter
les enclosures et à dynamiser les milieux ruraux. Celles-ci furent largement contredites par les libéraux qui
considèrent alors que c’est une atteinte à l’allocation efficace du capital par la concurrence. Toutefois,
selon K. Polanyi l’appréhension du changement ne passe pas exclusivement par la direction qu’il prend
mais aussi par l’intensité à laquelle il s’effectue. Si ce changement était, en partie bénéfique sur le plan
économique, notamment car il permit un accroissement de la productivité, de la fertilité des terres et
accompagna le développement de l’industrie textile, ce changement (« progrès ») impliquait d’en réduire
la rapidité du processus via la mise en place de politiques qui adoucissent la transition. « La croyance dans
le progrès spontané nous rend nécessairement aveugle au rôle de l’Etat dans la vie économique. Ce rôle
consiste souvent à modifier le rythme du change du changement en l’accélérant ou en le ralentissant,
selon les cas. »

Ainsi, les ravages sociaux provoqués par les enclosures et l’avènement d’un système politique
constitutionnel ; qui n’est que la conséquence de la volonté du souverain d’altérer le rythme du
changement et qui conduirent à son discrédit politique ; constituèrent selon l’auteur un « avant-goût » du
délitement social qu’engendra la révolution industrielle au XIXème siècle qui se caractérisa par l’apparition
de taudis et le développement de la pauvreté ouvrière. Les auteurs classiques cherchèrent à expliquer ce
phénomène par la loi des salaires (allusion probable à D. Ricardo ou à J. B. Say) ou celle de la population
(allusion plus que probable à T. R Malthus), d’autres à l’exploitation d’une classe par une autre (allusion
plus que probable à K. Marx), mais selon K. Polanyi, celui-ci résulte avant tout de la mise en place
institutionnelle d’une économie de marché. Il est dès lors selon lui nécessaire de préciser à quel point
l’apparition de machines complexes a permis l’accélération et l’affirmation du processus
d’institutionnalisation marchande des sociétés. En effet, l’acquisition pour un capitaliste d’une machine
complexe est trop onéreuse pour que celui-ci prenne le risque de l’acquérir s’il ne dispose pas d’une part
des possibilités de produire et d’écouler de la marchandise à grande échelle pour rentabiliser son
investissement, et si le prix ainsi que le temps du travail nécessaire à son fonctionnement ne sont pas
librement négociables et modulables. Cela a donc pour conséquence principale de transformer les
ressources naturelles et l’homme en marchandise et donc le délitement progressif du lien social et la
destruction de l’environnement : « La conclusion, bien que singulière, est inévitable, car la fin recherchée
ne saurait être atteinte à moins ; il est évident que la dislocation provoquée par un pareil dispositif doit
briser les relations humaines et menacer d’anéantir l’habitat naturel de l’homme. »
4) Sociétés et systèmes économiques
Dans un premier temps, K. Polanyi insiste sur le fait que le fonctionnement des économies
« civilisées » repose sur l’idéologie née, suite à la publication de la richesse des nations par A. Smith, d’un
marché autorégulateur. Celui-ci est considéré comme un antécédant à toute forme de société et est né
de la propension naturelle qu’ont les hommes à échanger. C’est cette hypothèse de départ que la grande
majorité des travaux en sciences humaines ont cherché à conforter tout au long du XIXème et au début du
XXème et que l’auteur souhaite alors discréditer. D’abord, la répartition des tâches et la division du travail
ne peut résulter de la seule quête du profit mais aussi du sexe, de la nature du territoire, des dispositions
de chacun etc. Par ailleurs, l’objectif économique n’est, sur le plan anthropologique, que secondaire ; c’est
avant tout la reconnaissance et le prestige social qui sont à l’origine des activités de production et de
distribution. L’échange a une dimension symbolique qui confère aux individus une place dans la
communauté. L’auteur, sur la base de travaux anthropologiques, explique ainsi que le fonctionnement de
certaines tribus repose sur un double principe : celui de la réciprocité et de la redistribution. La réciprocité
résulte d’une organisation institutionnelle, celui de la symétrie ; puisque les travaux anthropologiques
témoignent d’échanges symboliques entre deux individus appartenant à deux tribus distinctes l’une dans
les terres, l’autre sur la côte par exemple. Ce schéma régulier est appelé dualité. La redistribution repose
quant à elle, sur une autre organisation institutionnelle, celui de la centralité. Les sociétés primitives vivant
de la chasse, activités collectives et irrégulières, il a vite été nécessaire de centraliser les ressources auprès
de ce que les anthropologues nomment un « headman » qui redistribue les richesses afin d’assurer la
cohésion et la pérennité du groupe. Dans de telles communautés, la notion de profit n’existe pas,
l’organisation sociale est institutionnalisée et assure la division du travail et l’effort collectif, sans pour

autant que chacun ne cherche spécifiquement à maximiser ses gains individuels. Ce qui permet à l’auteur
d’affirmer que : « En fait, le système économique est une simple fonction de l’organisation sociale ». Le
marché ne précède donc pas la vie en société il n’est qu’une contingence. Le commerce a donc été rendu
possible dans les sociétés primitives sans que celui-ci ne soit à aucun moment guidé par la quête du profit
mais par le principe de réciprocité qui caractérise un échange symbolique, un potlatch. K. Polanyi s’attache
ensuite à montrer que le principe de la redistribution est au fondement même de toutes les organisations
sociales à travers l’histoire avant l’apparition des économies de marché. Ainsi, les sociétés primitives, tout
comme les systèmes féodaux dont les rapports sociaux s’organisent soit autour du principe de symétrie,
de centralité ou d’autarcie, fonctionnent économiquement via un système de redistribution des
ressources. A noter par ailleurs, que l’auteur stipule que l’idée d’un mode de vie autarcique ayant précédé
la vie en collectivité est erroné sur le plan anthropographique ; l’autarcie renvoie à un mode de
redistribution spécifique aux communautés ayant atteint un niveau d’agriculture relativement avancé. Le
modèle autarcique repose sur la conception d’un groupe clos qui peut être de taille différente (familiale,
domaine seigneurial etc.), de natures institutionnelles diverses (patriarcal, servage etc.) et de nature plus
ou moins despotique et oppressive. Dès lors, l’auteur revient sur la distinction effectuée par Aristote dans
« La politique » entre production d’usage, domestique, d’où vient le mot « œconomia » de la
chrématistique qui consiste à produire dans l’objectif de s’enrichir. Ce dernier avait ainsi parfaitement
anticipé l’émancipation d’un modèle économique déconnecté des relations sociales dans lequel il s’inscrit
et en avait pointé les limites : la dimension infinie du processus de production et l’aliénation qui en
découle. L’auteur se propose ensuite de retracer brièvement l’histoire des marchés en tant qu’institutions.
5) L’évolution du modèle du marché
Contrairement à un modèle économique qui repose sur la symétrie, la redistribution ou l’autarcie,
l’instauration d’un système de trocs ou d’échanges nécessite la mise en place d’une institution : le marché.
En effet, si la redistribution nécessite de centraliser les ressources, elle ne nécessite pas d’institution
spécifique à l’allocation économique puisque cette institution peut aussi bien avoir des fonctions
politiques ou religieuses et donc revêtir des formes diverses d’une société à l’autre. Dès lors une économie
de marché ne peut exister qu’à partir du moment où la société s’organise pour assurer le bon
fonctionnement de cette institution : « une économie de marché ne [peut] fonctionner que dans une
société de marché. ». L’institution marchande se désencastre donc des institutions sociales. Toutefois,
l’existence de marché, de troc ou d’échange monnayé n’implique pas nécessairement son extension. Le
mythe de la théorie classique stipule que c’est la propension qu’ont les hommes à échanger qui pousse à
une division toujours plus grande du travail et à une extension toujours plus importante du marché.
Toutefois, l’auteur avance que c’est avant tout le goût de l’aventure et de la découverte qui a conduit dans
un premier temps à ce qui s’apparente davantage à du pillage ou de la piraterie, ou si échange il y a, alors
il doit s’institutionnaliser et se rapproche dans ce cas davantage de la réciprocité. En aucun cas, l’existence
des échanges marchands internationaux ne tiennent donc de la propension qu’auraient les hommes à
échanger et à étendre la division du travail. D’ailleurs, la nature des échanges sur le marché local, extérieur
et intérieur est différente ; en effet, le commerce extérieur, contrairement au commerce local, se
caractérise notamment par le transport de marchandises non périssables et dont la production est
spécifique à une région donnée, ce qui n’implique donc pas spécifiquement de concurrence. Le commerce
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%