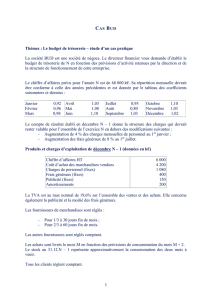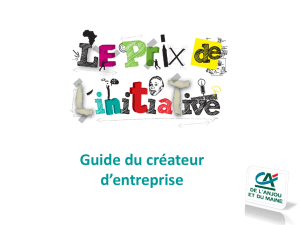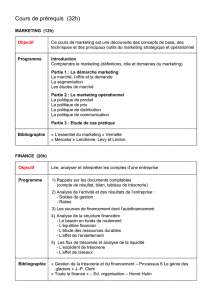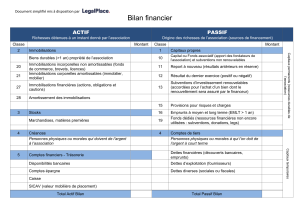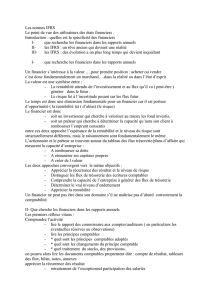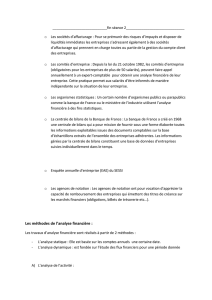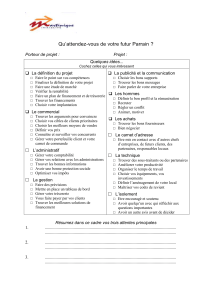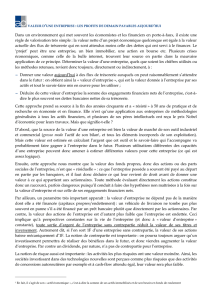Finance d'entreprise DCG : Manuel & Applications, 2e édition
Telechargé par
kindiyé Dit Bouréïma Ogolba

Groupe
Revue Fiduciaire
DCG ÉPREUVE
6
Finance
d’entreprise
2e édition
Jean-Luc Bazet
Pascal Faucher
Manuel &
Applications
• Cours, synthèses
• Exercices d’application, QCM
• Études de cas
Groupe
Revue Fiduciaire
DCG
6
Finance d’entreprise
Groupe
Revue Fiduciaire
Manuel &
Applications
ISBN 978-2-09-160992-8
DCG ÉPREUVE
6
Finance d’entreprise
> Cet ouvrage conforme au Nouveau Programme a pour
objectif de vous préparer efcacement à l’épreuve n° 6
• un cours clair, structuré et détaillé, illustré de très nombreux exemples
pour bien comprendre les points évoqués
• une synthèse présentée sous forme de tableaux ou de schémas pour
mémoriser rapidement les principales notions
• des applications nombreuses et variées, comprenant notamment des
QCM et des Vrai/Faux, organisées suivant la progression du cours pour
vérier la bonne acquisition des connaissances
> Également disponibles : les conseils méthodologiques pour
réussir l’épreuve et les corrigés des applications réunis dans
l’ouvrage d’accompagnement du manuel intitulé « Corrigés des
applications »
Groupe
Revue Fiduciaire
Groupe
Revue Fiduciaire
• Jean-Luc Bazet
Docteur en gestion, Jean-Luc Bazet est maître de
conférences à l’Université Paris XI. Il exerce éga-
lement une activité de consultant en analyse
financière, contrôle des performances et risques.
Enfin, Jean-Luc Bazet est membre du jury du Di-
plôme d’Expertise Comptable.
• Pascal Faucher
Professeur certifié d’économie et gestion et titu-
laire à l’IUT de Sceaux, Pascal Faucher enseigne
la gestion financière dans différentes formations
à l’Université Paris XI (DUT, licence, Master – DCG
et DSCG).
Retrouvez sur le site
www.nathan.fr/expertise-comptable
en accès réservé* :
4 Des contenus de référence
• Pour l’achat d’1 Manuel & Applications
accès en ligne pendant un an au Diction-
naire comptable et financier
• Pour l’achat de 3 Manuels & Applications
accès en ligne pendant un an :
- au Dictionnaire comptable et financier
- au Dictionnaire fiscal
- au site revuefiduciaire.com
4 Des ressources complémentaires
pour chaque Manuel & Applications
de la collection
* Voir modalités détaillées sur le rabat
de la couverture
* Inscription simplifiée
en saisissant un mot
de l’ouvrage :
exemple : le 1
er
mot de la page 32
management ok
Le site
www.nathan.fr/expertise-comptable
dédié à la collection DCG propose en accès réservé*
des ressources complémentaires et des actualisations
par épreuve en lien avec chaque Manuel & Applications
de la collection DCG
1 an d’accès en ligne
à des contenus de référence
Groupe
Revue Fiduciaire
DCG
www.nathan.fr/expertise-comptable
1 an d’accès en ligne
à des contenus
de référence
Groupe
Revue Fiduciaire
2e édition
le Dictionnaire
comptable et financier
en ligne
pour l’achat de 3 Manuels & Applications DCG :
le Dictionnaire
comptable
et financier
en ligne
le Dictionnaire
fiscal
en ligne
le site
revuefiduciaire.com
*Modalités et conditions d’accès détaillées sur le site
pour l’achat d’1 Manuel & Applications DCG :
conforme au
PROGRAMME
2010
B
O
d
u
1
8
m
a
r
s
2
0
1
0


© Nathan

Édition :
Sébastien Mazurkiewicz – Sylvie Ogée
Coordination artistique :
Evelyn Audureau
Conception intérieure :
Anne-Danielle Naname
Conception couverture :
Killiwatch
Mise en pages :
MCP
© Nathan 2009 – 25, avenue Pierre de Coubertin – 75013 Paris
ISBN 978-2-09-160992-8
© Nathan
ISBN numérique : 9782098123533

3
MODE D’EMPLOI
Index 465
3
ANNEXES
INDEX
A
Accroissement du besoin
en fonds de roulement 2,55, 375, 456
Acquisition d’immobilisations 374
Actif
économique 337
net comptable corrigé 342
Action 57, 252, 412, 456
ordinaire 354
Actions
à bon de souscription d’actions (ABSA) 354
à dividendes prioritaires 354
de préférence 354
privilégiées 354
Activité 100, 378, 456
Activités stratégiques 330
Affacturage 296, 402, 456
Affactureur 296
Affectation du résultat 355
Agence de notation 198, 297
Agios 295, 407
Alternext 59
AMF 411
Analyse
discriminante 195, 456
fonctionnelle 327
Annexe 88, 456
Annuité
constante équivalente 263
Annuités 25, 316, 375, 456
Apport
en nature 309
en numéraires 309
Arbitrage 380
Arbre de décision 41
Asymétrie de l’information 54
Augmentation de capital 376
Autofinancement 312, 355
Autorité des marchés financiers (AMF) 59, 311
Avantage
absolu 258
concurrentiel 250
économique futur 251
Avenir
aléatoire 35
certain 456
incertain 35, 456
B
Bailleur 319
Barrière à l’entrée 135
BCE 404
Bénéficiaire 295
Besoin
(ou ressource) en fonds de roulement (BFR ou
RFR) 130, 279, 281, 327
en fonds de roulement d’exploitation (BFRE)
280, 341
en fonds de roulement hors exploitation
(BFRHE) 281
en fonds de roulement normatif (BFRN) 286
Bilan
financier 342
fonctionnel 123, 456
patrimonial 342, 457
social 77
Billet
à ordre 295
de trésorerie 403
Bon
à taux fixe 413
de caisse 411, 457
du Trésor annualisé 413
du Trésor négociable 413
Boston Consulting Group (BCG) 330
Bourse 57, 457
BTAN 413
BTF 413
BTN 413
Budget de trésorerie 395, 457
Business plan 374, 457
C
CAC 40 66
Call 429
Cap 431
Capacité
d’autofinancement (CAF) 104, 256, 375, 457
de remboursement 139, 329, 457
Capital
financier 137
risque 309
Capitalisation boursière 59, 457
Capitaux
investis 136, 281, 341, 353
permanents 341
propres 356
Cash-flows 255
Caution 345, 376, 457
Certificat
d’investissement 354
de dépôt négociable 413
De nombreuses applications :
– des exercices permettant de vérifier
la bonne assimilation des points
du cours ;
– des études de cas couvrant plusieurs
difficultés du cours et identiques
aux situations pratiques à étudier
lors de l’épreuve.
CHAPITRE
15
1
La valeur et le temps
Si la comptabilité nous renseigne sur les coûts supportés par l’entreprise, elle
n’a pas été imaginée pour nous fournir de l’information sur la valeur. Une
machine acquise par l’entreprise a un coût qui figure à l’actif de son bilan. La
valeur de cet actif sera constatée beaucoup plus tard, lorsque l’entreprise aura
enregistré les flux de liquidités nés de l’utilisation de cet actif.
Pour certains biens, il existe des marchés organisés où les valeurs sont le fruit
de la rencontre de l’offre et de la demande : les biens immobiliers, les automo-
biles, les objets d’art, etc. ; mais pour la majeure partie des biens mis à la dis-
position de l’entreprise, c’est de leur utilisation et de leur combinaison que
naîtra la valeur.
Deux machines identiques dans deux entreprises différentes ne seront pas uti-
lisées de la même façon et par conséquent, n’auront pas la même valeur. La
valeur est spécifique puisqu’elle est liée à l’utilisation du bien, alors que le coût
est unique.
Pour pouvoir évoquer la valeur d’un bien, il est nécessaire de s’inscrire dans le
temps et d’imaginer des flux de liquidités futurs : « Time is money » suppose
que dans tout problème financier, il y a un échéancier. Pour ce faire, il faut
mobiliser des connaissances en mathématiques financières, ce que nous ferons
en seconde partie de ce chapitre.
De la difficulté d’estimer la valeur d’un bien
En économie, le problème de l’évaluation d’un bien ou d’un service est facilité
lorsqu’il existe un marché organisé et dynamique où se rencontrent l’offre et la
demande. Dans ce cas, il n’y a pas d’ambiguïté : le prix fixé par le marché répond au
besoin d’évaluation, ce qui est souvent le cas du marché immobilier, du marché des
actions, etc.
I
La valeur et le temps 17
CHAPITRE
1
La valeur de marché pour certains biens et services est donc la première information
disponible dont l’analyste devra tenir compte dans sa démarche de valorisation.
2. Prix de marché, rente et concurrence
L’entreprise innovante qui offre au marché ce que la concurrence est incapable de
produire dispose d’une situation de monopole temporaire. Les consommateurs
sont alors prêts à payer un prix élevé plus ou moins justifié par les coûts de produc-
tion. Cet avantage concurrentiel est généralement limité dans le temps puisque la
concurrence investira à plus ou moins long terme ce marché attractif.
Pour conserver sa position, si le marché est en expansion, l’entreprise innovante
devra naturellement être capable de croître en même temps que le marché pour
éviter qu’une demande insatisfaite ne sollicite la concurrence. L’entreprise a-t-elle
les moyens de financer le développement de l’affaire ? Cette question est fonda-
mentale.
La rente économique que procure cette situation permet généralement à l’entre-
prise d’amortir ses coûts de recherche et développement investis préalablement.
La prévision des rentes économiques est difficile à réaliser car elle dépend de la
capacité de la concurrence à réagir à une innovation. Le développement de la con-
trefaçon industrielle dans certaines Low Cost Countries (LCC) limite dans le temps
cette possibilité de rente.
Une entreprise envisage l’exploitation d’un nouveau produit qui lui permettra de pratiquer
un prix de vente élevé au cours des 2 premières années suivant son lancement. Pour ce faire,
elle doit réaliser un investissement de 1 500 k . Les prévisions de chiffre d’affaires et de
résultat sont les suivantes :
Compte tenu de ces données, l’entreprise réalisera un résultat cumulé de 2 200 k qui cou-
vrira l’investissement initial et laissera un bénéfice pour l’actionnaire.
Dans la réalité, la concurrence a investi plus rapidement le marché et l’entreprise a enregis-
tré les conditions de marché suivantes :
Le résultat cumulé (1 100 k ) est inférieur à l’investissement initial. Le marché n’a pas per-
mis à la société de bénéficier de la rente économique liée à sa position dominante et, malgré
ses efforts de productivité, l’opération n’est pas rentable.
N N+1 N+2 N+3
Quantités 1 000 2 000 5 000 5 000
Prix de vente 2,00 1,80 1,50 1,30
Coût de production 2,10 1,40 1,30 1,20
Résultat –100 800 1 000 500
N N+1 N+2 N+3
Quantités 1 000 2 000 5 000 5 000
Prix de vente 2,00 1,50 1,30 1,10
Coût de production 2,10 1,40 1,20 1,00
Résultat –100 200 500 500
EXEMPLE
La valeur et le temps 31
1
APPLICATIONS
CHAPITRE
Répondez par « Vrai » ou par « Faux » aux affirmations ci-dessous.
Exercices fondamentaux de mathématiques
financières
1. Que devient un capital de 10 000 placé pendant 6 ans et 3 mois au
taux de 5,5 % l’an ?
2. Actualisez au taux de 5 % une somme de 75 000 payable dans 5 ans et
9 mois.
3. À quel taux une somme quadruple-t-elle en 25 ans par capitalisation
annuelle ?
1. Les intérêts simples sont utilisés dans le calcul d’un escompte
commercial.
2. Les intérêts composés sont utilisés dans les opérations de durée
supérieure à une période.
3. Le taux d’intérêt correspond toujours à une période d’un an.
4. Le taux proportionnel est calculé pour les intérêts composés et le taux
équivalent pour les intérêts simples.
5. Une rente économique peut être protégée par un brevet.
6. Une annuité constante correspond au versement ou au prélèvement
d’une somme identique sur plusieurs périodes.
7. Le taux de marché est le taux moyen attendu par l’ensemble des
investisseurs sur un marché.
8. Les intérêts composés suivent une progression géométrique de raison
(1 + i) alors que les intérêts simples suivent une progression
arithmétique de raison i.
9. Un versement à échoir se fait en début de période.
10. I. Fisher est à l’origine de la théorie de la valeur.
11. Pour la majeure partie des matières premières, le prix de marché est le
plus souvent indépendant des conditions de production.
12. Le taux requis est un taux réclamé par le marché qui aura pour
conséquence de rejeter des investissements cependant rentables.
13. La spéculation est une opération à laquelle se livrent certains acteurs
sur le prix de marché.
14. Une interpolation permet de calculer la valeur acquise ou la valeur
actuelle lorsque les périodes ou les taux ne sont pas des entiers.
15. La valeur acquise est l’inverse de la valeur actuelle.
APPLICATION VRAI–FAUX
1
APPLICATION 2
32 La valeur
1
APPLICATIONS
CHAPITRE
4. Au bout de combien de temps une somme double-t-elle au taux
semestriel de 4 % par capitalisation semestrielle ?
5. Calculez la valeur acquise par une suite de 12 annuités de fin de période
de 7 000 au moment du versement de la dernière annuité et placées
au taux de 5,5 %.
6. Calculez les taux proportionnels et les taux équivalents correspondant
au taux annuel de 3 % pour un semestre, pour un trimestre, pour un
mois.
7. Quelle est la valeur actuelle d’une suite de 8 annuités constantes de
10 000 , la première venant à échéance immédiatement au taux de
5 % ?
Problèmes de mathématiques financières
1. Un débiteur doit s’acquitter des dettes suivantes : 24 000 payables
dans 1 an, 16 000 payables dans 1 an et 6 mois, 30 000 payables dans
2 ans et 6 mois et 40 000 payables dans 4 ans. Il préfère se libérer par
un paiement unique dans 5 ans. Calculez le montant de ce paiement
unique au taux annuel de 6 %.
2. Un capital de 242 149,20 a été constitué par le versement de 14
annuités constantes en fin de période capitalisées au taux de 8 %. Quel
est le montant de l’annuité ?
3. Une société de crédit-bail met immédiatement à la disposition d’un
industriel un équipement d’un coût de 300 000 contre paiement de 5
annuités de 80 000 payables en fin d’année, la première venant à
échéance dans 1 an. Quelle est la valeur actuelle des annuités au taux de
10 % au moment où l’industriel reçoit le matériel ?
Comparaison de placements
Une entreprise dispose de 100 000 pendant 2 ans. Le banquier lui propose plusieurs
types de placement.
Classez les valeurs acquises de la plus importante à la plus faible selon les
différentes modalités suivantes :
– taux n° 1 : taux trimestriel de 3 % en intérêts simples ;
– taux n° 2 : taux annuel de 10 % en intérêts simples ;
– taux n° 3 : taux mensuel de 1,1 % en intérêts simples ;
– taux n° 4 : taux annuel de 12 % en intérêts composés ;
– taux n° 5 : taux mensuel de 1 % en intérêts composés.
APPLICATION 3
APPLICATION 4
■Une partie cours présentée
de manière claire
et structurée et illustrée
d’exemples.
Une boîte à outils comprenant un
index pour retrouver facilement
les concepts étudiés dans l’ouvrage.
■
■
■
© Nathan
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
 287
287
 288
288
 289
289
 290
290
 291
291
 292
292
 293
293
 294
294
 295
295
 296
296
 297
297
 298
298
 299
299
 300
300
 301
301
 302
302
 303
303
 304
304
 305
305
 306
306
 307
307
 308
308
 309
309
 310
310
 311
311
 312
312
 313
313
 314
314
 315
315
 316
316
 317
317
 318
318
 319
319
 320
320
 321
321
 322
322
 323
323
 324
324
 325
325
 326
326
 327
327
 328
328
 329
329
 330
330
 331
331
 332
332
 333
333
 334
334
 335
335
 336
336
 337
337
 338
338
 339
339
 340
340
 341
341
 342
342
 343
343
 344
344
 345
345
 346
346
 347
347
 348
348
 349
349
 350
350
 351
351
 352
352
 353
353
 354
354
 355
355
 356
356
 357
357
 358
358
 359
359
 360
360
 361
361
 362
362
 363
363
 364
364
 365
365
 366
366
 367
367
 368
368
 369
369
 370
370
 371
371
 372
372
 373
373
 374
374
 375
375
 376
376
 377
377
 378
378
 379
379
 380
380
 381
381
 382
382
 383
383
 384
384
 385
385
 386
386
 387
387
 388
388
 389
389
 390
390
 391
391
 392
392
 393
393
 394
394
 395
395
 396
396
 397
397
 398
398
 399
399
 400
400
 401
401
 402
402
 403
403
 404
404
 405
405
 406
406
 407
407
 408
408
 409
409
 410
410
 411
411
 412
412
 413
413
 414
414
 415
415
 416
416
 417
417
 418
418
 419
419
 420
420
 421
421
 422
422
 423
423
 424
424
 425
425
 426
426
 427
427
 428
428
 429
429
 430
430
 431
431
 432
432
 433
433
 434
434
 435
435
 436
436
 437
437
 438
438
 439
439
 440
440
 441
441
 442
442
 443
443
 444
444
 445
445
 446
446
 447
447
 448
448
 449
449
 450
450
 451
451
 452
452
 453
453
 454
454
 455
455
 456
456
 457
457
 458
458
 459
459
 460
460
 461
461
 462
462
 463
463
 464
464
 465
465
 466
466
 467
467
 468
468
 469
469
 470
470
 471
471
 472
472
 473
473
 474
474
 475
475
 476
476
 477
477
 478
478
 479
479
 480
480
 481
481
 482
482
 483
483
 484
484
 485
485
 486
486
 487
487
 488
488
 489
489
 490
490
 491
491
 492
492
1
/
492
100%