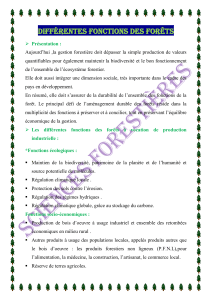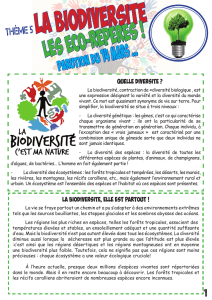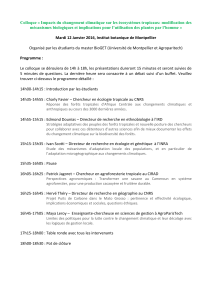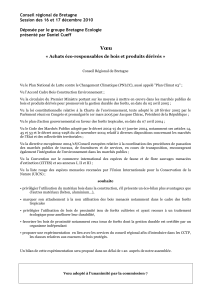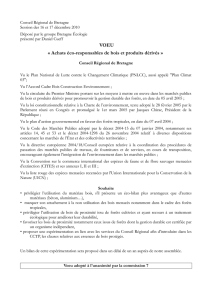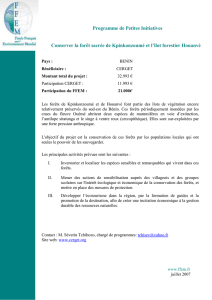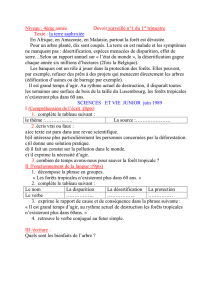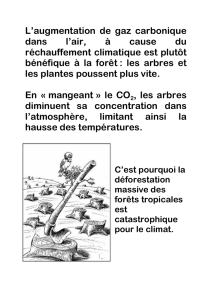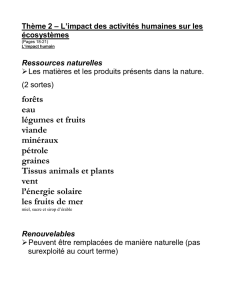Diversité des milieux
Cours 1
Un Biome est défini comme étant « une des principales communautés, animales et végétales,
classées en fonction de la végétation dominante et caractérisées par les adaptations des organismes
à leur environnement spécifique (Campbell‐ 1996) ».
Selon le Larousse, il s’agit d’une vaste région biogéographique s’étendant sous un même climat,
comme la toundra, la forêt tropicale humide, la savane ou encore les récifs coralliens.
Au premier semestre on a vu qu’un biome peut aussi être défini comme un ensemble
d'écosystèmes caractéristiques d'une aire biogéographique.
Il ne peut jamais être dissocié de la notion d’homogénéité des facteurs abiotiques d’un côté (ex.
climatiques) et biotiques (ex. structure de la végétation) de l’autre.
Les biomes sont aussi appelés type d’habitat majeur (WWF)
Le terme macro écosystème = Écosystème occupant de vastes étendues géographiques peut aussi
être associé aux biomes, définis comme les communautés/biocénoses qui les peuplent (ex. Ramade,
2002; Triplet 2018)
Les caractéristiques locales influencent les patrons de distribution du vivant à l’échelle locale (ex.,
végétation et altitude ; algues et lumière…).
A l’échelle de la planète les caractéristiques locales interagissent avec celles au niveau globale,
telles que le rayonnement solaire ou la circulation atmosphérique et océanique, déterminant ainsi la
répartition des écosystèmes sur Terre.
Un biome est un ensemble d'écosystèmes caractéristique d'une aire biogéographique.
Un biome est l'expression des conditions écologiques du lieu à l'échelle régionale/continentale.
Mais les limites entre ces biomes n’étant pas toujours nettes, plusieurs classifications des biomes
ont été proposées dans le passé.
En 2001 le WWF a effectué un important travail de synthèse de la littérature existante sur les
biomes et leur distribution au niveau globale.
Depuis, la classification et la distribution proposées par le WWF sont globalement acceptées et
représentent la référence
Les biomes sont divisés en biomes terrestres et aquatiques.
Les biomes terrestres sont bien connus (structure, composition, fonctionnement, distribution,
menaces…), mais beaucoup de travail reste à faire pour les biomes aquatiques (traités plus loin dans
ce cours).
Habitat: partie de l'environnement définie par un ensemble de facteurs physiques, et dans laquelle
vit un individu, une population, une espèce ou un groupe d'espèces (définition Larousse).
On peut voir cela comme l’adresse d’une espèce, c’est‐à‐dire l’endroit physique où elle trouve les
conditions du milieu adéquates à sa vie et reproduction, telles que les ressources, d’autres
organismes avec qui interagir…
La notion d’habitat d’une espèce est liée à sa niche écologique, qui regroupe en un espace
multidimensionnel (mais pas un espace physique cette fois), tous les facteurs abiotiques et biotiques
importants pour l’espèce considérée.
Et il y a des « conflits » liés au fait que deux espèces ne peuvent pas partager la même niche
écologique (ex. pour la nourriture, l’espace…)

La niche écologique potentielle peut être réduite à cause des ces conflits (facteurs biotiques): niche
réalisée
Mais des interactions positives (ex. symbiose, facilitation…) peuvent mener à une niche réalisée
plus importante de la niche fondamentale
Niche fondamentale : variables environnementales Niche réalisée : interactions biotiques
Biogéographie: Étude scientifique de la distribution des espèces végétales et animales à la surface
du globe et des changements qui affectent cette distribution (définition Larousse).
Elle définit la répartition spatio‐temporelle des êtres vivants ainsi que les éléments et les causes
qui conditionnent celle‐ci. Elle s’intéresse aux causes actuelles de répartition des espèces (raisons
climatiques par exemple) et aux causes anciennes d’ordre paléogéographique. (Triplet, 2019.
ISBN/ISSN, 978‐2‐9552171‐5‐3)
Les espèces possèdent une répartition géographique d’étendue variable et irrégulière.
Aire de distribution géographique : Zone géographique délimitant la répartition d’une espèce vivante
et intégrant l’ensemble de ses populations
● Répartition cosmopolite Les espèces ayant une répartition cosmopolite peuvent se
rencontrer soit dans l’ensemble des biomes terrestres ou océaniques de la biosphère, soit
dans une vaste aire de répartition continue et circumterrestre.
● Aires disjointes Certaines espèces peuvent avoir une répartition fragmentaire. Cela peut
résulter de plusieurs facteurs, tels que la dérive des continents, les fluctuations climatiques
et/ou la compétition évolutive.
● Répartitions régionales Certaines espèces ont une répartition localisée à une zone
déterminée, tout en présentant, éventuellement, une aire de distribution de surface
importante. Il s’agit souvent d’espèce à affinités chaudes ou froides qui ne se rencontrent que
dans une région.
● Répartitions endémiques Espèce dont l’aire de répartition est limitée à une région
géographique particulière et qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Les endémismes sont
fréquents dans les îles ou dans les zones montagneuses, où des phénomènes de spéciation
et parfois de radiation évolutive sont plus probables. (Les espèces hautement endémiques,
avec des aires de répartition très réduites, sont particulièrement vulnérables à l’extinction si
leur habitat naturel est supprimé ou significativement endommagé.)
● Répartitions vicariantes Les espèces vicariantes occupent des aires disjointes mais
continues (une espèce est remplacée par une autre espèce occupant la même niche
écologique).
Empire biogéographique (biogeographic empire) Unité biogéographique correspondant à une
grande région, voire à un continent. Les empires sont souvent déterminés grâce à l’endémisme des
végétaux. A titre d’exemple, l’empire holarctique – dans lequel se situe la France ‐ est caractérisé
par la présence des Bétulacées, des Salicacées et des Renonculacées.
Le terme ÉCOZONE est souvent utilisé comme synonyme d’empire biogéographique, même si
dans sa définition sont inclus des facteurs liés à la géologie, à la géographie, au sol, à la végétation,
au climat, à la faune sauvage, aux milieux aquatiques et à la présence humaine qui peuvent
caractériser la région.
Les écozones ou empires sont subdivisés en :
• région, ou écorégion, subdivision de l’empire, correspond à l’endémisme de familles ou de genres.
• domaine, subdivision de la région, correspond à l’endémisme de genres.
• secteur, subdivision du domaine, correspond à l’endémisme d’espèces.
• district, subdivision du secteur, correspond à l’endémisme de sous‐espèces.

En 2001, sur la base de subdivisions existantes, le WWF a établi formellement 8 écozones et 867
écorégions terrestres.
Les écorégions sont définies comme des « unités relativement importantes de terres contenant un
assemblage distinct de communautés et d'espèces naturelles, avec des limites qui se rapprochent de
l'étendue originelle des communautés naturelles avant les grands changements d'utilisation du sol
[par l'humain] ».
Les limites entre écorégions sont rarement nettes sur le terrain, elles sont plutôt constituées d'éco
tones (on reparlera de cela plus tard).
Chaque écorégion possède un code unique permettant de l'identifier facilement. Ce code est
constitué de deux lettres indiquant l'écozone dans laquelle se situe la région, suivi de deux chiffres
(de 01 à 14) renvoyant au biome auquel appartient cette dernière.
Le WWF a attribué un statut de conservation à chacune des écorégions terrestres.
● Critique : la portion intacte du système est cantonnée à des fragments isolés de taille réduite
avec une faible probabilité de persistance à court terme sans des mesures immédiates de
protection et de restauration. De nombreuses espèces ont déjà disparu en raison de la perte
de leur habitat. Les fragments encore intacts ne présentent pas les conditions minimales pour
maintenir les processus écologiques et des populations viables de nombreuses espèces.
L'utilisation du sol entre ces fragments est souvent incompatible avec la survie de
nombreuses espèces natives. La propagation d'espèces exogènes peut être un problème
écologique sérieux, particulièrement dans les milieux insulaires. Les grands prédateurs* ont
presque tous été exterminés.
● En danger : la portion intacte du système est cantonnée à des fragments isolés de taille
variable avec une probabilité moyenne à faible de persistance à court terme sans des
mesures immédiates de protection et de restauration. Plusieurs espèces ont déjà disparu en
raison de la perte de leur habitat. Les fragments encore intacts ne présentent pas les
conditions minimales pour maintenir les processus écologiques à grande échelle et des
populations viables de nombreuses espèces. L'utilisation du sol entre ces fragments est en
grande partie incompatible avec la survie de nombreuses espèces natives. Les grands
prédateurs ont, pour la plupart, été exterminés.
● Vulnérable : la portion intacte du système est divisée en blocs de taille variable dont
plusieurs fragments restent intacts à court terme, surtout si des mesures adéquates de
protection et de restauration sont entreprises. Dans de nombreuses zones, les espèces
sensibles ont disparu ou déclinent, particulièrement les grands prédateurs et le gibier.
L'utilisation du sol entre ces blocs est parfois incompatible avec la survie de nombreuses
espèces natives.
● Relativement stable : les communautés naturelles ont été altérées dans certaines zones,
causant le déclin local des populations exploitées et la perturbation des processus
écologiques. Ces zones peuvent être étendues, mais restent encore éparpillées au milieu des
portions du système demeurées intactes. Les liens écologiques entre les portions intactes
sont encore largement fonctionnels. Les espèces sensibles à l'activité humaine, comme les
grands prédateurs et les oiseaux terrestres, sont présentes à une densité inférieure aux
variations naturelles de leur distribution.
● Relativement intact : les communautés naturelles de l'écorégion sont largement intactes.
Les espèces sensibles à l'activité humaine, comme les grands prédateurs et les oiseaux
terrestres, ne sont pas présentes à une densité inférieure aux variations naturelles de leur
distribution. Les organismes se déplacent et se dispersent naturellement dans les limites de
l'écorégion et les processus écologiques fluctuent tout au long d'habitats largement contigus.
En collaboration avec l'Environmental Systems Research Institute (ESRI), le WWF a publié en ligne
l'application « WildFinder » qui permet de visualiser la distribution des espèces animales en fonction

des écorégions terrestres. La base de données du programme comprend actuellement quatre taxons:
mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens. Les informations sont disponibles pour 825 écorégions,
les mangroves ayant été volontairement omises en raison de leurs tailles très réduites. La distribution
des espèces est basée sur leur répartition historique (environ 1500 apr. J.‐C.) dans la continuation
de l'idée que les écorégions dessinent la carte de la biodiversité en dehors des perturbations induites
par l'humain, ce qui permet la mise en place de programmes de réintroduction. Ces données sont
principalement extraites des quatre bases de données suivantes:
• « Amphibian Species of the World » pour les amphibiens ;
• « EMBL Database » pour les reptiles ;
• « The Sibley/Monroe World List of Bird Names » pour les oiseaux ;
• « Mammal Species of the World » pour les mammifères.
Cours 2
Les facteurs climatiques sont déterminants pour la distribution des biomes, en particuliers les
biomes terrestres.
Des climats variés selon les régions : tropical, polaire, boréal, saharien, tempéré, alpin, montagnard
sec…
Les facteurs les plus importants en milieu continental sont la température et la pluviosité
L’altitude et la latitude ont une influence similaire sur les différents types de végétation
(arborescente, arbustive, herbacée) et en conséquence sur la distribution des biomes.
Sol : formation naturelle de surface à structure meuble et d’épaisseur variable résultant de la
transformation de la roche‐mère sous‐jacente, sous l’influence de divers processus physique,
chimique et biologique (Demolon).
C'est d'ailleurs la répartition zonale des climats qui a conduit à mettre en évidence la zonation des
sols à la fin du XIXe siècle, puis des biomes.
En 1890, Vassili Vassilievitch Dokoutchaïev définit les sols comme des « corps naturels se formant
sous l’effet d’un certain nombre de facteurs écologiques » (climat, végétation). Relation étroite avec
les BIOMES.
Nous ne parlerons pas de pédogénèse lors de ce cours, mais il faut retenir que le type de sol est
strictement lié à l’habitat et donc, à grande échelle, à la distribution des biomes.
En fonction de la roche mère et des organismes qui s’y développent, les sols peuvent avoir des
caractéristiques très différentes, telles que la texture (granulométrie), porosité, hygrométrie (capacité
de rétention d’eau), pH, proportion en éléments minéraux et en humus.
Il existe un grand nombre de types de sols, parmi lesquels on peut mentionner :
● les podzols, sols acides caractérisés par plusieurs horizons et qui se forment sous climats
boréaux froids (ex. : Taiga);
● les sols bruns forestiers, caractérisés par un humus très fertile, riche en sels minéraux,
typiques des forêts tempérées caducifoliées et des forêts mixtes de feuillus et de conifères
tempérées ;
● les sols ferrugineux, riches en fer mais dépourvus d’alumines, typiques des zones tropicales
avec une longue saison sèche (ex. : savane)
● Les sols ferrallitiques, typiques des zones tropicales humides, très riches en oxydes de fer
et d'alumine (ex. : forêts humides tropicales).
Nous allons voire les caractéristiques principales des différents biomes. Suivant les définitions du
WWF, on verra quelle est la biodiversité associée à chaque biome, ainsi que leur sensibilité aux
perturbations

La toundra est une formation végétale qui se trouve aux hautes latitudes, dans les régions polaires
(Alaska, Canada, Russie, Groenland, Islande, Scandinavie et certaines îles sub‐antarctiques)
Le climat est caractérisé par de longs hivers secs avec des mois d’obscurité totale et des
températures très basses.
Les sols des toundras, dénommés permafrosts, sont gelés en profondeur de façon permanente.
Seules les couches superficielles sur quelques décimètres à quelques mètres dégèlent pendant l’été.
Précipitations en hiver sous forme de neige ; le sol tend à être acide et est saturé en eau.
Le renard polaire et l’ours peuvent adapter leurs régimes alimentaires temporairement et se nourrir
de mousses et lichens.
Les biomasses végétales sont faibles (6 t * ha‐1), comparables à celle des déserts.
Biodiversité : la plupart des espèces ont une distribution large (à l’exception de certaines espèces
végétales). La biodiversité est faible.
Sensibilité aux perturbations :
• la végétation et l’écoulement de l’eau en surface sont sensibles aux perturbations;
• Plusieurs espèces de vertébrés sont sensibles à la présence de l’homme ou à une basse intensité
de chasse;
• Changement climatique
La Taïga est une immense forêt subarctique de conifères et constitue un des biomes majeurs de
l’hémisphère nord : elle est la plus vaste continuité boisée de la planète et occupe à elle seule 10 %
des terres émergées
Les températures sont basses et les précipitations assez faibles (40 – 100 cm/an), étalées sur
l’année, avec un maximum en été.
La forêt boréale se développe sur des sols d’origine glaciaire peu épais et très lessivés (podzols).
Ils sont très pauvres en sels nutritifs et dans cet humus acide se développe le mycélium des
champignons qui couvre les racines des conifères (symbiose entre champignon et plante :
mycorhize).
La faune est semblable à la faune des forêts tempérées caducifoliées.
Biomasse végétale moyenne aux alentours des 200 t * ha, production secondaire de 37 kg /ha*an
Biodiversité : la plupart des espèces ont une large distribution. La biodiversité est faible.
Menaces :
• La régénération de forêts matures est très lente;
• Plusieurs espèces de vertébrés sont sensibles à la présence de l’homme ou à une basse intensité
de chasse;
• Sensible à la pollution et aux pluies acides.
Les forêts tempérées sempervirentes se développent dans les régions tempérées du monde aux
étés chauds, hivers doux et avec une pluviosité suffisante à la vie d'une forêt.
On les trouve dans les zones côtières de régions à hivers doux et pluies abondantes, ou à l'intérieur
des terres sous des climats plus secs ainsi qu'en montagne.
Structurellement, ces forêts sont assez simples, généralement constituées de deux couches :
l'étage supérieur et inférieur (rarement on trouve une strate intermédiaires d'arbrisseaux).
Les forêts de pins ont un étage inférieur herbacé généralement dominé par des plantes vivaces et
sont souvent sujettes à des feux naturels écologiquement importants.
Parmi les forêts de conifères tempérées, les forêts pluviales tempérées (ou ombrophiles, du grec
ombro = pluie) sont remarquables
Elles sont composées d’arbres gigantesques pouvant dépasser les 100 m de haut (séquoia géant,
eucalyptus, kauri trees…).
Les forêts ombrophiles tempérées couvrent une surface faible par rapport à celle occupée par les
autres biomes forestiers.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%