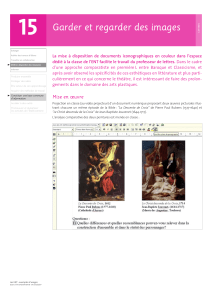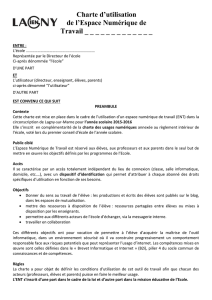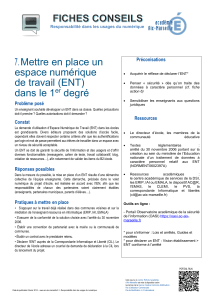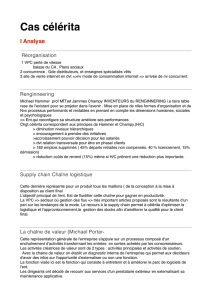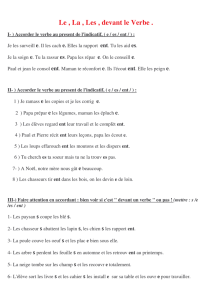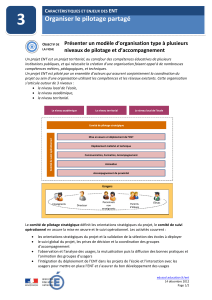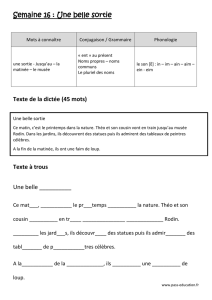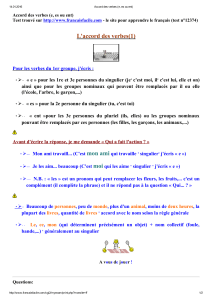MANAGEMENT & SYSTÈMES D’ INFORMATION
P IL O T A G E
Les DONNEES BANCAIRES,
NOUVEL ENJEU DE FUITE
VERS LA QUALITÉ
Jacques Richer
D irecteur
C a p g e m in i
C o n s u lt in g
La pression réglementaire en faveur d’une plus grande
transparence et d’une fiabilité mieux assurée des reportings
bancaires n’a jam ais été aussi forte. Dans le même temps,
la transition numérique et les technologies du Big Data
rendent possibles des projets nouveaux de valorisation
des données jusqu’ici thésaurisées sans aucun profit
par les banques. La convergence de ces tendances de fond
va obliger les banques à gérer leurs données comme
des actifs dont la qualité conditionne la valeur, au prix
d’une profonde transformation de leur gouvernance.
P
our une banque, la qualité de
ses données est essentielle. La
satisfaction de ses clients en
dépend, qui attendent légi
timement un service à zéro défaut.
Elle conditionne l’efficacité de ses
processus dont l’automatisation
(Straight Through Processing) est mise en
défaut par des données manquantes
ou erronées, multipliant les besoins
de coûteux ajustements manuels et
autres traitements d’exception. Elle
est au cœur de la pertinence de son
pilotage qui doit pouvoir déceler au
plus tôt les inflexions de tendances
sans être leurré par des variations
sans fondement. Enfin, sans elle,
l’image de la banque est en risque
auprès des analystes et des régula
teurs qui exigent une communication
de plus en plus détaillée et scrutent
les moindres incohérences dans les
chiffres publiés.
Le recours à des algorithmes sophis
tiqués de modélisation des risques
détermine en outre complètement la
consommation de ressources rares
(fonds propres, actifs liquides) des
banques et donc leur potentiel de
rentabilité et de croissance. Or la
pertinence de ces algorithmes est
conditionnée par l’existence et la
qualité des données qu’ils utilisent
comme inputs. Le principe de pru
dence oblige d’ailleurs les banques à
dégrader leur méthode d’évaluation
des risques, en cas de défaut sur les
données, en recourantàdes méthodes
plus grossières qui induisent un sur
coût en capital ou en actifs liquides.
Ce phénomène confère de fait un
prix à la qualité des données : il ne
s’agit visiblement pas d’une simple
commodité !
ENTRE EXIGENCES
RÉGLEMENTAIRES ET
OPPO RTUN ITÉS DU BIG DATA
L’actualité vient encore renforcer
cette importance. Côté superviseurs,
le Comité de Bâle a pris la peine de
formuler au début de l’année dernière
les principes de bonne gestion des
données qui nourrissentles reportings
de pilotage des risques [i]. Le FSB a
missionné sur cette base les super
viseurs nationaux pour conduire, au
[ i ] P r in c ip le s f o r
Effective
R i s k D a t a A g g r e g a t io n a n d
R i s k
Reporting,
B C B S 2 3 9 , j a n v i e r 2 0 1 3 .
Revue Banque N° 77 5 SEPTEMBRE 201 4

1 di oo-fb 161 oobo 101 o i o* ;& * * # w * *9 *9 i9-
010100010000
iq}oooiooqiû)oç>Qiowo
10101000100010100010000
101000100010100010000
10101000100010100010000
X <1*01010101011110^010
^ < 1n\oiOlOlOilUOi
J0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 «,V
rWSOiiH
'Ooo-joioioioiooo«,
'♦WWtWftWIMKHlWt,
10100101010000101OÏ0
10010101000010101010'V o lo lô è o io6o i o ioo dioooo
00610001©100010000
I00100010100010000
0000001010101
^lOiOOOOOOOl^
10100101o1Ô00o i0iô i ô 4irtffi6i
1010010101000010101010101 >$*010000
iSik -
>iè^iè4oiüooô16iooi
' fin « a n * n < n 4 a -i f) 1, Q
101001010100V.
■ . 30010100010000
101010001 30010000
01000100 ,010000
101010001 -106010000
10101000010
1001010100.0010'
10100101011
66
La
première
clé tiers la maîtrise
de la qualité
des données
est une attribution
claire des respon
sabilités.
99
printemps 2013, une évaluation de
maturité auprès des banques d’im
portance systémique dont ils ont la
charge. À en juger par les projets lan
cés par les intéressées à la suite de
cette enquête, on peut penser que le
message a été pris au sérieux.
La BCE, de son côté, a inauguré la
phase préparatoire de sa future res
ponsabilité de superviseur unique des
grandes banques de la zone euro en
lançant une Asset Quality Review qui
s’est attachée à qualifier dans le détail
la qualité des données enregistrées
par les banques pour décrire leurs
engagements et leurs sûretés.
Mais l’actualité, c’est aussi la vague de
transformation numérique qui met sou
dain en lumière le fantastique potentiel
de valeur renfermé par les gisements
de données dont les banques ne sont
pas les dépositaires les moins dotés.
La course aux usages innovants de type
Big Data les conduit à élargir sans cesse
le spectre des données manipulées,
quitte à gommer les frontières naguère
infranchissables entre données struc
turées et données non structurées ou
entre données internes et données
externes, et à accroître aussi ainsi les
enjeux de qualité associés.
DES DÉRIVES NUISIBLES
À LA QUALITÉ DES DONNÉES
Or la qualité des données n’est pas
naturelle dans une grande organisa
tion, moins encore dans une grande
banque. De multiples phénomènes
s’y combinent pour conduire à une
qualité médiocre des données, sans
que personne ne s’en sente légitime
ment responsable.
Les données de qualité sont celles
qui sont bien définies, utilisées fré
quemment et que leurs utilisateurs
ont la capacité et le loisir de corriger
sans délai. Malheureusement, c’est
un cas assez minoritaire. Pour de
nombreuses données, la chaîne est
longue entre les producteurs et les
utilisateurs. Les uns et les autres sont
en outre souvent multiples pour une
même donnée et ne travaillent pas
directement ensemble, intégrés à
des processus disjoints, de vente, de
production, de marketing, de pilo
tage ou encore de reporting... voire à
des entités légales distinctes.
Les données de reporting ne sont fré
quemment contrôlées qu’une fois
par trimestre, à l’occasion de l’ar
rêté des comptes. Bien souvent, la
contrainte des délais de publication
SEPTEMBRE 2014 N° 775 Re v u e Ba n q u e

MANAGEMENT & SYSTÈMES D ’ INFORMATION
II faut mettre
en œuvre un
plan de contrôle
permanent
pour chaque
donnée dont la
qualité est jugée
suffisamment
sensible pour
ne pas être
abandonnéeà un
simple traitement
réactif en cas
d’incident.
ne laisse guère le choix que de pro
céder à des corrections à chaud, en
aval des chaînes de production sans
pouvoir diagnostiquer, ni a fortiori
corriger à la source, les causes des
anomalies relevées.
Les données de référence constituent
un enjeu emblématique de qualité.
Elles décrivent des réalités internes
(organisation, nomenclatures...) ou
externes (tiers, titres...) préexistantes
aux activités bancaires proprement
dites et servent à référencer les tran
sactions ou les indicateurs de pilo
tage. Elles sont omniprésentes et
ont des utilisateurs particulièrement
nombreux. Leur production est en
revanche beaucoup plus probléma
tique : il n’est pas rare que personne
ne s’en sente responsable ou qu’elles
fassent l’objet de plusieurs gestions
indépendantes difficiles à réconcilier.
Le cas des tierces personnes morales
est un classique du genre : chaque
enseigne ou ligne métier gère légi
timement ses clients corporate, mais
la mesure des risques portés par le
groupe face à chaque contrepartie
requiert une consolidation a posteriori
qui peut se révéler très complexe,
même avec des outils de Master Data
Management.
Les enjeux du pilotage
de la liquidité ont récemment révélé
le même type de situation pour la
gestion des titres.
Autre cas de dérive nuisible à la qua
lité: le foisonnement des usages
« parasites » des données qui ont le
mérite d’exister. La recherche de la
facilité - qu’on ne saurait blâmer-
peut conduire à des malentendus
graves sur la signification d’une don
née, à des interprétations erronées et
donc à des reportings trompeurs ou à
des mauvaises décisions. La confu
sion entre les douteux comptables et
les défauts bâlois en est un exemple.
Pire, une forme de parasitage peut
même venir corrompre le contenu
même de la donnée, la dévoyer pour
lui faire porter, à moindre coût (du
moins à court terme), une informa
tion pour laquelle elle n’était pas pré
vue, au risque d’en polluer les autres
usages. Lorsque BâleIII a imposé
un reporting sur les différents appels
de marge associés aux transactions
passés avec une contrepartie ou par
une chambre de compensation, il
a ainsi été tentant de collecter ces
informations comme des pseudo
transactions affublées de codes pro
duits ad hoc qui sont venus brouiller
la classification des produits.
Etpuis, s’agissant de la matière pre
mière de la production bancaire, on
aurait pu s’attendre à trouver dans
les banques le même niveau d’assu
rance et de contrôle qualité sur leurs
produits informationnels que n’en
déploient les industriels fabricants
de produits matériels. On en est sou
vent assez loin : les préoccupations
de qualité des données sont rare
ment très présentes dans les projets
de transformation bancaires, tandis
que la mise en œuvre de contrôles
systématiques permettant d’iden
tifier les non-qualités avant qu’elles
aient bloqué un processus ou cho
qué un utilisateur, voire un client,
est encore exceptionnelle.
DES CONTRAINTES
TECHNIQUES INÉVITABLES
Les données bancaires sont enfin
pour l’essentiel modélisées et enre
gistrées dans des bases de données
informatiques chargées d’en faci
liter la manipulation : cette implé
mentation ne peut qu’accentuer les
imprécisions et les redondances des
besoins métier exprimés. Le pas
sage du concept bancaire au modèle
applicatif peut même rajouter des
causes spécifiques de non-qualité.
Les contraintes techniques inévi
tables (optimisation des traitements
et des performances) tendent en effet
à induire une multiplication des ins
tances de la même donnée dans le
SI sans que les moyens soient pris
pour garantir, sinon une stricte éga
lité de leurs valeurs à tout moment,
du moins que les différents usages
manipuleront bien des valeurs cohé
Revue Banque N" 775 SEPTEMBRE 20 14
rentes. Le risque est grand dans cette
situation que les utilisateurs, voire
même les informaticiens, ne sachent
plus quelle instance de la donnée
doit faire foi.
LA NÉCESSITÉ D’UNE
GOUVERNANCE DES DONNÉES
Seul un système de gouvernance for
melle des données et un réseau actif
de professionnels de la qualité des
données sont de nature à apporter des
solutions à ces types de difficultés.
Gouvernance parce que la première
clé vers la maîtrise de la qualité des
données est une attribution claire des
responsabilités. Chaque donnée doit
avoir un propriétaire, responsable
d’établir et de communiquer sa défi
nition ainsi que de formuler les exi
gences de qualité et les conditions
d’utilisation associées (au nom des
utilisateurs). Mais, compte tenu du
nombre de données concernées (je
n’ai connaissance d’aucun recense
ment en la matière mais l’ordre de
grandeur du nombre d’articles dans
le dictionnaire de données virtuel
d’une grande banque est sans doute à
5 chiffres), un niveau intermédiaire de
pilotage par grand domaine de don
nées semble incontournable. C’est
à ce niveau que seront modélisés la
structuration des données en objets et
le réseau de relations entre les objets.
C’est aussi à ce niveau que pourra être
exercé un contrôle de cohérence et mis
en œuvre un effort de simplification.
C’est enfin sur cette base que pourra
être mise sous contrôle l’implémenta
tion dans les applications en veillant
à la traçabilité depuis les concepts
jusqu’aux enregistrements physiques
et en explicitant pour chaque donnée
sa « source d’or », l’instance applica
tive unique qui fait foi, ainsi que les
exigences d’asservissement de ses
éventuelles copies.
GARANTIR LA QUALITÉ
DES DONNÉES
Il faut ensuite que la gestion cou
rante des données (création, mise à

U
La q u a lité des données
n ’est pas n a tu relle dans une g rande
organisation, m oins encore
dans
une g rand e banque. 99
jour, suppression...) soit entourée,
lorsque le besoin en est exprimé, de
toutes les précautions de nature à en
garantir la qualité. Or la plupart des
données bancaires sontde fait gérées
à travers des processus bancaires
(gestion des contrats, gestion de la
relation client, production d’indica
teurs de pilotage ou de reportings...) et
confiés à des banquiers qui ne sont
pas des spécialistes de l’assurance
qualité. Il est donc important que les
dispositifs de production de données
(équipes, organisations, processus,
systèmes) jugés critiques en termes
de qualité soient dotés de spécialistes
qui sauront mettre en œuvre les leviers
efficaces : formation des utilisateurs
sur les définitions et exigences, sur
l’utilisation de sources externes, tuork-
JIoiüs de validation, enrichissement
des contrôles interactifs de saisie...
Ces spécialistes d’assurance qualité
seront notamment des contributeurs
obligés aux décisions de lancement
de nouveaux produits ou plus géné
ralement à toutes les revues de pro
jets transformations ayant un impact
sur les données à gérer ou sur leurs
usages.
Troisième élément requis pour maî
triser la qualité des données : il faut
se doter d’instruments de mesure
de la qualité des données qui per
mettent d’objectiver le degré de satis
faction des exigences et de déceler
le plus tôt possible les non-qualités,
avant qu’elles aient créé un incident
dans un traitement ou fait réagir un
utilisateur interne ou externe. Cela
signifie qu’il faut définir et mettre
en œuvre un plan de contrôle per
manent, automatisé et/ou humain,
pour chaque donnée dont la qualité
est jugée suffisamment sensible pour
ne pas être abandonnée à un simple
traitement réactif en cas d’incident
ou de réclamation.
Cette objectivation est essentielle
pour mettre en œuvre un véritable
pilotage de la qualité des données
qui focalise les moyens sur la résolu
tion des anomalies vraiment pénali
santes sans tomber dans le piège de
la sur-qualité ni se laisser ballotter
par les aléas du dialogue de sourds
entre utilisateurs et producteurs des
données.
U N E N O U V E L L E D IM E N S I O N
T R A N S V E R S E D A N S LE
P IL O T A G E D E L A B A N Q U E
Pris un à un, les éléments de réponse
au défi de la qualité des données
bancaires ne sont donc pas bien
sorciers, mais leur mise en œuvre
simultanée requiert une transfor
mation importante dans les grandes
banques. Les données sont en effet
irréductiblement transverses à l’or
ganisation : transverses aux struc
tures juridiques et aux lignes métier
bien sûr, mais transverses aussi aux
filières de pilotage (finance, risques,
conformité...), transverses enfin aux
approches processus et, transverses
aux SI, même les mieux urbanisés.
Sans dispositif ni gouvernance ad
hoc, cette transversalité soulève de
véritables difficultés pour faire émer
ger des définitions partagées, pour
mutualiser des dispositifs de pro
duction de données de référence
ou pour définir des indicateurs de
qualité globaux. Il ne s’agit de rien
de moins que d’introduire une nou
velle dimension transverse dans le
pilotage de la banque. Cette trans
formation ne peut être engagée avec
quelques chances de succès sans être
portée par un champion fortement
soutenu par la direction générale.
C’est le rôle de celui que les Anglo-
Saxons identifient sous le nom de
C hief D ata Officer
et dont les banques
françaises commencent également
à se doter. ■
RB
LIBRAIRIE Nouveauté
PRATIQUE DES PRODUITS
BANCAIRES
BANQUE ET FISCALITÉ
DU PARTICULIER:
TECHNIQUES, CONSEIL ET
ASTUCES
Auteur: Aurélien Giraud
Editeur: Eyrolles
Collection: Finance
Nombre de pages: S60 pages
Pratique des
produits bancaires
Banque et fiscalité du particulier ;
techniques, conseils et astuces
les commentés EVRou.es
Ce guide présente de façon très pratique et concrète
les produits bancaires.
S’appuyant sur plus de 200 exemples commentés,
il constitue un outil indispensable pour le conseiller
bancaire, mais aussi pour le particulier désireux de mieux
comprendre les produits qui lui sont proposés.
Pratique des produits bancaires aborde les sujets les plus
importants sur lesquels les particuliers souhaitent un
accompagnement efficace et pragmatique :
• Les produits d’épargne bancaire: Quels sont les bons
critères de choix des livrets? Comment fonctionne
exactement la fiscalité sur ces livrets?
• Les enveloppes fiscales (PEA, assurance-vie, PERP,
contrat Madelin, etc.) : Pourquoi autant de produits ?
Pour qui sont-ils réellement intéressants?
• Les prêts immobiliers: Quelles sont les clés d’une
négociation de prêt immobilier? Quels sont ces montages
qui font gagner de l’argent à la banque et au client?
• Les régimes matrimoniaux, donations et successions:
Comment s’appliquent les barèmes de donations et de
successions, concrètement, à chaque situation? Comment
anticiper au plus juste l’impact du choix du régime
matrimonial?
• L’impôt sur le revenu : Comment fonctionne le système de
plafonnement du quotient familial ? Quelles sont les astuces
à connaître dans la déduction des frais réels?
Comment calcule-t-on exactement l’impôt sur le revenu,
les plus- values immobilières?
Commandes,
informations,
catalogue :
revue-banque.fr
y
_______________
)
SEPTEMBRE 2 0 14 N° 775 Revue Banque 73

CopyrightofRevueBanque/BanqueMagazineisthepropertyofRevueBanqueandits
contentmaynotbecopiedoremailedtomultiplesitesorpostedtoalistservwithoutthe
copyrightholder'sexpresswrittenpermission.However,usersmayprint,download,oremail
articlesforindividualuse.
1
/
5
100%