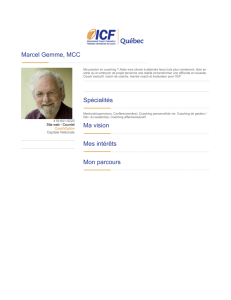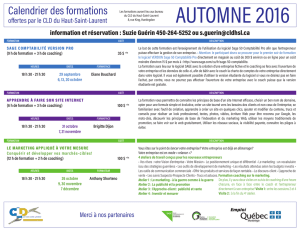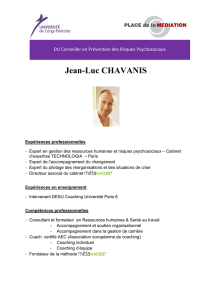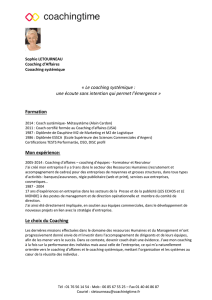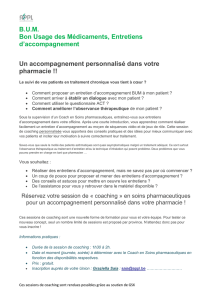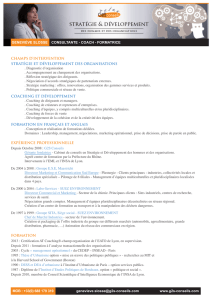Coaching et gestion du temps : L'autodiscipline en management
Telechargé par
rainpochenatan

UN COACH POUR BATTRE LA MESURE ?
La rationalisation des temporalités de travail des managers par la discipline de soi
Scarlett Salman
S.A.C. | « Revue d'anthropologie des connaissances »
2014/1 Vol. 8, n° 1 | pages 97 à 122
Article disponible en ligne à l'adresse :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2014-1-page-97.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour S.A.C..
© S.A.C.. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la
licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage
dans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
© S.A.C. | Téléchargé le 22/08/2020 sur www.cairn.info (IP: 82.64.162.119)
© S.A.C. | Téléchargé le 22/08/2020 sur www.cairn.info (IP: 82.64.162.119)

Revue d’anthropologie des connaissances – 2014/1 97
Dossier «À la recherche Du métronome
invisible Des organisations»
un coach pour battre
la mesure?
La rationalisation des temporalités de
travail des managers par la discipline de soi
scarlett
SALMAN
RÉSUMÉ
Cet article prend pour objet les temporalités de travail telles
qu’elles sont exposées par trois managers dans le huis clos de
séances de coaching individuel, dispositif adossé à des techniques
psychologiques qui leur a été prescrit par leur entreprise. Se
dégagent trois figures prises par leur temps au travail: un temps
réduit au présent, voire à l’instant; un temps fragmenté; enfin, un
trop-plein, un temps qui déborde. Le coaching se présente comme
une réponse néomanagériale mise en place par les organisations
pour aider leurs cadres supérieurs à mieux gérer la complexité
et la diversité des situations professionnelles, dont relèvent les
enchevêtrements, voire les contradictions, entre les différentes
temporalités dans l’activité de travail. Or, à rebours du nouvel
esprit du capitalisme, le coaching tend, dans les faits, à étendre
les limites de la planification et à réaffirmer des normes sociales
inverses à la société connexionniste. Sont en effet préconisées
une focalisation de l’attention, mais aussi ce que nous appelons
une hygiène des territoires, à savoir une répartition des tâches
la plus stricte et la plus étanche possible et la réaffirmation d’une
frontière vie privée/vie professionnelle.
Mots clefs : coaching, entreprise, temporalités de travail,
managers, dispersion au travail, psychologisation, planification,
hygiène des territoires/hygiène psychique, cité par projets/cité
industrielle
© S.A.C. | Téléchargé le 22/08/2020 sur www.cairn.info (IP: 82.64.162.119)
© S.A.C. | Téléchargé le 22/08/2020 sur www.cairn.info (IP: 82.64.162.119)

98 Revue d’anthropologie des connaissances – 2014/1
INTRODUCTION
Comme l’ont rappelé G. de Terssac et J. Thoemmes (2006), le temps est
orienté dans le travail vers une rationalité calculatrice (Thrift, 1981). Les
cadres qui ont une responsabilité d’encadrement, qu’on désignera comme des
managers ou des encadrants (Mispelblom-Beyer, 2006), sont particulièrement
confrontés à la question de l’organisation de leur temps au travail: leur statut
leur confère un pouvoir de gestion de leurs temporalités et une autonomie
(Boltanski, 1982) à laquelle ils sont attachés, qui sont, cependant, limités et
contraints de facto par leurs responsabilités et la spécificité de leur activité.
Cette dernière est, en effet, caractérisée par la «fragmentation»1 (Mintzberg,
1973, 1984) et par la «polyactivité» (Benguigui et al., 1978; Cousin, 2008).
Des études plus ethnographiques mettent au cœur de l’activité du manager les
«situations dispersives» (Datchary, 2005, 2011) tandis que d’autres parlent
de « temporalités professionnelles “parasitées” » (Thoemmes et al., 2011).
Les transformations de l’organisation de la production (Vatin, 1987; Coriat,
1991), l’introduction massive des nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC) et l’évolution des normes managériales
comme la montée de l’organisation par projet ont contribué à exacerber ces
caractéristiques de l’activité des managers (Datchary & Licoppe, 2007). Ainsi,
pris entre les prescriptions du plan et les aléas du terrain, le manager constitue
un bon exemple pour analyser le «travail d’articulation temporelle» à l’œuvre
dans les activités productives contemporaines.
Or les organisations tentent de mettre en place des dispositifs pour former
leurs cadres à la gestion de ces situations professionnelles complexes, notamment
en vue de rendre plus compatibles les temporalités organisationnelles, collectives
et individuelles qui s’enchevêtrent dans l’activité de travail. L’un de ces dispositifs
est le coaching individuel, prestation de service introduite en France dans les
années 1990, en partie importée des États-Unis, et régulièrement utilisée par
les grandes entreprises pour certains cadres supérieurs et dirigeants depuis
le début des années 2000. Consistant en une dizaine d’entretiens individuels,
confidentiels et réguliers, entre un cadre et un consultant coach, la prestation
a pour but « l’accompagnement de personnes pour le développement de leurs
potentiels et de leurs savoir-faire, dans le cadre d’objectifs professionnels»
2. Les
thèmes abordés sont multiples (relations interpersonnelles au travail, «savoir-
être», carrière…), mais la question de la «gestion du temps» y figure en bonne
place, dans la continuité des stages de formation et de la littérature managériale,
précisément parce qu’elle fait partie des préoccupations centrales des managers
et des injonctions organisationnelles à l’augmentation de l’efficacité dans un
temps réduit. Bien que ce dispositif soit souvent «prescrit» – selon le terme en
1 Par convention, les expressions entre guillemets sans italique sont celles des auteurs mobilisés,
tandis que les propos entre guillemets et en italique sont ceux des acteurs étudiés. Les expressions
sans guillemets et en italique correspondent à nos propres notions.
2 Selon la définition de la Société Française de Coaching.
© S.A.C. | Téléchargé le 22/08/2020 sur www.cairn.info (IP: 82.64.162.119)
© S.A.C. | Téléchargé le 22/08/2020 sur www.cairn.info (IP: 82.64.162.119)

Revue d’anthropologie des connaissances – 2014/1 99
vigueur – par leur supérieur hiérarchique ou par un gestionnaire des ressources
humaines, il semble toutefois apprécié des cadres, en ce qu’il représente un
support de réflexivité professionnelle, notamment temporelle. Ouvrir la boîte
noire de ce dispositif managérial individuel et personnalisé permet de poursuivre
l’analyse des temporalités de travail des encadrants et des appuis qui leur sont
proposés par l’organisation. Il s’agit d’abord de donner à voir le rapport des
managers aux temporalités, les attentes normatives qui pèsent sur eux, ainsi
que les techniques de «gestion du temps» que leur proposent les coachs, et ce
qu’ils en font.
La pratique professionnelle des coachs repose sur des méthodes
psychologiques relevant du « développement personnel », courant qui vise
l’accroissement des potentialités individuelles par une meilleure connaissance
de soi (Brunel, 2004; Stevens, 2005). Si les techniques de gestion du temps
proposées par les coachs doivent être distinguées des modes opératoires
du coaching, le prisme par lequel elles sont présentées aux cadres n’est pas
neutre. Ainsi, on peut se demander pourquoi des méthodes reposant sur
des savoirs psychologiques sont mobilisées en entreprise pour aider les
cadres à mieux «gérer» leurs temporalités de travail. Quel est l’intérêt, en
matière d’articulation temporelle, de ce type d’intervention reposant sur des
connaissances psychologiques?
Le coaching met l’accent sur une gestion individualisée et personnelle
des temporalités de travail. Il renvoie les individus à leurs valeurs, à leur
personnalité. Une hypothèse serait de considérer que la gestion du temps en
milieu organisé serait affaire de créativité individuelle, de flexibilité, d’adaptabilité
aux circonstances. La recherche d’un métronome des organisations serait ici
vaine, car le travail des managers serait fait de projets et de connexions qui
réclameraient une souplesse d’adaptation et une disponibilité constantes. C’est
l’hypothèse qui se dégage des écrits de la littérature néomanagériale, dont le
coach est l’une des figures emblématiques. Au contraire, la thèse de notre
article, qui repose sur une enquête approfondie sur la genèse et les usages
du coaching en entreprise (cf. encadré méthodologique), est que ce dispositif
contribue à un surcroît de rationalisation et de planification du temps de travail.
À rebours du «nouvel esprit du capitalisme» (Boltanski & Chiapello, 1999), les
appuis qu’il propose relèvent davantage d’un ordre de grandeur industrielle, au
sens de Boltanski et Thévenot (1987). Pour aider les managers à mieux faire
face à la gestion des aléas, les coachs cherchent à repousser les limites de ce qui
est proprement incertain et imprévisible en planifiant tout ce qui est susceptible
de l’être, y compris la place des aléas eux-mêmes et des «temps morts». C’est
une meilleure maîtrise du temps qui est visée. De plus, un «recentrage» du
cadre sur son périmètre de travail est préconisé, tant en termes de tâches et de
responsabilités qui lui incombent en propre qu’en termes spatio-temporels. Ce
«recentrage» réaffirme des normes sociales comme la focalisation de l’attention
ou encore la frontière vie privée/vie professionnelle, mises à l’épreuve dans
les situations contemporaines de travail. Il s’agit d’une certaine manière de
© S.A.C. | Téléchargé le 22/08/2020 sur www.cairn.info (IP: 82.64.162.119)
© S.A.C. | Téléchargé le 22/08/2020 sur www.cairn.info (IP: 82.64.162.119)

100 Revue d’anthropologie des connaissances – 2014/1
remettre les choses à leur place: à chacun sa tâche; à chaque espace sa fonction.
C’est pourquoi nous proposons de parler d’une hygiène des territoires, en nous
inspirant de l’analyse de M.Douglas sur la souillure (1967). L’usage des méthodes
psychologiques aurait alors une double visée: d’une part, inciter le manager à
faire preuve de réflexivité sur sa propre activité de travail, parce qu’il serait
le mieux placé pour percevoir comment articuler les différentes temporalités
qui s’enchevêtrent, en rationalisant son temps et en tenant le cap des objectifs
professionnels; d’autre part, envelopper des principes disciplinaires dans un
langage psychologiste centré sur l’épanouissement de soi.
L’article commence par présenter les trois principaux enjeux en matière de
temporalité auxquels sont confrontés les encadrants interrogés et à les resituer
dans leur activité de travail. Il met ensuite en évidence le type de réponses
proposé par le coaching, en se centrant sur les techniques de rationalisation du
temps, tout en donnant à voir quelques-uns des modes opératoires des coachs.
Encadré méthodologique
Cet article s’appuie sur une enquête de sociologie sur le coaching en entre-
prise en France dans les années 2000, menée dans le cadre d’une thèse de doc-
torat (Salman, 2013). Celle-ci a d’abord consisté en un important volet quali-
tatif: une quarantaine d’entretiens approfondis avec des coachs, comportant
une première partie biographique et une deuxième partie sur leur activité pro-
fessionnelle et la présentation détaillée de cas réels de coachings; près de
vingt entretiens avec des cadres coachés dans leur travail, également constitués
d’une partie biographique permettant de retracer la carrière professionnelle du
cadre et d’y situer le moment où il s’est fait coacher, ainsi qu’un récit détaillé
des séances, des thèmes abordés (qui donnent à voir certains aspects de l’acti-
vité concrète des cadres et des difficultés éprouvées), du traitement opéré par
le coach, comme de ce qu’en a retiré le cadre; enfin, une vingtaine d’entretiens
avec des gestionnaires de ressources humaines. Pour mieux saisir de l’intérieur
la pratique du coaching, tant du point de vue du prestataire que du «bénéfi-
ciaire», trois observations participantes ont été réalisées: comme bénéficiaire
d’un coaching, effectué avec une coach en formation, en face-à-face et par télé-
phone, sur une année; comme stagiaire dans deux formations au coaching, une
universitaire française et une américaine privée. S’est ajouté un volet quantita-
tif composé de deux questionnaires: l’un, sur le profil et l’activité des coachs,
complété par une centaine d’adhérents de la Société Française de Coaching;
l’autre, sur les usages du coaching en entreprise, par plus de 200adhérents de
l’Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines.
© S.A.C. | Téléchargé le 22/08/2020 sur www.cairn.info (IP: 82.64.162.119)
© S.A.C. | Téléchargé le 22/08/2020 sur www.cairn.info (IP: 82.64.162.119)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%