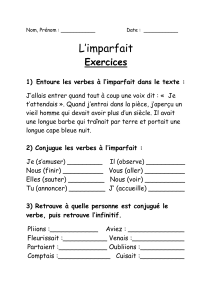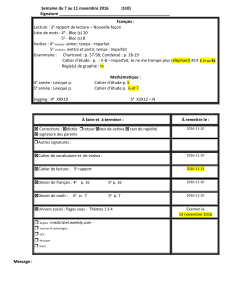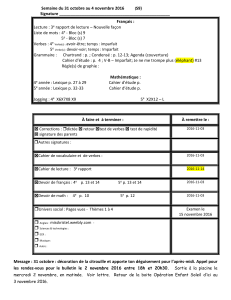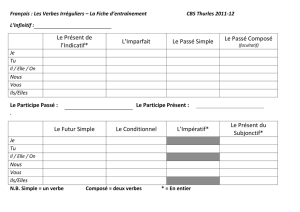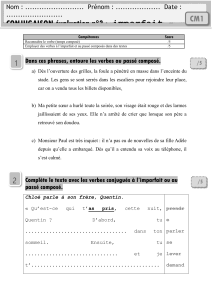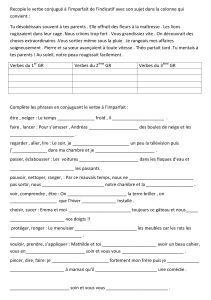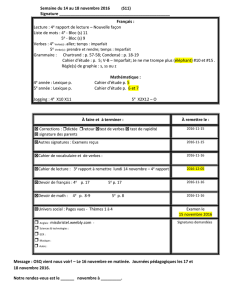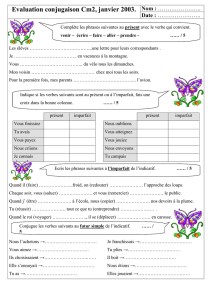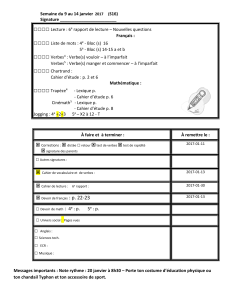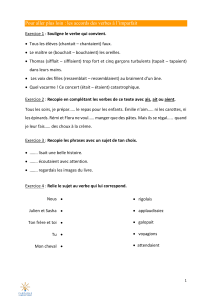L’imparfait de l’indicatif
I. Situation en latin classique et modifications survenues en latin vulgaire et gallo-
roman
A. En latin classique
āre › abam
ēre › ēbam
ĕre › ēbam, iebam
īre › iebam
B. Modifications survenues dès le latin vulgaire
Verbes en ĕre imparfait iebam › ēbam
Verbes en īre imparfait iebam › ēbam
C. En gallo-roman à date prélittéraire
āre : ābam › ēbam
Ainsi tous les verbes, quel que soit leur infinitif ont la même finale en ēbam à l’imparfait.
C’est une situation simplifiée.
II. Evolution des finales ēbam, as,… aux formes primitives de l’ancien français.
En AF dans l’état primitif on avait graphiquement (début XIe)
eie [ eie]
eies [ eies]
eiet [eiet]
iiens [iyens]
iiez [iyets]
eient [eient]
A) Dans toutes les formes, probablement vers fin IIe, IIIe s la consonne [b] s’est effacée.
Dans les verbes qui présentaient 2 consonnes labiales intervocaliques, l’une dans le radical,
l’autre dans la finale d’imparfait, il y a eu un phénomène de dissimilation entre les deux
labiales et la conséquence a été l’effacement de la labiale contenue dans la finale
*ēam

*ēas
*ēat
*ēat
*eāmus
*eātis
*ēant
Les finales ainsi réduites dans le cas de ces verbes par dissimilation se sont par analogie
étendues à tous les autres verbes, ceux qui ne présentaient pas les deux[b] envisagés.
B) A partir des finales *eam, *eas, … l’évolution phonétique ultérieure est régulière. ẹ
tonique libre se diphtongue › ei (XIe)
a en situation finale ou finale devant s, t, ou nt va s’assourdir en e sourd
Problème de t final de 3 : t final a subsisté sous la forme t alors qu’on attendait normalement
sa transformation en constrictive θ et la disparition de la constrictive.
C) Pour eāmus et eātis le résultat phonétique correspond à une évolution difficile hors
programme.
III. Evolution des formes primitives de l’AF jusqu’aux formes du FM
a Les modifications de nature phonétique
1) Pour 3, milieu XIe e sourd s’efface, effacement dû probablement à la durée très
brève de cette voyelle devant t final
2) Pour 1, 2, 3, 6 : évolution de la diphtongue ei ; ei › oi › we (fin XIIe)
Lp (2e partie du XIIIe) we › e ouvert. Entre le XIVe et le XVIe siècle, cette prononciation e
ouvert gagne du terrain, non seulement dans l’usage de la bourgeoisie, mais également
semble-t-il dans l’usage de la noblesse. Progression facilitée par la présence à la cour de
nombreux italiens incapables de maintenir la prononciation correcte. A partir de la fin du
XVIe et au XVIIe siècle, la prononciation e ouvert (toujours graphiée oi) est admise par toute
la population. C’est en 1835, que dans la sixième édition du dictionnaire de l’académie, les
finales de l’imparfait sont écrites ai.
Pour les consonnes finales s et t, cf cours de 2e année.

b Modifications de nature non phonétique, donc analogique
1. Effacement de e sourd pour 1, 2 et 6
Effacement phonétique et graphique pour 1 et 2 alors qu’il n’est que phonétique pour 6.
L’explication probable est l’analogie de l’effacement de e sourd qui s’était produit à la 3e
personne du singulier.
2. Pour 1, introduction de s final au XIVe siècle. Explication : analogie de la personne 2
et désir d’éviter l’hiatus quand le mot suivant commençait par une voyelle. S est
définitivement admis au milieu du XVIIe siècle.
3. Pour 4, finale ïens remplacée par ïons : par analogie des personnes 4 et 5 de
l’indicatif et du subjonctif présent, du futur et du subjonctif imparfait : ons. Premiers
exemples au XIIe siècle, courant XIVe, la désinence primitive ïens a pratiquement
disparu.
4. Pour 4 et 5, à l’origine désinence en 2 syllabes d’où le tréma ï-ons ; ï-ez
Par analogie des désinences correspondantes de subjonctif présent qui étaient
monosyllabiques, les désinences d’imparfait peuvent être monosyllabiques dès le XIIe siècle.
Puis il y a eu hésitation entre les formes monosyllabiques et les formes bisyllabiques. Au
XVIIe siècle, les formes monosyllabiques s’imposent partout sauf lorsqu’elles sont derrière
un groupe consonne + liquide
ex : livrions, livriez = 3 syllabes alors que devions = 2 syllabes
Evolution des terminaisons : AF
eie puis oie et ois
eies- oies puis ois
eie(t) puis oit
iiens ou iens
iiez ou iez
eient ou oient

FM
ais
ais
ait
ions
iez
aient
aveie puis avoie et avois
verbe être stabam › *estēbam › esteie/ estoie/ estois
LC eram › iere (forme tonique) / ere (forme atone) type disparu après 1300
1
/
4
100%