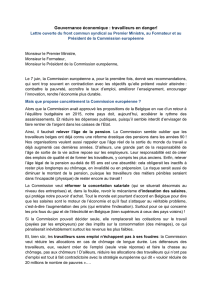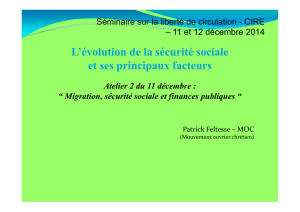1
Droit de la sécurité sociale
Notes de cours (2018-2019)
Cours premier – 19 septembre 2018
Introduction
Cours introductif. L’intitulé n’a pas bonne presse… L’image dominante est : branche de
l’ordre juridique qui est poussiéreuse, fastidieuse, avec des réglementations complexes et
pas harmonisées, peu lisibles. L’étude semble dès lors ennuyeuse. Ce n’est pas totalement
faux. Le droit de la sécurité sociale est peu lisible. Un peu comme le droit fiscal. Cela dit,
il n’empêche que ça mérite de l’intérêt. Pourquoi ? D’abord parce que c’est une branche
qui est traversée par des enjeux fondamentaux.
Et ça nous concerne de très près, plus que les autres branches sans doute. Pour deux
raisons au moins : (1) en tant qu’individu d’abord, parce que la sécurité sociale est
omniprésente dans nos vies quotidiennes. La pension, le chômage, les cotisations de
sécurité sociale… C’est toujours de la sécurité sociale. Nous sommes tous des assurés
sociaux. Nous sommes donc tous des ayants droit à un certain nombre de prestations
sociales. Mais en tant que (2) citoyen aussi, dans le sens où c’est très présent dans le débat
public, dans les médias, dans les échanges d’idées. On parle toujours et tout le temps de
la sécurité sociale : les soins de santé, les pensions, le chômage, etc. Récemment, on parle
de plus en plus de l’allocation universelle. L’idée est que notre système est trop complexe, et
donc il faudrait remplacer le tout ou une partie par une garantie d’un même revenu de
base pour tout le monde.
Il y a aussi une grande ampleur financière. Le budget de la sécurité sociale : 100 milliards.
C’est 25% du PIB ! Chaque année dans ce pays (et c’est un peu pareil partout), un quart
de la richesse du pays est redistribuée par la sécurité sociale : allocation familiale, pension,
CPAS, etc.
Dans ce cours, on ne prendra évidemment pas position. Mais on verra une série d’outils
pour mieux décoder ces débats en maîtrisant les bases de notre système de sécurité
sociale.

2
Objectif du cours
Transmettre et expliquer un certain nombre de données factuelles et de concepts
juridiques, qui forment l’ossature de notre système de sécurité sociale. Le cours est assez
interdisciplinaire. On aura surtout une approche technique-juridique, mais aussi
sociopolitique. C’est un cours de droit avant tout, mais systématiquement, il y aura avant
l’exposé un peu sec des normes en vigueur, par des explications empruntées aux autres
sciences humaines, surtout l’histoire. Donc on réinscrira le droit positif dans son
contexte historique. On n’aura donc pas une approche positiviste qui isole le droit de son
histoire.
Prérequis
Il faut avoir suivi le cours de droit du travail. Et pour rappel, le droit de la sécurité sociale
et le droit du travail forment ensemble le droit social. Le droit de la sécurité sociale est
moins privé que le droit du travail. Le droit de la sécurité sociale indemnise les risques
sociaux, protège la population contre les risques de l’existence. Et ce sont les autorités
publiques qui sont en charge. Mais il y a quand même des notions qui viennent du droit
du travail.
Dispositions pratiques
Il n’y a pas de support de cours (ça va venir l’année prochaine). Mais il y a des morceaux
de ce petit syllabus, qui seront postés sur l’UV (pour la seconde moitié du cours surtout).
Et la matière change parfois. Il y a aussi un plan de cours sur l’UV, avec des indications
bibliographiques, avec les deux manuels qui existent en Belgique. Le francophone est très
bien fait, est très didactique surtout. Mais le meilleur c’est le néerlandais, c’est la Bible de
la sécurité sociale (par un professeur de la KUL). C’est le livre de référence. D’ailleurs, en
général, c’est du côté néerlandophone que ça se passe pour cette branche du droit !
À l’examen, ça sera le même type de questionnaires que les années précédentes. La
matière n’est constituée que de la matière enseignée au cours oral et des notes écrites pour
les parties du cours pour lesquelles elles existent. Dans les notes il y a parfois un peu plus
que ce que le prof dit au cours.
Pour les étudiants en droit seulement, il faut travailler avec les textes. Aucun sens
d’apprendre par cœur… Kluwer édite un Code du droit de la sécurité sociale, fait par le prof et
son homologue à l’UCL. Il faut l’acheter. C’est le moins cher, hors commerce, et la
sélection recoupe la matière du cours. Il faut prendre l’édition 2018-2019, surtout pas une
autre. Le code peut être fluoré, souligné, etc., on peut renvoyer entre dispositions, mais
pas recopier le cours !
Le prof a lu dans les Novelles ce qu’on dit sur lui. Il aime la précision, etc. Il faut bien
préparer le code et utiliser les termes exacts. C’est vrai.

3
Structure du cours
Il y aura quatre parties :
1) Introduction générale au droit de la sécurité sociale. Pour le prof, c’est la partie la plus
importante. Toute la suite va s’appuyer là-dessus ! C’est l’infrastructure… Il divise cette
partie en quatre temps :
a) Construction historique. Notre droit de la sécurité sociale est vraiment marqué
par son histoire. Pourquoi est-ce comme ça et d’où ça vient ? La réponse c’est
toujours l’histoire.
b) Concepts fondamentaux. On va essayer de définir la sécurité sociale par
contraste avec les assurances privées.
c) Aperçu comparé des différentes façons de penser et organiser la sécurité
sociale. Après, on viendra sur le système belge, mais ailleurs, ça peut se faire
autrement. On va donc se situer dans le paysage international.
d) Interactions entre la sécurité sociale et le droit constitutionnel.
2) Triptyque lié : assujettissement, financement et organisation administrative des régimes. Trois
questions qui correspondent : qui paye ? Comment on calcule les cotisations ? Qui fait
quoi dans l’organigramme de la sécurité sociale ? Et sur ces trois plans, il faudra à chaque
fois distinguer la situation des salariés de celle des indépendants (même si exclus du droit
du travail).
3) Le cœur du système : on va voir les principales branches du régime de sécurité sociale
des salariés (accidents du travail, chômage, pension et soins de santé).
4) L’aide sociale, qui est différente de l’assurance sociale. L’aide sociale c’est les
différentes prestations pour les personnes en situation de pauvreté. Mais aussi le droit à
l’intégration sociale (alloué par les CPAS).
Partie I. Introduction générale au droit de la sécurité sociale
Section I
Pour retracer la genèse de notre système, on va structurer notre parcours en cinq grandes
périodes. On va voir les deux premières aujourd’hui. La toute première chose à souligner
c’est que quand on réinscrit la sécurité sociale dans l’histoire, on réalise d’abord qu’elle n’a
rien de naturel. Rien d’évident ou de spontané non plus… La sécurité sociale est le fruit
d’un très long combat social et politique. Il s’agit d’une construction arrachée par le mouvement
ouvrier aux classes possédantes.
L’événement déclencheur de la sécurité sociale c’est la grande révolution économique de
la fin du XVIIIe siècle : la révolution industrielle. On est dans un contexte où les
campagnes sont désertées pour les milieux urbains. Toute une population nouvelle dans
les villes… Et qui sont très largement dénuée de moyens de subsistance. Cette
concentration dans les villes fournit aux capitaines d’industrie la main-d’œuvre nécessaire
pour faire tourner les usines. Le capitalisme prend son envol…

4
Avec le développement du capitalisme, il y a un phénomène, un mal nouveau qui fait son
apparition : le paupérisme. La sécurité sociale est une réponse à ce phénomène. C’est quoi
le paupérisme ? Faut revenir au rapport déséquilibré entre le prolétaire et le capitaliste. Le
prolétaire doit accepter le travail pour survivre. Les salaires permettent à l’époque à peine
de vivre. Tout au long de cette période, les prolétaires vivent dans un état de pauvreté qui
est totale et permanente. On a dit qu’il était épidémique : ça se reproduit de génération en
génération. L’ouvrier est pauvre toute sa vie, peu importe son travail, et a priori, sa
descendance le sera aussi. C’est cela que désigne le paupérisme : état de privation extrême
dans lequel une part considérable de la société a vécu pendant très longtemps.
L’abbé Sieyès a, dès la fin du XVIIIe siècle, que les prolétaires étaient « une foule
immense d’instruments bipèdes sans liberté. »
Bref, immense insécurité d’existence pour une grande partie de la population. C’est dans
ce contexte qu’il y a des aléas nouveaux. On sait qu’avoir un travail permet au mieux de
survivre. Mais ne pas avoir de travail, c’est pire encore, car on n’a aucun revenu. Si un
événement empêche quelqu’un de travailler, de mettre sa force de travail en location, les
conséquences sont considérables. Et ça peut arriver facilement alors. Il y a en effet deux
risques nouveaux qui n’existaient pas avant. D’abord (1) les accidents du travail, car
machinisme et usine. Le nombre des accidents explose ! Et face à ça, les ouvriers sont
démunis. Car la seule réponse de l’ordre juridique, c’est 1382. Il y a trois conditions
(faute, dommage, lien causal). Mais dans le cadre des accidents de travail, le dommage est
bien là : membre en moins, décès… Mais la faute ? À qui la faute ? Souvent on ne sait
pas. Et la réalité, c’est le système socio-économique qui fait que… 1382 n’a pas du tout
évolué et donc n’offre aucune réponse à ce phénomène. Et en plus, apparaît aussi le (2)
chômage. Avant ça n’existait pas (le terme). Pourquoi ça devient un risque ? Car dès qu’il y
a une conjoncture économique, on peut licencier les ouvriers. On est mis à la porte et
c’est tout. L’industrialisation génère ces deux nouveaux risques de l’existence.
Parallèlement, il y a d’autres risques qui prennent une dimension nouvelle. Ainsi, la
maladie, la vieillesse et la charge d’enfants. Ce n’est pas nouveau, évidemment, mais le
contexte d’alors fait que ça a des conséquences différentes. En cas de maladie ou de
vieillesse, on ne pourra plus faire appel aux solidarités communautaires ! (En ville, c’est
difficile.) Car ça empêche de mettre sa force de travail en location…
Fin du XIXe siècle, la classe prolétaire est confrontée à ces cinq grands risques :
accidents du travail, chômage, maladie, vieillesse et charge d’enfants. Et bien, encore
aujourd’hui, la sécurité sociale offre en Belgique une protection pour ces mêmes risques.
À l’époque, il y avait deux possibilités et deux impasses. On pouvait d’abord faire appel à
la bienfaisance. Or, la bienfaisance, ça ne donne aucun droit. Vous recevrez ou pas, un peu
ou beaucoup, selon la volonté du donateur. Et c’est même parfois humiliant de devoir
tendre la main. Deuxième possibilité : c’est la prévoyance individuelle, qui était perçue à
l’époque comme logique dans l’imaginaire du Code civil (et du bon père de famille) : tout
un chacun doit se prémunir contre les risques d’insécurité d’existence. Bref, pas de réelles
solutions.
Et que font alors les pouvoirs politiques ? Rien. Pendant un siècle, ils n’ont rien fait. Ils
ne l’ont sans doute pas toute de suite mesurée… Mais à partir du milieu du XIXe siècle,
on savait. Pourquoi ? Car il y a eu les premières grandes enquêtes sur les conditions
ouvrières. Des médecins, des journalistes, des avocats sont descendus dans les usines et
ont répertorié et rendu compte de la misère de la classe laborieuse.

5
Pourquoi n’ont-ils rien fait, même quand ils ont pris connaissance de la chose ? Le
premier facteur est évident : (1) facteur politique, car le droit de vote était réservé aux
hommes riches. On ne voulait pas remettre en cause les avantages de la classe
bourgeoise. Ce facteur est important, dit le prof, et on insiste énormément dessus : les
classes dominantes avaient intérêt à… Un calcul cynique donc. Mais ce n’est pas la seule
raison, car à côté de cela, il y avait aussi un (2) blocage philosophique ou conceptuel. Celui qui a
mis ça en évidence c’est François Ewald, dans L’État providence (1986). Il essaye de se
replonger dans l’esprit des bourgeois de l’époque, des libéraux éclairés, etc. Ce qu’il
montre que c’est quand on fait ça, on voit qu’il y avait une conscience certaine d’un gros
problème social. Pour les libéraux, faire la charité, venir en aide aux pauvres, c’est un
devoir moral de première importance. Ce qui par contre était totalement inenvisageable,
c’était de juridiciser la bienfaisance ! On ne pouvait pas mettre de la contrainte, on ne pouvait
pas donner un droit aux démunis d’exiger de… Pourquoi ? On sort de la Révolution
française qui a mis fin au système féodal et on a consacré les droits individuels (comme la
propriété). La hantise des libéraux c’était alors de perdre les acquis de la révolution. Si
l’État descend dans l’arène et réglemente les relations économiques et sociales, le droit va
tout envahir, on va mettre à mal les libertés individuelles récemment acquises. D’où le
fait de s’être tenu à 1382 seulement. Et donc un imprévoyant ne peut s’en prendre qu’à
lui-même… Sociologiquement, les bourgeois savent bien qu’on ne peut pas reprocher aux
pauvres leurs situations ; mais juridiquement, ils ne voyaient pas de situation (car on ne
peut porter atteinte aux acquis de la révolution).
Section II
Les choses ont fini par bouger. Le verrou du dogme de la non-intervention a sauté.
Pourquoi ? Le déblocage a été politique et philosophique, comme le verrou. Le grand
déclencheur politique, ce sont les événements dramatiques de 1886 : les grèves
insurrectionnelles ! La conjoncture économique est mauvaise et les grands capitaines des
usines vont baisser drastiquement les salaires. Ajoutez à cela le chômage… C’est la goutte
d’eau qui fait déborder le vase. C’est surtout dans le Hainaut et à Liège que ça éclate. Et
ces grèves sont réprimées dans le sang par la gendarmerie et l’armée. Il y a des morts. Et
c’est là le point de basculement. À partir de là, la machine va s’enclencher, les choses sont
allées trop loin.
Léopold II prononce son discours du trône (à chaque début de l’année parlementaire) et,
en 1886, il prend le « parti » de la classe ouvrière, ou donne du moins le ton : « Peut-être
a-t-on trop compté sur le seul effet des principes, par ailleurs si féconds, de liberté. Il est
juste que la loi entoure d’une protection plus spéciale les faibles et les malheureux. » Dès
l’année suivante, le gouvernement s’exécute et les premières législations sociales sont
lancées.
Aussi, le mode de suffrage change : suffrage universel plural, où tout le monde vote, mais
la classe possédante a plus de voix. Mais les premiers élus du POB (Parti Ouvrier Belge)
font leur entrée au Parlement et vont relayer à la Chambre les revendications des
mouvements ouvriers. Ces derniers mouvements se structurent, les syndicats se
renforcent. Après la Première Guerre mondiale, c’est le suffrage universel simple : un
homme, une voix. Les choses changent complètement.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
1
/
89
100%