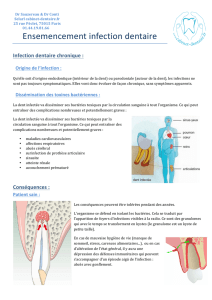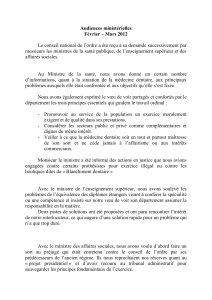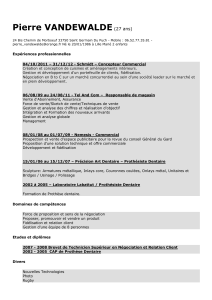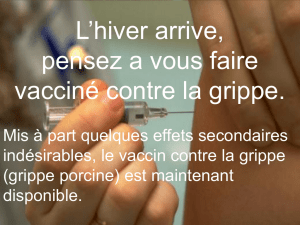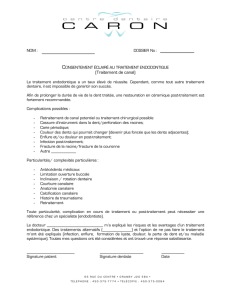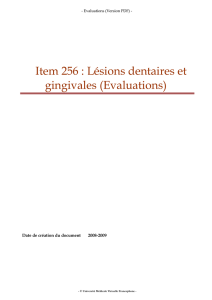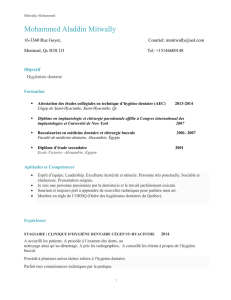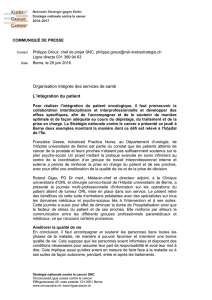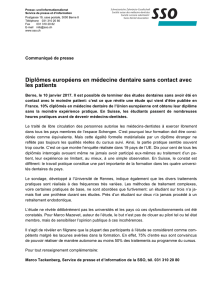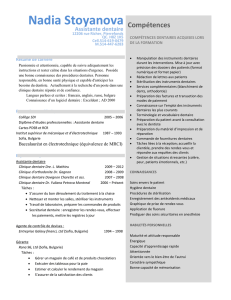La formation continue en ligne n`en est-elle qu`à ses débuts?

Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 113: 11/2003
1244
L’actualité en médecine dentaire
La formation continue en ligne n’en est-elle
qu’à ses débuts?
DrAlessandro Devigus
«64% des médecins allemands utilisent régulièrement Internet et la majeure partie d’entre eux
y recherchent des éléments de formation continue. Mais un cinquième de ces collègues tout au
plus obtient satisfaction et trouve ce qu’il recherchait.»
Près de dix ans après la déferlante d’In-
ternet, l’offre de formations continues en
ligne reste très limitée. Le corps médical
a donc beaucoup de mal à trouver, par
voie électronique, sur Internet, les infor-
mations nécessaires, dans toute leur
étendue et leur profondeur, telles qu’elles
existent sur le support papier.
Si on la compare aux supports écrits clas-
siques et aux stages de formation, la voie
électronique présente des avantages évi-
dents:
– Confort, disponibilité (dans le temps,
dans l’espace, étendue/profondeur des
informations): le médecin peut réaliser sa
formation continue, de son plein gré, à
tout moment et quel que soit l’endroit où
il se trouve.
– Environnement collectif intégré avec
accès renforcé aux informations (re-
cherches, forums, etc.): ce support per-
met la communication avec des experts
et fournit les moyens techniques pour
trouver les données recherchées.
- Vitesse d’apprentissage individuelle: les
systèmes d’apprentissage électroniques
peuvent fournir des contingents de don-
nées adaptés à chaque personne (con-
trairement aux articles des magazines,
par exemple).
– Multipliable à volonté: frais propor-
tionnels réduits, car les cours électroni-
ques, qui ont engendré des frais de déve-
loppement élevés au départ, peuvent en-
suite être exploités rentablement par l’or-
ganisateur.
– Standardisation: contrairement aux
stages de formation, les cours en ligne
peuvent être standardisés de façon plus
vaste et optimisés plus simplement,
par le biais de mesures d’assurance
qualité.
De fait, les maisons d’édition se limitent
aujourd’hui en premier lieu à utiliser une
seconde fois les contenus produits pour
la presse à l’origine, ce qui est économi-
quement avantageux. De cette façon,
l’activité principale des maisons d’édition
n’est pas mise en péril mais, dans le
meilleur des cas, discrètement élargie. Le
passé a clairement montré que la vente
d’informations médicales par voie élec-
tronique n’est que très peu lucrative. Les
projets ambitionnés pour des raisons di-
dactiques et techniques ont, en grande
partie, bénéficié de subventions publi-
ques et ne sont donc pas soumis à un
contrôle strict de la rentabilité, comme
c’est le cas dans la branche de l’édition et
de la formation.
(Extraits d’un article publié dans le journal
DERMAforum en juillet 2003 par le DrFrank
Hoffmann)
Formation continue en ligne avec
la SGcZ
Nous avons déjà attiré votre attention,
en divers endroits, sur les initiatives de
la SGcZ (Schweizerische Gesellschaft
für computerunterstützte Zahnmedizin).
Malgré les progrès continus de la «nu-
mérisation», de nombreux collègues re-
chignent toujours à participer activement
aux «sessions de formation continue en
ligne».
Ainsi, nous avons décidé de donner une
nouvelle impulsion à la formation conti-
nue. Pour ce faire, nous misons sur un
nouveau logiciel, spécialement dévelop-
pé par la société solutionpark.ch pour et
en collaboration avec l’Institut Supérieur
de Technologie (ETH) de Zurich. A partir
de cette base, une nouvelle plateforme de
formation va être créée. Le logiciel de
production PLAY (streaming) permet de
publier immédiatement les présentations
et les exposés.
En tant que solution client-serveur basée
sur le web, le logiciel PLAY permet de
diffuser des exposés et des présentations
orales en direct sur Internet, puis de les
proposer, sans aucun travail supplémen-
taire, sous la forme d’un enregistrement
(vidéo sur demande). Il suffit d’appuyer
sur un bouton pour préparer automati-
quement, transmettre en direct, retra-
vailler et archiver les données. Le logiciel
PLAY supporte simultanément et avec
différents niveaux de qualité les formats
MPEG4, Real, QuickTime et Windows-
Media – sous la forme d’un programme
radio avec diapositives synchronisées
pour une connexion Internet lente; avec
video-stream haute résolution pour une
connexion large bande.
Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur le logiciel «Play» sur les sites:
http://www.play.ethz.ch/ et
http://www.speaknplay.ch/
Les premiers «cours pilote» seront acces-
sibles gratuitement. Ensuite, l’offre sera
proposée aux membres de la SGcZ à des
conditions spéciales. Les autres collègues
sont également invités à venir profiter de
cette offre intéressante.
Nous espérons avoir le plaisir de vous ac-
cueillir à l’un de nos prochains événe-
ments.Vous trouverez davantage d’infor-
mations et une démonstration en ligne à
l’adresse http://www.dentist.ch ■
Vue d’un événement en ligne sur l’écran
de l’internante
Vue d’un événement en ligne sur l’écran
de l’internante
Vue d’ensemble du déroulement tech-
nique d’un événement en ligne

L’actualité en médecine dentaire
Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 113: 11/2003 1247
De tout temps les médecins ont cherché
à supprimer la douleur et il a fallu at-
tendre jusqu’au milieu du siècle dernier
pour obtenir un résultat dont nous béné-
ficions tous – patients et soignants –
maintenant.
Je vous dirai rapidement quelles tenta-
tives furent faites dans ce domaine avant
d’arriver à la prodigieuse découverte du
siècle dernier. Depuis la plus haute Anti-
quité, les médecins cherchaient le moyen
de supprimer – ou tout au moins de di-
minuer – la douleur. La légende et l’his-
toire racontent ces nombreuses tenta-
tives, toutes empreintes d’un espoir fou.
Puis la nuit se fait de nouveau jusqu’à
l’apparition d’un nouveau chercheur et
d’un nouveau moyen qui tombe à son
tour dans l’oubli. Et les hommes conti-
nuent à souffrir et à espérer, tandis que
certains croient qu’il est criminel de vou-
loir supprimer la douleur; que c’est une
atteinte aux prérogatives du Créateur;
que c’est se mettre en travers des des-
seins de la Providence; que c’est contre-
carrer l’ordre naturel de la Création.
D’autres pensent que la douleur est thé-
rapeutique en soi, et ce n’est certaine-
ment pas cette théorie qui risquait de fai-
re avancer les recherches. Alors qu’en
Orient les médecins essayaient déjà des
narcoses au moyen de l’opium au IIIe
siècle avant Jésus-Christ, pour faciliter les
trépanations, en Europe on tâtonnait ti-
midement. Et bien plus tard encore les
médecins n’étaient pas délivrés de la
crainte d’être accusés de sorcellerie, car
c’était une charge qui coûtait cher à celui
qui en était la victime.
Les expériences d’un barbier
téméraire soulèvent un tollé général
Lorsqu’au XVIIIesiècle, le barbier-chirur-
gien Bailly de Troyes essaya d’endormir
ses patients avec des sucs végétaux avant
d’opérer, cette innovation périlleuse pro-
voqua l’indignation générale. Guy Patin, le
célèbre professeur de l’Université de Paris
fulmina contre le barbier téméraire et
adressa aux médecins de Troyes une lettre
de protestation dans laquelle il disait:
«... Si votre médecin emploie des plantes nar-
cotiques, cela lui portera malheur. Ce poison a
déjà abusé de plus habiles que lui. Prenez gar-
de! Empêchez-le de se livrer à ses pratiques
dangereuses et ne lui pardonnez pas. Ce systè-
me n’a encore accompli aucun miracle.»
Et pourtant, près de 500 ans auparavant,
un fameux médecin, Raymon Lulle, le
«doctor illuminatus» avait découvert un
liquide blanc qu’il appela le «vitriol doux»
et qui n’était rien d’autre que l’éther!
Mais sa découverte sombra dans l’oubli,
jusqu’au début du XVIesiècle où un fa-
meux alchimiste et médecin suisse, Para-
celsus, allait redécouvrir le vitriol doux
qu’il appela à son tour «l’eau blanche» et
qu’il expérimenta lui-même sur des pou-
lets qu’il anesthésia. Il put ainsi recom-
mander l’emploi de l’eau blanche dans
les maladies douloureuses; il fabriqua
aussi du laudanum, calmant à base
d’opium. Mais ses découvertes disparu-
rent aussi avec lui.
Un étrange liquide nommé
«vitriol doux»
Un siècle plus tard, Isaac Newton et les
chimistes Godfrey et Boyle firent de nou-
veau allusion à l’existence du vitriol doux
en vantant ses qualités médicinales; mais
de nouveau cet étrange liquide disparaît
pour réapparaître cette fois à la fin du
XVIIIesiècle où l’allemand Frobenius lui
donne le nom d’«éther». L’éther fait alors
une brillante carrière jusqu’à nos jours.
La Renaissance qui avait révolutionné le
monde européen dans les arts et dans les
lettres devait aussi donner une nouvelle
impulsion à la science et à la recherche
scientifique. Jusque là, il faut le recon-
naître, la foi seule servait d’anesthésiant,
et dans la plupart des cas, on ne s’en
étonnera guère, cela restait insuffisant.
Aussi le résultat le plus clair, c’est la per-
sistance de la douleur que n’ont pu gué-
rir et soulager ni la foi, ni les herbes, ni les
panacées médiévales qu’elles qu’en ait
été leur composition.
Les succès du «Vitalisme
guérisseur»...
C’est pourquoi, devant l’écrasante tâche
de soulager la douleur, il se trouva enco-
re des hommes pour recourir au sortilè-
ge. Et l’on vit alors surgir le «Vitalisme
guérisseur». Son fondateur, Franz Anton
Mesmer (1733–1813), prétendait que
A propos du centenaire de l’anesthésie
(1846–1946)*
Roger Joris, Genève
Transcription, adaptation et illustrations de Thomas Vauthier
Il nous est difficile maintenant d’imaginer ce temps où toute intervention chirurgicale était
une source de douleurs considérables – et même mortelles. Représentez-vous ce que devait être
une amputation d’un membre il y a un peu plus de cent ans, une laparotomie, une trépana-
tion, une réduction de fracture ou même une extraction de dent. Pendant des milliers d’années
les hommes ont supporté les pires souffrances; pendant des milliers d’années ils ne pouvaient
espérer qu’une bienheureuse syncope pour abréger un peu la douleur. Cela nous paraît terri-
fiant et inconcevable, et cela ne nous émeut qu’à moitié, tant il est vrai qu’il n’est rien que l’on
supporte si bien que la douleur des autres...
CLIN D’ŒIL DU PASSÉ
Mesmer n’ayant jamais voulu entrer
dans la description de ses procédés,
voici comment les témoins, dont Puy-
ségur, décrivent ces séances: «Au mi-
lieu d’une grande salle, se trouve ‹l’Ins-
trument›; un véritable baquet en bon
bois de chêne, d’une hauteur de
50 cm. Et dans ce baquet, de l’eau,
dans laquelle trempe du verre pilé, de
la limaille et d’autres ingrédients en
tout genre. Sur un anneau suspendu en
dessus sont fixées des branches de fer
coudés et mobiles. Chaque malade
tient une des tiges de fer et l’applique
sur la région malade. Une corde passée
autour du corps unit les patients entre
eux. Le magnétiseur, Mesmer, vêtu
d’un habit de soie couleur lilas, passe
autour des patients en les fixant dans
les yeux, promène devant, ou sur eux,
sa baguette ou sa main avec une auto-
rité souveraine. Quel rituel sacré!» Or, à
cette époque, le baquet fit fureur dans
la haute société. Illustration: un magni-
fique exemplaire d’«instrument» de
Mesmer.
* A l’origine, ce texte a été publié en 1946.

Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 113: 11/2003
1248
L’actualité en médecine dentaire
l’Univers est parcouru par un réseau de
forces vitales, par un fluide astral guéris-
seur que certains élus peuvent capter et
infuser dans le corps malade. Cet ancien
théologien, astronome amateur, juriste
de rencontre et médecin de fortune ob-
tint un immense succès. Il posait deux ai-
mants sur le corps du malade et caressait
la région douloureuse entre les deux
pôles jusqu’à ce que le fluide guérisseur
amassé entre les deux aimants parcourût
le corps déséquilibré et le réintégrât dans
l’harmonie du Cosmos.
Sa popularité augmentant avec le
nombre de malades qui venaient lui de-
mander le secours de son savoir, Mesmer
magnétisa alors des bassins, des arbres,
des pelouses, des parcs et même des fo-
rêts entières. Il transféra même son fluide
aux miroirs ce qui permettait aux ma-
lades de guérir en se regardant! Il alla
plus loin encore puisqu’il magnétisa des
instruments de musique, de sorte que les
sons qui en sortaient étaient magnétisés
et donc guérisseurs. Mais l’Académie se
refusa à accepter les travaux de Mesmer,
et celui-ci s’enfuit à Vienne lors de la Ré-
volution et vint mourir dans sa ville nata-
de Meersburg en 1813.
... et du «Somnambulisme»
Or, les expériences de Mesmer avaient
éveillé un grand intérêt dans les milieux
scientifiques et c’est ainsi qu’un disciple
de Mesmer, le Comte de Puységur dé-
couvrit alors une autre technique d’anes-
thésie, l’hypnotisme, qu’il appela Som-
nambulisme et qui connut aussi un grand
succès, car il fut utilisé par des chirur-
giens qualifiés pour leurs interventions,
en particulier Potel, Récamier et Cloquet.
Ce fut surtout à Edimbourg que la chirur-
gie somnambulique eut ses plus chauds
partisans, les chirurgiens John Elliotson
et James Esdaille. Mais la vielle querelle
entre médecins et chirurgiens se rallume
à cette nouvelle occasion, et Elliotson fut
sommé de renoncer à sa chaire de l’Uni-
versity College Hospital de Londres.
Quant à Esdaille, il s’expatria aux Indes
où son succès fut sensationnel. Sa re-
nommée ébranla les esprits en Europe et
la médecine officielle fit timidement
quelques essais – non concluants – et se
dépêcha de déclarer que le somnambu-
lisme n’était qu’une mystifications ce qui
était somme toute une conclusion un peu
téméraire.
1733: un pas de géant vers
l’anesthésie moderne
Pendant ce temps, la chimie fait des pas
de géant, et c’est d’elle que l’homme tire-
ra enfin le secret de l’anesthésie. C’est en
effet à Joseph Priestley que nous sommes
redevables de la découverte de plusieurs
corps et gaz, entre autres le «bioxyde
d’azote» (renommé depuis protoxyde,
n.d.l.r.), qui se révéla être un narcotique
puissant. Nous sommes en 1773. Priest-
ley doit fuir en Amérique au bout de
quelques années, à la suite de contro-
verses religieuses. Il y meurt en 1800.
Mais voilà que surgit un nouveau phéno-
mène de la science: Humphrey Davy, qui
à l’âge de 16 ans, après de nombreuses
expériences faites en secret, découvre les
propriétés du protoxyde d’azote, réussit à
l’isoler et à l’obtenir chimiquement pur
en partant des travaux de Berzelius et La-
place, un Suédois et un Français.
En 1841, un médecin américain, le doc-
teur Long, fait des essais concluants avec
le protoxyde d’azote, connu par la suite
sous l’appellation «gaz hilarant»; toute-
fois, devant l’hostilité de la population, il
renonça à poursuivre ses travaux.
Hormis ses textes consacrés aux ava-
tars de la médecine dentaire à travers
différentes époques, notre confrère
Roger Joris, ancien président de la
Société Suisse de l’Histoire de la Mé-
decine et de la Société Européenne de
l’Histoire de la Médecine, a également
commenté dans ses publications cer-
tains événements marquants de l’his-
toire de la médecine en général. Ainsi,
en 1946, il a rédigé le présent texte
consacré au centenaire de l’anesthé-
sie. C’est en effet le 16 octobre 1846
qu’a eu lieu à Boston la première in-
tervention chirurgicale sous narcose.
L’anesthésie locale, quant à elle, a été
introduite quelques années plus tard,
soit en 1884. Heureuse découverte,
tant il est vrai qu’il est difficile d’ima-
giner que serait notre profession sans
ce moyen thérapeutique fabuleux!
Thomas Vauthier
Dès 1844, le médecin-dentiste H. Wells
commença à travailler dans son cabinet
avec des inhalations de protoxyde
d’azote pour opérer ses patients sans
douleur. Son échec cuisant en janvier
1845 devant le chirurgien Warren au
Massachusetts General Hospital fait ré-
fléchir le jeune chirurgien dentiste Mor-
ton William Green qui oriente aussitôt
ses recherches vers l’éther. Associé au
chimiste Jackson, il travaille sur les
principes anesthésiants de l’éther sul-
furique. Le 16 octobre 1846, Warren,
assisté par Morton, pratique l’ablation
d’une tumeur du maxillaire, sans que le
patient ne ressente aucune douleur. Il
s’agissait de la première démonstration
publique d’une opération sous anes-
thésie. Illustration: Morton (au centre)
lors d’une démonstration de narcose
selon sa méthode.
Les dernières années ont vu évoluer les
systèmes d’injection pour l’anesthésie
dentaire. L’injection contrôlée électro-
niquement permet de remplacer l’in-
jection manuelle traditionnelle. Cette
évolution concerne également la pré-
hension du support de l’aiguille. En ef-
fet, la seringue classique nécessitait de
la part du praticien le contrôle simulta-
né de 2 gestes (pénétration de l’ai-
guille dans la muqueuse et injection).
Désormais, le praticien doit seulement
contrôler la pénétration de l’aiguille.
Ce contrôle, grâce à la prise dite «sty-
lo» du support de l’aiguille permet de
bons points d’appui. De plus, ces sys-
tèmes réalisent une injection douce et
progressive contrôlée électronique-
ment. Illustration: système «The Wand»
(= baguette magique) de Milestone
Scientific.

L’actualité en médecine dentaire
Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 113: 11/2003 1249
Et – enfin – les premières opérations
sous narcose
Et maintenant, nous approchons du but
recherché depuis tant de siècles. En 1844,
le dentiste américain H. Wells fait des ex-
périences avec le N2O sur lui-même et
sur ses patients. Or, par manque de mé-
thode, lorsqu’il veut présenter sa métho-
de au corps médical de Boston (dont fait
partie le fameux chirurgien Warren), sa
tentative se solde par un échec. Il aban-
donne alors ses travaux et ses expérien-
ces. Mais un autre dentiste américain,
Thomas Green Morton, reprend les tra-
vaux abandonnés par Wells. Devant l’échec
cuisant de Wells, il oriente cependant ses
recherches vers l’éther et construit alors
un inhalateur pour l’administration du
gaz. Enfin le but est atteint et le 16 oc-
tobre 1846 a lieu la première opération
sous narcose au General Hospital de
Massachusetts à Boston. C’est Morton
qui fait la narcose à l’éther, tandis que le
DrJohn Collins Warren pratique l’inter-
vention. A peine 15 jours plus tard, on
pratique dans ce même hôpital une am-
putation sous narcose. Et le 21 novembre,
le poète-médecin Oliver Wendel Holmes
donne à l’invention de Morton son nom
définitif: l’anesthésie.
C’est le 21 décembre de la même année
que la première opération sous narcose
est pratiquée en Europe par le DrListon à
Londres. En janvier 1847, des opérations
sont pratiquées en France et en Alle-
magne.
Enfin, en 1884, le DrKoller, collaborateur
du grand Sigmund Freud, fait à son tour
une découverte d’importance, puisqu’il
découvre le procédé de l’anesthésie lo-
cale. Nous sommes ainsi au bout du
cycle, nous pouvons dire désormais que
l’homme a enfin vaincu la douleur chi-
rurgicale. ■
Université de Berne
Interview du Professeur
Sabine Ruf
DrGiovanni Grossen
Depuis 1 an maintenant, vous occupez les fonctions de Directrice de la Clinique d’orthodontie
de Berne. Pour les conseillères fédérales, on tire généralement un premier bilan au terme de
100 jours de mandat. En médecine, le bilan se fait «un an après».
A présent, vous n’êtes plus une inconnue à Berne. L’objet de cette interview est de vous faire
connaître à la Société suisse d’Odonto-stomatologie. Je suis personnellement très heureux que
la rédaction de la Revue mensuelle suisse d’odonto-stomatologie m’ait prié de réaliser cette
interview avec vous.
Vous êtes la plus jeune Directrice de clinique
de la faculté de médecine de Berne. Racontez-
nous comment vous vous êtes retrouvée dans
cette ville.
Je suis née le 11.6.1967 à Wolfsburg, je
suis une enfant «Volkswagen» (elle rit).
En 1976, une mission importante a été
confiée à mon père dans les usines VW
de Puebla. Je suis donc partie avec ma fa-
mille au Mexique et ce pays est devenu
ma deuxième patrie.
En 1982, je suis rentrée en Allemagne et
j’ai séjourné un an en internat à Braun-
schweig.
Après avoir passé le baccalauréat à Wolfs-
burg en 1986, j’ai commencé mes études
de médecine dentaire à Giessen. L’année
1991 a été celle du Diplôme d’état.
En 1992, j’ai débuté ma formation en or-
thodontie. La promotion au grade de Dr
méd. dent. s’est déroulée en 1994. Un an
plus tard, j’ai acquis mon titre de médecin
spécialisé.
L’année 2001 a été celle de mon habilita-
tion.
En juin 2001, j’ai été nommée à Berne.
Parallèlement, j’avais posé ma candidatu-
re à Homburg/Sarre et à Cologne.
En définitive, j’ai opté pour diverses rai-
sons pour Berne. Mon activité à la cli-
nique a débuté le 1.9. 2002.
Vous êtes arrivée en tant que «capitaine»
dans une équipe dont les membres tra-
vaillaient ensemble depuis longtemps déjà.
Comment avez-vous été accueillie?
Je me souviens très bien de ma premiè-
re journée à la clinique. Les collabora-
trices et collaborateurs avaient préparé
un brunch en l’honneur de mon arrivée.
J’ai été accueillie de manière très cor-
diale. Les Directeurs des autres clini-
ques sont venus et m’ont souhaité la
bienvenue avec des fleurs. C’était un ac-
cueil que l’on ne peut guère s’imaginer
en Allemagne.
Quelles étaient vos attentes lors de votre
arrivée?
Les jeunes femmes sont soumises à une
très forte pression en termes de perfor-
mance, c’est un véritable handicap. On
attend beaucoup de nous. C’est un fait,
les femmes sont aujourd’hui encore ju-
gées de manière plus critique que leurs
collègues masculins. Mais je pense avoir
surmonté ce premier obstacle.
Je savais que la réorganisation de la cli-
nique constituerait une tâche importante
pour moi. C’est un travail qui exige un in-
vestissement énorme en temps et laisse
peu de place à d’autres projets.
Venant d’Allemagne, je ne me doutais
pas de la complexité du système des as-
surances en Suisse qui est nettement
plus compliqué et plus vaste qu’en Alle-
magne.
Lesquelles de vos attentes se sont-elles réali-
sées?
Pour l’essentiel, j’ai réussi à organiser la
clinique selon mes conceptions. Cette ré-
organisation a demandé beaucoup plus de
temps que je ne l’avais pensé au départ.
Lesquelles ne se sont pas réalisées?
La recherche, à laquelle je m’étais adon-
née de manière très intensive à Giessen,
ne trouve pas vraiment son compte dans
mes activités.
Quels sont vos projets pour l’avenir proche?
Je souhaite intensifier à nouveau la re-
cherche qui m’est essentielle. Une Direc-
trice de clinique se doit, parallèlement à
la formation, de faire de la recherche.
Dans ma clinique, les assistantes et assis-
tants ont pour objectif d’acquérir une for-
mation de spécialiste. Les exigences re-
quises pour l’acquisition d’un titre de
spécialiste sont très élevées en Suisse, de
sorte qu’à l’avenir, une part essentielle de
mes activités sera consacrée à l’élabora-
tion d’un programme de spécialisation
propre à notre établissement.

Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 113: 11/2003
1250
L’actualité en médecine dentaire
L’optimisation de la formation des étu-
diants me tient par ailleurs beaucoup à
cœur.
Quels sont les grands axes de votre travail de
recherche?
En collaboration avec mon ancien chef,
j’ai mené des recherches centrées sur le
traitement de la classe II (protusion). A
Giessen, nous nous sommes consacrés
de manière très intensive à l’appareil de
Herbst (encore) peu utilisé en Suisse.
Par ailleurs, je m’intéresse de très près au
thème de l’articulation temporo-maxil-
laire. Ces deux secteurs de recherche ont
également constitué le contenu de ma
thèse d’habilitation:
«Influence de l’appareil de Herbst sur la
croissance et le fonctionnement de l’ar-
ticulation temporo-maxillaire». Il s’agit
d’une étude clinique, par imagerie par ré-
sonance magnétique et céphalométrique.
A Berne, nous avons des projets com-
muns avec la division de pédodontie ain-
si qu’avec la Clinique de parodontologie
et de prothèses fixes.
Où en est la collaboration avec les autres cli-
niques d’orthodontie de Suisse/d’Europe?
Des contacts approfondis existent déjà
entre les cliniques suisses.
Avec Genève (Prof. Stavros Kiliaridis),
nous essayons de mettre au point un pro-
gramme commun de formation de base
pour les nouvelles assistantes et les nou-
veaux assistants.
Toutes les cliniques réunies souhaitent
mettre à profit les ressources dont elles
disposent pour optimiser la formation.
Pour des raisons de personnel et de fi-
nancement, il serait souhaitable que les
quatre cliniques d’orthodontie se sou-
tiennent mutuellement dans le domaine
de la formation. Ceci signifierait que les
assistantes et les assistants pourraient
avoir accès aux autres universités. Nous
souhaitons ainsi promouvoir l’esprit
d’équipe entre les quatre universités. De
surcroît, cette démarche aurait sans au-
cun doute pour effet d’élever la qualité de
la formation.
Je souhaite également promouvoir les
contacts avec les cliniques d’orthodontie
à l’étranger. Pour la recherche et l’ensei-
gnement, il est très important d’entrete-
nir de bons contacts par delà les fron-
tières. L’échange de savoir et d’expé-
riences fait également progresser la
qualité de la formation ainsi que celle de
l’exercice de la profession de médecin-
dentiste spécialisé.
Mes contacts avec l’université de Giessen
(Prof. H. Pancherz) demeurent très inten-
ses. Actuellement, j’y encadre encore 10
candidats au doctorat. Des études sont
en cours, en collaboration avec mon pro-
fesseur.
Nous avons également des projets com-
muns avec les universités de Hong-Kong
(Honorary Assistent Professor), de Dresde
et de Freiburg i.B.
Où en est la collaboration avec les cliniques
de l’Université de Berne?
En ce moment, nous essayons d’intensi-
fier la collaboration avec la division de
pédodontie (Prof. A. Lussi). Pour la for-
mation de base et postgraduée, les « me-
sures interceptives » constituent un thè-
me essentiel. Avec les autres cliniques,
notre objectif est d’approfondir en com-
mun les thèmes interdisciplinaires. En
traumatologie dentaire, nous avons un
projet de consultation commune avec la
clinique de chirurgie orale (Prof. DrD.
Buser, PD Th.Von Arx).
Avez-vous un souhait particulier en qualité
de Directrice de clinique?
Pour me décharger de certaines tâches,
j’aurais besoin d’avoir à mes côtés, à long
terme, une première assistante ou un pre-
mier assistant qui travaille à 100% dans la
clinique. J’ai conscience que ce n’est pas
facile, les conditions financières en cabi-
net privé étant nettement meilleures que
celles existant en clinique.
Je souhaiterais par ailleurs déléguer une
partie de mes responsabilités.
En résumé, j’aurais – ou plutôt j’ai – be-
soin d’un bras droit.
Souhaitez-vous ajouter quelque chose con-
cernant votre vie personnelle?
Je me sens bien à Berne. Je partage ma vie
avec deux perroquets, Peter et Paul.
En ce moment, j’ai trop peu de loisirs du
fait de mon travail très prenant à la cli-
nique.
Mon passe-temps préféré est de voyager.
Je suis une fan du trekking. J’ai déjà par-
ticipé à des trekkings en Nouvelle-Zé-
lande, sur les îles Galapagos et récem-
ment en Namibie. La proximité de la na-
ture ne cesse de me fasciner.
Je suis également une skieuse passion-
née et je me réjouis bien entendu d’avoir
les pistes de ski pratiquement devant ma
porte. ■
Les chiffres et faits suivants témoignent de l’activité intense du Prof. S. Ruf en tant
que scientifique.
Madame Ruf possède déjà une liste considérable de publications. Pas moins de
32 publications dont elle est la première auteur sont en effet déjà parues dans des
revues nationales et internationales.
A la date d’aujourd’hui, 30 abstracts ont également été publiés.Trois grands prix de
la recherche ont été décernés au Prof. S. Ruf:
– «W.J.B. Houston Research Award» de l’European Orthodontic Society (1997),
– «Sixth S.I.D.O. World Award» de l’Italian Orthodontic Society (1997),
– «Best Poster Award» de l’European Orthodontic Society – Co-auteur (2001).
Le prof. S. Ruf a par ailleurs déjà tenu quelque 30 exposés scientifiques à l’occasion
de congrès et de rencontres en Europe et outre-mer.
Congrès commun de la Société suisse de chirurgie orale et
de stomatologie (SSOS) et de la Société suisse de radiologie
dento-maxillo-faciale (SGDMFR)
Lugano, les 30.4. et 1. 5. 2004
Concours de communications scientifiques pour assistants en formation
Ce congrès mettant nos deux sociétés en commun permettra à tous les assistants en
formation de présenter une communication scientifique. Celle-ci sera limitée à 10 mi-
nutes et devra intégrer le thème du congrès: «Le diagnostic clinique et radiologique en
chirurgie orale».Chaque exposé sera suivi d’une brève discussion. Le résumé (abstract)
doit être rédigé selon les normes IADR (objectifs, matériels et méthodes, résultats,
conclusion) et adressé par courrier électronique au secrétariat de la SSOS.
Une somme de 1000 Sfr. récompensera la meilleure présentation. Tous les partici-
pants admis au concours seront invités au congrès.
E-mail: [email protected] Mot-clé: «Lugano 2004»
PD DrThomas von Arx DrKarl Dula
secrétaire SSOS président SGDMFR
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%