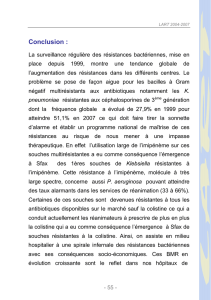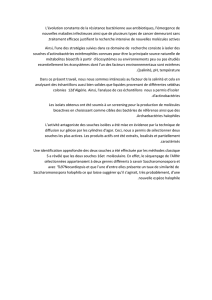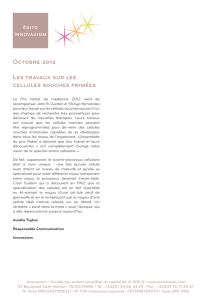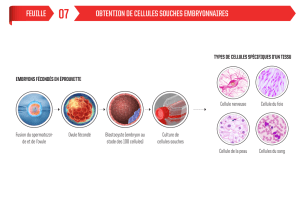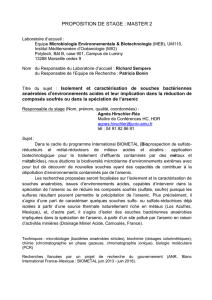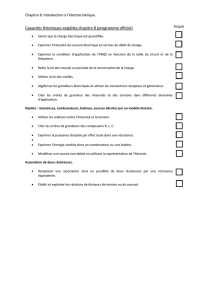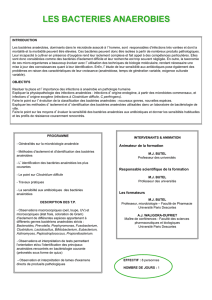See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/328113222
Bactéries anaérobies et résistances aux antibiotiques
ArticleinRevue Francophone des Laboratoires · September 2018
DOI: 10.1016/S1773-035X(18)30256-9
CITATIONS
0
READS
329
6 authors, including:
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
MOLTRAQ: Molecular tracing of viral diseases in aquaculture View project
Cysteine proteases View project
Rémy Froissart
French National Centre for Scientific Research
65 PUBLICATIONS967 CITATIONS
SEE PROFILE
Anne-Laure Bañuls
Institute of Research for Development
212 PUBLICATIONS5,174 CITATIONS
SEE PROFILE
Godreuil Sylvain
Institute of Research for Development
154 PUBLICATIONS1,378 CITATIONS
SEE PROFILE
All content following this page was uploaded by Anne-Laure Bañuls on 14 March 2019.
The user has requested enhancement of the downloaded file.

Dossier scientifique
RÉSUMÉ
Le terme « bactéries anaérobies » recouvre de nombreuses
espèces phylogénétiquement très différentes. Ainsi, si on retrouve
quelques résistances naturelles communes, chaque espèce pré-
sente des résistances naturelles et une épidémiologie de la résis-
tance différente qu’il faut connaître pour orienter les médecins
vers des antibiothérapies efficaces. Les résistances acquises
peuvent toucher la majorité des molécules utilisées dans les infec-
tions à anaérobies, même si dans la majorité des cas les souches
restent fréquemment sensibles aux associations pénicilline inhibi-
teur de béta-lactamase (et notamment à la pipéracilline tazobac-
tam), aux carbapénèmes et au métronidazole. Cependant, la mise
en évidence de souches multirésistantes parmi les Bacteroides du
groupe fragilis, très fréquemment impliqué dans les infections, les
échecs cliniques associés à ces souches, et l’évolution des résis-
tances pour certains antibiotiques, montre que, comme pour les
entérobactéries au cours des dernières décennies, la situation est
en train de changer. Il est donc essentiel de tester la sensibilité des
souches isolées dans les situations cliniques critiques et pour les
espèces les plus pourvoyeuses de résistance. Pour les souches les
plus résistantes, l’utilisation d’autres classes antibiotiques (oxazo-
lidinones, nouvelles cyclines) devra alors être envisagée.
ABSTRACT
Anaerobic bacteria and antibiotic resistances
The term “anaerobic bacteria” covers many phylogenetically very different species.
Thus, if we nd some common natural resistance, each species has natural resis-
tance and epidemiology of the different resistance that must be known to guide
physicians to effective antibiotic therapy. The resistances acquired can affect most of
the molecules used in anaerobic infections, although in most cases the strains are
frequently sensitive to penicillin-beta-lactamase inhibitor associations (and especially
piperacillin tazobactam), carbapenems and metronidazole. However, the demonstra-
tion of multiresistant strains among the Bacteroides of the fragilis group, which is very
frequently involved in infections, the clinical failures associated with these strains, and
the evolution of resistance for certain antibiotics, shows that, as for enterobacteria-
ceae during in recent decades, the situation is changing. It is therefore essential to
test the susceptibility of isolated strains in critical clinical situations and for the most
resistant species. For the most resistant strains, the use of other antibiotic classes
(oxazolidinones, new cyclins) should then be considered.
© 2018 – Elsevier Masson SAS
Tous droits réservés.
Bactéries anaérobies
et résistances aux antibiotiques
Yann Dumont1,2,*, Remy Froissart2, Anne-Laure Bañuls2, Lucas Bonzon1, Hélène Jean-Pierre1,
Sylvain Godreuil1,2
1 Hôpital Arnaud de Villeneuve, CHU de Montpellier, Laboratoire de bactériologie, Université de Montpellier, Montpellier, 191 Avenue du
Doyen Gaston Giraud, 34295 Montpellier Cedex 5, France.
2 UMR MIVEGEC IRD-CNRS-Université de Montpellier, IRD, Montpellier, France.
*Auteur correspondant : y-dumont@chu-montpellier.fr (Y. Dumont).
MOTS CLÉS
◗ antibiotiques
◗ bactéries anaérobies
◗ épidémiologie
◗ Europe
◗ résistance
KEY WORDS
◗ anaerobic bacteria
◗ antibiotics
◗ epidemiology
◗ Europe
◗ resistance
© DR KARI LOUNATMAA/SPL/PHANIE
57
REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES • N° 505 • SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES • N° 505 • SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018
Introduction
Comme toutes les bactéries, les bactéries anaérobies
sont sujettes à des résistances aux antibiotiques. Si elles
ne sont pas comparables aux bactéries hautement résis-
tantes émergentes (BHRe) comme les entérocoques
résistants aux glycopeptides ou les entérobactéries
résistantes aux carbapénèmes, les bactéries anaérobies
peuvent exprimer de nombreuses résistances, naturelles
ou acquises. Si elles sont bien connues et maîtrisées
pour certains genres, avec des seuils critiques de CMI
et des fréquences de sensibilité concordantes dans la
littérature, on ne connaît pour d’autres espèces que des
répartitions de concentrations minimales inhibitrices
(CMI), sans bien connaître la corrélation qu’il peut y
avoir entre ces CMI et la probabilité d’un échec clinique.
Par conséquent, seules des valeurs critiques communes
à l’ensemble des anaérobies (cas du référentiel CASFM)
ou séparés en aérobie à Gram positif ou négatif (cas
des seuils de l’Eucast) ne sont donnés, accompagnées
de quelques règles d’expertises. L’objectif de ce chapitre
est de décrire les résistances observées chez les bacté-
ries anaérobies et leurs mécanismes, illustrées par les
données récentes de la littérature Européenne quant
à leurs incidences.
Résistances naturelles
Le référentiel du Comité de l’antibiogramme de la
société française de microbiologie liste quatre résistances
naturelles chez les bactéries anaérobies : les aminosides,
l’aztréonam (exception faite des Fusobacterium), le tri-
méthoprime et les quinolones. Il est cependant à noter
que, les bactéries anaérobies n’appartenant pas à une
entité phylogénétique unique et ces résultats ayant prin-
cipalement été mis en évidence chez les Bacteroides et
les Clostridium, des exceptions pourraient être trouvées.
La résistance aux aminosides est directement due au
métabolisme des bactéries anaérobies. Si les ribosomes
d’espèces anaérobies sont bien sensibles à ces molé-
cules, ces dernières nécessitent un transport actif à tra-
vers la membrane pour rejoindre leurs cibles. Or, du fait
des différences métaboliques spéciques aux bactéries
anaérobies, ce transport actif est absent (Clostridium
perfringens) ou décient (Bacteroides fragilis) chez les
bactéries anaérobies, expliquant l’absence d’activité
de cette famille d’antibiotique [1]. Cependant, comme
pour les streptocoques, une activité synergique de la
gentamicine avec la pénicilline, la clindamycine et, plus
rarement, le métronidazole chez certaines souches de
Prevotella et de Porphyromonas a pu être observée in
vivo et chez l’animal [2]. Cette activité est toutefois à
relativiser, la baisse de pH fréquemment constatée loca-
lement lors d’une infection étant un autre mécanisme
limitant l’action de ces molécules.
La résistance à l’aztréonam est quant à elle due à la
faible afnité de cette molécule pour les protéines liant
la pénicilline (PLP) des bactéries anaérobies, notam-
ment celles des PLP 1 et 3, responsable de l’activité de
cette molécule chez les bactéries à Gram négatif [3].
La résistance au triméthoprime provient d’une forte
activité dihydrofolate réductase des bactéries anaé-
robies, provoquant une hausse de CMI pouvant aller
jusqu’au centuple comparée à Escherichia coli [4].
L’activité synergique du triméthoprime avec le sulfa-
methoxazole est toutefois conservée chez une partie
des souches [5].
Enn, une grande partie des uoroquinolones pos-
sède une faible activité sur les bactéries anaérobies,
dont l’ofloxacine, la ciprofloxacine et la lévofloxa-
cine. Il existe cependant des uoroquinolones ayant
une forte activité contre les bactéries anaérobies [6].
Parmi celles-ci, seule la moxioxacine est actuellement
disponible en France, mais des résistances acquises
peuvent être rencontrées.
Bactéries à Gram négatives
Genre
Bacteroides
Le genre Bacteroides, et notamment le groupe Bacte-
roides du groupe fragilis, est le plus grand porteur de
résistance chez les anaérobies. Ces bactéries étant
fréquemment rencontrées en pratique clinique (infec-
tions intra-abdominales ou gynécologiques), leurs
résistances naturelles et leurs résistances acquises les
plus fréquentes doivent régulièrement être prises en
compte dans les antibiothérapies probabilistes. Ces
espèces sont naturellement résistantes aux aminopé-
nicillines, au céfamandole, au céfuroxime et à la céfa-
lotine, ainsi qu’à la fosfomycine, aux glycopeptides et
aux polymyxines (colistine et polymyxine B). La pré-
sence d’une pénicillinase naturelle (CepA) est asso-
ciée à la résistance aux aminopénicillines. Cette péni-
cillinase n’est cependant pas présente ou exprimée
chez toutes les souches, et certaines souches peuvent
donc avoir des concentrations minimales inhibitrices
(CMI) sensibles [7]. La sensibilité des Bacteroides aux
céphalosporines de 3e génération est considérée
comme médiocre, et tout résultat sensible doit être
considéré comme intermédiaire (CASFM 2013, encore
valable pour l’interprétation des sensibilités chez les
bactéries anaérobies). Les antibiotiques fréquemment
sensibles sur ces espèces sont le métronidazole, les
associations pénicillines-inhibiteurs (contrairement
aux associations céphalosporines inhibiteurs, l’adjonc-
tion de ce dernier ne sufsant pas à rattraper la faible
afnité des premières pour les PLP), la céfoxitine, les
carbapénèmes, la clindamycine, la tigécycline, le métro-
nidazole, et aussi le linézolide.
De nombreux mécanismes de résistance peuvent
être retrouvés chez Bacteroides. Le principal méca-
Dossier scientifique
58 REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES • N° 505 • SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

Dossier scientifique
Les bactéries anaérobies
nisme de résistance à la céfoxitine est une diminution
de l’afnité de certaines PLP à cette molécule, mais
cette résistance peut aussi être imputable à un autre
type de béta-lactamase, CfxA, transportée par un élé-
ment génétique mobile [7,8]. La béta-lactamase de
type métalloprotéinase CA (aussi appelée ccrA) peut
être responsable d’une perte d’activité de l’ensemble
des béta-lactamines, mais de nombreuses souches
conservent une sensibilité aux carbapénèmes du fait
d’une expression variable du gène en fonction de l’in-
sertion d’un promoteur efcace en amont (élément
d’insertion notamment) [7]. Une imperméabilité de la
paroi peut être associée à chacun de ces mécanismes,
renforçant la résistance et diminuant l’effet des inhi-
biteurs [9].
De nombreux types de gènes nim ont été mis en évi-
dence chez des Bacteroides, portés soit par des plas-
mides, soit par des transposons. Ils entraînent
une diminution de la sensibilité au
métronidazole, mais d’autres méca-
nismes de résistance non-trans-
missibles à cet antibiotique sont
aussi rencontrés[10]. Plusieurs
gènes de résistance aux macro-
lides et apparentés ont été
décrits chez Bacteroides (gènes
erm, linA, mefA, msrSA), parfois
retrouvés associés dans une
même souche, et fréquemment
responsables de résistances in
vitro [7]. Le gène tetQ est respon-
sable, quant à lui, de la majorité des
résistances à la tigécycline observées,
même si d’autres gènes ont été décrits[7].
Enn, il n’a pas encore été décrit de souche résis-
tante au linézolide, mais cet antibiotique reste peu
fréquemment testé, même dans les cas les plus
problématiques[11].
Certains taux de résistances observés en Europe
sont relativement faibles : environ 90 % des souches
sont sensibles à l’association amoxicilline acide cla-
vulanique, et aussi à l’association pipéracilline-tazo-
bactam (à l’exception notable de B. thetaiotaomi-
cron, pour lequel entre 55 % et 70 % des souches
sont sensibles) et à la céfoxitine, plus de 95 % des
souches sont sensibles au méropénème et plus de
99 % au métronidazole [12,13]. La clindamycine, à l’in-
verse, est régulièrement retrouvée résistante. Alors
que seulement 12 % des souches étaient résistantes
avant les années 1990, leur fréquence a fortement
augmenté : si moins de 22 % des B. fragilis stricto sensu
restent sensibles, les autres espèces ont un taux de
résistance avoisinant les 50 % [13]. De même, le
taux de résistance à la moxioxacine s’élève jusqu’à
13 %[12]. L’ensemble de ces résistances est en
augmentation nette depuis le début des dernières
années, surtout pour les associations pénicillines
inhibiteurs de béta-lactamase pour lesquelles moins
de 1 % des souches étaient alors résistantes [12].
Ces taux de résistance relativement faibles ne doivent
pas pour autant rassurer : de nombreuses souches mul-
tirésistantes (résistance à au moins 3 classes d’antibio-
tiques différentes) ont été décrites depuis le début des
années 2000, causant plusieurs décès. De même, un clone
portant nimB et cA en plus de plusieurs autres gènes
de résistance aux antibiotiques (tet, erm) a été récem-
ment mis en évidence dans plusieurs pays d’Europe [14].
Ce clone semble toutefois garder une sensibilité à la
tigécycline, au linézolide et, dans une moindre mesure,
à la moxioxacine.
Genre
Prevotella
Le genre Prevotella, séparé du genre Bacteroides depuis
la n des années 1980, est naturellement résis-
tant aux sulfamides, à la fosfomycine, à
l’acide fusidique, et aux glycopeptides.
Ce genre ne possède pas de pénicilli-
nase constitutive, et peut donc être
sensible aux pénicillines sans inhi-
biteurs. De nombreuses souches
sont toutefois porteuses du
gène cfxA, induisant une résis-
tance aux pénicillines mais sur
laquelle les inhibiteurs sont actifs
[15,16]. Cette béta-lactamase à
spectre étendu peut aussi induire
une résistance au céphalosporine
de 3e génération, mais elle n’est pas
active sur la cefoxitine [17]. Comme
pour le genre Bacteroides, des gènes de résis-
tances aux macrolides et apparentés (erm not-
tamment) et aux cyclines (tetQ) ont été décrits [17],
ainsi que la présence de gènes nim, et notamment le
gène nimI chez P. baroniae (qui pourrait être constitutif
chez cette espèce, mais n’est pas systématiquement
exprimé) [18].
Deux études européennes récentes, une publiée par
Ulger Toprak et al. portant sur 508 souches, et l’étude
T.E.S.T. portant sur 1 106 souches, montrent que le
genre Prevotella est fréquemment sensible aux asso-
ciations pénicilline-inhibiteur (>90 %), à la cefoxitine
(99,6 %), aux carbapénèmes (>99 %), au métronidazole
(>99 %) et à la tygécycline (100 %). La moxioxacine
reste fréquemment sensible (81,7 %) mais, à l’instar
des Bacteroides, un tiers des souches sont résistantes
à la clindamycine [13,19].
Genre
Porphyromonas
Le genre Porphyromonas, lui aussi distingué du groupe
Bacteroides depuis la n des années 1980, est naturel-
lement résistant à la fosfomycine et aux polymixines.
Peu de résistances ont été décrites en Europe chez les
différentes espèces de Porphyromonas. Seule la présence
De nombreuses
souches
multirésistantes ont
été décrites depuis le
début des années 2000,
causant plusieurs
décès
59
REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES • N° 505 • SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES • N° 505 • SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018
d’une béta-lactamase de type CfxA a été décrite [20].
Les études rapportent de très faibles taux de résistance
pour l’amoxicilline, les associations pénicilline-inhibi-
teurs, la clindamycine et le métronidazole [21]. Il faut
cependant noter que des résultats radicalement diffé-
rents ont été obtenus dans une étude Colombienne, où
des taux de résistance de 20 à 25 % ont été observés
pour l’amoxicilline, la clindamycine et surtout le métro-
nidazole [22].
Genre
Fusobacterium
Les Fusobacterium possèdent une résistance naturelle
de bas niveau aux macrolides. Deux espèces, F. varium et
F. mortiferum, possèdent de plus une résistance natu-
relle à la rifampicine. La production d’une béta-
lactamase est possible, mais reste cepen-
dant rare [21]. Très peu de résistances
ont été décrites jusqu’alors dans ce
genre[21].
Genre
Veillonella
Les espèces du genre Veillo-
nella possèdent un bas niveau
de résistance aux macrolides,
et une résistance aux glycopep-
tides. Environ 60 % des souches
sont résistantes à la pénicilline, et
40 % à l’amoxicilline [23]. Un peu
plus de 10 % des souches ont une
résistance à la tétracycline, de par l’ac-
quisition d’un gène tetM [24].
Autres bacilles à Gram
négative
Suterella wadsworthensis présente fréquemment une
résistance au métronidazole, à la pipéracilline et à
l’association pipéracilline tazobactam. L’amoxicilline
acide clavulanique, la cefoxitine et le méropénème
sont très sensibles. Un quart des souches observées
présentaient une résistance à la clindamycine [25].
Chez les souches de Campylobacter, C. gracilis peut
présenter des résistances à la pipéracilline avec et
sans tazobactam, ainsi qu’à la clindamycine et à la
tétracycline. L’espèce C. rectus apparaît souvent sen-
sible [26].
Les Desulfovibrio sont résistants à la pipéracilline
avec ou sans tazobactam, et à la céfoxitine. Cer-
taines souches sont porteuses d’une béta-lactamase
inhibable par l’acide clavulanique. L’imipenème et le
métronidazole ont une très bonne activité [27].
Enn, les Dialister restent très sensibles, même si
certaines souches présentent des sensibilités dimi-
nuées à la pipéracilline, à la rifampicine ou encore au
métronidazole [28].
Genre
Clostridium
Les Clostridia présentent des résistances naturelles aux
polymyxines et à la fosfomycine. Cependant beaucoup
d’espèces possèdent des résistances propres. C. per-
fringens est sensible à l’ensemble des béta-lactamines
(céphalosporines comprises), à l’inverse de C. difcile qui
possède une résistance naturelle aux céphalosporines
et à la céfoxitine. C. innocuum possède une résistance
de bas niveau à la vancomycine (mais pas à la teicopla-
nine) du fait d’une modication des précurseurs du
peptidoglycane [29]. Les espèces C. butyricum, C. clos-
tridiiforme et C. ramosum peuvent posséder des béta-
lactamases. Celles de C. butyricum sont sensibles aux
inhibiteurs de béta-lactamase, mais celles portées
par C. clostridiiforme et C. ramosum ne peuvent
être inactivées aux concentrations théra-
peutiques. C. tertium, enn, est résistant
à l’ensemble des béta-lactamines, au
métronidazole et à la clindamycine,
ne laissant comme seules alterna-
tives que les glycopeptides et les
oxazolidinones. Des résistances
à la clindamycine et aux cyclines
liées à des gènes erm (ermQ et B
chez C. perfringens, et ermB et Z
chez C. difcile principalement) et
tet (tetP nottamment), respective-
ment, ont été mises en évidence.
Peu d’études récentes se sont intéres-
sées aux taux de résistance des clostridia, à
l’exception de C. difcile. L’étude T.E.S.T. rapporte
chez C. perfringens des taux de sensibilité de 82 % pour
la pénicilline, 90 % pour la clindamycine, 98 % pour la
pipéracilline-tazobactam, et enn plus de 99 % pour le
métronidazole et le méropénème [13]. Wybo et al. ont
rapporté en 2014, sur une collection de souches belges,
des taux de sensibilité similaires (sans distinguer les
espèces de clostridia), ainsi que des taux à 90 % pour la
céfoxitine, 100 % pour l’amoxicilline acide clavulanique,
et 66 % pour la moxioxacine [30].
Pour l’espèce C. difcile, outre un très faible niveau de
sensibilité à la clindamycine, les souches restent très
sensibles au métronidazole et aux glycopeptides, ainsi
qu’aux carbapénèmes [31].
Genre
Actinomyces
Les bactéries du genre Actinomyces sont naturellement
résistantes au métronidazole (absence du métabolisme
ciblé), mais sont fortement sensibles aux aminopénicil-
lines. Des souches de sensibilité diminuée à la pipéra-
cilline-tazobactam ont été rencontrées chez certaines
espèces (A. europaeus, A. funkei et A. turicensis), ainsi qu’à la
ceftriaxone (A. europaeus) [32]. Le linézolide et la clinda-
mycine sont aussi très fréquemment sensibles et peuvent
donc être utiliser en alternative aux pénicillines [33].
Peu d’études récentes
se sont intéressées aux
taux de résistance des
clostridia, à l’exception
de
C. dicile
Dossier scientifique
60
 6
6
 7
7
1
/
7
100%