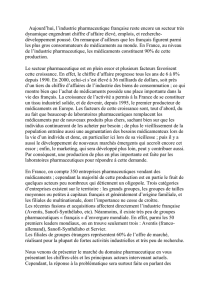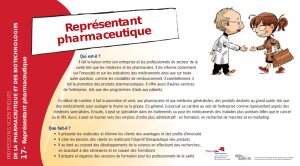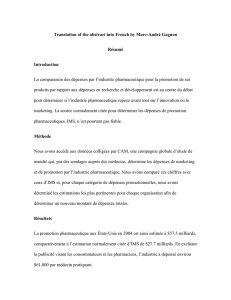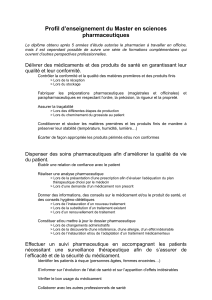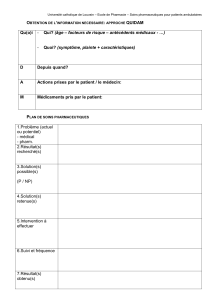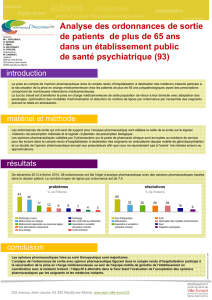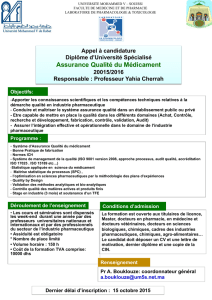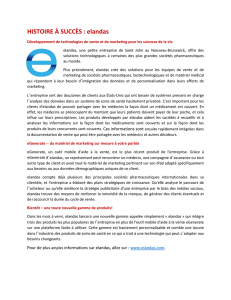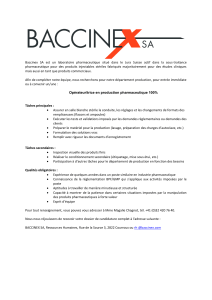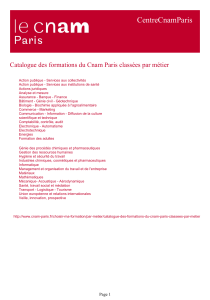I. GENERALITES 1. L’industrie pharmaceutique L’industrie pharmaceutique est, dans le monde
entier, un élément important des systèmes de santé. Elle comprend de nombreux services et
entreprises, publics ou privés, qui découvrent, mettent au point, fabriquent et commercialisent
des médicaments au service de la santé humaine et animale (Gennaro, 1990). L’industrie
pharmaceutique repose principalement sur la recherche-développement (R-D) de médicaments
destinés à prévenir ou à traiter des affections ou des troubles divers. Les différents
médicaments ont une action pharmacologique et des propriétés toxicologiques très variables
(Hardman et Limbird, 1996; Reynolds, 1989). Les progrès scientifiques et technologiques
accélèrent la découverte et la mise au point de produits pharmaceutiques plus efficaces et aux
effets secondaires réduits. Les spécialistes de biologie moléculaire et de chimie médicale et les
pharmaciens améliorent les effets des préparations médicamenteuses en augmentant leur
puissance et leur spécificité. Ces progrès suscitent néanmoins de nouvelles préoccupations
pour la sécurité et la santé des travailleurs de l’industrie considérée (Agius, 1989; Naumann et
coll., 1996; Sargent et Kirk, 1988; Teichman, Fallon et Brandt-Rauf, 1988). 3 L’industrie
pharmaceutique subit l’influence de plusieurs facteurs dynamiques de nature scientifique,
sociale ou économique. De nombreux groupes pharmaceutiques sont présents sur les marchés
nationaux et multinationaux, de sorte que leurs activités et leurs produits sont soumis aux lois,
aux règlements et aux politiques qui s’appliquent à la mise au point, à la fabrication, à
l’autorisation, au contrôle de la qualité et à la commercialisation des médicaments dans de
nombreux pays (Spilker, 1994). Les chercheurs, des institutions universitaires, de l’industrie et
des services gouvernementaux, les praticiens de la médecine et de la pharmacie ainsi que le
grand public exercent tous, à des degrés divers, une influence sur l’industrie pharmaceutique.
Les dispensateurs de soins (médecins, dentistes, infirmiers, pharmaciens et vétérinaires), qu’ils
travaillent dans un hôpital, une clinique, une pharmacie ou un cabinet privé, peuvent prescrire
des médicaments ou recommander comment les administrer. Les règlements officiels et la
politique en matière de présentations pharmaceutiques sont également influencés par les
consommateurs, des groupes de pression et des intérêts privés. Ces facteurs complexes sont
interdépendants et jouent un rôle dans la découverte, la mise au point, la fabrication, la mise
sur le marché et la vente des médicaments. L’industrie pharmaceutique a pour moteur
principal la R-D, à laquelle s’ajoutent les connaissances toxicologiques et l’expérience clinique
(voir figure 1). Il y a des différences considérables entre les grands groupes qui se livrent à de
multiples activités de R-D, de fabrication, de contrôle de la qualité et de commercialisation, et
les firmes moins importantes qui se concentrent sur un aspect particulier. La plupart des
sociétés pharmaceutiques multinationales mènent de front toutes ces activités, mais elles
peuvent aussi se spécialiser dans un domaine particulier, en fonction des données du marché
local. Les biotechnologies contribuent de plus en plus à l’innovation pharmaceutique (Swarbick
et Boylan, 1996). Des accords de collaboration sont souvent conclus entre des centres de
recherche ou des hôpitaux et de grands groupes pharmaceutiques pour explorer et tester le
potentiel de médicaments nouveaux. Figure 1 : Mise au point d'un médicament dans l'industrie
pharmaceutique De nombreux pays appliquent aux spécialités pharmaceutiques et à leurs
procédés de fabrication un système de protection juridique spécifique qui relève de la
propriété intellectuelle. Lorsque cette protection est limitée ou fait défaut, certaines sociétés
se spécialisent dans la fabrication et la commercialisation de médicaments génériques (Medical
Economics Co., 1995). L’industrie pharmaceutique doit consentir des investissements massifs
en raison des dépenses élevées liées au secteur de la R-D, aux autorisations réglementaires, à la
fabrication, à l’assurance et au contrôle de la qualité, à la commercialisation et à la vente
(Spilker, 1994). Beaucoup de pays ont des règlements très détaillés régissant la mise au point et
l’homologation des médicaments destinés à la vente et fixent des exigences rigoureuses pour
les opérations de fabrication ainsi que pour la qualité, la sécurité et l’efficacité des produits
(Gennaro, 1990). 4 Par ailleurs, le commerce national et international ainsi que les politiques et

les pratiques fiscales et financières influent sur le fonctionnement de l’industrie
pharmaceutique à l’intérieur d’un pays (Swarbick et Boylan, 1996). Les besoins en produits
pharmaceutiques sont très différents d’un pays à l’autre. Dans les pays en développement, où
prédominent la malnutrition et les maladies infectieuses, les produits les plus nécessaires sont
les compléments nutritionnels, les vitamines et les antiinfectieux. Dans les pays développés, où
les principaux problèmes de santé sont les maladies liées au vieillissement ainsi que certaines
affections spécifiques, ce sont les produits agissant sur le système cardio-vasculaire, le système
nerveux central ou l’appareil digestif, ainsi que les anti-infectieux, les antidiabétiques et les
anticancéreux qui sont le plus demandés. Les médicaments, qu’ils soient destinés à l’humain ou
à l’animal, donnent lieu à des activités de R-D et à des procédés de fabrication similaires, même
s’ils ont des avantages thérapeutiques et des mécanismes d’homologation, de distribution et
de commercialisation spécifiques (Swarbick et Boylan, 1996). Les vétérinaires administrent
couramment des vaccins, des anti-infectieux et des antiparasitaires pour lutter contre les
maladies infectieuses et parasitaires des animaux d’élevage et des animaux de compagnie.
L’agriculture moderne fait largement appel aux compléments nutritionnels, aux antibiotiques
et aux hormones pour améliorer la croissance et la santé des animaux d’élevage. Les activités
de R-D consacrées aux médicaments à usage humain ou vétérinaire sont souvent apparentées,
la nécessité de lutter contre les agents infectieux et les maladies qu’ils provoquent étant la
même dans les deux secteurs. Définitions Les termes ci-après sont fréquemment employés
dans l’industrie pharmaceutique: Agents biologiques: vaccins d’origine bactérienne ou virale,
antigènes, antitoxines et produits analogues, sérums, plasmas et autres dérivés sanguins
utilisés à des fins préventives ou curatives chez l’humain et chez l’animal. Agents diagnostiques:
produits utilisés pour aider à dépister les maladies et les troubles chez l’humain ou chez
l’animal. Il peut s’agir de produits chimiques inorganiques destinés à étudier le tractus digestif,
de produits chimiques organiques permettant de visualiser l’appareil circulatoire ou le foie, ou
encore de composés radioactifs pour étudier le fonctionnement d’un système organique.
Excipients: constituants inertes incorporés à des substances médicamenteuses dans une
présentation pharmaceutique. Les excipients peuvent influer sur la vitesse d’absorption, la
dissolution, la libération, le métabolisme et la distribution chez l’humain ou chez l’animal.
Médicaments: substances possédant des propriétés pharmacologiques actives chez l’humain et
chez l’animal. Les médicaments sont associés à d’autres produits, tels que des excipients, pour
donner des produits à usage médicamenteux. Médicaments sur ordonnance: agents
biologiques ou chimiques destinés à prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies ou des
troubles chez l’humain et chez l’animal, délivrés sur ordonnance ou avec l’autorisation d’un
médecin, d’un pharmacien ou d’un vétérinaire. Pharmacie: art et science de la préparation, du
contrôle et de la délivrance des médicaments destinés à prévenir, diagnostiquer ou traiter des
maladies ou des troubles chez l’humain et chez l’animal. Pharmacocinétique: étude du devenir
des médicaments dans l’organisme, c’est-à-dire des processus métaboliques liés à l’absorption,
la distribution, la biotransformation et l’élimination d’un médicament chez l’humain et chez
l’animal. 5 Pharmacodynamie: étude de l’action exercée par les médicaments sur l’organisme
sain, en fonction de leur structure chimique et de leur lieu d’action, et analyse de leurs
répercussions biochimiques et physiologiques chez l’humain et chez l’animal. Présentations
pharmaceutiques en vente libre: produits médicamenteux vendus dans une pharmacie ou dans
un magasin et dont la délivrance ne nécessite ni ordonnance ni autorisation d’un médecin, d’un
pharmacien ou d’un vétérinaire. Principes actifs: substances ayant un pouvoir thérapeutique.
Produits chimiques de base: principes actifs utilisés pour fabriquer des produits sous forme
pharmaceutique (galénique), des aliments pour animaux ayant des propriétés thérapeutiques,
ou encore des médicaments ne pouvant être délivrés que sur ordonnance. 2. Les produits
chimiques industriels et les substances médicamenteuses présentant des risques L’industrie
pharmaceutique découvre, met au point et utilise de nombreux agents biologiques et

chimiques (Hardman et Limbird, 1996; Reynolds, 1989). Si certains de ses procédés de
fabrication sont analogues à ceux de la biochimie et de la chimie organique de synthèse, ils s’en
distinguent cependant par leur plus grande diversité, leur échelle plus réduite et la spécificité
de leurs applications. Etant donné que l’objectif principal est la production de substances
médicinales ayant une activité pharmacologique, de nombreux produits utilisés par l’industrie
pharmaceutique dans le secteur de la R-D et dans la production comportent des risques pour
les opérateurs. Il convient donc de prendre des mesures efficaces pour assurer leur protection
contre les produits chimiques et les substances médicamenteuses utilisés dans de nombreuses
opérations dans les secteurs de la R-D, de la fabrication et du contrôle de la qualité (Bureau
international du Travail (BIT), 1983; Naumann et coll., 1996; Teichman, Fallon et Brandt-Rauf,
1988). L’industrie pharmaceutique utilise des agents biologiques (com-me les bactéries et les
virus) dans de nombreuses applications spéciales, telles que la production de vaccins, les
processus de fermentation, la préparation de dérivés sanguins et la biotechnologie. Du fait de
leurs applications particulières, les agents biologiques ne sont pas traités ici, mais de
nombreuses études leur ont été consacrées (Swarbick et Boylan, 1996). Les agents chimiques,
quant à eux, peuvent être classés en deux catégories: les produits chimiques industriels et les
substances médicamenteuses (Gennaro, 1990); il peut s’agir de matières premières, de
produits intermédiaires ou de produits finis. L’utilisation de produits chimiques industriels ou
de substances médicamenteuses en R-D, en laboratoire, dans les essais d’assurance et de
contrôle de la qualité ou dans les activités d’ingénierie et de maintenance crée des situations
particulières. Il en va de même lorsque ces produits ou substances sont des sous-produits ou
des déchets. 3. Les produits chimiques industriels Les produits chimiques industriels sont
utilisés dans le secteur de la R-D pour la mise au point de substances actives et la fabrication de
matières de base et de produits pharmaceutiques finis. Les produits organiques et minéraux
peuvent être des matières premières utilisées comme réactifs, catalyseurs ou solvants.
L’utilisation des produits chimiques industriels dépend du procédé mis en œuvre et des
opérations de fabrication. Nombre de ces produits peuvent présenter des dangers pour les
opérateurs, ce qui a conduit les gouvernements et les organismes gouvernementaux
techniques ou professionnels (American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(ACGIH), 1995) à fixer des limites d’exposition professionnelle, telles que les valeurs seuils. 4.
Les substances médicamenteuses 6 Les substances pharmacologiquement actives peuvent être
subdivisées en produits naturels et en médicaments de synthèse. Les produits naturels sont
d’origine végétale ou animale, alors que les médicaments de synthèse sont obtenus par des
techniques microbiologiques et chimiques. Les antibiotiques, les hormones stéroïdes et
peptidiques, les vitamines, les enzymes, les prostaglandines et les phéromones sont des
produits naturels importants. La recherche s’intéresse de plus en plus aux médicaments de
synthèse, compte tenu des progrès récents de la biologie moléculaire, de la biochimie, de la
pharmacologie et de l’informatique. Le tableau 79.1 donne une liste des principales catégories
de substances pharmaceutiques La pharmacie galénique associe des principes actifs à des
matières inertes pour produire des médicaments sous la forme désirée (comprimés, capsules,
gélules, solutions, suspensions, émulsions, 7 granulés, poudres, crèmes, pommades, etc.)
(Gennaro, 1990). Les médicaments peuvent être classés d’après leur procédé de fabrication et
leurs avantages thérapeutiques (Environmental Protection Agency (EPA), 1995). Ils sont
administrés aux patients selon des modalités (voie orale, parentérale, percutanée, etc.) et des
posologies strictement définies, mais les travailleurs de l’industrie pharmaceutique peuvent
également y être exposés en inhalant accidentellement des particules ou des vapeurs ou en
ingérant des boissons ou des aliments contaminés. C’est pourquoi les toxicologues et les
hygiénistes industriels ont défini des limites d’exposition professionnelle aux produits
chimiques (Naumann et coll., 1996; Sargent et Kirk, 1988). Des adjuvants ou excipients
pharmaceutiques (liants, supports, aromatisants, diluants, conservateurs, antioxydants) sont

mélangés aux principes actifs pour conférer au produit les propriétés physiques et
pharmacologiques désirées (Gennaro, 1990). De nombreux excipients ont un effet
thérapeutique nul ou limité et sont relativement inoffensifs pour les travailleurs au cours des
opérations de mise au point et de fabrication. Il s’agit des antioxydants, des agents
conservateurs, colorants et aromatisants, des diluants, des agents émulsifiants et de
suspension, des vecteurs d’onguents et des solvants pharmaceutiques. II. GESTION DES
DECHETS PHARMACEUTIQUES 1. Introduction: L’homme a toujours cherché des solutions à ses
maladies multiples en commençant par la nature pour satisfaire ses besoins, puis il a passé à
l’échelle industrielle après l’explosion démographique des derniers siècles, d’où une nouvelle
industrie est née « l’Industrie Pharmaceutique ». cette dernière a beaucoup amélioré la santé
des habitants de la terre. Mais ceci a engendré une nouvelle crise dont l’homme n’a pas
attendu, c’est la pollution, ce nouveau terme prend de plus en plus de place dans les
préoccupations des chercheurs car la nouvelle Industrie Pharmaceutique a eutralisé plusieurs
Maladies, mais les déchets de cette industrie ont donné naissance à des autres maladies qui
sont parfois plus dangereuses que les anciennes entre autres : des centaines de types de
Cancer, asthmes, des nouveaux Virus résistants aux antibiotiques 2. Les déchets
pharmaceutiques Le terme « Pharmaceutique » serre une multitude d’ingrédients actifs et de
type de préparation, aillant des infusions aux métaux lourds contenant des médicaments très
spécifiques. De ce fait, la gestion de ces déchets nécessite l’utilisation d’une approche
différenciée. Cette catégorie de déchets inclus les produits pharmaceutiques périmés ou non
utilisables pour d’autres raisons (exemple : les campagnes de retrait de produits). Les déchets
pharmaceutiques sont divisés en 3 classes. Leur traitement s’effectue d’une manière spécifique
à chaque classe : - Déchets pharmaceutiques non dangereux. -Les déchets pharmaceutiques
dangereux. -Les déchets pharmaceutiques potentiellement dangereux. 3) Les différents types
des déchets : 3. Les types déchets • les déchets Biodégradables est la décomposition de
matières organiques par des microorganismes comme les bactéries les champignons ou les
algues. La biodégradabilité est la qualité d'une substance biodégradable on a aussi les déchets
inertes qu’ils sont des déchets qui ne se 8 décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent
aucune autre réaction physique, chimique ou biologique de nature à nuire à l’environnement.
Ils ne sont pas biodégradables et ne se détériorent pas au contact d'autres matières. • le
déchet recyclable ; c’est un matériel que l'on peut techniquement recycler. Pour qu‘un déchet
soit recyclé, il faut qu'il soit récupéré dans le cadre d’une collecte de tri sélectif. Un objet
recyclable n'est donc pas forcément recyclé. • les déchets dangereux qu’il présente une ou
plusieurs des caractéristiques suivantes : explosif, comburant, inflammable, irritant, nocif,
toxique, cancérogène, infectieux, corrosif, mutagène … 4. Les déchets dangereux sont
multipliés: - Les DTQD (Déchets Toxiques en Quantités Dispersées) : Les DTQD produits en
petites quantités par les ménages, les commerçants ou les PME (petites et moyennes
entreprises) qui sont chargées de les faire éliminer ou valoriser dans les installations classées
pour la protection de l’environnement. - Les DIS (Déchets Industriels Spéciaux) : Les DIS
correspondent aux déchets produits par les entreprises ainsi que les déchets spéciaux produits
par les hôpitaux, les laboratoires et les agriculteurs. - Les DEEE (Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques) : Les DEEE sont composés de téléphones portables, de télévisions,
d’ordinateurs et de tout appareil électroménager, … - Les DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) :
Les DMS sont séparés des déchets ménagers à cause de leur caractère toxique nuisible pour
l’homme. Ils peuvent être assimilés aux DTQD car ils comprennent des produits tels que :
aérosols, acides, ammoniaque, métaux lourds, piles, les médicaments non utilisés (MNU), les
produits électroniques et électriques en fin de vie (PEEFV), les produits phytosanitaires, … 5.
L’objectif de la gestion des déchets : La gestion des déchets implique de pouvoir obtenir une
maîtrise globale du cycle de vie des produits, depuis leur production jusqu'à leur élimination.
Elle se doit de viser un double objectif : gérer de façon optimale les ressources naturelles.

rechercher systématiquement à tendre vers la nuisance “zéro”. Une politique de gestion des
déchets se traduira, dans l'ordre de priorité, par : la prévention de l'apparition du déchet. le
recyclage et la valorisation du déchet comme source de matière. la valorisation du déchet
comme source d'énergie. le traitement du déchet dans le respect intégral de
l'environnement. la réduction maximale des quantités de déchets ultimes et la réservation
exclusive de l'élimination au déchet ultime 9 6. Exemples de gestion des déchets : Les
déchets générés par SAIDAL Constantine 2 : Lors de la production certains déchets vont être
générés à savoir : -La pesée : Les déchets générés : les produits chimiques et contenant
(matière première, excipient et parfois Les articles de conditionnements) -Préparation du
mélange: Les déchets pouvant être générés lors de la préparation : - Direct : Les produits
chimiques et l’eau ou médicament - Indirecte : gaz générer lors du fonctionnement de la
chaudière et les huiles lubrifiants des autres installations (compresseur). -Filtration : Les
déchets générés lors de la filtration : Filtre et impuretés (produits chimiques ou médicament). -
Remplissage : Les déchets générés lors du remplissage : Flacon (verre), capsule (Al),
médicament (sirop). -Conditionnement: Les déchets générés lors du conditionnement : Carton,
verre, capsule, notice, étui, palette, nylon, l’eau non conforme, produits chimiques et
solvants…. Identification des différents types des déchets générés par SAIDAL Constantine 2:
Dans chaque industrie pharmaceutique et pendant la production de n’importe qu’elle
médicament on trouve plusieurs déchets, tout type de déchet classifié selon la règlementation
pour le bien gérés. Pour SAIDAL Constantine 2 spécialisé dans la production de sirop et
l’insuline, notre travail consiste à étudié les différents types de déchets générés par la
fabrication des sirops proprement dit. Au début et avant la production on doit préparer : Les
articles de conditionnements et la matière première (excipient et principe actif). Lors de la
production on trouve plusieurs déchets à savoir : -Carton (plat ou ondulé) : le carton peut être
un déchet s’il est contaminé ou défectueux donc il est non conforme. -Flacons (verre) : le flacon
peut être dangereux s’il est cassé (déversement et débris de verre). -Capsule (Aluminium) : les
capsules deviennent un déchet s’ils sont cassé ou défectueux. -Plastique (film d’emballage) :
pendant l’empaquetage le film d’emballage peut être un déchet s’il est touché par l’eau ou la
haute chaleur ou déchiré. -Notice (papier) : devient déchet s’il est non conforme. -Palette (Bois)
: devient déchet s’il est touché par l’eau ou autres. 10 -l’eau : peut-être un déchet s’il est non
conforme. -Principe Actif et excipient : peuvent être déchets s’ils sont non conformes. Lors de
la fabrication on peut trouver aussi d’autre catégorie des déchets : -gaz générés lors du
fonctionnement de la chaudière et les huiles générés par des autres appareilles
(compresseurs). -le filtre et impuretés. 7. Contrôle et gestion des effluents liquides : Concerne
la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable et l’amélioration
continue, relatif aux mécanismes d’auto surveillance et d’auto contrôle de l’environnement.
Mode opératoire : L’assistant délégué de l’environnement est responsable de suivi du
procédés de contrôle et gestion des effluents liquides, qui se manifeste par plusieurs actions
dont : identifier les différents points des rejets des effluents liquides de l’usine. Prendre
contact avec un laboratoire pour une sous-traitance après accord préalable de la direction
d’usine. Effectuer trimestriellement des prélèvements des effluents liquides, selon la norme
règlementaire et le mode opératoire du laboratoire : Prélever l’eau à partir d’un robinet.
Laisser couler l’eau suffisamment pour éliminer l’eau stagnante dans les Canalisations.
Remplir les flacons en réglant un débit pas trop fort, éviter au maximum l’introduction d’air.
Laisser l’eau déborder des flacons, et les fermer soigneusement. Transmettre les échantillons
prélevés au laboratoire d’analyse Conventionné, conformément au protocole de conservation
des échantillons (en fonction du laboratoire conventionné). Recevoir le certificat d’analyse des
différents paramètres physico-chimiques. Exploiter les résultats, et transmettre un rapport
trimestriel avec copie du certificat d’analyse à la direction de l’environnement conformément
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%