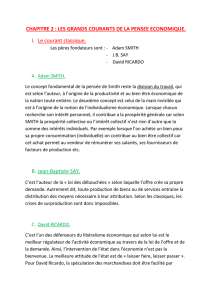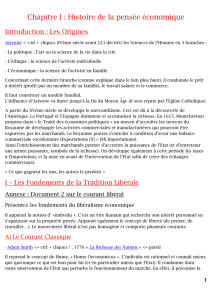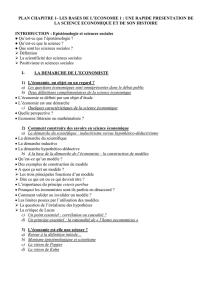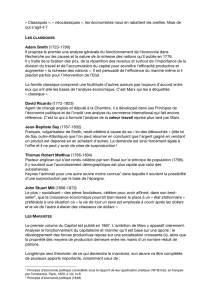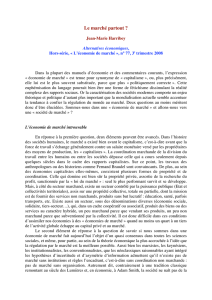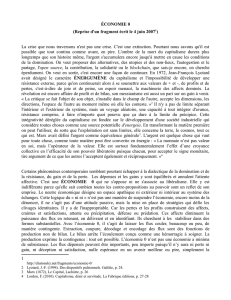!"#
$%
&'((
)$')$
**++
(,-(
.+&(($*
/
0!0
"*(
0!0)$ $
1 2 3 &
.45467""
/(+
+)$'
(***8
$"9
/$0 &
+
,
& $ *
&$
$***
$//%!,"
,*

'&3 *+
*****(
"*"*"&1(*
&*("(
$%
:;,":;$*
(*-(
1*("
*(3
$
;**+
*-*
(-
*'*,;*
1
8,
(<8&3 *("
**,
3.+<=!:*
*.***
>"3*
/.?
.8
.+&**
'1&4@@54@AB '
1*&
!" !!
C"((
+$
!
244AD*E *4@4@B
&0!!!*
>4646*6
$&F
! /"
$(
! "
!#$-3/
$-""F
"
-

$#
"!G
$*!+
(3*
-% +
3*0!!!0H!!!'&+
**2I
4J5A
%
'+/
-$
$(*
)$(
K$(
2$+C
L$(
($-
M
!***
$**(
("4@5N *2?
+%$
*
&?
%GC
(%
(-* ( G
((*+(
&
C8+
#3($8
:(9*
$:***
*$$:
$+*
*/2
38(
(,",
"-**
" $" +$
'$ (
:8$&+/
""/*(/
2
+2
*F 3

$ "
+<(,+#
*(
(*/
I
*(:(*(*
(
M(";
***((+:
(O
M P
**"
.-8O
(*:Q"**
.".&"FRO
!)*+,
-.
)$F
2**
+
)$$
O:(O$$
(0!0"
*-"*$S
(
/
*
$2*0H!0H!!*
(
'(
+
-8
(C;C
(( *Q"$$
$3*G*/
$$$

$1.T3+
M+($"+*
&(
"($
+$
S' $U
?*&.*3?(*F:U?
:(454D45JE
V"+*+
*:((
S(I
(
($$*$***
:(*/7(*
'*'W */
'7( "I
+$*
)3
+245J@+
/$
:( >$
!455B
+
&S+K*.F*
IS#+45DB4AAB C
()$&
.(C *,(*/
*
###+4A6J
#+$$
*
$>*
*S*('
,3K?
('
("8(3
K
(
/,$(
3*(>+*
*.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%