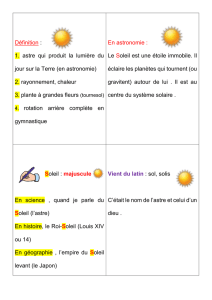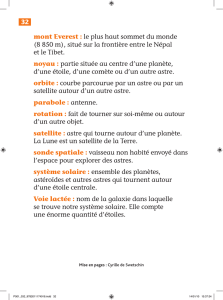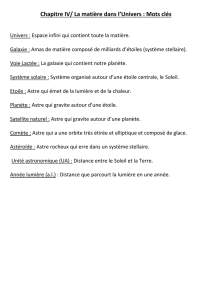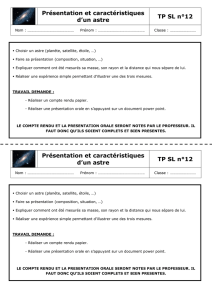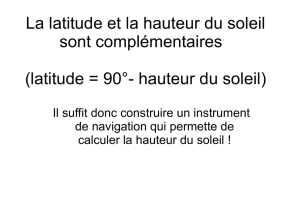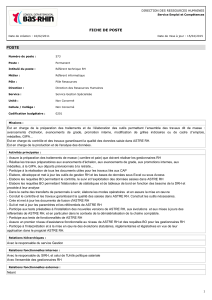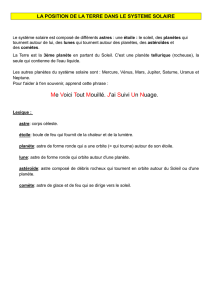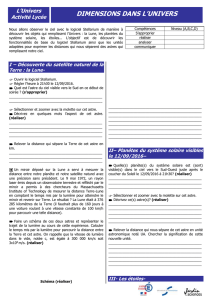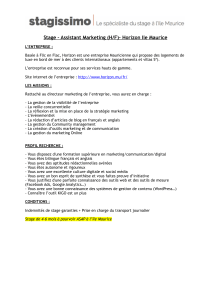Le sextant
I- INTRODUCTION :
Pour déterminer sa position par observation des astres, le navigateur ne peut utiliser les mêmes
méthodes que celles employées par les observatoires (passage des astres au méridien précis : méthode
méridienne). Sur un bâtiment qui est mobile, le navigateur ne peut qu’observer les coordonnées
horizontales des astres : azimut et hauteur.
1- Mesure des azimuts :
Cette mesure s’effectue à l’aide du compas et est affectées d’erreurs provenant du défaut
d’horizontalité de la rose du compas. Cette erreur est de la forme θtg h où h est la hauteur de l’astre et
θ le défaut d’horizontalité.
Si on relève un astre suffisamment bas, h <30° on peut considérer que la précision du relèvement est de
l’autre du degré dans de bonnes conditions.
2- Mesure des hauteurs :
La hauteur se mesure dans le plan vertical de l’astre, aussi utilise t on comme repère horizontal
l’horizon de la mer qui , nous le verrons plus tard ne coïncide pas avec l’horizon astronomique.
L’instrument permettant d’observer la hauteur d’un astre devra permettre une visée simultanée de
l’horizon et de l’astre. Cet instrument est le sextant.
II- Description :
Le sextant l’instrument le plus abouti pour la mesure de la hauteur d’un astre par rapport à
l’horizon.

Le sextant se compose essentiellement d’une armature constituée par
- Un secteur circulaire gradué de 60° d’ouverture PQ appelé limbe
- Deux montant CP et CQ qui relient le limbe au centre C.
Le montant CP porte le petit miroir m fixe et parallèle au montant CQ. Ce miroir est réfléchissant
sur la moitié de sa surface de façon à pouvoir observer simultanément une image directe et une image
réfléchie par la partie argentée.
Un autre miroir M appelé grand miroir est fixé à une alidade CI mobile autour d’une axe
perpendiculaire au plan du limbe et passant par C. Cette alidade porte un curseur et un index qui se
déplace en regard des graduations du limbe.
Une lunette de visée L est fixée sur le montant CQ et son axe passe par le centre du petit miroir tout
en restant parallèle au plan du limbe.
1- Principe de la double réflexion :
Considérons les deux miroirs M et m tels qu’ils ont été définis ci-dessus.
Soient CN et cn les normales à ces miroirs passant par leur centre.
Un rayon incident Ax vient frapper le premier miroir M en son centre C sous l’incidence I, le
rayon réfléchi Cc fait d’après les lois de réflexion le même angle I avec la normale CN. Le rayon
réfléchi atteindra le petit miroir m en son centre c sous une incidence i. Il sera à nouveau réfléchi dans
la direction cB faisant même angle i avec la normale cn. Les rayons AC et cB font entre eux un angle α,
les normale CN et cn un angle β.

Dans le triangle cCD 2I= 2i+ α
CcE I=i+ β
D’où l’on ne tire que α =2β
Or dans le sextant par construction β= QCF donc :
Si il est porté sur le limbe une graduation dont les valeurs sont doubles de celles des angles
au centre β balayé par l’alidade, on lira sur la graduation directement l’angle α que fait la direction de
l’astre Ax avec le plan de l’horizon si cB est contenu dans ce dernier.
2- Principe de la visée :
La position « zero » de l’index correspond au parallélisme des deux miroirs, si le sextant est
dans le plan vertical et si on vise l’horizon, celui-ci apparait à la fois en visée directe et en image
réfléchie.
En déplaçant l’alidade CI, tout en visant directement l’horizon on balaye le plan vertical dans
lequel doit se trouver le plan du limbe du sextant. Un astre de hauteur h est vu dans la lunette lorsque
l’alidade a tourné de h/2. Ceci revient à descendre l’image réfléchie de A sur l’horizon, d’où
l’expression « descendre un astre sur l’horizon ».
3- Lecture de la hauteur affichée :
Le sextant est muni d’un tambour micrométrique dont le principe est le suivant :

Le tambour est divisé en 60 divisions représentant chacune une minute d’angle du limbe. Une rotation
complète du tambour correspond donc à un déplacement de ‘index de l’alidade d’un degré sur le
limbe.
III- Les erreurs du sextant :
1- Rectification du sextant :
Pour que les conditions géométriques de la mesure des angles soient réalisées, il faut que le
limbe soit parfaitement plan et l’axe de rotation de l’alidade perpendiculaire au plan du limbe.
Ces conditions sont réalisées à la construction et se maintiennent par la suite.
Il faut de plus que les rayons lumineux donnant l’image directe et réfléchie soient dans un plan
parallèle au plan du limbe, c’est à dire qu’il faut :
- Que l’axe optique de la lunette soit parallèle au pal du limbe ;
- Que le grand miroir et le petit miroir soient tous deux perpendiculaires au pal du limbe ;
Rectifier un sextant consistera à se rapprocher le plus possible des deux dernières conditions
énoncées ci-dessus.
Rectification de l’axe optique : le sextant étant posé à plat sur une table, on place sur le
limbe, parallèlement à la lunette deux viseurs qui servent à jalonner un trait horizontal sur
une mire placée à une trentaine de mètres. La lunette est ensuite mise au point sur la mire
en agissant sur les vis du collier porte lunette. Une fois cette rectification effectuée on a
généralement plus besoin de le refaire du moins tant que le sextant n’aura pad été mal
traité.
Sue les sextants modernes l’axe optique est réglé une fois à la construction et le collier porte
lunette est fixe.
Réglage du grand miroir :

On dépose sur le limbe les deux viseurs V1 et V2 et on oriente le grand miroir M de telle sorte que l’on
puisse apercevoir simultanément la moitié de V1 en vue directe et la moitié de V2 en vue réflexion. On
agit alors sur la vis du miroir de façon que l’image des arêtes supérieures de V1 et V2 soient au même
niveau.
Sur les sextants modernes le grand miroir est réglé une fois pour toute en usine.
Réglage du petit miroir :
L’axe optique et le grand miroir ayant été rectifiés, le petit miroir sera lui aussi réglé c'est-à-
dire parfaitement perpendiculaire au plan du limbe si l’image directe et l’image réfléchie d’un point
très éloigné coïncident.
Il suffira d’amener l’image réfléchie A’ sur la perpendiculaire du limbe passant par l’image
directe A en agissant sur l’alidade et le vernier.
Si A et A’ ne coïncident pas, on les fera coïncider en agissant sur la vis de perpendicularité
du petit miroir qui sera alors réglé.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%