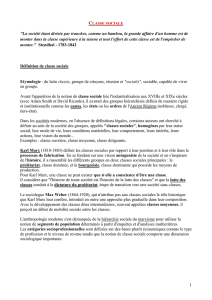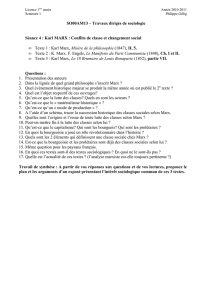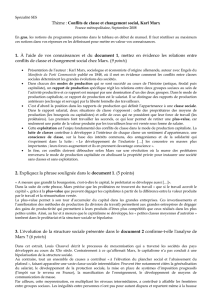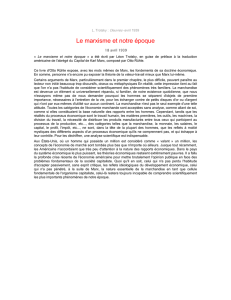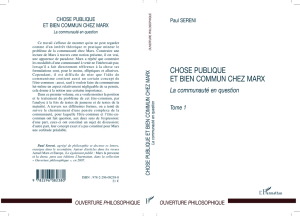Marx et le moment messianique : Théologie politique du Vormärz
Telechargé par
ADIL PHILO

Revue germanique internationale
8 | 2008
Théologies politiques du Vormärz
Le moment messianique de Marx
Étienne Balibar
Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/rgi/381
DOI : 10.4000/rgi.381
ISSN : 1775-3988
Éditeur
CNRS Éditions
Édition imprimée
Date de publication : 30 octobre 2008
Pagination : 143-160
ISBN : 978-2-271-06770-8
ISSN : 1253-7837
Référence électronique
Étienne Balibar, « Le moment messianique de Marx », Revue germanique internationale [En ligne],
8 | 2008, mis en ligne le 30 octobre 2011, consulté le 19 avril 2019. URL : http://
journals.openedition.org/rgi/381 ; DOI : 10.4000/rgi.381
Tous droits réservés

Le moment messianique de Marx
Étienne Balibar
«Im düstern Auge keine Träne,
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne :
Deutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch -
Wir weben, wir weben 1!»
Dans le présent article je voudrais réexaminer, et si possible éclaircir, une
question récurrente de l’interprétation de la pensée de Marx : quel rapport y a-t-il
entre son concept de la politique et sa dimension religieuse (ou théologique) ? En
vue de la comparaison que ce numéro de la Revue Germanique Internationale
souhaite instruire, mais aussi en raison de l’importance stratégique qu’il faut, je
crois, lui conférer, je m’intéresserai essentiellement à un texte : l’article publié en
mars 1844 dans les Deutsch-Französische Jahrbücher sous le titre « Zur Kritik der
Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung », dans lequel apparaît pour la première
fois chez Marx le nom du « prolétariat 2». Je soutiendrai que, pris à la lettre et
replacé dans son contexte, il représente le « moment messianique » de sa pensée,
et permet d’interroger la permanence mais aussi les métamorphoses de cette
dimension tout au long de son œuvre. En isolant ainsi un moment singulier, à
partir de l’écriture, je souhaite m’installer au-delà des débats sur le rapport entre
la « formation de la pensée de Marx » et sa « systématisation » ou son « dévelop-
pement », vu selon les cas comme continuité ou discontinuité, qui ont tendance
à décontextualiser les formulations, et à substituer des reconstructions totalisantes
aux lectures différentielles nécessaires.
Je choisis l’expression de « moment messianique » par symétrie avec celle de
« moment machiavélien » (empruntée à Pocock) dont s’est servi Miguel Abensour
dans une étude qui a fait date, centrée sur l’interprétation du texte immédiatement
antérieur : le « manuscrit de 1843 » connu sous le titre « Critique de la philosophie
1. Heinrich Heine, « Die armen Weber » [Die schlesischen Weber], publié le 10 juin 1844
dans le Vorwärts (1re strophe).
2. « Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Introduction », que je
citerai ci-après Einleitung (Marx-Engels Werke [M.E.W.], Berlin, Dietz, 1970, t. 1, p. 378-391).

hégélienne de l’État », rédigé par Marx avant son arrivée à Paris, dont il se peut
qu’il ait eu l’intention de faire un livre dont l’Einleitung de 1844 aurait fourni
l’ouverture 3. Ce que je veux montrer, c’est qu’entre ces deux écrits au titre quasi-
ment identique, mais de style radicalement différent, il y a aussi un contraste de
fond quant à la conception de la politique et à l’énonciation de ses fins. Il ne
réside pas tant dans un renversement de l’idéalisme au matérialisme, ou dans la
transition du démocratisme au communisme, bien que ces questions méritent
d’être posées, que dans le surgissement d’une dimension « impolitique » au cœur
de la politique elle-même, associée à la fonction rédemptrice qu’y assume le prolé-
tariat 4. Philosophiquement, toute la question est alors de comprendre comment
s’articulent dans une véritable unité de contraires le « moment machiavélien »
(éminemment politique, a-théologique et radicalement démocratique, si l’on suit
l’interprétation d’Abensour) et le « moment messianique » – non seulement du
point de vue de leur enchaînement, mais du point de vue de leur corrélation
conceptuelle et pour ainsi dire de leur présupposition mutuelle. Si tel est le cas, et
quelle que soit l’extrême diversité des figures sous lesquelles elle est appelée à se
manifester ensuite chez Marx et ses successeurs, on aurait bien affaire à une
structure de pensée comme telle irréductible.
b
On commencera par décrire l’architecture de l’Einleitung, à partir de ses
caractéristiques stylistiques et de son économie conceptuelle 5. Et sans doute, étant
3. Marx, Kritik des Hegelschen Staatsrecht, M.E.W. 1, p. 201-333 (la traduction française par
A. Baraquin : Karl Marx, Critique du droit politique hégélien, Paris, Éditions Sociales, 1975, est à ma
connaissance la seule à contenir également les passages de Hegel discutés par Marx). Je citerai l’essai
de Miguel Abensour dans la première édition : « Marx et le moment machiavélien. “Vraie démocratie”
et modernité » [in] Phénoménologie et politique. Mélanges offerts à Jacques Taminiaux, Bruxelles,
Ousia, 1989, p. 17-114 (voir également la nouvelle édition parue aux Éditions du Félin en 2004 : La
démocratie contre l’État).
4. Dans son article « Proletariat, Pöbel, Pauperismus » (Geschichtliche Grundbegriffe. Histo-
risches Lexikon der politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart, Klett, 1972-1997), Werner
Conze montre comment, au cours des années 1835-1840, le mot « prolétariat » importé de l’usage
des socialistes français s’est substitué en Allemagne à celui de Pöbel (populace) employé par Hegel
pour désigner la masse « sans » (propriété, domicile, profession, statut...) ou la classe paupérisée
extérieure au système corporatif de la « société civile-bourgeoise » (bürgerliche Gesellschaft). Sur fond
d’aggravation des antagonismes sociaux, il a fini par nommer les travailleurs salariés dont les intérêts
s’opposent à ceux du capital manufacturier. Conze confronte alors les usages qui en sont fait par
deux « hégéliens », Lorenz von Stein (1842) et Marx (1844), respectivement au titre d’ennemi interne
de la société industrielle et d’agent de la « décomposition » de l’ordre existant. De son côté Georges
Labica (art. « Prolétariat » [in] Dictionnaire critique du marxisme, Paris, PUF, 1982) insiste sur le
rôle de Moses Hess dans la réception du terme prolétariat par Marx à partir de la lecture de Stein,
et dans la combinaison d’une critique de la paupérisation avec une philosophie de l’action.
5. En toute rigueur il faudrait ici évoquer les principales interprétations existantes de l’Ein-
leitung, soit qu’elles lui consacrent une étude séparée à titre de « tournant » dans l’histoire de la
constitution du marxisme, soit qu’elles la citent par prédilection dans leur tentative pour caractériser
ce qui en fait l’essence (comme théorie de la lutte des classes, critique du capitalisme, philosophie
144 Théologies politiques du Vormärz

donné notre objectif, convient-il de le faire en commençant par la fin : « Quand
les conditions internes [i.e. l’alliance de la philosophie ou « théorie » allemande
et du prolétariat, dont l’une est la « tête » et l’autre le « cœur » de l’émancipation
humaine] en seront remplies, le chant du coq gaulois sonnera comme une trom-
pette pour annoncer le jour de la résurrection allemande [wird der deutsche Aufer-
stehungstag verkündet durch das Schmettern des gallischen Hahns]. » Parmi les
commentateurs qui ne réduisent pas ce trait prophétique à un effet journalistique,
aucun à ma connaissance n’en indique exactement la provenance, pourtant déci-
sive 6. Elle n’exclut pas l’ironie, et ne commande pas de lui attribuer une signifi-
cation univoque, mais elle interdit d’en faire une simple trouvaille de plume. À la
variation d’un verbe près, il s’agit de la reprise d’un texte célèbre de Heine, écrit
pour saluer la Révolution de Juillet, dans lequel se trouve aussi évoquée la relation
historique entre Réforme luthérienne, Révolution française et Philosophie alle-
mande qu’on retrouvera dans l’Einleitung : « Voici que le coq gaulois a chanté
(gekräht) pour la deuxième fois, et en Allemagne aussi le jour se lève (...) Mais
que faisions-nous pendant la nuit ? Eh bien nous rêvions à notre manière alle-
mande, c’est-à-dire que nous faisions de la philosophie (...) N’est-il pas étrange,
cependant, que l’activité pratique de notre voisin de l’autre côté du Rhin ait cette
affinité élective avec le rêve philosophique que nous poursuivons dans la tranquil-
lité allemande ? (...) la philosophie allemande ne serait-elle rien d’autre que la
révolution française transposée en rêve 7?... » Le chant du coq gaulois qui annonce
le jour de l’émancipation signale donc une interprétation des révolutions modernes
comme un cycle historique transeuropéen dont Marx croit pouvoir prophétiser la
« résolution » imminente (comme il le fera dans le Manifeste du parti communiste
de 1847), en même temps qu’il proclame dans le surgissement du prolétariat
l’arrivée d’un sauveur du monde 8. Cette conjonction relève aussi d’un dispositif
d’écriture caractérisé par une superposition brève, mais intense et réciproque,
de l’histoire, voire « religion séculière »). Je ne dispose pas ici de la place pour le faire, et j’y reviendrai
brièvement en conclusion. Évoquons, de façon non limitative, les noms de Shlomo Avineri, Ernst
Bloch, Auguste Cornu, Hal Draper, Jürgen Habermas, Eustache Kouvélakis, Georges Labica, Karl
Löwith, Michael Löwy, Pierre Macherey, Emmanuel Renault, Eric Voegelin...
6. Eustache Kouvélakis, dans son importante étude, renvoie plusieurs fois à ce « signe » de la
communauté de pensée entre Marx et Heine en 1844 (op. cit. infra, p. 90, 117, 335). Il en propose
une interprétation conjoncturelle liée à la circulation de la problématique révolutionnaire entre la
France et l’Allemagne dans la première moitié du XIXesiècle (renvoyant en particulier aux travaux
de Lucien Calvié), mais n’en explore pas la dimension allégorique.
7. Introduction à Kahldorf über den Adel [in] Briefen an den Grafen M. von Moltke, 1831
(Heinrich Heine, Historisch-Kritische Gesamtausgabe der Werke. Düsseldorfer Ausgabe, Hamburg,
Hoffmann u. Campe, 1979, t. 11, p. 174). De l’influence de cette phrase sur Marx témoigne sa
reprise dans l’article du 12 novembre 1848 de la Neue Rheinische Zeitung, commentant le cycle des
révolutions et des contre-révolutions en Europe : « Von Paris aus wird der gallische Hahn noch
einmal Europa wachkrähen ». L’ouvrage auquel Marx a emprunté l’essentiel de sa conception de
l’influence de la Réforme luthérienne sur la philosophie et de la signification « révolutionnaire »
commune à l’idéalisme allemand (Kant, Fichte, Hegel) et à la politique française moderne est le Sur
l’histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne (1834/1835) (rééd. J.-P. Lefebvre, Paris,
Imprimerie Nationale, 1993).
8. Dans le chant du coq gaulois identifié à une trompette eschatologique (schmettern), il est
145Le moment messianique de Marx

entre les « voix » propres de Marx et de Heine, qui commence aujourd’hui à être
mieux connue 9. En quoi éclaire-t-elle l’ensemble de la signification du texte ? J’en
proposerai schématiquement trois clés.
La première concerne le rapport entre cette conclusion et les formules intro-
ductives beaucoup plus célèbres concernant la religion (« opium du peuple ») :
En Allemagne la critique de la religion, qui forme le préalable de toute critique,
est maintenant achevée pour l’essentiel (...) Le fondement de la critique irréligieuse
est le suivant : ce n’est pas la religion qui fait l’homme, c’est l’homme qui fait la
religion (...) Mais l’homme c’est le monde de l’homme, c’est-à-dire l’État, la société.
Cet État et cette société produisent, avec la religion, une conscience inversée, parce
qu’ils forment eux-mêmes un monde à l’envers (...) La lutte contre la religion est
donc médiatement la lutte contre ce monde dont elle est comme l’arôme spirituel.
La misère religieuse est à la fois l’expression de la misère réelle et la protestation
contre la misère réelle (...) La critique de la religion est donc en son centre critique
de la vallée de larmes dont la religion est elle-même la sacralisation illusoire...
Laissons ici de côté le débat sur ce que ces formules doivent à Feuerbach,
dont on sait que le « renversement anthropologique » de la théologie a revêtu une
importance capitale pour les jeunes hégéliens en général, ainsi qu’à un athéisme
issu des « Lumières radicales » dont Marx est très proche et qui inspire sa dénon-
ciation de la restauration européenne monarchique et cléricale, et passons tout de
suite à la signification théologico-politique engendrée par le rapprochement entre
l’ouverture de l’article, énonçant l’acte de décès de la religion, et les énoncés
messianiques de la fin relatifs au prolétariat. On pourrait l’exprimer en latin de
cuisine (ou d’Église) par la formule : exeat religio, adveniant proletarii. En rappor-
tant l’illusion ou mystification religieuse à l’expression contradictoire d’un monde
réel aliéné, Marx dégage un problème politique, mais qui apparaît dans l’immédiat
sans solution, car il ne lui correspond pas d’acteur ou de force pratique. Cette
force se « trouve » cependant, au terme d’une discussion historico-théorique
complexe, dans la figure matérielle du prolétariat (sous la condition, sur laquelle
je vais revenir, d’une alliance ou fusion organique avec la philosophie qui s’est
elle-même autonomisée dans le cours d’une longue altercation avec la religion).
loisible de voir la condensation de deux lignées allégoriques. Le « coq gaulois » est un symbole
national français inventé à la Renaissance, associé pendant la Révolution à l’idée de fraternité, puis
inscrit sur les monnaies par le Consulat et sur les drapeaux par la révolution de Juillet 1830, en
attendant ses usages cocardiers et sportifs plus récents. Le chant du coq qui annonce l’imminence
du jour est un thème messianique à la fois chrétien (initialement rattaché à l’épisode du reniement
de Saint-Pierre, dans les évangiles de Matthieu et de Luc) et juif médiéval (remontant peut-être à
l’exil de Babylone : cf. JewishEncyclopedia.com, art. « cock »).
9. Cf. en particulier Jean-Pierre Lefebvre, « Marx und Heine », Schriften aus dem Karl-Marx
Haus 4 (1972) ; Jacques Grandjonc : Marx et les communistes allemands à Paris, Paris, François
Maspero, 1974 ; Lucien Calvié, Le renard et les raisins. La Révolution française et les intellectuels
allemands (1789-1845), Paris, EDI, 1989 ; Christoph Marx, Heinrich Heine als politischer Dichter und
das ideologische Verhältnis zu Karl Marx 1843/44, Studienarbeit, GRIN Verlag für Akademische
Texte, 1997 (ebook) ; Eustache [Stathis] Kouvélakis, Philosophie et Révolution de Kant à Marx, Paris,
PUF, 2003, 427 pages (je cite la traduction anglaise, Philosophy and Revolution from Kant to Marx,
London, Verso, 2003).
146 Théologies politiques du Vormärz
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%