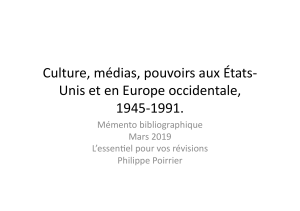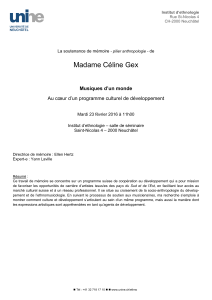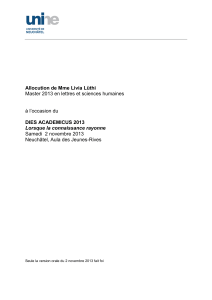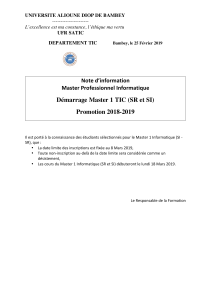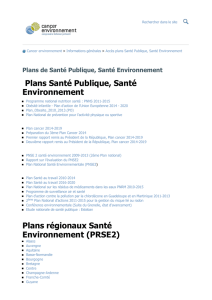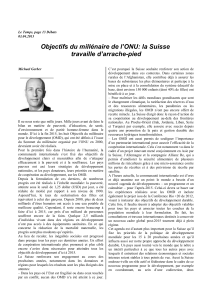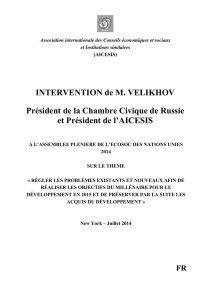OMD et Droit au Développement : Analyse et Enjeux Éthiques
Telechargé par
jeromecurty

LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT : UNE
OPÉRATIONNALISATION DU DROIT AU DÉVELOPPEMENT ET AU-
DELÀ ?
Jérôme Ballet, Jean-Marcel Kouamékan Koffi et Boniface Kouadio Koména
De Boeck Supérieur | « Mondes en développement »
2016/2 n° 174 | pages 49 à 62
ISSN 0302-3052
ISBN 9782807390294
Article disponible en ligne à l'adresse :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2016-2-page-49.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour De Boeck Supérieur.
© De Boeck Supérieur. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la
licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage
dans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Neuchâtel - - 130.125.60.209 - 27/03/2019 15h02. © De Boeck Supérieur
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Neuchâtel - - 130.125.60.209 - 27/03/2019 15h02. © De Boeck Supérieur

Mondes en Développement Vol.44-2016/2-n°174 49
DOI : 10.3917/med.174.0049
Les Objectifs du Millénaire pour le développement :
une opérationnalisation du droit au développement et
au-delà ?
Jérôme BALLET1, Jean-Marcel Kouamékan KOFFI2
et Boniface Kouadio KOMÉNA3
Les Objectifs du Millénaire pour le développement sont une opérationnalisation
du droit au développement. Dans cet article nous balayons l’historique du droit
au développement et les principales critiques qui lui ont été portées. Nous
montrons que ces critiques ont largement pu trouver réponse. Cependant, trois
enjeux majeurs restent largement ouverts : la participation des populations, le
droit des populations autochtones, et le droit à un environnement sain. La
particularité de ces trois enjeux est d’ouvrir sur un débat opposant droit
individuel inaliénable et droit collectif.
Mots-clés :
Objectifs du Millénaire pour le développement, droit au
développement, éthique du développement
Classification JEL :
O10
Millennium Development Goals:
An Operationalization of the Right to Development and Beyond?
The Millennium Development Goals are an operationalization of the right to
development. In this article we scan the history of the right to development and
the main criticisms that were brought to it. We show that these criticisms have
largely been answered. However, three major issues remain largely open: people
participation, the right of indigenous peoples and the right to a healthy
environment. The particularity of these three issues is to open a debate between
inalienable individual right and collective right.
Keywords:
Millennium Development Goals, Right to Development,
Development ethics
1 Université de Bordeaux, Groupe de recherche en économie théorique et appliquée
(GRETHA-CNRS). [email protected]
2 Université de Bouaké, Côte d’Ivoire et UMI Résiliences, Institut de recherche pour le
développement. [email protected]
3 Université de Bouaké, Côte d’Ivoire et UMI Résiliences, Institut de recherche pour le
développement. [email protected]
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Neuchâtel - - 130.125.60.209 - 27/03/2019 15h02. © De Boeck Supérieur
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Neuchâtel - - 130.125.60.209 - 27/03/2019 15h02. © De Boeck Supérieur

50 Jérôme BALLET, J.-M. Kouamékan KOFFI et B. Kouadio KOMÉNA
Mondes en Développement Vol.44-2016/2-n°174
n septembre 2000, les 189 États membres de l’Organisation des Nations
Unies se sont engagés à réaliser huit objectifs de développement, dits
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), à l’horizon 2015. Cet
engagement s’inscrit dans une volonté pratique de donner corps à une
conception du développement qui ne se réduit pas à la croissance économique.
Ce nouveau cadrage articule les dimensions économiques, écologiques et
sociales du développement, et tend à combiner les valeurs liées aux droits
humains, aux conditions de vie des populations dans une approche
multidimensionnelle.
Si les réalisations de ces objectifs ont été plus ou moins respectées (Nations
Unies, 2015), la vision du développement sous-jacente qui les a guidées se
démarque nettement d’une approche économique réductrice. Elle s’appuie, au
contraire, sur une conception éthique qui vise à donner toute sa place aux droits
de l’homme.
Cet article ne vise pas à proposer une critique des OMD, ni même de leurs
réalisations. Car au-delà des critiques qui peuvent être adressées à ces objectifs,
ils introduisent un vrai changement pragmatique dans le développement. Nous
mettons en lumière leur fondement éthique, les critiques qu’ils ont dû affronter
pour imposer ce nouveau cadre. Nous défendons l’idée que les OMD ne
constituent finalement qu’une opérationnalisation du concept de « droit au
développement », concept qui a émergé trente ans plus tôt.
Dans une première partie, nous rappelons le cadre éthique de référence des
OMD, celui du droit au développement, en remontant à la déclaration du juriste
sénégalais Keba M’Baye en 1972 à la Commission des Nations Unies sur les
droits de l’homme, dont les OMD peuvent être lus comme une
opérationnalisation. Dans cette première partie, nous défendons spécifiquement
que les OMD sont une opérationnalisation des droits de l’homme via le droit au
développement.
Dans une seconde partie, nous discutons des critiques qui sont adressées à cette
approche, notamment les critiques issues du droit positif et les critiques
émanant de l’éthique conséquentialiste. En effet, du fait de la filiation avec les
droits de l’homme, les OMD reposent fondamentalement sur une éthique
déontologique. Nous avançons alors que ces critiques ne sont pas robustes et
que les réponses apportées permettent largement de les dépasser.
Dans une troisième partie nous discutons des enjeux qui restent encore ouverts
et qui interrogent le soubassement éthique des OMD. Trois enjeux sont
particulièrement relevés : la participation des populations au processus de
développement, le droit des populations autochtones, l’intégration de la
dimension environnementale. Ces trois enjeux ont comme particularité de
remettre en question le fondement éthique des OMD, à savoir le droit au
développement comme droit individuel, en appuyant sur la dimension
collective. Au droit au développement conçu comme droit de l’homme
individuel s’oppose ainsi un droit collectif au développement.
E
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Neuchâtel - - 130.125.60.209 - 27/03/2019 15h02. © De Boeck Supérieur
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Neuchâtel - - 130.125.60.209 - 27/03/2019 15h02. © De Boeck Supérieur

Les OMD : une opérationnalisation du droit au développement et au-delà ? 51
Mondes en Développement Vol.44-2016/2-n°174
1. DE L’ÉMERGENCE DU DROIT AU
DÉVELOPPEMENT AUX OMD
Le droit au développement est apparu dans les années 1970, dans un contexte
de guerre froide, comme outil de dépolitisation du développement. Il s’est
ensuite largement autonomisé de cette opposition pour devenir un concept
unificateur des droits de l’homme dans le contexte des pays en développement.
1.1 Bref historique du droit au développement
En 1972, le juriste sénégalais Keba M’Baye faisait une déclaration à la
Commission des Nations Unies sur les droits de l’homme, dans laquelle il
défendait le concept de « droit au développement ». Ce concept se voulait une
défense des droits de l’homme dans le contexte des pays du Sud, conciliant les
principes universels des droits de l’homme et les exigences de développement.
Le concept se voulait intégrateur de l’héritage de la Conférence afro-asiatique
de Bandung4 de 1955 et des exigences de la Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement5 dans le cadre global de l’architecture des
droits de l’homme promue par les Nations Unies. Keba M’Baye soulignait que
la Déclaration Universelle des droits de l’homme a constitué une voie ouverte
pour la communauté internationale à s’engager dans un développement
reposant sur des principes universels, largement cadenassée par la politique de
la guerre froide. La reconnaissance d’un droit au développement constituerait
ainsi pour lui une avancée permettant de dépasser les clivages politiques.
Sous son impulsion, le 2 mars 1979, la Résolution n°4(XXXV) de la
Commission des Nations Unies sur les droits de l’homme reconnaissait le droit
au développement comme un droit de l’homme. Le 4 décembre 1986, la
Déclaration de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le droit au
développement adopta majoritairement le droit au développement comme un
droit de l’homme (146 votes pour, 1 vote contre et 6 abstentions). Dans cette
Déclaration, le droit au développement est défini en ces termes : « Le droit au
développement est un droit de l’homme inaliénable en vertu duquel toute personne
humaine et tous les peuples ont le droit de participer à, de contribuer à, et de
bénéficier d’un développement économique, social, culturel et politique, dans
4 La Conférence de Bandung (Indonésie) s’est tenue dans un contexte de guerre froide, en
réunissant pour la première fois des pays anciennement colonisés. 29 pays y manifestèrent
leur volonté de ne s’aligner ni sur le bloc occidental, ni sur le communisme (neutralité et
coexistence pacifique). Favorable à l’autodétermination des peuples, cette conférence a
contribué à accélérer la décolonisation.
5 La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) est un
organe crée en 1964 sous l’impulsion de pays du tiers monde, d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique Latine, en vue de favoriser l’essor des pays en développement, en les intégrant
à l’économie mondiale (accès aux marchés des pays développés, échanges commerciaux
équilibrés).
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Neuchâtel - - 130.125.60.209 - 27/03/2019 15h02. © De Boeck Supérieur
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Neuchâtel - - 130.125.60.209 - 27/03/2019 15h02. © De Boeck Supérieur

52 Jérôme BALLET, J.-M. Kouamékan KOFFI et B. Kouadio KOMÉNA
Mondes en Développement Vol.44-2016/2-n°174
lequel tous les droits de l’homme et les libertés fondamentales peuvent être
pleinement réalisés. »6
Il fallut cependant attendre 1990 pour la constitution d’un groupe global de
consultation sur les problèmes d’intégration du droit au développement dans les
opérations des Nations Unies. En 1993, lors de la Conférence de Vienne sur les
Droits de l’Homme, le droit au développement devient un couvre-chef des
droits de l’homme. Cette conférence marque un changement important. Tandis
que jusque-là, le droit au développement n’était conçu que comme un droit de
l’homme, il devient un droit qui englobe les autres droits de l’homme dans
l’optique du développement.
En 1998, un groupe de travail se crée aux Nations Unies pour la promotion du
droit au développement, en même temps que la campagne annonçant le
sommet du Millénaire. Ce parallèle n’est pas fortuit. Dès le début, les Objectifs
du Millénaire pour le développement sont constitutifs d’une opérationnalisation
du droit au développement. Avec le Sommet du Millénaire du 6 au 8 septembre
2000 à New York, puis le début de la campagne du Millénaire, en 2002,
l’opérationnalisation devient une réalité dans les politiques de développement.
Les Objectifs du Millénaire ne sont donc pas seulement une nouvelle façon de
penser la pauvreté, ils sont fondamentalement une mise en œuvre des droits de
l’homme. Lors du sommet mondial sur le Millénaire en septembre 2005, Kofi
Annan affirmait vouloir passer de « l’ère de la déclaration » à « l’ère de
l’implémentation » du droit au développement. Son discours pointait
parfaitement le caractère d’opérationnalisation du droit au développement par
les Objectifs du Millénaire pour le développement.
1.2 Trois aspects tirés de la définition du droit au
développement
La définition du droit au développement fait ressortir trois caractéristiques
essentielles de ce droit.
Premièrement, il s’agit, comme tout droit de l’homme, d’un droit individuel et
inaliénable. Cette caractéristique est fondamentale puisque le développement
n’est pas conçu dans cette optique comme un ensemble de relations entre pays
et gouvernements, mais bien comme un processus d’accroissement des libertés
pour les individus.
Deuxièmement, en corollaire, il s’agit d’un processus économique, social et
politique qui permet la réalisation des libertés. Les OMD constituent en ce sens
un mécanisme de promotion des libertés entendues au sens des capabilités à la
Sen (1979). Au-delà, ce sont bien les débats sur la relation entre croissance et
6 Notre traduction de « The right to development is an inalienable human right by virtue of
which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and
enjoy economic, social, cultural and political development, in which all human rights and
fundamental freedoms can be fully realized ».
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Neuchâtel - - 130.125.60.209 - 27/03/2019 15h02. © De Boeck Supérieur
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Neuchâtel - - 130.125.60.209 - 27/03/2019 15h02. © De Boeck Supérieur
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%