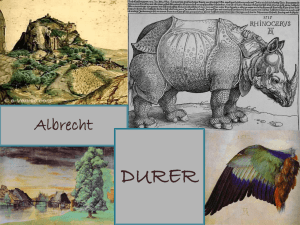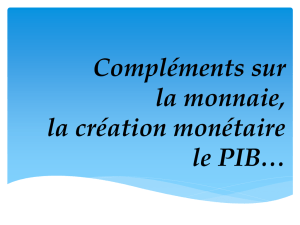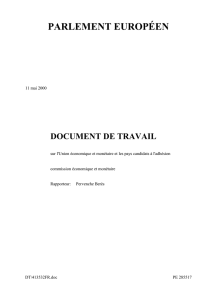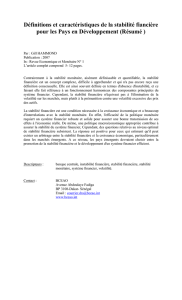Asymétries financières et transmission de la politique monétaire en Europe
Telechargé par
nafee.teyeb

Économie & prévision
Asymétries financières et transmission de la politique monétaire en
Europe
Virginie Coudert, Benoît Mojon
Citer ce document / Cite this document :
Coudert Virginie, Mojon Benoît. Asymétries financières et transmission de la politique monétaire en Europe. In: Économie &
prévision, n°128, 1997-2. L'intégration européenne : nouveaux enjeux. pp. 41-60;
doi : https://doi.org/10.3406/ecop.1997.5848
https://www.persee.fr/doc/ecop_0249-4744_1997_num_128_2_5848
Fichier pdf généré le 12/05/2018

Résumé
Asymétries financières et transmission de la politique monétaire en Europe par Virginie Coudert et
Benoît Mojon
Dans la perspective d'une politique monétaire unique en Europe, il est essentiel de savoir si une même
politique monétaire a un impact similaire sur les économies nationales. Malgré l'utilisation générale du
taux d'intérêt comme instrument par les banques centrales, les canaux de transmission de la politique
monétaire à la sphère réelle sont multiples. En plus du canal de type ISLM qui transite par la monnaie
ou le taux d'intérêt et le canal du taux de change dont l'impact sur les prix et le commerce extérieur
sont bien connus, un canal de transmission par le crédit a été récemment mis en avant par une
littérature abondante. La dépendance au crédit bancaire de certaines catégories d'agents, les
ménages et les PME, introduit un canal de transmission si les banques modifient leur offre de crédit
selon la tension de la politique monétaire. L'importance relative de ces différents canaux, dont les
effets peuvent être contradictoires, conditionne l'efficacité de la politique monétaire. Or, tout porte à
croire que ces canaux de transmission peuvent différer d'un pays à l'autre, voire d'une période à l'autre
pour un même pays, parce que l'organisation institutionnelle des systèmes financiers est différente et
qu'elle évolue dans le temps.
Abstract
Financial Asymmetries and Monetary Policy Transmission by Virginie Coudert and Benoît Mojon
In view of an impending single monetary policy in Europe, it is essential to know whether one and the
same monetary policy has a similar effect on national economies. Despite the prevalent use of the
interest rate as an instrument by the central banks, there are numerous channels via which monetary
policy is transmitted to the real sphere. In addition to the IS-LM channel concerning the money supply
and interest rates, and the exchange rate channel with its well-known effect on prices and foreign
trade, a credit transmission channel has recently been highlighted by numerous studies. Dependency
on bank loans by certain categories of players, households and SMEs, introduces a transmission
channel when banks adjust their credit supply in line with the tightness of the monetary policy. The
relative weight of these different channels, with their potentially contradictory effects, conditions the
efficiency of the monetary policy. Yet there are good grounds for believing that these transmission
channels can differ from one country to another and even from one period to another in a single
country. This is because the institutional organisation of the financial system differs and changes over
time.

Asymétries
financières
et
transmission
de
la
politique
monétaire
en
Europe
Virginie
Coudert(*)
Benoît
Mojon^
L'adhésion
à
une
union
monétaire
se
traduit
par
la
Çerte
d'un
instrument
de
politique
économique.
Évaluer
le
coût
de
l'union
monétaire
suppose
donc
d'estimer
si
la
perte
de
l'instrument
a
des
conséquences
négatives
ou
non.
Deux
questions
importantes
se
posent
alors.
Premièrement,
il
s'agit
de
savoir
si
l'instrument
monétaire
peut
sans
difficulté
être
utilisé
pour
atteindre
des
objectifs
communs
à
l'ensemble
des
pays
de
l'union.
Les
pays
sont
d'autant
moins
pénalisés
que
leur
conjoncture
est
en
phase,
ou,
pour
être
plus
précis
que
les
chocs
subis
par
les
économies
nationales
sont
symétriques.
De
nombreuses
études
ont
été
consacrées
à
cette
question
à
la
suite
des
travaux
de
Bayoumi
et
Eichengreen
(1993)(1).
Deuxièmement,
en
admettant
la
possibilité
de
définir
un
objectif
commun
à
la
politique
monétaire
de
l'union,
il
reste
la
question
de
savoir
si
cet
objectif
peut
être
atteint,
de
manière
uniforme
pour
tous
les
pays.
La
mise
en
oeuvre
d'une
politique
monétaire
unique
pose
le
problème
de
l'homogénéité
de
son
impact
dans
les
différents
pays
d'une
union
monétaire.
Les
différences
de
transmission
de
la
politique
monétaire
entre
les
pays
membres
de
l'Union
monétaire
européenne
pourraient
en
effet
conduire
à
des
distorsions
préjudiciables.
C'est
à
cette
question
qu'est
consacré
cet
article.
Dans
la
réalité,
la
transmission
de
la
politique
monétaire
ne
fonctionne
pas
selon
des
mécanismes
invariants,
tels
qu'ils
sont
représentés
par
exemple
dans
un
modèle
ISLM.
Cette
transmission
dépend
des
caractéristiques
des
économies
et
en
particulier
de
leur
structures
financières.
Ainsi,
une
politique
monétaire
restrictive
n'aura
pas
les
mêmes
effets
sur
la
consommation
dans
un
pays
où
les
ménages
sont
très
endettés
et
dans
un
pays
où
leur
endettement
est
limité.
(*)
Centre
d'Études
Prospectives
et
d'Informations
Internationales.
Nous
remercions
les
deux
lecteurs
anonymes
de
la
revue
pour
leurs
remarques
et
suggestions.
Économie
et
Prévision
n°128
1997-2
La
théorie
économique
distingue
plusieurs
canaux
de
transmission
de
la
politique
monétaire.
Au
canal
ISLM
traditionnel,
qui
passe
par
la
quantité
de
monnaie
disponible
et
son
impact
sur
le
taux
d'intérêt
réel,
il
faut
ajouter
le
canal
du
taux
de
change
et
le
canal
du
crédit.
Le
canal
du
taux
de
change
renforce
le
canal
traditionnel
dès
lors
qu'une
augmentation
des
taux
d'intérêt
entraîne
une
appréciation
de
la
monnaie
nationale.
Ce
canal
ne
devrait
plus
jouer
en
union
monétaire.
En
revanche
le
canal
du
crédit
devrait
perdurer
et
se
trouve
fortement
conditionné
par
les
structures
financières.
Son
influence
sur
la
sphère
réelle
résulte
de
la
dépendance
de
certains
agents
non
financiers
à
l'égard
du
crédit
bancaire.
Comme
le
crédit
bancaire
représente
la
seule
source
de
finance
externe,
pour
les
ménages
ou
les
PME,
une
politique
monétaire
restrictive
réduit
la
demande
finale
si
elle
conduit
à
une
baisse
de
l'offre
de
crédit
bancaire.
Parallèlement,
une
hausse
des
taux
d'intérêt
peut
réduire
la
valeur
des
actifs
patrimoniaux,
ce
qui
contribue
également
à
réduire
le
crédit
bancaire
en
affectant
leur
valeur
du
collatéral
des
emprunteurs.
41

Dans
cette
perspective,
il
est
important
de
comparer
les
structures
financières
qui
influencent
la
transmission
de
la
politique
monétaire
dans
les
pays
de
l'Union
européenne.
Deux
séries
d'études
menées
à
la
BRI
(1993,1995)
ont
déjà
examiné
ces
questions
pour
les
pays
membres
de
la
BRI
et
rassemblé
un
grand
nombre
d'éléments
permettant
de
comparer
leurs
structures
financières.
Mais
la
problématique
n'était
pas
abordée
sous
l'angle
d'une
comparaison
européenne.
Cet
article
décrit
d'abord
les
raisons
pour
lesquelles
la
transmission
de
la
politique
monétaire
pourrait
s'effectuer
différemment
dans
quatre
grands
pays
européens
l'Allemagne,
la
France,
le
Royaume-Uni
et
l'Italie.
Une
contribution
empirique
est
ensuite
apportée
au
débat
en
calculant
les
réponses
de
l'économie
à
un
choc
de
taux
d'intérêt
dans
ces
quatre
pays
européens
au
moyen
d'un
modèle
Var,
incluant
instrument,
objectifs
de
la
politique
monétaire
et
variables
de
transmission.
Une
dernière
partie
est
consacrée
à
analyser
l'effet
d'une
décomposition
de
période
sur
les
résultats.
Ceci
permet
d'
évaluer
la
convergence
éventuelle
des
pays
européens
quant
à
leur
réponse
à
la
politique
monétaire.
Les
sources
de
différence
dans la
transmission
monétaire
La
transmission
de
la
politique
monétaire
passe
par
plusieurs
canaux,
dont
les
circuits
peuvent
être
différents
d'un
pays
à
l'autre.
L'intensité
de
la
transmission
est
d'abord
liée
à
la
vitesse
et
à
l'ampleur
avec
lesquelles
le
taux
directeur
de
la
banque
centrale
se
répercute
sur
les
taux
qui
sont
appliqués
aux
agents
non
financiers.
Une
source
de
divergence
réside
donc
dans
la
façon
dont
réagissent
les
différents
taux
d'intérêt
à
une
impulsion
de
la
politique
monétaire.
D'autres
sources
de
divergence
peuvent
intervenir
dans
les
répercussions
des
différents
taux
d'intérêt
eux-mêmes,
sur
le
revenu
et
la
richesse.
Les
hétérogénéités
liées
au
marché
du
crédit
L'intégration
plus
grande
des
marchés
financiers,
leur
décloisonnement,
la
création
de
nouveaux
produits
de
finance
directe
ont
partout
renforcé
la
liaison
entre
les
taux
d'intérêt.
La
libéralisation
financière
a
certainement
contribué
à
accroître
cette
transmission
en
créant
davantage
de
produits
de
finance
directs,
à
taux
liés
au
taux
du
marché
monétaire
(billets
de
trésorerie,
certificats
de
dépôts,
etc.)
et
en
limitant
les
produits
à
taux
rigides
et
réglementés.
Le
changement
a
surtout
eu
lieu
dans
les
années
quatre-vingts
en
France
et
en
Italie,
car
en
Angleterre,
le
système
financier
était
déjà
libéralisé
et
en
Allemagne
la
déréglementation
des
taux
d'intérêt
bancaires
était
acquise
de
longue
date.
Dans
les
quatre
pays
actuellement,
l'action
de
la
banque
centrale
sur
le
taux
du
marché
monétaire
se
trouve
plus
directement
répercutée
aux
conditions
appliquées
aux
agents
non
financiers.
Cependant
l'ensemble
des
taux
d'intérêt
ne
varie
jamais
parallèlement.
Il
persiste
des
écarts,
d'ailleurs
irréductibles,
entre
les
taux
d'intérêt
sur
les
différents
marchés
dus
notamment
à
l'imparfaite
substituabilité
des
actifs
sous-jacents.
Il
est
donc
important
d'observer
comment
les
intermédiaires
financiers
modifient
leurs
taux
d'intérêt
à
la
suite
d'un
changement
de
politique
monétaire,
et
aussi
sur
quels
taux
d'intérêt
sont
assis
les
actifs
et
passif
des
agents.
Sur
ces
points,
et
d'une
manière
plus
générale
sur
les
différences
entre
les
marchés
du
crédit
dans
les
pays
européens,
on
pourra
se
reporter
à
Barran,
Coudert
et
Mojon
(1996).
Trois
aspects
sont
examinés
dans
cette
étude,
qu'il
convient
de
rappeler
brièvement
:
l'indexation
des
crédits,
la
répercussion
du
taux
du
marché
monétaire
sur
les
autres
taux
d'intérêt
et
les
contraintes
d'accès
au
crédit.
Premièrement,
concernant
l'indexation
des
crédits,
les
différences
les
plus
frappantes
tiennent
certainement
au
marché
hypothécaire.
Ces
crédits
sont
accordés
majoritairement
à
taux
fixe
en
France,
et
à
taux
variables
en
Italie,
en
Allemagne
et
surtout
au
Royaume-Uni.
Les
hausses
de
taux
d'intérêt
ont
donc
peu
d'incidence
sur
les
ménages
déjà
endettés
en
France
et
au
contraire,
diminuent
le
revenu
des
ménages
endettés
au
Royaume-Uni.
Sur
le
crédit
total,
les
différences
paraissent
fortes
d'un
pays
à
l'autre.
Les
trois
quarts
sont
accordés
à
court
terme
ou
à
taux
ajustables
au
Royaume-Uni
et
en
Italie,
contre
43
%
en
France
et
39
%
en
Allemagne.
Ces
différences
semblent
persister,
puisqu'en
comparant
deux
dates,
1983
et
1993,
Borio
(1995)
ne
constate
pas
de
tendance
à
la
convergence
en
matière
de
pratique
d'indexation
des
taux
du
crédit
d'un
pays
à
l'autre.
L'importance
des
crédits
en
devises
joue
également
un
rôle
et
contribue
sans
doute
à
atténuer
l'effet
interne
de
la
politique
monétaire.
De
même
les
crédits
bonifiés
sont
une
pratique
fréquente,
qui
peut
réduire
l'impact
de
la
transmission
de
la
politique
monétaire
à
certains
secteurs
économiques.
Deuxièmement,
le
taux
du
crédit
bancaire
s'ajuste
à
des
vitesses
variables
au
taux
du
marché
monétaire
dans
les
pays
européens,
même
s'il
est
vrai
qu'à
long
terme,
le
coefficient
est
proche
de
1.
C'est
ce
que
montrent
deux
études
de
Cotarelli
et
Kourelis
(1994)
et
de
Borio
et
Fritz
(1995),
dont
les
résultats
sont
reportés
dans
le
tableau
1.
C'est
au
Royaume-Uni
que
la
répercussion
sur
le
taux
du
crédit
est
la
plus
rapide.
L'effet
est
répercuté
à
plein
au
bout
de
trois
mois,
ce
qui
est
l'effet
le
plus
fort
à
cet
horizon
parmi
les
pays
de
l'OCDE.
En
Allemagne
et
en
Italie,
l'impact
est
nettement
plus
faible
à
court
terme.
C'est
en
France
que
la
réaction
est
la
plus
longue.
42

Tableau
1
:
ajustement
du
taux
d'intérêt
du
crédit
sur
le
taux
du
marché
monétaire
Sources
:
Allemagne
Italie
Royaume-Uni
France
Instantané
(D
0,38
0,11
0,82
n.d.
(2)
0,11
0,26
1,00
0,43
À
trois
mois
(1)
0,67
0,40
1,02
n.d.
(2)
0,45
0,69
1,01
0,45
À
six
mois
(D
0,83
0,61
1,04
n.d.
(2)
0,61
0,84
1,01
0,51
À
long
terme
(D
1,04
1,22
1,04
n.d.
(2)
1,05
1,22
1,01
0,74
Sources
:
(1)
Cotarelli
et
Kourelis
(1994),
p.
16,
modèle
1
,
en
niveau
;
n.d.
:
non
disponible.
(2)
Borio
et
Fritz
(1995)
p.
125
1984-1994.
Tableau
2
:
conditions
d'accès
au
crédit
et
endettement
des
ménages
Apport
personnel
minimum
en
%
de
la
valeur
du
logement
(1980-1987)
Dette
des
ménages
en
%
de
leur
revenu
disponible
(1993)
Allemagne
20
77,9
France
20
51,0
Italie
44
31,4
Royaume-Uni
13
102,0
Sources
:
Japelli
et
Pagano
(1994),
p.
92
et
Kneeshaw
(1995),
p.
12.
Troisièmement,
les
contraintes
d'accès
au
crédit
de
certains
agents,
ménages
ou
petites
et
moyennes
entreprises,
peuvent
donner
lieu
à
des
changements
importants
dans
la
transmission
d'une
politique
monétaire
par
les
taux
d'intérêt.
En
effet,
si
les
agents
sont
contraints
dans
leur
demande
de
crédit,
une
hausse
du
taux
d'intérêt,
à
supposer
qu'elle
soit
répercutée
sur
le
coût
du
crédit,
pourra
susciter
une
baisse
de
la
demande
de
crédit
bancaire,
mais
en
situation
d'excès
de
demande,
cela
ne
se
traduira
pas
nécessairement
par
une
baisse
des
crédits
distribués.
De
nombreuses
études,
liées
au
canal
du
crédit
(Bernanke
et
Blinder,
1992
;
Barran,
Coudert
et
Mojon,
1995a)
montrent
en
effet
qu'une
hausse
du
taux
d'intérêt
n'est
généralement
pas
suivie
immédiatement
d'une
baisse
du
crédit
bancaire.
Naturellement,
plus
le
crédit
est
contraint,
moins
la
politique
monétaire
par
le
taux
d'intérêt
est
efficace,
puisque
les
effets
de
substitution
intertemporelle
sont
limités.
Des
éléments
empiriques
montrent
que
l'accès
au
crédit
est
différencié
pour
les
ménages
européens
en
matière
de
logement.
Jappelli
et
Pagano
(1994)
ont
procédé
à
une
comparaison
internationale
sur
un
échantillon
de
30
pays
en
utilisant
un
indicateur
intéressant
:
il
s'agit
de
l'apport
personnel
initial
requis
pour
un
emprunt
en
vue
de
l'acquisition
d'un
logement.
Pour
les
quatre
pays
européens
qui
nous
intéressent
ici,
le
montant
minimum
de
cet
apport
personnel
par
rapport
à
la
valeur
du
logement
acheté
était
fixé
à
44
%
en
Italie,
20
%
en
France
et
en
Allemagne,
contre
13
%
seulement
au
Royaume-Uni
sur
la
période
1980-1987
(tableau
2).
L'accès
au
crédit
est
donc
très
différent
entre
ces
pays.
Cet
indicateur
est
corrélé
négativement
avec
le
crédit
aux
ménages
rapporté
à
leur
revenu.
Plus
l'indicateur
d'apport
initial
est
élevé,
plus
l'accès
des
ménages
au
crédit
est
contraint,
et
plus
faible
est
le
ratio
d'endettement
des
ménages.
La
confrontation
avec
les
statistiques
plus
récentes
d'endettement
des
ménages
de
Kneeshaw
(1995)
montre
que
ces
asymétries
persistent
encore.
Les
ménages
sont,
proportionnellement
à
leur
revenu
disponible,
faiblement
endettés
en
Italie,
davantage
en
France
et
en
Allemagne
et
beaucoup
plus
fortement
au
Royaume-Uni
(tableau
2).
Effets
revenus
et
effets
richesse
Toute
variation
des
taux
d'intérêt
produit
mécaniquement
une
modification
du
revenu
des
agents
proportionnelle
aux
différents
stocks
d'actifs
mais
aussi
de
dettes
qu'ils
détiennent.
Les
effets
directs
se
répercutent
dans
les
flux
d'intérêts
reçus
ou
versés.
Mais
là
aussi
les
divergences
de
pays
à-
pays
sont
importantes
pour
plusieurs
raisons.
D'abord,
les
différents
agents
sont
plus
ou
moins
créditeurs
ou
débiteurs.
Cette
hétérogénéité
se
constate
aisément
au
vu du
tableau
2
en
ce
qui
concerne
les
dettes
des
ménages
et
du
tableau
3
pour
ce
qui
est
de
leur
richesse
financière,
mais
ceci
est
aussi
valable
pour
la
dette
des
entreprises
et
des
États.
Ensuite,
les
actifs
sont
détenus
en
proportion
variable
sous
forme
de
dépôts
bancaires,
d'obligations
ou
d'actions.
Les
dettes
sont
contractées
à
plus
ou
moins
long
terme,
sous
forme
de
crédit
bancaire
ou
d'obligations
;
d'où
des
effets
revenus
variables
d'un
pays
à
l'autre.
Les
flux
d'intérêt
versés
et
reçus
par
les
ménages
dépendent
de
la
répartition
de
leurs
actifs
et
dettes
ainsi
que
des
taux
d'intérêt
pratiqués
dans
les
pays.
Le
tableau
4
montre
que
leur
ampleur
est
assez
différente
dans
les
quatre
pays
étudiés
ici.
Naturellement
dans
les
pays
à
forte
inflation
et
à
taux
d'intérêts
nominaux
élevés,
on
peut
s'attendre
à
ce
que
les
flux
d'intérêts
bruts
soient
importants.
Les
ménages
italiens
sont
ceux
qui
perçoivent
le
plus
d'intérêts
bruts
en
%
de
leur
revenu
(16
%
en
1992),
et
leur
endettement
étant
limité,
ce
sont
eux
qui,
de
loin,
perçoivent
le
plus
d'intérêts
nets,
(11,3
%
de
leur
revenu
disponible
en
1992).
Pour
les
ménages
britanniques,
les
flux
d'intérêts
représentent
une
part
importante
du
revenu,
tant
pour
les
intérêts
reçus
(15,8
%)
que
pour
les
versés
.
43
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%