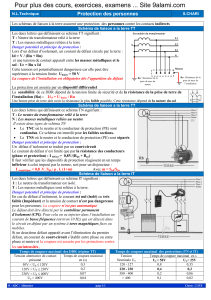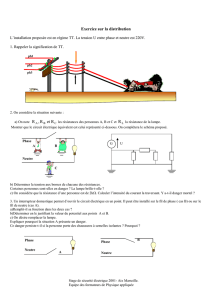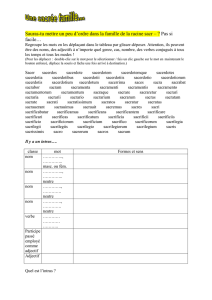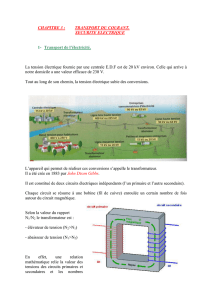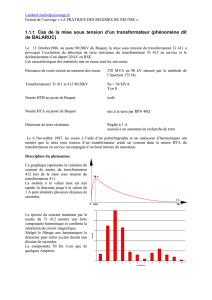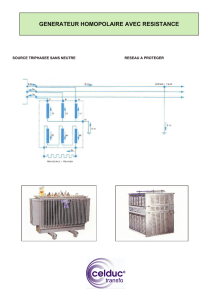Réseaux de distribution: Structure et planification

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique D 4 210 − 1
D 4 210 12 - 1991
Réseaux de distribution
Structure et planification
par Philippe CARRIVE
Ingénieur de l’École Nationale Supérieure des Ingénieurs Électriciens de Grenoble
Ingénieur à EDF GDF SERVICES ASNIÈRES
a fonction générale d’un réseau électrique est d’acheminer l’énergie
électrique des centres de production jusque chez les consommateurs et,
l’électricité n’étant pas directement stockable (dans ce traité, article Stockage
de l’électricité dans les systèmes électriques [D 4 030]), d’assurer la liaison à tout
instant dans l’équilibre production-consommation.
De plus, le réseau a un rôle de transformation, puisqu’il doit permettre de livrer
aux utilisateurs un bien de consommation adapté à leurs besoins, le produit
électricité, caractérisé par :
— une puissance disponible, fonction des besoins quantitatifs du client ;
— une tension fixée, fonction de cette puissance et du type de clientèle ;
— une qualité traduisant la capacité à respecter les valeurs et la forme prévues
de ces deux paramètres et à les maintenir dans le temps.
1. Généralités................................................................................................. D 4 210 - 2
1.1 Structure générale d’un réseau. Hiérarchisation par niveau de tension — 2
1.2 Réseaux de distribution : objectifs généraux............................................ — 2
2. Options techniques fondamentales.................................................... — 3
2.1 Choix du système et de la fréquence......................................................... — 3
2.2 Distributions triphasée et monophasée..................................................... — 3
2.3 Choix de la moyenne tension..................................................................... — 3
2.4 Choix de la basse tension ........................................................................... — 6
2.5 Régimes de neutre MT................................................................................ — 6
2.6 Régimes de neutre BT................................................................................. — 8
2.7 Choix du courant maximal de court-circuit............................................... — 8
3. Architecture des réseaux de distribution ......................................... — 9
3.1 Choix de l’architecture des réseaux........................................................... — 9
3.2 Postes sources de la MT ............................................................................. — 9
3.3 Réseaux MT.................................................................................................. — 12
3.4 Postes MT/ BT............................................................................................... — 16
3.5 Réseaux BT................................................................................................... — 19
3.6 Contrôle-commande associé aux réseaux ................................................ — 19
3.7 Évolution des réseaux de distribution ....................................................... — 21
4. Planification des réseaux de distribution ......................................... — 21
4.1 Enjeux. Contexte politico-économique...................................................... — 21
4.2 Calcul technico-économique ...................................................................... — 22
4.3 Connaissance des charges.......................................................................... — 23
4.4 Qualité du produit électricité ...................................................................... — 25
4.5 Méthodologie. Outils informatiques.......................................................... — 28
4.6 Organisation et nature des études de planification.................................. — 29
4.7 Planification budgétaire des investissements........................................... — 30
5. Conclusion ................................................................................................. — 31
6. Annexe A : ouvrages de distribution EDF
(statistiques au 1er janvier 1990) ........................................................ — 31
7. Annexe B : caractéristiques des réseaux et de la qualité
du produit électricité (1986)................................................................. — 32
L

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ______________________________________________________________________________________________________________
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
D 4 210 − 2© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique
1. Généralités
1.1 Structure générale d’un réseau.
Hiérarchisation par niveau de tension
Dans les pays dotés d’un système électrique élaboré, le réseau
est structuré en plusieurs niveaux (figure 1), assurant des fonctions
spécifiques propres, et caractérisés par des tensions adaptées à ces
fonctions.
■Les réseaux de transport à très haute tension (THT) transportent
l’énergie des gros centres de production vers les régions consomma-
trices (de 150 à 800 kV, en France 400 et 225 kV). Ces réseaux sont
souvent interconnectés, réalisant la mise en commun de l’ensemble
des moyens de production à disposition de tous les consommateurs.
■Les réseaux de répartition à haute tension (HT) assurent, à
l’échelle régionale, la desserte des points de livraison à la distribution
(de 30 à 150 kV, en France 90 et 63 kV).
■Les réseaux de distribution sont les réseaux d’alimentation de
l’ensemble de la clientèle, à l’exception de quelques gros clients
industriels alimentés directement par les réseaux THT et HT. On
distingue deux sous-niveaux :
— les réseaux à moyenne tension (MT) : 3 à 33 kV ;
— les réseaux à basse tension (BT) : 110 à 600 V.
Il est à noter que les choix des différents niveaux de tension
résultent directement de l’optimisation des volumes d’ouvrages au
regard de la fonction à assurer, les tensions les plus élevées étant
les plus adaptées au transport de quantités d’énergie importantes
sur de longues distances.
Dans le présent article, sont traités les réseaux de distribution, les
autres réseaux étant développés dans l’article Réseaux de transport
et d’interconnexion de l’énergie électrique. Développement et
planification [D 4 070].
1.2 Réseaux de distribution :
objectifs généraux
1.2.1 Traité de concession. Service public
Dans pratiquement tous les pays, la distribution de l’électricité fait
l’objet d’une concession attribuée au distributeur par la puissance
publique. Le sociétés concessionnaires, qu’elles soient publiques ou
privées, ont le bénéfice du monopole sur un territoire fixé.
Cette situation de monopole permet de développer un réseau de
distribution optimal pour la collectivité. En contrepartie de ce mono-
pole, ces sociétés sont assujetties à un certain nombre d’obligations
constitutives de leur mission de service public.
En France, cette mission impose notamment le respect de deux
règles fondamentales :
—règle d’égalité : service de l’électricité dans des conditions
égales pour tous (égalité de traitement et d’accès), dès lors que les
besoins desservis sont semblables ;
—règle de continuité : fonctionnement sans interruption du
service de l’électricité (sauf cas de force majeure).
Les cahiers des charges relatifs aux traités de concessions pré-
cisent ainsi l’ensemble des règles qui définissent les performances
de base dont doivent être capables les réseaux de distribution, en
tant qu’outil principal du distributeur.
1.2.2 Priorités liées au contexte socio-économique
Si le respect des cahiers des charges est un objectif fondamental
que doit viser à remplir le réseau, les priorités en matière de dévelop-
pement de réseau peuvent être variables en fonction de l’environ-
nement social, technique, économique et écologique auquel est
confronté le distributeur.
Dans la suite de cet article, on se référera à cette classification
des tensions, couramment utilisée.
Néanmoins, il convient de signaler que la récente publication
UTE C 18-510 relative à la sécurité sur les ouvrages électriques,
applicable en France depuis janvier 1989, définit de nouveaux
domaines de tension. En courant alternatif, ces domaines sont :
— domaine haute tension (HT) :
• HTB .................................................................... Un > 50 000
• HTA........................................................1 000 < 50 000
— domaine basse tension (BT)
• BTB...........................................................500 < 1 000
• BTA.............................................................50 < 500
• domaine très basse tension (TBT)................... 50
avec Un tension nominale (valeur efficace en volts).
Un
Un
Un
Un
Figure 1 – Hiérarchisation d’un réseau

_____________________________________________________________________________________________________________ RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique D 4 210 − 3
Suivant le niveau de développement du pays, la distribution se
situe dans un contexte différent. On distingue généralement trois
phases :
— la phase électrification, dans laquelle le souci essentiel consiste
à créer et étendre le réseau sur l’ensemble du territoire pour satisfaire
les besoins élémentaires de la population (l’éclairage
principalement) ;
— la phase croissance, dans laquelle le réseau doit suivre la
demande spontanée en énergie électrique, liée à l’expansion écono-
mique du pays (développement quantitatif) ;
— la phase qualité, dans laquelle le réseau doit répondre à des
exigences accrues de la clientèle, liées au développement des usages
de l’électricité dans les domaines les plus divers (développement
qualitatif) et, particulièrement, dans les techniques de pointe ; ce
souci de la qualité est d’autant plus important, qu’il est une condition
de l’augmentation des ventes dans un contexte où, en raison de la
saturation relative des usages captifs, la pénétration de l’électricité
se fait de plus en plus dans les secteurs concurrentiels.
La France, après avoir successivement connu les deux premiers
stades, se situe depuis quelques années dans cette troisième phase.
Il convient, également, de prendre en compte, dans la conception
et la réalisation des réseaux, d’autres aspects, notamment :
— la sécurité des personnes (exploitants ou tiers) ;
— les contraintes relatives à l’environnement (écologie, encom-
brement).
2. Options techniques
fondamentales
2.1 Choix du système et de la fréquence
■Historiquement, et notamment dans beaucoup de grandes villes
des pays industrialisés, c’était le courant continu qui était utilisé
dans les premiers réseaux de distribution.
L’évolution technologique des moyens de production, la faculté
d’adapter les tensions aux puissances au moyen de transformateurs,
l’avantage que procure le passage par zéro du courant pour couper
celui-ci dans les disjoncteurs ont conduit depuis longtemps déjà à
utiliser le courant alternatif dans les réseaux de distribution, et cela
de manière quasi universelle.
À Paris, par exemple, les derniers réseaux à courant continu ont
disparu vers 1965. Ceux-ci n’étaient d’ailleurs plus développés
depuis 1930, ce qui montre le poids de l’histoire dans les structures
de réseaux.
■Par le passé, des fréquences diverses ont été utilisées à travers le
monde. Actuellement, il n’en reste que deux : 50 Hz, notamment en
Europe, et 60 Hz, principalement en Amérique du Nord.
Notons qu’une valeur commune de la fréquence a l’avantage
capital de permettre une interconnexion internationale des réseaux
de transport, ce qui est effectivement largement le cas en Europe.
Le cahier des charges français spécifie une tolérance de ± 1 Hz
autour de la valeur nominale. Dans la réalité, et du fait de l’inter-
connexion, les écarts enregistrés sont beaucoup plus faibles (de
l’ordre de 0,1 Hz en exploitation normale).
Les baisses de fréquences sont liées à un déséquilibre accidentel
entre production et consommation, la production devenant insuf-
fisante.
2.2 Distributions triphasée et monophasée
Un avantage bien connu des systèmes électriques triphasés est
de permettre le transport de la même quantité d’énergie avec une
section conductrice totale deux fois moindre qu’en système
monophasé.
L’intérêt économique découlant de ce principe fait que, dans les
pays industrialisés, la distribution MT est très généralement
triphasée, tout au moins sur les lignes d’ossature.
Néanmoins, sur des dérivations desservant des charges faibles et
dispersées, les transits étant faibles par rapport aux capacités
électriques des conducteurs, même de faible section (la limite infé-
rieure étant liée à des considérations de tenue mécanique),
l’alimentation monophasée peut être intéressante économiquement
(2 fils au lieu de 3).
En vertu de ces principes, et en fonction des topologies
rencontrées, on distingue, à travers le monde, différents systèmes
de distribution MT. Citons principalement (figure 2) :
— le système nord-américain (figure 2a) à neutre distribué direc-
tement mis à la terre ; l’ossature triphasée est composée de quatre
fils, et les dérivations, à distribution monophasée entre phase et
neutre, comportent un ou plusieurs fils de phase, suivant la puis-
sance à desservir, plus le neutre ;
— le système utilisé par exemple en Grande-Bretagne ou en
Irlande (figure 2b), qui à partir d’ossatures triphasées à trois fils
sans neutre distribué alimente des dérivations qui peuvent être à
deux fils de phase ;
— le système australien (figure 2c), particulièrement écono-
mique, est constitué d’ossatures à trois fils sans neutre distribué,
avec, entre autres, des dérivations monophasées à un seul fil avec
retour par la terre (cette solution nécessite une faible résistivité du
sol) ;
— le système français (figure 2d), entièrement triphasé en
ossatures et dérivations, à neutre non distribué.
Il est à noter que, à ces différents systèmes, doivent être associés
des dispositifs de protection contre les défauts électriques adaptés,
dont la mise en œuvre est plus ou moins aisée, mais que nous ne
détaillerons pas ici (articles Protection des réseaux [D 4 800]
[D 4 810] [D 4 815] [D 4 820] dans ce traité).
Nota : signalons au passage, l’existence à Paris, de réseaux diphasés, liés à des errements
anciens et destinés à disparaître à terme.
2.3 Choix de la moyenne tension
Le choix d’une moyenne tension est une décision stratégique
engageant l’avenir, lourde de conséquences quant à la structure et
à l’évolution des réseaux et ayant un impact économique important.
La volonté de standardiser les matériels, pour des raisons
d’exploitation, d’approvisionnement et de réduction des prix de
revient au niveau des constructeurs, conduit naturellement à limiter
le plus possible le nombre de MT à mettre en œuvre sur les réseaux.
On voit ainsi que l’évolution d’un réseau de distribution est
conditionnée par le respect de trois objectifs fondamentaux,
même si les priorités sont variables :
—la desserte de la clientèle ;
—l’aptitude à faire face au développement de la consom-
mation ;
—la recherche d’une qualité du produit électricité adaptée
aux besoins de la clientèle (si nécessaire au-delà des spécifica-
tions des cahiers des charges de concession).
Et, bien évidemment, cela doit se faire au coût le plus faible
(coûts d’investissements, d’exploitation et d’entretien).

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ______________________________________________________________________________________________________________
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
D 4 210 − 4© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique
Figure 2 – Différents modes de distribution

_____________________________________________________________________________________________________________ RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique D 4 210 − 5
De plus, la coexistence de plusieurs tensions pose des problèmes
de jonctions entre les portions de réseaux de tensions différentes,
limitant ainsi la souplesse d’exploitation (secours mutuel compliqué
en cas d’incident) et restreignant les possibilités de développement
des réseaux.
2.3.1 Critères de choix de la MT
■Sur le plan théorique, les tensions élevées présentent des
avantages incontestables :
— dans les zones urbaines à densité de charge élevée, les
distances de desserte sont faibles, mais les puissances à desservir
importantes ; les contraintes essentiellement rencontrées sont les
limites dues à l’intensité du courant admissible dans les câbles ; à
section de conducteur égale, la charge pouvant être desservie est
directement proportionnelle à la tension du réseau ;
— dans les zones rurales à faible densité de charge, les problèmes
sont rarement liés aux contraintes de courants admissibles dans les
conducteurs, mais aux chutes de tensions admissibles en bout de
ligne, les longueurs des conducteurs étant beaucoup plus impor-
tantes qu’en milieu urbain ; à section et longueur de conducteur
égales, la charge pouvant être desservie est directement propor-
tionnelle au carré de la tension du réseau ;
— de plus, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, à puis-
sance desservie égale, une tension plus élevée a l’avantage de
diminuer les pertes Joule dans les conducteurs.
On voit donc que les tensions élevées sont bien adaptées à la
fois en zones rurales et urbaines, surtout si les charges à desservir
sont importantes.
Néanmoins, il existe un facteur limitatif essentiel, qui est le coût
des ouvrages associé à la tension. Cela est vrai pour les réseaux
aériens ruraux, la taille des ouvrages augmentant avec la tension,
mais cela l’est encore plus en milieu urbain. En effet, les problèmes
liés aux techniques des réseaux souterrains (câbles, matériels de
coupure) et les contraintes d’encombrement font que la mise en
œuvre des matériels de tension élevée, particulièrement lorsque
l’on dépasse 20 kV pour atteindre 30 kV et plus, devient rapidement
coûteuse et délicate.
■La tension optimale de desserte résulte fondamentalement
d’un compromis entre charge à desservir et coût des ouvrages.
D’une façon générale, en Europe notamment, on peut classer les
tensions en trois groupes.
— Les tensions comprises entre 10 et 15 kV, plus particulièrement
utilisées dans les distributions urbaines, ont longtemps eu
l’avantage, contrairement aux tensions plus élevées, de permettre
l’utilisation de câbles souterrains simples, sûrs et bon marché. La
valeur limitée du rayon d’action des lignes à ces tensions rend néces-
saire l’utilisation d’une tension de répartition pour les zones rurales.
— Les tensions voisines de 20 kV peuvent être utilisées aussi bien
dans les distributions urbaines, grâce aux performances apportées
par des câbles maintenant sûrs et économiques, que dans les
distributions rurales, grâce au rayon de desserte des lignes
aériennes ; elles assurent une capacité de desserte beaucoup plus
étendue que celles du groupe précédent.
— Les tensions comprises entre 30 et 35 kV, d’utilisation difficile
dans les distributions urbaines par suite de l’encombrement de
l’appareillage et des transformations, et du coût des câbles, ont
retrouvé un regain d’intérêt pour la distribution en lignes aériennes
dans les zones d’habitat dispersé à faible densité de charge. La
capacité et le rayon de desserte des lignes à 30 kV leur permettent
également, pour ces mêmes zones, de jouer un rôle de répartition,
voire de transport pour les régions en début d’électrification.
Par ailleurs, les perspectives de développement des charges sont
un élément déterminant. En théorie, il y a une tension de desserte
optimale à un instant donné, fonction de la charge à desservir à ce
moment-là (schématiquement, en milieu rural tout au moins, elle
est proportionnelle à la racine carrée de la charge). Cependant la
décision de choix d’une tension doit couvrir une large période (de
l’ordre de 30 ans et plus), compte tenu de l’ampleur financière et
technique d’une opération de changement de niveau de tension, et
de l’inertie qui en découle.
On voit donc qu’un compromis doit être recherché sur la période,
qui peut en général conforter le choix d’une tension élevée, surtout
pour les pays ayant une forte croissance.
La Commission Électrotechnique Internationale (publication 38
de la CEI) a donc été amenée à normaliser une gamme de tensions
visant à regrouper les techniques et les marchés autour de valeurs
qui résultent d’un compromis entre ce qui existe dans le monde et
ce qui va se développer (tableau 1). (0)
La qualité de service est également un facteur qui intervient. En
zone rurale, des tensions de l’ordre de 30 kV ne sont intéressantes
que pour alimenter des départs de grandes longueurs issus de postes
sources à grands rayons d’action. Si, pour des raisons de qualité
de service, on veut diminuer les longueurs de départs (les défauts
éventuels affecteront d’autant moins de clients), et c’est notamment
la politique appliquée en France, la tension de 20 kV est alors
préférable.
2.3.2 Exemple du choix français
■En France, la décision a été prise, en 1962, de normaliser la
tension MT à la valeur unique de 20 kV, sur l’ensemble des réseaux
aériens et souterrains. Mais le choix de cette option est l’épilogue
d’une longue histoire.
Après la Seconde Guerre mondiale, il existait sur le territoire
français un grand nombre de moyennes tensions. On trouvait, par
exemple, en triphasé :
10 ; 11 ; 13,5 ; 15 ; 16,5 ; 17,3 ; 18 ; 22 kV
Les premières directives de normalisation n’ont retenu que 5
valeurs possibles, soit :
• 5,5 ; 10 ; 15 et 20 kV pour les réseaux de distribution MT propre-
ment dits, en considérant la tension de 15 kV comme préférentielle ;
• 30 kV pour les réseaux de sous-répartition MT.
En 1960, 85 % des longueurs des réseaux MT étaient exploitées
à l’une des 5 tensions normalisées et, parmi celles-ci, le réseau à
15 kV en représentait 52 %.
En réalité, beaucoup de réseaux fonctionnant à des tensions infé-
rieures à 15 kV étaient équipés de matériel prévu pour 15 kV (matériel
de tension spécifiée 17,5 kV). Cependant, il apparaissait que cette
tension de 15 kV était peu répandue sur le plan international.
Les résultats positifs d’études basées sur des essais de tenue du
matériel à 15 kV sous 20 kV, poursuivies sur plusieurs années, ont
été un critère essentiel du choix de 20 kV.
En 1991, les réseaux exploités à 20 kV représentent plus de 75 %
de l’ensemble des réseaux MT français. C’est d’ailleurs dans les
zones urbaines que l’inertie dans le transfert à 20 kV est la plus
forte, la rentabilité du changement n’étant pas, dans certains cas,
facilement justifiable sur le plan local.
Tableau 1 – Gamme normalisée (CEI)
des moyennes tensions
Réseaux triphasés sans neutre Réseaux triphasés avec neutre
11 kV ou 10 kV 12,5 kV ou 13,5 kV
22 kV ou 20 kV 25 kV
33 kV ou 35 kV 34,5 kV
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%