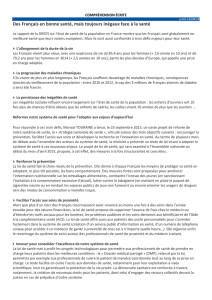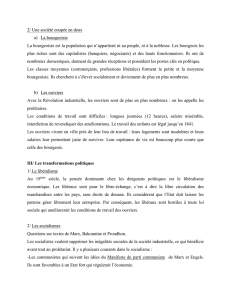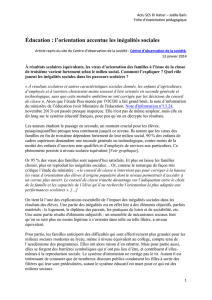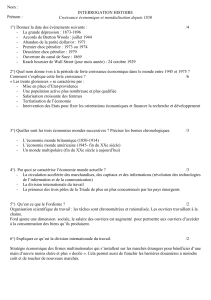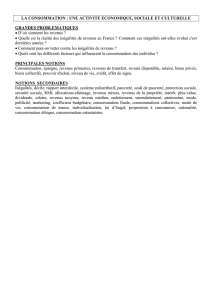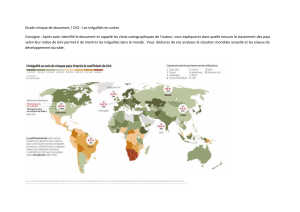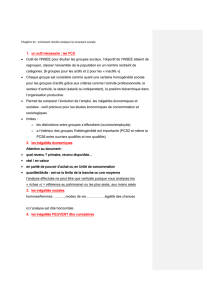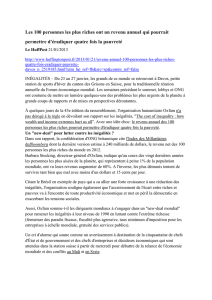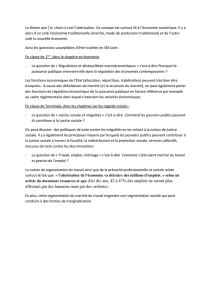c. La grande bourgeoisie : une « classe sociale mobilisée

Thème n°2 socio :
Les stratifications sociales
Il s’agit d’un thème d’actualité : depuis le milieu des années 90, la question des fractures et les
inégalités voire même des classes sociales est très présente dans débat intellectuel et
scientifique, mais aussi dans l’espace public. En général, les études concluent un accroissement
des inégalités sociales dans la période contemporaine, à une société plus morcelée et segmentée
à travers différents indicateurs : les inégalités scolaires, les discriminations raciales ou ethniques,
la ségrégation résidentielle, l’opposition entre précaires et stables…
Il existe deux types de définition de la notion de stratification sociale :
- une première plutôt large correspond aux manières dont on peut penser, conceptualiser
et mesurer les inégalités dans la société. Maints se pose notamment la question des
conflits entre différentes classes sociales.
- une deuxième, plus restrictive, mais plutôt en avant l’existence d’une société avec des
différences de position qui ne débouchent pas nécessairement sur des conflits entre
groupes sociaux.
Ces deux approches peuvent se résumer par une série de couples d’opposition : une structure
sociale considérée comme constituée d’éléments homogènes (individus ou positions sociales) et
une structure sociale envisagée comme un ensemble de groupes distincts ; entre des positions
potentiellement similaires est proche et des positions fondées sur l’opposition et la distinction ;
entre un schéma de base est l’individu et un autre où ce groupe ; entre la mise en évidence de la
compétition individuelle et de la fluidité sociale et celle de la prédominance des antagonismes
collectifs à travers les conflits sociaux.
Dans « La classe comme représentation et comme volonté », in Cahiers internationaux de
sociologie, 1965, Raymond ARON en 1964 considérer que les classes sociales se caractérisaient
de trois manières : « une communauté objectivement saisissables » ( qui correspond la classe en
soi de Marx ; « une consistance à travers la durée de ces êtres collectifs (fermeture ou ouverture,
la classe étant plus forte si moins ouverte) » ; « une prise de conscience de ces êtres collectifs par
eux-mêmes » ( qui correspond à la classe pour soi chez Marx. Cette triple définition de la sociale
est reprise notamment par Louis CHAUVEL qui distingue « l’identité temporelle » (reproduction
et stabilité du groupe), « l’identité culturelle » et « l’identité collective »( capacité à agir
collectivement pour défendre ses intérêts) (« Le retour des classes sociales ? », Revue de l’OFCE,
2001).
Il y a donc un certain consensus parmi les sociologies français pour définir les classes sociales à
partir de ces trois dimensions (position d’utile, conscience de classe et action collective). Les
désaccords portent sur le poids relatif à accorder à chacun de ces trois critères. Mais les
désaccords porte surtout sur la validité et la pertinence des approches en termes de classes
sociales pour penser la société française contemporaine. On retrouve la le débat entre les deux
approches en termes de stratification sociale.
Précisons que la notion de groupe social se distingue de celle de classe sociale :
- la construction des groupes socioprofessionnels fonctionne par assemblage de
profession dans des catégories puis des groupes, alors que les classes sociales sont
identifiées par leur reconnaissance dans la réalité sociale : il y a donc une approche
nominaliste et une approche réaliste.
- La notion de groupe social se restreint à la position dans le travail tandis celle de classes
sociales se réfèrent à une identité sociale qui déborde le statut professionnel (Elle inclut
des éléments culturels…)
Dans la bibliographie, trois grands pôles structurants qui s’ordonnent de façon chronologique
sont traités :

- le premier pôle correspond aux auteurs considérés comme classiques ou jugés dans
l’analyse des stratifications sociales : Marx, Halbwachs, Weber…
- un second pôle invite à penser et observer la diversification des paradigmes en matière
de stratification sociale : on retrouve alors les auteurs qui se réfèrent à une approche
classiste ( Bourdieu, Hoggart, Touraine, Dahrendorf…) ; et les auteurs qui proposent
une entrée stratificationniste (Boudon, Vallet, Mendras, Dirn…)
- un troisième pôle d’ouvrage se concentre sur la belle la plus contemporaine avec
surtout des enquêtes empiriques plus d’un renouveau théorique. Ces enquêtes peuvent
porter sur les ségrégations spatiales et ethniques (Maurin, Donzelot, Préteceille,
Fassin…) ; scolaires (Euriat et Thélot, Albouy et Wanecq, Merle…) ; l’accroissement
désigne l’idée de revenus (Piketty, Landais) ; le renforcement des formes d’exclusion du
marché du travail (Castel…) ; l’opposition entre les précaires et stables (Maurin) ; les
inégalités intergénérationnelles (Peugny)….Le développement de ces études empiriques
n’empêche pas l’existence d’une approche classiste : plusieurs auteurs dans la
bibliographie insiste sur la vitalité de cette manière de penser comme Chauvel, Pinçon-
Charlot, Amosse et Chardon…
De plus, il faut tenir compte de certaines études sur certains groupes socioprofessionnels : les
paysans à travers Mendras et Hervieu; les ouvriers (Terrail) ; les employés (Chenu) ; cadres
(Bouffartigues)…
Ajoutons que dans la bibliographie, peu de place est accordée aux approches historiques ou
sociaux historiques (par exemple, l’ouvrage de Noiriel sur les ouvriers par la société française au
XIX-XXè siècle (1986) n’apparaît pas), aux approches ethnographiques ( à l’exception d’Hoggart
et de Pinçon-Charlot, rien sur les ouvriers (Beaud et Pialoux), les ouvriers ruraux (Renahy), les
classes populaires (Schwartz…)). Presque rien n’apparaît sur les inégalités liées au sexe (lire
Maruani à ce sujet). Peu de chose sur les inégalités dans les pratiques culturelles (Notamment les
études de Donnat). Ces différents manques peuvent nécessiter des lectures supplémentaires
à la bibliographie.
Chapitre n°1 – Diviser le monde social en « classes » ?
Transformations socio-économiques et débats intellectuels
(19è- Première moitié du 20è)
Ce premier chapitre recouvrent un double objectif : d’une part revenir sur les transformations
socio-économiques du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle ; d’autre part, préciser
les outils intellectuels mobilisés pour penser ces transformations.
1. les fondements économiques et politiques d’une société de classes au
XIXe siècle
a. D’une société d’ordres à une société de classes
Sous l’Ancien Régime, la notion « d’ordre » renvoie à une division politico-juridique de la société.
En France, il s’agit du fameux critique ordre ecclésiastique, ordre aristocratique (ou noblesse) et
du tiers état. La perpétuation de cette société s’opère par l’hérédité et la propriété des terres.
Au même moment, soit au XVIe et au XVIIe siècle, le terme de « classe » correspond à celui de
catégories de citoyens rangés selon leur fortune. Catégories et classes sont synonymes. Ce n’est
qu’au XIXe siècle en France que le terme de classe s’autonomise et se diffuse : il est entendu au
sens de divisions sociales et économiques. Il se distingue alors de la notion d’ordre : d’une part, il
renvoie moins à une hiérarchisation juridico-politique qu’à une hiérarchisation économique et

sociale ; d’autre part, il fait référence à une société fondée sur le contrat social et non pas sur un
ordre traditionnel héréditaire.
Alexis DE TOCQUEVILLE pense le passage des sociétés aristocratiques aux sociétés
démocratiques et leurs conséquences sur les rapports sociaux. Deux principaux ouvrages : de la
démocratie en Amérique (1835) et l’Ancien Régime et la Révolution (1856).
Né en 1805 à Paris, il vient d’une famille d’aristocrates. Critique face au non-respect des droits et
des règles qui encadraient le pouvoir de Charles X, il se retrouve en porte-à-faux vis-à-vis du
monde politique et par en Amérique en 1832. À son retour il publie en 1835 le premier tome de
De la démocratie en Amérique et le deuxième tome en 1839. Il entame alors une carrière politique
et se retrouve le député en 1837. Il se rallie plus tard à à l’opposition de gauche favorable à
l’extension du suffrage. Tocqueville est donc favorable aux réformes progressives des institutions
politiques et à l’amélioration des conditions d’existence des ouvriers. Avec l’arrivée de Napoléon
en 1852, il se retire du jeu politique.
À travers ces ouvrages, il se pose la question de savoir quelles sont les bonnes formes de
gouvernement, quels mouvements permettent la démocratisation de la vie politique et
l’apparition sur la scène politique de la classe ouvrière.
Le point de départ de sa réflexion est centré sur les changements de systèmes politiques,
notamment les sociétés démocratiques. Dans De la démocratie en Amérique, il souligne que «
l’État social démocratique » n’abolit pas à « les classes », mais change la nature des rapports
sociaux ( il définit la notion de classe de manière très lâche au sens de catégories sociales définies
selon des critères variables (juridiques, économiques…) il peut renvoyer à l’opposition entre
« maîtres » et « serviteurs » mais aussi aux ordres, aux castes… Le terme de classe n’est pas
encore autonomisé et fixé). En effet, c’est la nature des divisions sociales qui change : alors que
dans les sociétés aristocratiques, les rapports sociaux sont fixés juridiquement par l’hérédité des
positions, le rapport social est de nature contractuel dans les sociétés démocratiques. Ouvre
illustrer ce raisonnement, il prend l’exemple du maître et du serviteur : dans les sociétés
aristocratiques, le il y a une perpétuité dans la condition de mettre et le serviteur, alors que dans
la société démocratique, l’un est serviteur de l’autre dans les limites du contrat fixé car, en dehors
de ce contrat, ce sont deux citoyens.
Dans son ouvrage de 1856 l’Ancien Régime et la Révolution, il cherche à comprendre l’origine de
la révolution française et, en contrepoint, à critiquer le despotisme de l’ancien régime. Le roi lui,
la révolution s’explique comme un moment d’ajustement entre l’état social et l’état politique de la
société. En effet, la monarchie absolue a encouragé le peuple à s’opposer à l’aristocratie et donc
a favorisé 1+ grande égalité politique alors que, dans le même temps, elle a ruiné les pouvoirs
intermédiaire et donc les mécanismes de démocratisation. Cette dynamique contradictoire a
entraîné un réajustement entre les sculptures sociales et les institutions politiques violent. En
témoignent par exemple la remise en cause du système et les droits féodaux : par exemple, Le
système des droits féodaux est inacceptable pour les paysans alors que les seigneurs ont perdu
leurs pouvoirs politiques et que les paysans sont en situation d’acquérir leurs terres. On voit bien
alors comment les inégalités sociales ne sont plus tolérées alors qu’un mécanisme d’égalisation
des droits politiques se met en place.
La Révolution s’appuie sur des logiques d’opposition et le conflit entre groupes sociaux.
Tocqueville montre par exemple comment l’aristocratie, à qui la monarchie a repris la plupart
des pouvoirs politiques et que la bourgeoisie concurrence dans le domaine économique, devient
une caste perdant ses pouvoirs réels.
Il observe que les oppositions de glace s’adoucissent dans les sociétés démocratiques sur un
temps long. Dans les sociétés aristocratiques, il y a peu de pension tant que le décalage entre
Célestin BOUGLE dans Essai sur le régime des castes (1908) définit les castes à travers trois dimensions : la répulsion (
la société ne tolère pas le mélange de sang) ; la hiérarchie et la spécialisation héréditaire. La notion de caste repose
donc sur une structuration hiérarchique de la société et une reproduction sociale élitaire stricte de groupes sociaux
hermétiques entre eux. De ce point de vue, il considère que les sociétés d’ordres de l’ancien régime ne sont pas des
castes (même s’il peut exister des similitudes) : par exemple, le clergé n’est pas une caste car avec le principe du célibat,
il est contraint de recruter en dehors de son corps.

l’État social et la politique n’est pas trop important ( qui se le long de nous ne ni un jouetant que
les individus perçoivent les hiérarchies de manière naturelle). En revanche dans les sociétés
démocratiques, s’il peut y avoir dans un premier temps une montée des antagonismes, dans un
second temps, le il y a une égalisation des conditions qui atténuent les différences de classe et
entraîne le développement d’une classe moyenne.
b. Mutations économiques et formation des classes sociales au XIXè siècle
Pour simplifier, on distingue trois tendances dans les mutations économiques depuis du XVIe
siècle : une phase de proto- industrialisation qui s’appuyait sur ce que l’on appelle le domestic
system (des marchands fabricants salarient des travailleurs indépendant chez eux, la plupart du
temps hors des villes) ; un développement du commerce par le biais de la colonisation ; un essor
de la finance qui renforce le capitalisme marchand.
Le progrès technique joue un rôle essentiel dans l’émergence d’une industrie moderne et le
développement de l’économie sous la forme du marché. Plusieurs cycles d’innovations
technologiques ont lieu : au milieu du XIXe siècle, le développement du chemin de fer et le
progrès de la métallurgie ; à la jointure entre le 19e et 20e, le développement du moteur à
combustion, de l’électricité, du progrès dans la chimie et la sidérurgie et dans les
communications avec le téléphone…
C’est dans ce contexte que se développe la fabrique avec de nouveaux rapports sociaux
déterminés par la séparation du capital et du travail et caractérisé par l’apparition de
l’entrepreneur et de l’ouvrier.
Ces mutations économiques entraînent un changement dans les structures sociales : croissance
du groupe des ouvriers ; marginalisation progressifs des actifs agricoles, notamment des
ouvriers agricoles ; la bourgeoisie supplante l’aristocratie au cours du XIXe siècle ; la montée en
puissance des salariés et plus tardive (elle s’opère à la veille de la première guerre mondiale
avec le développement des grands magasins puis dans l’entre-deux-guerres avec la croissance
des administrations et la bureaucratisation des entreprises).
Il faut faire attention à cette schématisation pour deux raisons : ce récit applique à des catégories
des représentations comme la distinction salarié/employeur qui n’est pas encore fixée au XIXe
siècle ; D’autre part, ces dynamiques relativement générales ne s’imposent pas partout au même
rythme ni avec les mêmes formes : par exemple elles sont beaucoup plus rapide en Angleterre
qu’en France ou en Allemagne.
Ainsi, en France, le développement de la grande industrie n’arrive vraiment qu’à la fin du XIXe
siècle. Le prolétariat industriel reste tout au long du XIXe siècle dominé numériquement par les
ouvriers ruraux (ils oscillent entre le travail agricole et le travail manufacturier) : en 1881, les
ouvriers agricoles représentent 3,4 millions d’individus et des ouvriers de l’industrie 3 millions.
Ajoutons que à la campagne, la polyactivité est dominante : les salariés travaillent à domicile
pour un industriel ou un petit artisan, exploite un lopin de terre ou vont travailler en ville dans la
petite industrie. L’enracinement des ouvriers est plus rural qu’urbain. On est encore dans le
domestic system. Il faut aussi ajouter à ces deux catégories de salariés les « gens de métier »
(artisanat urbain). Ainsi, les structures sociales qui se maintiennent jusqu’à la fin du XIXe siècle
rendent difficile la création d’une classe ouvrière dans la grande industrie.
Mais, à la fin du XIXe siècle, plusieurs éléments expliquent le développement de la grande
industrie et de la classe ouvrière : le développement du chemin de fer explique la progression du
commerce et de la concurrence entre les différentes industries et les nouveaux modes de
production ; le patronat industriel profite de la crise des années 1880-1890 pour renforcer son
emprise sur les ouvriers ( concentration de la main-d’œuvre, construction des cités ouvrières
autour des usines et dans les banlieues, encadrement patronal des associations...) ceux qui
participent à la création d’une classe ouvrière.

C. « Classes laborieuses » et « classes dangereuses » imposition et représentations
de la question sociale au XIXè siècle
Le développement de la grande industrie entraîne s’accompagne tout au long du XIXe siècle
d’une paupérisation des ouvriers. Dans les grands centres industriels (les usines) les ouvriers
sont plus qualifiés, interchangeables, vulnérable et précaires car soumis aux aléas de la
conjoncture économique et peu protégé par un code du travail quasi inexistant. En outre, l’exode
rural s’accompagne d’une désagrégation des anciennes formes de solidarité. Historien et
intellectuelle décrivent ainsi des problèmes d’hygiène, de criminalité, de santé et de
désintégration sociale à l’époque.
L’un d’eux, Louis CHEVALIER, publie en 1958 classes laborieuses et classes dangereuses de Paris
pendant la première moitié du XIXe siècle où il constate que la ville est dans un « état
pathologique » car la criminalité et la violence sont très présentes. Il lie cet état pathologique à
l’exode rural qu’entraîne le développement d’une grande industrie : de nombreuses migrations
vers la capitale déborde la ville car les équipements ne sont pas adaptés, ce qui entraîne une
détérioration sociale : infanticide, prostitution, folie, indigence, suicide, naissances illégitimes,
développant la criminalité et inégalité des classes sociales devant la mort. On est donc les classes
dangereuses sont liés aux classes laborieuses autrement dit à la question sociale.
Dans son ouvrage, il insiste aussi sur d’influence des représentations qui existent sur les classes
laborieuses dans les autres milieux sociaux. Il montre par exemple que un véritable racisme
antique ouvrier se dégage dans les classes bourgeoises. On n’hésite pas à à qualifier les ouvriers
de sauvages, barbares, nomades… en fait, les représentations des divisions sociales en objet de
débats et de lutte entre intellectuels et entre groupes sociaux.
Marx et Engels contribuent à ce débat.
D. classes et antagonisme des rapports socio-économiques chez Marx et Engels
Karl Marx vient du milieu de la bourgeoisie libérale allemande. Il commence d’abord une
carrière universitaire dans le milieu de philosophes hégéliens, mais face à la censure et au
contrôle exercé par l’aristocratie prussienne, ces intellectuels progressistes ont des difficultés à
faire carrière et ils se retrouvent souvent en position de déclassés. Il vivra de manière
relativement précaire toute sa vie. Ses écrits doivent être replacés dans les enjeux liés aux luttes
politiques et intellectuelles qu’il mène jusqu’à sa mort. Par exemple, le manifeste du parti
communiste qu’il écrit en 1848 a été commandé par la ligue des communistes, une association de
révolutionnaires allemands exilé pour beaucoup à Bruxelles ou à Londres.
La théorie des classes sociales chez Marx recouvre deux dimensions importantes :
- la société est divisée en classes dont les délimitations relèvent de l’activité économique
(et non pas d’un statut juridique ou religieux)
- les classes notamment la bourgeoisie et le prolétariat s’affrontent au travers d’une lutte
pour faire prévaloir leurs intérêts antagonistes.
Les écrits de Marx s’appuient sur l’observation du développement de la société industrielle au
milieu du XIXe siècle en France ou en Allemagne, même si celle-ci n’en est qu’à un stade de
protoindustrialisation. En par exemple, il observe les premières révoltes ouvrières en Allemagne,
celle des tisserands en Silésie en 1844 : ouvriers à domicile, ces tisserands se retrouvent
menacés par le développement de la grande industrie avec laquelle se renforce le contrôle
patronal sur les ouvriers et où le machinisme réduit l’autonomie des ouvriers.
Pour Marx, la lutte des classes est le moteur de l’histoire est donc le rejaillie dans l’espace
politique pour le contrôle des institutions politiques et étatique. Les luttes économiques et
politiques sont très fortement liées. En 1850, il publie la lutte des classes en France Dans lequel
il cherche à dévoiler derrière les luttes politiques entre orléanistes, qui soutiennent le roi Louis-
Philippe, et légitimistes, qui font parti de l’opposition, les conflits de classes. Il montre comment
ces oppositions politiques et leur contenu idéologique renvoie à des clivages économiques : les
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
1
/
42
100%