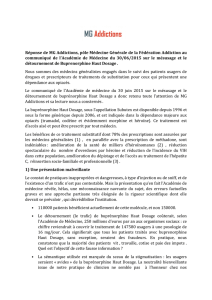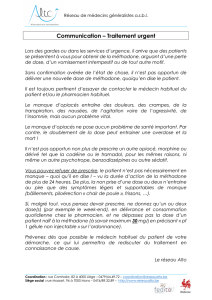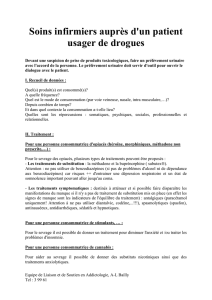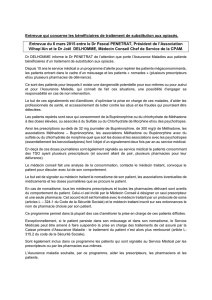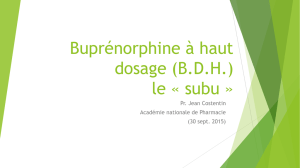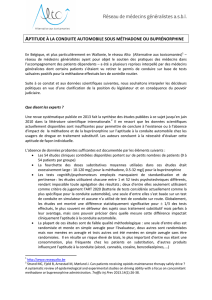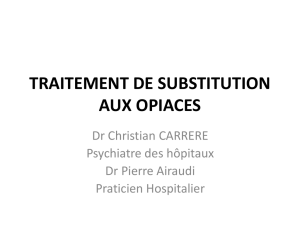Lire l'article complet

168
Le Courrier des addictions (6), n° 4, octobre-novembre-décembre 2004
Médicaments de substitution :
quelles indications ?
Méthadone, buprénorphine haut dosage :
ici on “penche” pour l’une (comme la
Suisse), là, tout en multipliant les pro-
grammes méthadone, on a beaucoup déve-
loppé “l’autre” (comme la France). Au-delà
de l’Atlantique où la méthadone a été expé-
rimentée depuis une bonne portion de
siècle, on commence seulement à “expéri-
menter” la buprénorphine haut dosage en
pratique de ville. Et on regarde ce qui se
passe dans l’hexagone comme le “film”
d’une aventure encore pionnière… Match
entre tenants de deux thérapeutiques, que-
relle d’écoles, spécificités nationales ?
Peut-être, tant il est toujours vrai que la
façon d’aborder et de prendre en charge
une pathologie et des comportements
dépend toujours, en partie, de l’histoire des
pays et des populations, des acquis des pra-
tiques professionnelles, des contingences
économiques et sociales… Mais aujour-
d’hui – et ce congrès d’Europad l’a bien
montré – cette dialectique habituelle semble
bien dépassée : l’ordre du jour est plus à la
“gestion” des traitements, à leur évaluation
fine qu’aux passes d’armes. Quel médica-
ment choisir pour quel patient, et selon quel
mode de prescription et de dispensation ?
Et pour quels bénéfices ?
Comme le soulignait Marc Reisinger, psy-
chiatre, pionnier des traitements par la
L’association européenne pour le traitement de l’addiction aux
opiacés (Europad) a tenu son 6econgrès du 1er au 3 novembre 2004
à Paris. Congrès européen certes, mais d’une Europe aux
frontières quelque peu “élargies”, ce dont témoignait la présence
d’une forte délégation américaine. Il faut dire que nombre des
organisateurs et intervenants de ce congrès, et notamment ses deux
présidents, ont été, depuis plus de dix ans, très mobilisés sur la scène
internationale des professionnels spécialisés dans ces modes de prise
en charge. Ils ont donc largement participé (avec les fondateurs du
Courrier des addictions, d’ailleurs) à la constitution d’un réseau
informel réunissant des professionnels internationaux et notamment
nord-américains. Et depuis plus de dix ans, les uns s’informent auprès
des autres et vice versa, dans le but d’améliorer l’utilisation de ces
traitements et les bénéfices pour les patients, dans leurs “territoires”
respectifs. Les Européens d’Europad étant régulièrement conviés aux
grands congrès nord-américains sur les dépendances (CPDD), il était
logique que les leaders d’outre-Atlantique viennent suivre les travaux,
plus récents, menés dans “la vieille Europe”… Les traitements de
substitution ont évidemment tenu la vedette, avec une mention
spéciale pour la buprénorphine haut dosage, bénéficiaire d’un
symposium satellite, organisé par les laboratoires Schering-Plough.
Un certain nombre de communications ont donc repris des
thèmes déjà abordés lors du congrès de San-Juan de Porto Rico
en juin 2004*, mais, d’autres sujets, plus spécifiquement
européens, ont été exposés : de la réduction des risques aux
troubles de la sexualité induits par la méthadone en passant par
la prise en charge des hépatites, la substitution dans les prisons
européennes ou chez les femmes enceintes, les structures de
soins... Un programme varié de séances plénières et symposiums
enrichi par la session des 35 posters affichés.
6econgrès européen Europad
Paris, 1-3 novembre 2004
Simone et Robert Berthelier
La buprénorphine haut dosage
Symposium Schering-Plough
Communications au cours du congrès
(E.C. Strain, W. Ling, M. Auriacombe,
T.G. Gilhooly, Kakko).
La méthadone
M.S. Shinderman, B. Eap, K. Dyer,
L. Okruhlica, P. Pani, M. Torrens,
Guelfi.
Substituts : quelles indications ?
J. Caplehorn, I. Maremmani,
M. Reisinger.
Prévention/réduction des risques
Symposium 11 (mortalité) : D. Touzeau,
A. Coppel, M. Sanchez.
Traitement des hépatites
Symposium 2 : S. Walcher.
Structures de soins (médecine
communautaire, rôle des généralistes)
Symposium 8 : C. Ford.
Femmes enceintes et nouveau-nés
Symposium 9.
Conclusion : paroles des présidents.
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
* Voir Le Courrier des addictions 2004;6,
3:132-5.

169
Le Courrier des addictions (6), n° 4, octobre-novembre-décembre 2004
buprénorphine haut dosage et la méthadone
(Bruxelles) et l’un des deux présidents de la
conférence, de nombreuses questions subsis-
tent quant aux indications respectives de ces
deux traitements de substitution. En effet,
d’abondantes études ont montré qu’ils sont
l’un et l’autre à peu près équivalents : en
termes de compliance comme de diminution
du recours à l’héroïne, de réinsertion psy-
chosociale, d’amélioration de la qualité de
vie...
Icro Maremanni, psychiatre, “l’autre” pré-
sident d’Europad (Pise), a tenté de donner à
cette question une réponse en présentant les
résultats d’une étude sur ce dernier critère
d’évaluation : pendant un an, il a étudié un
échantillon de 213 patients traités par des
médicaments de substitution, dont 106 sous
buprénorphine haut dosage et 107 sous
méthadone. De nombreux paramètres ont été
évalués : indice de satisfaction globale, effi-
cacité, amélioration générale (par auto-ques-
tionnaire), qualité de vie, travail, loisirs,
appétit, ressources, image de soi, absence
d’héroïne dans les urines, consommation
parallèle de cocaïne et d’amphétamines.
La buprénorphine haut dosage, prescrite à
la posologie quotidienne de 8 mg, a donné
de meilleurs résultats sur la qualité de vie,
l’absence de symptômes psychopatholo-
giques, l’intensité du craving et la réduc-
tion des abus de produits que la méthadone
à 60 mg par jour, chez les patients présentant
un tableau clinique peu sévère et ayant
conservé une bonne insertion psychosociale.
John Caplehorn (Sydney, Australie) s’est
livré, pour sa part, à une vaste revue de la
littérature en vue de déterminer le traitement
de substitution qui permet le maximum de
compliance : méthadone, buprénorphine
haut dosage, LAAM ou méthadone plus
héroïne ?... Il estime que les études existantes
établissent d’une part la supériorité de la
méthadone en ce qui concerne la diminution
des contaminations par les infections virales
et de la délinquance, d’autre part son équiva-
lence avec la buprénorphine haut dosage en
ce qui concerne la mortalité et des consom-
mations intercurrentes d’héroïne. Et à propos
de la pratique clinique, il conclut ainsi son
exposé : “Vous pouvez d’emblée éliminer le
LAAM et la naltrexone. La buprénorphine
haut dosage représente actuellement la seule
alternative sûre à la méthadone. Celle-ci
reste le médicament de premier choix pour
les patients candidats à un programme de
substitution, sauf si la présence régulière
dans le cadre de la délivrance quotidienne
est impossible ou difficile à obtenir ; s’il existe
un doute quant à la sécurité des doses de
médicament en possession des patients et/ou
un risque important de polytoxicomanie per-
sistant pendant le traitement de substitution ;
le toxicomane refuse d’entrer dans un pro-
gramme méthadone. Mon expérience cli-
nique récente m’a montré que les jeunes
toxicomanes aux opiacés ne veulent pas res-
sembler aux patients plus âgés sous métha-
done : ils refusent de vieillir comme eux. La
popularité actuelle de la buprénorphine haut
dosage est due à ce qu’elle n’est justement
pas de la méthadone et à sa plus grande faci-
lité d’utilisation”.
Réels bénéfices, mais aussi
risques persistants
À gérer sérieusement
Ce thème incontournable s’est vu consacrer,
outre un symposium, plusieurs interventions
en séances plénières. Didier Touzeau et al.
(clinique Liberté, Bagneux) a évoqué les
problèmes soulevés par l’allongement de
l’intervalle QT à l’ECG chez les patients
sous méthadone. Vingt-sept sujets, dont
60 % recevaient plus de 120 mg par jour, ont
passé un ECG dans les deux heures suivant la
prise de leur traitement, mettant en évidence
cette modification qui n’apparaît pas corré-
lée à l’importance de la dose. Il s’agit d’un
facteur de risque, qui n’est peut-être pas
majeur, mais qu’il faudrait prévenir par l’ins-
titutionnalisation d’une surveillance électro-
cardiographique régulière.
Substitution et troubles
de la sexualité
On connaît depuis longtemps l’existence de
troubles de la sexualité chez les patients
sous morphine et les héroïnomanes : baisse
de la libido, problèmes d’érection et d’éja-
culation… Ces mêmes difficultés ont été
longtemps sous-estimés chez les sujets sous
méthadone, soit que les patients ne s’en
plaignent pas, soit qu’ils compensent par
une polyconsommation (alcool, cannabis,
benzodiaépine, cocaïne…).
J.J. Deglon et al. (Genève), enquêtant en
2003 auprès de 370 patients sous métha-
done, ont évalué parallèlement le statut hor-
monal de 150 personnes. Ils ont découvert
chez certains un déficit en hormones hypo-
physaires LH et FSH entraînant une baisse
du taux de testostérone dans 74 % des cas
après la prise de méthadone, plus impor-
tante dans la tranche d’âge 20-35 ans.
Il apparaît donc que les opiacés induisent
une andropause précoce/prématurée dont
la symptomatologie clinique est souvent
attribuée à tort à un état dépressif : la pres-
cription d’antidépresseurs aggrave les
troubles de la sexualité !
Le but de la prise en charge est de faciliter
le passage du plaisir chimique à des plai-
sirs relationnels, émotionnels et sexuels. Les
manifestations provoquées par le déficit en
testostérone, anxiogènes, font courir le
risque d’une poursuite de l’addiction et/ou
d’une polytoxicomanie (cocaïne).
Après discussion avec les endocrinologues,
les auteurs ont mis en place le schéma thé-
rapeutique suivant :
•Diminution, si possible, de la posologie
de méthadone.
•Confirmation de l’hypogonadisme par
des dosages de testostérone.
•Injection de testostérone, toutes les 2 à 4
semaines en fonction de la réponse cli-
nique, en demeurant vigilants quant aux
risques de l’hormonothérapie, développe-
ment d’un cancer de la prostate en parti-
culier (dosage du PSA tous les 2 ans).
Les résultats cliniques sont encourageants :
amélioration du désir sexuel, de la perfor-
mance et de la vitalité, mieux-être, diminu-
tion de l’irritabilité, de la fatigue, de la ner-
vosisité, meilleure qualité du sommeil, dimi-
nution de la masse grasse au profit de la
masse musculaire.
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s

170
Le Courrier des addictions (6), n° 4, octobre-novembre-décembre 2004
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
Autre facteur de risque important : le
mésusage de la buprénorphine haut dosa-
ge, autrement dit son injection, problème
important abordé et par Marc Reisinger
(Bruxelles) et par Marco Sanchez (clinique
Montevideo, Boulogne-Billancourt). Pour
ce dernier, 17 % environ des patients pre-
nant ce médicament l’injectent, ce qui,
compte tenu de l’abus concomitant de ben-
zodiazépines qu’ils font dans leur grande
majorité, peut être un facteur majeur de
décès dans lesquels la buprénorphine haut
dosage est impliquée. Un pourcentage d’in-
jecteurs presque du même ordre (14 %)
parmi les patients observés par Marc
Reisinger, mais autant dans les pro-
grammes méthadone que buprénorphine
haut dosage. Toutefois, alors que, dans le
premier cas, les pratiques d’injection
concernent l’héroïne et la cocaïne, dans le
second, c’est la buprénorphine haut dosage
qui les remplace. On sait qu’il s’agit là
d’une conduite à haut risque infectieux,
vasculaire et de contamination virale dont
l’origine est plurifactorielle : habitude de
l’injection, impulsivité (réduite par les
ISRS l’abstinence d’alcool et de cocaïne),
mais surtout dépression, dont le traitement
réduit le risque d’injection et sur laquelle la
buprénorphine haut dosage est plus effica-
ce que la méthadone ; symptômes de
manque dont la sédation est alors le but
majeur de l’injection, ce qui renvoie à l’in-
suffisance d’un dosage du médicament.
D’où, devant la persistance de ces pratiques
à risques, la nécessité de réévaluer les
posologies prescrites et d’expliquer soi-
gneusement les modalités d’utilisation des
comprimés sublinguaux. Dans certains cas,
il peut se révéler nécessaire de “passer” le
patient à la méthadone. Reste que le risque
d’injection peut exister aussi avec le sirop,
ce qui est décrit de manière anecdotique, en
France, mais concerne 11 % des injecteurs
à Adélaïde en Australie ! Donc, un risque
de détournement réel, mais gérable.
Quant au risque létal chez les usagers de
drogue, rarement évoqué, il a fait, à lui
seul, l’objet d’un symposium. À cette occa-
sion, Julian Vicente (Lisbonne) a présenté
le travail de recueil de données mené par
l’EMCDDA (European Monitoring Center
for Drugs and Dray Addiction) qui s’attache
à harmoniser les définitions, les méthodo-
logies et les protocoles, avec ses partenaires
institutionnels hollandais et italiens. Ainsi,
Anna Maria Bargagli et al. (Rome) ont
comparé les taux de mortalité chez les usa-
gers de drogues de sept villes et un pays
européen (Amsterdam, Barcelone,
Danemark, Dublin, Lisbonne, Londres,
Rome, Vienne) entre 1990 et 1998. Leur
enquête a montré des différences de distri-
bution dans les causes de décès, la surmor-
talité et l’impact des opiacés. Exemples : la
mortalité globale varie de 1 % (Dublin) à
3,8 % (Barcelone) ; la mortalité par overdo-
se est de 10 ‰ à Barcelone, 7 ‰ au
Danemark, à Rome et à Vienne, inférieure
à 3,5 ‰ dans les autres sites ; celle par sida
est inférieure à 2 ‰ partout, sauf à
Lisbonne, Rome et Barcelone (6 ‰).
Sorties de prison : danger !
Sheila H. Bird (Cambridge) constate, pour
sa part, que les décès dus aux drogues, liés
à une baisse de la tolérance, sont sept fois
plus fréquents dans les 15 jours suivant
une libération de prison que dans le
même laps de temps chez des sujets en
liberté. Ainsi, en Écosse, dans une cohorte
de 19 486 hommes de 15 à 35 ans sortis
après 14 jours d’incarcération au moins,
on a observé 34 décès liés aux drogues au
cours des deux premières semaines contre
23 dans les semaines suivantes. L’auteur
souligne la nécessité d’une étude large, ran-
domisée, pour déterminer si la délivrance
de petites doses de naloxone aux prison-
niers libérés ayant des antécédents d’injec-
tions d’héroïne peut réduire le nombre de
décès dans les 15 jours suivant la remise
en liberté (de 30 %, environ). Elle a posé
également la question de savoir si le traite-
ment de substitution était susceptible d’in-
fléchir le risque de décès dû aux drogues
des “vieux héroïnomanes’’. Une question à
laquelle Dominique Lopez et al. (Saint-
Denis-La Plaine) et Anne Coppel (Paris)
ont apporté de solides éléments de réponse
: l’enquête menée par D. Lopez avait pour
but de chiffrer la mortalité et d’analyser les
causes de décès chez les sujets arrêtés pour
usage de drogues selon la substance incri-
minée et, jusqu’à un certain point, d’esti-
mer la mortalité générale chez les toxico-
manes français. L’échantillon comportait
42 485 personnes appréhendées pour usage
et/ou trafic de stupéfiants (héroïne, cocaï-
ne, crack, ecstasy, cannabis) en 1992, 1993,
1996 et 1997. Le statut vital de chacune
d’elles était connu au 7 août 2002, alors
que les causes de mort n’avaient pu être
identifiées que pour les décès survenus
avant 2000.
Principaux résultats : la mortalité des usa-
gers d’héroïne, de cocaïne et de crack est
trois fois plus importante que celle des
consommateurs de cannabis ; le risque létal
des héroïnomanes est 5 à 9 fois supérieur que
celui de la population générale de même âge
et de même sexe ; la mortalité masculine est
plus importante que la féminine, sauf au
cours des deux ans suivant l’infraction ;
comme prévu, les consommateurs d’héroïne,
cocaïne et crack, meurent plus de facteurs
spécifiquement liés à la toxicomanie (VIH ,
overdose) que de traumatismes ou de causes
accidentelles ; la mortalité a significative-
ment baissé durant la période d’observation
(1992-2001) avec l’introduction des traite-
ments de substitution, la trithérapie pour le
sida et la mise en œuvre de la politique fran-
çaise de réduction des risques.
Pour en pérenniser
les bons résultats
Anne Coppel, à son tour, a rappelé le très
positif bilan global de cette politique “res-
ponsable” d’une baisse de 80 % des over-
doses, de 67 % des interpellations pour
usage d’héroïne, de deux tiers des décès par
sida dans la période 1994-1999. Ces
chiffres, connus des seuls experts car non
diffusés par les médias, rencontrent l’ac-
cord de tous comme le fait qu’ils sont
imputables aux bénéfices apportés par les
traitements de substitution. Deux hypo-
thèses peuvent en rendre compte : soit l’hé-
roïne n’est plus à la mode, il n’y a plus de
patients en traitement et la baisse du
nombre des overdoses et des interpellations
est corrélée à cette extension de l’accès aux
soins ; soit ce sont les bonnes pratiques cli-
niques, particulièrement en ce qui concerne
la méthadone (posologie adaptée, traite-
ment individualisé, qualité de l’accueil,
compétence des intervenants), qui expli-
quent ce bon “rendement”. En effet,
comme l’ont montré de nombreuses études
réalisées au niveau international, l’accès à
la substitution a bien réduit les risques mais
n’explique pas tout car libéraliser la pres-
cription ne suffit pas à modifier les com-
portements des usagers. Il faut, parallèle-
ment, que les médecins modifient aussi
leurs pratiques, en particulier en instaurant

171
une vraie relation de confiance avec eux,
par l’alliance thérapeutique, et non en dur-
cissant les contrôles exercés sur eux, qui
ont pour effets de les détourner des struc-
tures de soins. Moyennant quoi, les usagers
adoptent réellement des conduites de
réduction des risques, ce dont témoigne la
chute des taux de contaminations par injec-
tion : 25 % en 1990, 3 % en 2003. De bons
résultats confortés, comme le rappelait
Anne Coppel, par l’instauration d’un tra-
vail en réseau, dont tout le monde s’accor-
de à reconnaître qu’ils lui sont imputables..
Il reste beaucoup à faire pour
prévenir et soigner les hépatites
S’il est actuellement un risque majeur à pré-
venir chez les usagers de drogues, c’est bien
celui de la contamination par les virus des
hépatites B et C, dont S.Walcher (Munich) se
demandait, avec le goût du paradoxe, pour-
quoi faut-il les traiter ?… tout en répondant
immédiatement : “Parce que prévenir et soi-
gner est humain, possible, nécessaire et ren-
table’’. J.M. Guffens (congrès THS, Saint-
Tropez) a rappelé l’importante prévalence des
morbidités liées aux hépatites virales C chez
les toxicomanes : 60 à 80 % des porteurs de
VHC développeront une maladie hépatique
chronique, dont 3 à 20 % vont évoluer vers
une cirrhose ou un hépatocarcinome. On sait
aussi maintenant que la bithérapie interféron
pégylé + ribavirine est efficace dans 80 %
des hépatites C à sérotypes 2 ou 3, les plus fré-
quents chez les usagers de drogues. Pourtant,
cette population bénéficie encore trop rare-
ment de ce traitement des infections VHC.
Cela pose la question des obstacles au dépis-
tage et au traitement de la maladie.
P. Le Gall (Fréjus, Saint-Raphaël) et al. ont
réalisé, dans l’ouest de la région PACA, une
enquête “un jour donné’’ à ce sujet, en
novembre 2002, chez des consultants de
médecins généralistes incités à répondre à un
autoquestionnaire. Sur 772 personnes ayant
répondu, 51,8 % (400) avaient au moins un
facteur de risque pour le VHC, 202 l’appre-
nant par le questionnaire ; 52,5 % de ces der-
niers ont accepté un dépistage sérologique,
mais 47,5 % l’ont refusé. Cent trois sujets se
savaient à risque de VHC, dont 67 % avaient
déjà été dépistés. Au total, 44 à 70 % des per-
sonnes ont refusé le dépistage, 32,3 % avaient
peur de la ponction biopsie hépatique (PBH)
et 26 à 28 % des effets secondaires du traite-
ment. Cette étude confirme la nécessité de
renforcer l’information sur l’infection VHC
pour faciliter et élargir l’accès aux soins des
usagers de drogues.
Même en cas de dépression et
de VIH+ asymptomatique
Pour S. Walcher (Munich), il est, de toute
façon, nécessaire et efficace de dépister et
traiter les usagers de drogues porteurs d’une
hépatite C. Ils ont une très bonne compliance,
parfois meilleure que celle des patients non
Europe : traitements de substitution en prison (TSP)
Laetitia Hennebel (Cranstoun) a présenté les résultats d’une enquête menée avec Heino Stover
(Brême) et Joris Casselman (Louvain), entrant dans le cadre des activités de l’ENOSP
(European Network of Drug Services in Prison), sur les traitements de substitution en prison
(TSP). D’une durée de 18 mois (décembre 2002-mai 2004), elle a concerné les 15 États
membres de l’UE avant le 1er mai 2004, la République Tchèque, la Pologne et la Slovénie. À
la fois quantitative et qualitative, elle a recueilli les données globales de chaque pays et des
interviews effectuées lors des visites sur le terrain avec l’appui des contacts nationaux. Au
total, 17 nations et 33 prisons (soit à peu près 2 dans chaque pays) ont été concernées et
des groupes témoins organisés dans tous les cas pour obtenir des informations par les déte-
nus : ils ont réuni 184 personnes, soit 132 hommes et 32 femmes.
L’estimation des taux de dépendance aux drogues chez les sujets incarcérés a montré
d’assez importantes disparités, allant de 13 % (Slovénie) à 77 % (Espagne).
Les TSP dépendent du ministère de la Justice dans toutes les nations visitées, à l’exception de
la France où ils sont rattachés au ministère de la Santé : Le sirop de méthadone est le sub-
stitut le plus utilisé. La buprénorphine haut dosage n’a été introduite que récemment dans la
plupart des pays, France exceptée. Chacun des deux médicaments est considéré comme pré-
sentant des avantages que l’autre ne possède pas, et réciproquement. Méthadone et bupré-
norphine haut dosage sont cependant considérées comme complémentaires, certains déte-
nus pouvant passer de l’une à l’autre en fonction de leurs besoins individuels.
Principaux points positifs mis en avant pour le TSP : identification des toxicomanes, réduc-
tion des risques, amélioration des soins et de la maintenance, responsabilisation des détenus
qui sont plus conscients de la nécessité des soins et plus impliqués.
Points négatifs : persistance de l’idée selon laquelle on ne fait que remplacer une drogue par
une autre, détournement facile de la buprénorphine haut dosage signalée en France (sniff ou
injection après broyage, alimentation des trafics de la prison).
Le TSP est le plus souvent fourni essentiellement comme partie d’un processus de sevrage,
avec réduction des doses par paliers. La maintenance, impliquant le maintien de la même
posologie pendant une durée illimitée, est moins couramment offerte. Les modalités du trai-
tement sont hétérogènes, variant selon les pays, les établissements, les équipes soignantes,
les médecins. Dans beaucoup de pays, l’accès à la substitution en prison est considéré
comme inadéquat comparé aux prestations offertes dans la communauté, car le principe
d’égalité des soins n’est pas respecté. Le soutien psychosocial, en particulier, pourtant donné
comme nécessaire, est rarement fourni et la continuité prison-extérieur est limitée dans la plu-
part des États, à l’exception de la Slovénie.
Principales recommandations élaborées à partir de ces éléments : étendre la disponibilité et
l’accessibilité de la substitution, ainsi que la qualité des prestations ; améliorer la continuité
des soins entre prison et communauté et, dans cette perspective, parfaire les formations et le
soutien des équipes soignantes, renforcer la prise en charge psycho-sociale ; préserver la
variété des options thérapeutiques (sevrage, maintenance, méthadone, buprénorphine haut
dosage) considérée comme nécessaire car permettant de répondre aux besoins individuels.
Ces conclusions et recommandations, superposables à celles des organismes et experts inter-
nationaux, rejoignent largement celles exposées par Michael Farrel (Londres) qui recense les
failles existantes dans l’intégration des soins dans les structures pénitentiaires (Royaume-Uni,
Espagne, Allemagne). Il retrouve les insuffisances mises en évidence dans l’étude de L.
Hennebel et met particulièrement l’accent sur l’existence, dans les pays étudiés, de pro-
grammes ‘’drug free’’ qui n’existent pas en France ; la corrélation entre l’état de manque et
les conduites suicidaires, singulièrement fréquentes en prison. En 2002, on relevait chez les
usagers de drogues incarcérés : 11 % de suicides dans les 24 heures, 33 % dans la pre-
mière semaine, 47 % au cours du premier mois ; une surmortalité importante : 62 % des
détenus décédés sont des toxicomanes. Moralité : qu’il s’agisse du traitement des hépatites
virales ou de la substitution, il y a encore du travail à accomplir dans les prisons d’Europe.
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s

172
Le Courrier des addictions (6), n° 4, octobre-novembre-décembre 2004
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
toxicomanes. Cela se vérifie même en cas de
comorbidité psychiatrique sévère chez les
sujets en traitement de substitution : l’hé-
patite C doit être traitée après 3 à 6 mois de
stabilisation sous méthadone ou buprénor-
phine haut dosage, cette dernière offrant
l’avantage de ne pas interférer avec les médi-
caments antiviraux et, en cas de comorbidité
psychiatrique, permet d’améliorer le som-
meil, l’humeur et la compliance. Les états
dépressifs majeurs, habituellement considé-
rés comme des contre-indications au traite-
ment par interféron, peuvent, d’après des
études récentes, bénéficier d’antidépresseurs
de la famille des ISRS.
Et que faire lorsque l’usager de drogues est
non seulement séropositif pour le VHC, mais
encore pour le VIH, étant donné les risques
d’interactions médicamenteuses et de majo-
rations des effets secondaires qui peuvent
rendre impossible le recours à l’interféron ?
La réponse est : lorsque le patient est VIH +
asymptomatique, il faut, en réalité, traiter son
hépatite le plus rapidement possible afin
d’éviter qu’elle n’évolue vers la cirrhose,
cause majeure de mortalité en cas de co-
infection HIV/VHC.
“Il faut effectivement proposer aux usagers
de drogues susceptibles de bénéficier du trai-
tement de leur hépatite virale associée, la thé-
rapie buprénorphine haut dosage (ou métha-
done, dans certains cas), interféron pégylé +
et ribavirine’’, concluait J.M. Guffens.
On peut traiter les hépatite C
en prison
La prison fournit un bon exemple des limita-
tions à l’accès aux soins, notamment sur ce
point, comme le montrent les chiffres rappor-
tés par S. Yakoub et S. Balanger (maison
d’arrêt de Paris, La Santé). En juin 2003, une
enquête menée auprès de 139 sites péniten-
tiaires auprès de 49 150 personnes détenues
montrait que 4,2 % (2 064) étaient séropositifs
pour le VHC, dont 91 % asymptomatiques.
Cent quarante seulement étaient traités par
bithérapie interféron-ribavirine, 46 par mono-
thérapie. Au niveau de la maison d’arrêt de La
Santé, la prise en charge des détenus toxico-
manes et/ou VHC + relève de l’UCSA, du
SMPR et de son CSST. L’effectif de la prison
en 2003 se caractérise par une importante sur-
population, un fort taux d’étrangers (55 %) le
plus souvent en situation irrégulière ; 35 %
des incarcérations relèvent de délits liés aux
stupéfiants et leur durée moyenne est de 4 à
8 mois. En 2003, 179 détenus VHC + ont
été pris en charge par l’UCSA, 17 VHC +
bénéficiant d’une bithérapie. Divers obs-
tacles entravent le dépistage et le soin : refus
du patient, d’ordre psychologique, ethnique
et/ou socioculturel ; contexte carcéral ren-
dant difficile la mise en œuvre des PBH et
des consultations spécialisées dont les délais
d’attente peuvent être supérieurs à la durée
de l’incarcération (courtes peines ou
remises en liberté immédiates). Le CSST et
l’UCSA mettent en place une prise en char-
ge reposant sur une bonne coordination
entre les différentes équipes. Mais, en défi-
nitive, l’auteur est arrivée à ce constat déplo-
rable : des détentions inacceptables, aggra-
vées par un taux d’incarcérations record ;
des disparités importantes d’un établisse-
ment à l’autre en matière d’accès aux soins
alors que les pathologies VHC et VHB, en
prison, sont en train d’“exploser’’. Donc à la
conclusion “qu’il faut renforcer, plus que
jamais, le dispositif sur les plans sanitaire et
social”.
A.J. Remy (Perpignan) et al. montrent
cependant la faisabilité du traitement de
l’hépatite C en prison. En 2000, une étude
portant sur 85 unités pénitentiaires mettait
en évidence que la sérologie des patients
était connue dans les deux tiers des cas mais
que 36 % seulement avaient eu une PBH et
4 % un traitement. La ponction biopsie,
identifiée comme un obstacle à l’accès aux
soins, avait alors été introduite dans les uni-
tés médicales de 37 maisons d’arrêt. Ainsi,
200 patients d’un âge moyen de 37 ans
(94 % d’hommes) ont été suivis et, au 1er
juin 2004. Ils avaient été traités par bithéra-
pie interféron-ribavirine, la PBH n’étant que
facultative même si elle était souhaitée par
le médecin. La contamination était liée à des
injections iv de drogues dans 78 % des cas,
3 % étant d’origine transfusionnelle ; 12 %
des sujets étaient également VIH + ; 37 %
étaient sous substitution par méthadone
(12 %) ou buprénorphine haut dosage
(25 %). La durée moyenne du traitement a
varié de 4 mois chez les patients qui
l’avaient interrompu pour des motifs non
médicaux, à 7 mois chez ceux qui l’avaient
poursuivi jusqu’à son terme. Quatre vingt-
quinze sujets (47,5 %) ont eu une réponse
positive complète et aucun effet secondaire
sérieux n’a été relevé. Il est donc possible
d’instituer et mener avec succès un traite-
ment de l’hépatite C en prison. La limitation
Évaluation :
question(s) de méthode
•Mojca. Z. Dernovcek et Mercedes Lovrecic
(Ljubljana) ont rapporté les étapes de l’élabo-
ration, à partir de 2003, d’un questionnaire,
instrument d’évaluation de la qualité du
traitement de substitution par méthadone. Il
s’agissait d’une nouveauté dans un pays où
n’existait aucune tradition d’appréciation qua-
litative systématique et scientifiquement fon-
dée. Un questionnaire pilote a été mis au point
et testé dans un centre méthadone recevant
quotidiennement 500 clients dont 50 ont été
sélectionnés pour l’étude. Les questions concer-
naient le comportement et l’impression clinique
globaux, les conduites auto- et hétéro-agres-
sives, les overdoses, la consommation
parallèle de produits illicites, les dosages uri-
naires et les effets secondaires de la métha-
done au cours des six derniers mois, ainsi que
le statut du patient dans le programme.
Cette première partie du projet s’est terminée
en octobre 2004 et les premières conclusions
des utilisateurs sont : ‘’assez satisfaisant’’ pour
le temps nécessaire à remplir le questionnaire :
‘’peut mieux faire’’ en ce qui concerne la qua-
lité de la documentation ; ‘’satisfaisant’’ pour la
taille de l’échantillon, la période d’observation
de 6 mois et l’utilisation des variables sélec-
tionnées.
La prochaine étape comportera l’interview de
l’équipe soignante quant à l’utilité du ques-
tionnaire, sa mise en œuvre dans tout ou une
partie des centres méthadone, l’analyse des
réactions à ce type d’approche.
• Andréa Flego (Pordenone) a exposé les prin-
cipes du modèle d’excellence EFQM (Euro-
pean Foundation for Quality Management),
approche qualitative nouvelle des institutions et
de l’organisation des soins. Appliqué il y a
quelques années au Jellinek Centrum
d’Amsterdam, après ajustement aux besoins
d’un service traitant des addictions, il comporte
en résumé : une définition des missions à rem-
plir avec une attention particulière portée à
l’épidémiologie, à l’attitude des soignants et à
l’opinion de l’environnement social sur le trai-
tement par la méthadone ; des critères de fai-
sabilité concernant aussi bien le personnel
nécessaire que la politique de soins et la stra-
tégie à appliquer ou les divers partenariats ;
une auto-évaluation qui représente la grande
nouveauté du modèle EFQM.
L’excellence telle qu’elle est entendue ici signi-
fie : maintenir et élever progressivement le
niveau de tous les comportements de l’institu-
tion soignante ; être capable de changer en
permanence pour s’adapter à de nouvelles
réalités et de nouvelles vérités scientifiques
dans le cadre de l’“Evidence Based
Medicine”.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%