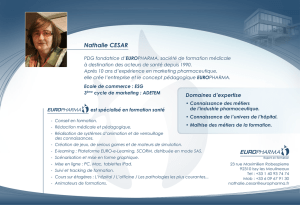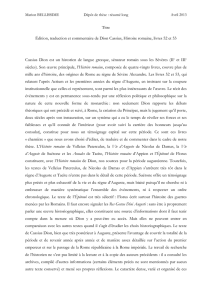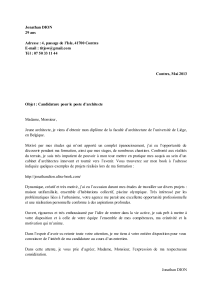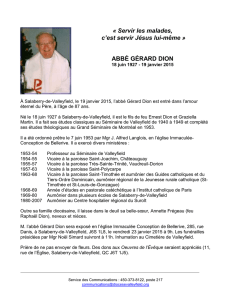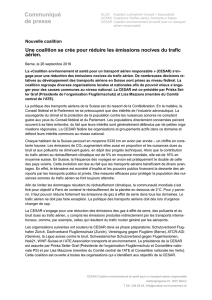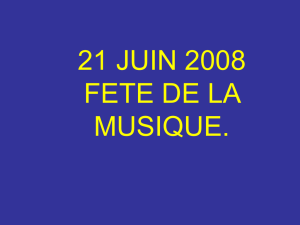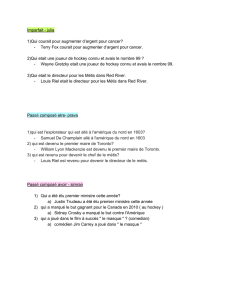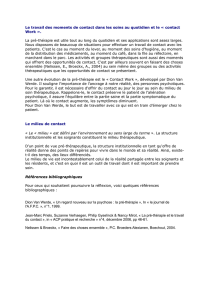rapport agrégation 2015

!
"#$%%&&"&&'
&&'$$&
('&$)&&$
%'&$
&$)&*%
&(&&$
'#&&+%%$&)%,
)%-$&$
&)$$$)
'#.'%%&&$
)/(&%
&#$&0%$%
(
)%&)&&+%%$(%&'
&&&$
$'&
&&1&#%-&&
$&))&&%&
%$&
+%$&)
-$)(2$
+$3#14"&1&
)()5&&$&$
)&%0&$
+%%$("7#8'$)%,
&$"&-&9$(
0&&&$#-##
%:"'&5-$$
)$.$"&
)$&&%+$
&$&)&$&(
;$$0$
)&)+%%$&$
&&$%%(&$&&
&$&#&<"&
;%$5$=$*$&(3$+$
><)$0&(
)
&&%%)&
$&#'
;%($&$$#
))$-$
%&&+%%$?&
'&$'0$
-')&$%%&/$

(('&$('
('1$'&$)%
%%-);#&(-($
&(0&
$0#&(&$
)$=&
'&&$$$
#)&('$#&&
%(&'%$#$#$(
$&$)*($'$&$
$$&)&+
(&%&)%''$$
'$'
@ ! ""#$%&'()**)) *+*))**,,$* -*
./$*0 $ 1223
!""
*&'4%*)5,*$*,%,*4,*$67%.7)*$*48*&*/%6&%6%*&'$
,*4,*&&*$,7),9,)*%6:,%*)76$%*7$8$;;*&$7*<*)*&%%,
%*/*,;*4)*;=,$*$)>)),,*$;?*$<*)*&%%,6$*4*$*,,
&*7,:)*%*&=,$*##!#5*,;767<5)*,)5!"! $! "#"#%#
%!##!&' "( &'"#!&) "&'!*&+!"!#"#',"!" #&"
""&-*78*&'$*<6$,%*&&*7$6&*$)*6/6*;*,%*
6*#@ ;%*,$*866$)* <5)>A,6&*$*%*%*&*%$*./*%*%6,)
&;7,:)*/*&%*/$%56&$,,*$;*%5*?*',$<* )/,)*;6$,*%*)/$*$*
&.#" ") #!&"#%!#"# "&!""%,&""#/'%#!&"'%"##!# $
!/ "/-
,$%&,##!#*%*/,7B,$*&%*&%%,7$6*,,%
)5,$%&,%*/,7$6&*$;;;<5)58,%5#"!" $#"
0"!"%"/' "#,1"#('# !/"/'&"!"! $!"Histoire
romaine ""%-*&%%,<?,*,<5)6,,;$<67$)$)&!"%" "!%. ""
+!$&#$#%, #&""!,"! "&&!""%+!" "&#"% "#'#+!"
","2",&##<*)*,$**,76)6,,*%,68)*;*,%*&%%,
*&&*'B,*%&""#+!" ! *! "&!""%,&"-3&$45,-6-7
- #"#'8&"%" "/'"("'&""##&"'!"# ,"#"
& "#"#*#"#( #!"9&"%+! "&:"%/'"#! "/*"!
'##(%&"#"&&#)6,,;7$,,<5*7$:)6;,<* %6>*%)5,$%&,
*$/*%*>)&%&,*$.)5*47)&,%*%&;*,C*)&"#!&!" !%)&""
#"/'"7/,B,$**?*7*$&*7,:)*7$,)*&%%,D7$,$%*). 7/,
%;*,,$*7)*$7) )5**,*)6,,<*&*$,7,**,*)*,:$%6C&*&$$86
7$:?*&,>%5*>$*$*)*/6D7$,$%*&*7,**,*) 7$7)*7)/,C
)&;7$*,$*6$*,;76**7$*;($*7$,* )5,*$7$6,,%&>),7$
*%*4(;*7$,**,)>&,,68$,$&*%*)8*$$*&/)**,$(;*7$,*
"/1"'";"!'%!#'&&1&"# $imperatores
-"!)!"# $ imperatores 8*E3E2C-5*,7$<<%)&%6$*,&*,,*
7*$7*&,/**,<5**,$* )*$*;6;$*,)*$&&(76F;76*)5>$<*
*$,$ ,'$%,* 8$**,);*$ 6$&*4%*G)* %578* %'*,%*+$*,8*F
):))*,%*707$6*,*6$*,;76*&;;*%*4
,H7*$6)6%*/&,$*7/,)68,;*;*,,,*%$*%*&%%,<5)

$77*))*,)*'"# "#%1"#"#'"%,"# "# "! ,"#"#6&*$*.)
&;7$6'*%,*4,*;76*/,&;;*&67$/&$*)*77)$**>$<**I1.
)%*;%*%*H))J)/,*,*$6%,)%%*&*%**$,$*78*J;)/,
$,,.&,>*8$%*47),%*6*3@C)56$%&,%*)7$,*$**3#)).
)-;*$0 )56);,%$%,,'$%,* <*);%*8*%$*)*$
%5$;6*8$*&*&&()5/*,%&;*6.+! &&"&$" "&/""8
&/"!"333I#,+!8&!%+!#&<!&"","&!"""1 *>>*&,6%*4
&$%*).%'""*,"E*,*+$*,8*""*,"&*<)*&&*$* )5)).
)578*7/,B,$*&;7$*%*%*4>KC,*$6>6$*&*.&,/,6<%)6,,
7$7$6,*$*),6$*$*31 <)/,7*$;%**7$6*,*$&;;*)*7$*;*$;./$
/86$)5&6 ,*6/&,%*&;78*6&)$*2&,$*)*;76*
=-"#')&# ))"#
8*1#1C-;;*)/*,6,6*,$=6.&*%&7)*%()5*>&**,<5)5H6,*,
%6&,*))*;*,LM0%*)5;7$*%*7$>);)$**),*,.)
%;*$'6,$<*%*,*4,* ;%,*.6)8*;*,&'$)8<*
,*;7$%*8*$$*&/)*%*12E12# )*7*$&*/,7*,B,$*7),$(*,,*;*,&*$,
*?*47),<*%*&*))*%*$(&)*/*&%%,%*/*,B,$**;*$*%*!%"
%"'&&&#/"("/"", "%" "# ))"%"# "%1"""&"# "!imperatoresC
/'"*,;6&$$($*;),$*%(?*** )$%*)8*$$*&/)**,$*H))*,)*
$,* N)7$*%)*7$,%7$*;*$,$*I*,3I )7*)5**,*)%*/**
&;78*'$%*;*)*,%&$*),/*;*,*476$;*,6$)*7)7),<**,7*.)5*
%)*<*$*))*%*>&,&$$($*H,6,6))68)* 7<5)586$6&*;8,$,$*
/,)*&),*#@ )5*,$*<*,$%/*;*,6,
)&$$($*%*#/&'6;/*$*(%)*&*&* )*,7)86%)*
)8<*7$,*.&*%**)*>;)4/*&)*7$,77)$* *,,<**/*%*
$)*,%&,$(,9,*886%&9,6%**,>,7$*/*%5*':)*,6&;;6*
%)*,$8* &;;**,6;8*6)*&,8$%7,>&,*%,&*7$*/*&
,)7$*7*/$&&6%*&;7)&,6)**$6/()**>,&'*>%*8*$$*<*
,$%/*;*, )$%*7$&),%*G)*.)%>>6$*&*%*)&$$($*%*;76* )
**$*7*&,6))68),6?<5.6)*&,&),*3@
-"&&%"%>%!"&&"?8*""C-&;;*,%67)$*$)*$,%*,$*<%
&*';;*;B;*</*,6,6,,&*))57$)5,$* < *,$* /*,*;,*
&/*$,*&$(,**,/*,&)):$64;B;*&, </*,8($*6,67$%*
)*>;)4*,/*,&'6$)*;B;**>, )5&;;*7($* )5,$*&;;*8$%7($* &*4
). ;)8$6,, *:,,*,0%67,%*&*7$>)%>>6$*, )*,6$$*%*6$*,%*
;76**,&$6 ?,*;*,.&*%**%>>6$*&*<)*$*%*,&;7)6;*,$*
$%*)5&&$%&&)*3@*,77*)6-$*;*$,$;/$,07$)*',$*;%*$* ;76*
77$,*8)$*;),$**,6$*$6*47),<* )*,,&;*,67$)5$8*,%*$
*&),%*6$*"2)),$*)*$&)):$,C6)&)8$O&*.)5%*%*)%,%*
;76* )>,/,*$*)8$$**>/*$%*/6,6$%*;76**,,*))&**,&*))6*7$
;$8**,$*;76**,)>))*%*6$ )*;*, 7*6,$8* %5*>, >)%*
)5;76**,7*,,>)%*)5,$*6$%,B,$*,*$7$6,6*&;;**)).)>*
&&'*<7$/<);$,%*)*$*/&'* )*;$8*/,6,6*$6,**,);$,%*
)*":*%,*%)*)**,$*)*%*4';;*
-"%/' "'!8*@IC-LM%6$*4%*577$7$*$&'&)8)$*
%*)5,$*$%*,)*:*%*/&&5*,$,,)*$*;<%*/*,)7$7$6,6%*
/<*$C**>>*,7))5%/*$$*<5:,,6,,8$%*,7, 7)',56)(/*
;B;*0)$* )5;7$*<*)8)$*&;7,*7)<*)*7/$*>,
;&4',)* )*$77$,*,$*)*%*4';;*,;$<6%5*$/),6,$(<*
5*,)..'+!" "&/"& "&*&"##"/"(%%#"'!

"#' "%/'"%"*-"%"%"&gloria("##""&&"/"/&"(+!'"/"
" '&."#virtus )12C-8$%*/)*$0;B;*)*;,&&*&*<*)/&,$*
%,:*&7.)>$,*)12C-&'&*0&*,,*)!""#!##&'"!," "&
'"%'"#"&&" $!" ,@A!#'!#"/'"B(.'+!" "&C"&
"#imperatores D-
"!1/"'";""'&% "&!""%,&"
-"'>" "/'";!'%'?
8*1IC-$)*&$&,($* )%>>6$*,)5%*)5,$**&*)<*)*%6$%*;76*6,,%*
5B,$*)**&%%*7*$*)$<*&*)%*6$6,,%5B,$*)*7$*;*$%*,LM05,*$
*;:)*5%;*,,$*<*%*%>>6$*&*%*&$&,($**,$*%*4>,*$%*8*$$*&/)*C)77*
%*>K,$($'6,$<*)5;:,&$7)*%*6$.)/,6%*;76*7*,
*/8*$<*&*,,*>$;)*6,:),*%>>6$*&**,$*)*$%*47$?*,7),<*C
;76*$,6,6;;$&'<* ,)6$,%*684;7%*76$*$8*EC-LM
,%<*)56,,&*4%5B,$*'$67$%*8*&*,, :6/*&)*$*,;*,*,
;6LM0;76*$,/)6,:)$7$66;*&*%)*&%$*$67:)&
:)*/*$*$)*$68;* *$*&'*$&',&**))*$;*,$%,*))*5))*$*
"I .),*%*)5,%*)% %686&)<* )/,>,$7%*;*,6)$*
&))(8*7$$*,*$%))68),6$67:)&**&%%,)*7)/*$,7/*,
$77$&'*$&*7$?*,%*))&"%%""#!&%"## $!! "(!princeps('!
""&'!*&+!"-
=-"'>" "#;!" %!"?8*"C-LM)5,$***>,7&$7)*%*
8/*$*$)*7*7)*;B;*&,$*8$6 %*%*$%*$%$*.%*';;*<)*%6,*,*, *,
%*5,,$:*$)*'*$%*7$7$*,$,6056/&,%*$$,*/
;$&'<*%7$?*,&6$*$*7,$,$,$;*:$,)*&%%,7/*,>$*
)).*$77$,',/*&)*6,*,.)77$*%*)):*$,6%*&;&* :)86
%*$,>*$)*&'4%*;8,$,>,.)5/&*5%6*<*6$/),$6,:)$)$H,6*,,$(
7$6*,*7),$%&'*P<%)$&,*,*7*%, &*,,*/*,68)*;*,
,$(;$<6*7$)*$68;*;$&'<*%*)567<*%*,6;88*$*/B,%&*
%;*,6)6)8<*C&,)5* )5,*$7$7**/*$;7)>6*%*
6/6*;*,)5*,*>,7A$<*6$,/)*>$*7$&);*$$&;;*)5&$
%$:)*;*,),O,6)8,*;7<,4:*&,,,*))*%*7/$*,,,*%3
7$&'$)%&,,$*)5*,7&*$,<5),*7$?*,&)$*
-"#"!&/.";&!""?8*#1@C-*>>*, )6,,;7:)*.<<*&*>A,
%5,,*%$*&*:,>$*)8*$$*.*&&,H* ;**$%*6,$8*$&,$**
&;7,$,* 7))*$&,$*)*%$,%*8*%*;;*&%6$:)* ,*$ $*7*&,%*
) :*&7;B;*%**,$(&'*$&;780
7*,*&$*5,*$$8*$$) /"#&&+!" "&,#%"E##!# $!"
!"" ","!",*&"-*>,>>$*,,:)*7)&;7)*4*C)*%*4,
)8,*;7&'*$&'6.)56/,*$&$*))*$*/H,.)5*4*;7)*%*H)) </,)6,$(;/
/*$$*,$%5$*, *3I ,,)*;%*5,,*%,.&*<*;76*7$=,)*7/$7$)
>$&*&;;*H)))*)*>,7*,)&*&$;6*&$$($*6,6;$<6*7$)*))68),6
?<5.&), ;),?$&'*$&'6.>$*&&*7,*$7$66;*&*7&><*;*,
Q,.6$ $**7$/*<5)%6$,)8*$$**"@2C)H6,6&&)67$)*7$/&,
%****;</)*,)5:)8*$.*7$6*,*$&),.;*)7$,*&,%*
$;6*;76* %*&9,6 )8,*;7'6,6
*4</)*,)8*$$* &*,%&$,,)* )*%6>**$%*)67:)<*
7*,B,$*6/<6%)5))4-;:$*4;*;:$*%6,0)IE <,76
;76*.&*&'47$6);*$6$
-"#)"%"#'!*&%"#; "#)!7#"/*&#?8*"C-*>>*, %);*$*

N)6,*,%;B;*$68;*7),<* <5)7$)*,%*;B;*?*, <*&'&%,
.)5,$*)*;%*,H$*,.;B;*&*)%*):6$,*$ )5/*,$*.%$*<)*
%>>6$*&O,0*) ;7$*;B;*;:, 6$*,;76***%,8*,
8($*7$)*$&;7$,*;*,<:,,.)8*$$*&/)*%*).%*%/*$8*&*%*&$&,($*
)5,*$*/,%5))*$&*/6$,:)*%>>6$*&*%6)8<**,$*6$*,;76*57$(
)*)8*EEE3 "@*,"231 .*H*4 )5H/,7%5&9,6)*%6>**$%*)
67:)<* %*)5,$* )*779,%*);$&'* &$)*%*4%/*$$*/*,7$:?*&,>
)5,$,%57/$7*$*);**$,%&6/,:)*;*,*$/*4/<*$
*$8;*,7),<*)1E,$6%,.%*;7)*7$6,*4,* &;;**,6;8*)*
%&$%*4,$7* 78*:)86/,):,))*)E"@&$)*)68
%*;*$*,&;76*%*&,H*<6,*,%*6)*&,*$*,%,)>)),:,*$)5%'6
/)$6)*&%%,&7:)*%*$*),/*$)7$)6,$,%*)68$* <*)5*
$6%,7).%*;7)*&)*,%*)*$&;;%,*&'*>&*,'(;*%*%&$%*&'*>
.)*$)%,,$'*,)*;7)>&,%*$) )8*$$**$6%,
&'&%*%*4;:,7$)*7/$7$B;*)68)8*)*>,<*/'"&&!
optimates('## "&'!*&+!" "&&"( /"'&"("%#!
,&"!# "&libertas-&#'"#"!&#"/'"%"#'!#!,"%"/"-5*,
7$<);?$,6%6,*,:*&7%*&'*/)*$,/;76*)IE*&9,6
#''F"%"%//"&$" !%!''!&"-&(""!"#(>!#)&"
'##" !!*%'& )"#" "# # "#*!# "&'&1*"(,&#&# !,"&"
%&""/'!*&%-"#1/"#* # ",&"##& #"," %8 "#
%,%#'!*&%"#"%"') /"'#'&"##& #/#!##&"#% "#;
%"&! "&libertas("" !" ))"//"%"E&"#%#","!#"&"#''!&"#(!"%"
&" "&."$H,6R
#1/"'";!""%,&"()%"! $ !/ "/
-"#)%"# "#
8*I@IEC-&*<&&*$*)*$>$&* 6$/,)7$,)7);:$***,)7)
,'*,<*%&,8*,%*&,H* *,)*';;*)*7):*))<*4%$*,*%*)5,)* %*
)578* %*)G)*,,*,($**,%*=)*<5)/,&<*J06$,$/*$6)5%$,<*
/*&P*)68;5*7)<*)56</)*,%*4.'$)* ,II@@@';;*5$;6*
%*G)**&,,*)*H$8*))**>>*&,>%*,$7*&6$**,6,6
8;*,67$%*)*/6*$6&*,*%)*G)*$)7**,)7* <5*,)**
&,$9)*%*)5,)*)$*)*//*$)*7);7$,,%*&,H*$;
6/<*)*,$7*4)$*)IIC&/)*$*&;7,,1@@@G)*,G*$;*4
</**,%578*6,*,)*)%,7;76*$))67$()&;78*6&)$%*28*
E@EIC-& ;76*/,%*))5/,8*%;:$* 6$*,)**)568)*,*
>$&*, .7$,$%5/,8*6</)*, )5*88**,%%*)6<):$6 /*&%*
$<*6840/),6$'6,$<*%*7$))6);* 7$7**/
7,;,*C;;:$** )*>$&*%*6$,>>:)*7$):,))*%*H$$&';
*,)&7$*%*)*/*&)5,)*<)*&,$,.*:,))*$7%*)*,/$<*
$;6*6,,7)8*$$*.)5*%*)8*$$*%*G)**&*7,%*/* 6/<*
.?,*,,$*-)*';;*)*7):*))<*40)II
=-"#)%"# "/'"
8*IEE@C-;76*/,*,$=6/*&)%*;:$*4;*;:$*%6,*,%*)5$%$*
6<*,$* *,%*,$7*$68)($*;*,*$9)6* *,)/,$*;:)6*8$%*;*%5';;*
>$*7$)*?*,*,)*))6 ,,)*7*7)*<*)*$*>>*, .)5*4&*7,%*'$&**,
%5$%(;B;*) :*<5)>A,**;%*7<5)/,,6$ ;76*/,*H6
%**)*&&)*$ ,&*4</*,?$6,6,,,7*)6.) )%($*,%*)5$8*,
*,)*/H($*,);*($*,%*$*>$,D/$%$*)*$,'*)/,7$;%5B,$*))6
5)7/,7$*%$*)H$* ; &;;*)*)5/,7:,** )*)77$,7%*0
 6
6
 7
7
1
/
7
100%