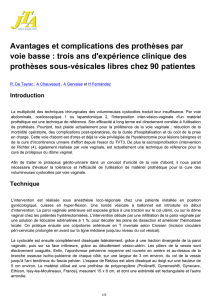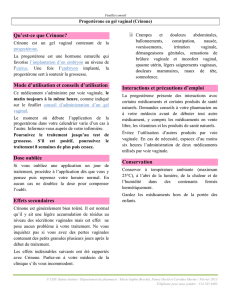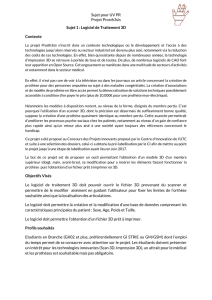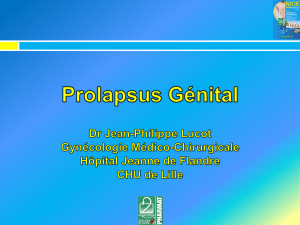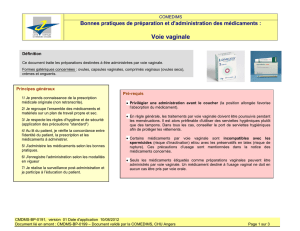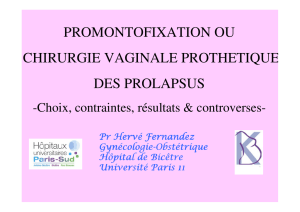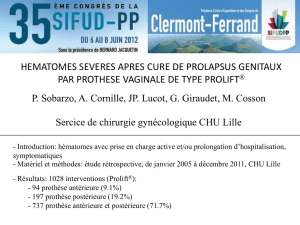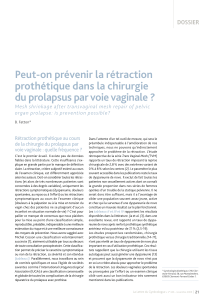Prolapsus récidivés de l’étage antérieur Place de la voie vaginale

25
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004
Prolapsus récidivés
Prolapsus récidivés
de l’étage antérieur
Place de la voie vaginale
dans la cure de cystocèle
récidivée
Anterior vaginal wall
recurrent prolapse:
management by vaginal
route
■
■
B. Fatton*, B. Jacquetin*
* Unité d’urogynécologie, maternité
de l’Hôtel-Dieu, CHU de Clermont-Ferrand.
E-mail : [email protected]
R
ÉSUMÉ
.
La cure de cystocèle reste un challenge difficile, notamment pour le chirurgien
vaginaliste. Si les techniques standard donnent des résultats satisfaisants dans les cystocèles de
grade faible ou modéré, elles exposent à un taux de récidives important quand on traite les
cystocèles de degré 3 ou 4 où la désinsertion du paravagin est fréquente. Dans ces circonstances,
le recours au soutien prothétique (biologique ou synthétique) peut représenter une alternative
logique, ce d’autant que les tissus natifs, distendus ou déchirés, sont difficilement utilisables. Ces
techniques de renfort prothétique par voie vaginale sont actuellement en cours de validation et ne
disposent pas encore de toutes les garanties indispensables à leur diffusion et à leur généralisation.
Dans l’attente de résultats fiables et scientifiquement validés, la prudence recommande de n’utiliser
ces matériaux qu’en cas de récidive, après une chirurgie “conventionnelle”. Elle impose aussi d’avoir
l’acceptation de la patiente préalablement et loyalement informée. Le respect de ces règles élémen-
taires et la volonté de la communauté scientifique urogynécologique de disposer d’arguments
forts plaident pour la réalisation d’essais prospectifs randomisés qui, seuls, permettront de définir
la place de la réparation prothétique par voie vaginale au sein de la chirurgie de la statique pelvienne.
Mots-clés : Cystocèle – Prothèse sous vésicale – Récidive – Chirurgie par voie vaginale.
A
BSTRACT
.
Efficient surgical management of anterior wall prolapse by vaginal route is a difficult
challenge. Whilst conventional techniques give satisfactory results in mild to moderate cystoceles,
the rate of failure increases with high grade cystoceles or those with paravaginal defect. In these
situations, particulary where vaginal tissue is weak and friable, the use of prosthetic mesh,
whether biological or synthetic, is recommended by some surgeons. However we await scientific
validation and long term results from randomised trials about these procedures. Patients must be
counselled appropriately and give informed consent.
With short term follow-up, vaginal erosions and retraction are the most common complications of
mesh repair.
So prudence is advised in the use of these meshes by the urogynecological community until such
time as we more fully understand the role of the mesh repair in vaginal prolapse surgery.
Keywords: Cystocele – Recurrent Cystocele – Mesh – Vaginal surgery.

26
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004
dossier
Figure 2. Colporraphie antérieure par plastie du fascia sous vésical de Halban selon des illustrations de Franz Batke
(issu du traité de Reiffenstuhl, Platzer et Knapstein [10]).
O
n peut classiquement admettre que le
point faible expliquant la majorité des
échecs de nos cures de prolapsus (notamment
par voie vaginale) est la paroi vaginale antérieure ;
cela est confirmé par une étude de prévalence
récente de Hendrix et al. (1).
La récidive de cystocèle (figure 1), dans la chirur-
gie par voie vaginale s’explique par :
– la situation anatomique, très antérieure, de la
vessie ; il est actuellement bien établi que le péri-
née antérieur est moins résistant que le posté-
rieur ;
– le caractère aléatoire du fascia vésico-vaginal
de Halban. Ce fascia est une entité chirurgicale
décrite comme un plan musculo-conjonctif formé
du septum vésico-vaginal et du fascia vaginal.
C’est un plan individualisé artificiellement par la
dissection dont l’épaisseur et la résistance sont
augmentées lorsque l’on s’éloigne de la ligne
médiane. S’appuyant latéralement sur le bord des
releveurs, il se perd en haut dans les deux piliers
vésico-cervicaux et assure le soutien principal de
la base vésicale. L’élongation et la distension de
ces fibres conduisent à la cystocèle (2) et l’on com-
prend aisément que les tentatives de réparation
reposant sur l’utilisation de ce fascia lésé puissent
exposer à des résultats parfois décevants. Par
ailleurs, la libération de ce fascia et sa réutilisation
sont plus difficiles chez une patiente antérieure-
ment opérée ;
– l’interposition impossible d’un plan musculaire
entre vessie et vagin, à l’inverse de ce qui peut
être réalisé pour la cure de rectocèle par la myor-
raphie des élévateurs de l’anus. La tentative de
transposer ce plan musculaire selon la technique
de Lahodny (3) a donné bien des déboires à cer-
tains d’entre nous… ;
– l’existence de deux types de cystocèles diffé-
rents dont le diagnostic préopératoire est délicat :
on différencie les formes centrales (simple hernie
médiane) des formes latérales secondaires à une
désinsertion du fascia vésico-vaginal de son attache
sur l’arc tendineux du fascia pelvien (c’est le clas-
sique défect paravaginal). En pratique clinique,
les deux formes de cystocèles sont fréquemment
associées (ces aspects ont déjà été abordés dans
l’article précédent de ce dossier) ;
– le rôle aggravant de certains gestes associés par
voie vaginale : la sacrospinofixation, par l’orien-
tation postérieure qu’elle donne à l’axe vaginal
accroît le risque de cystocèle avec un chiffre moyen
rapporté de plus de 20 % (4) et des extrêmes
situés entre 11,7 % (5) et 92% (6). Dans une revue
de la littérature publiée en 1997, Sze et al. (7)
constatent que les cystocèles secondaires repré-
sentent à elles seules plus de 50 % des récidives
clairement identifiées après sacrospinofixation.
De même, la désinsertion iatrogène du paravagin
au cours de la chirurgie (la fixation des bande-
lettes vaginales de Bologna à la face profonde de
l’aponévrose des droits avec l’aide de l’agrafeuse
DFS en est un bon exemple, déjà illustré dans ce
dossier) expose à la cystocèle secondaire ;
– le fait qu’aucune intervention n’a prouvé, à ce
jour, sa fiabilité : pas plus la classique colpecto-
mie-colporraphie (l’exérèse-suture de “l’excé-
dent” n’a jamais suffi à corriger une hernie), que
la plastie du fascia de Halban (figure 2) (sa dis-
Figure 1. La cystocèle récidivée : un
challenge pour le chirurgien vagina-
liste.

27
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004
section fragilise le vagin et compromet sa vas-
cularisation) ou encore l’artifice de Campbell-
Crossen (les ligaments utéro-sacrés et les ligaments
ronds étant par définition peu résistants en cas
de prolapsus) n’ont donné de résultats concluant
sur le long terme : ainsi le taux de récurrence
après colporraphie antérieure varie, de 3 % (8)
à 33 % selon les séries (les résultats varient entre
autres, en fonction du grade de la cystocèle ini-
tiale et de l’association éventuelle à un geste de
colposuspension).
La technique de suspension aux quatre coins
popularisée aux États-Unis par Raz et al. (11) est
entachée d’un taux de récidives, notamment en
cas de cystocèle de grades 3 et 4, qui peut atteindre
59 % pour certains auteurs (12). La technique du
plastron vaginal proposée par Crépin et al. (13)
est à réserver aux patientes ménopausées sans
traitement hormonal substitutif. Elle garde les
limites d’une suspension par fils et reste soumise
à la résistance de l’arc tendineux du fascia pel-
vien. Les tentatives de réparation du défect para-
vaginal par voie basse sont d’évaluation difficile
en termes de statique pelvienne, car leur effica-
cité est surtout jugée sur leur aptitude à guérir
l’IUE (14). Enfin, la greffe de vagin libre proposée
par Zacharin en 1992 n’a pas convaincu dans ses
résultats (15) et les techniques de renforcement
par prothèse autologue après prélèvement de
fascia imposent des délabrements importants
peu compatibles avec les principes d’une chi-
rurgie peu invasive.
C’est donc tout logiquement que l’idée d’utiliser
un renforcement prothétique soit synthétique
(résorbable ou non) (figure 3), soit biologique,
s’est imposée aux spécialistes de la chirurgie
reconstructrice pelvienne.
Ces initiatives restent cependant tempérées par
la crainte des complications propres des prothèses
synthétiques, en particulier le taux d’érosions
vaginales, chiffré en moyenne à 11 % dans la revue
d’Iglesia et al. (16) et situé dans une fourchette plus
large (10-30,3 %) dans la revue plus récente et
plus complète de Debodinance et al. (17).
Une brève étude historique montre que le concept
de renforcement des tissus natifs par un matériel
prothétique n’est pas neuf : les premières tenta-
tives dateraient de 1894 avec l’utilisation de pro-
thèses métalliques (18) !
Plus récemment, on retiendra que c’est Benson (19)
qui, le premier, utilise le polypropylène sous forme
d’une mèche trapézoïdale mise en place par voie
vaginale après un bain dans un mélange genta-
micine-bacitracine. Depuis, les expériences se sont
multipliées et, depuis 1992, plus d’une douzaine
de revues générales sur le thème de la réparation
prothétique par voie vaginale ont été publiées.
Prothèses libres, fixées ou posées selon un prin-
cipe tension free, les variantes techniques sont
nombreuses et les séries rapportées dans la litté-
rature ne font trop souvent état que de résultats
préliminaires avec des échantillonnages limités
ou des reculs insuffisants. La comparaison des
différentes séries se heurte par ailleurs, outre la
variabilité des techniques, à la diversité des maté-
riaux utilisés dont les propriétés respectives sont
parfois très différentes les unes des autres. Ces
réserves faites, il existe plusieurs travaux qui
méritent notre attention.
Contrairement à l’expérience française très diver-
sifiée, la littérature internationale, notamment
américaine, se montre encore assez discrète sur
le sujet, rapportant essentiellement l’utilisation
de prothèses biologiques, conçues notamment
à partir de derme de porc (Pelvicol
®
). Ce type de
prothèse biologique a aussi fait l’objet, en France,
de plusieurs publications : ainsi une étude
récente de Salomon et al. (20) rapporte, sur une
série de 27 patientes ayant bénéficié de la mise
en place d’une prothèse de Pelvicol
®
par voie
transobturatrice, un taux de cystocèles récidi-
vées de 18 % (toutes asymptomatiques) après
un recul moyen de 14 mois. Notre expérience ne
concerne que 15 patientes présentant une cys-
tocèle récidivée, pour la plupart après renfort
synthétique : les résultats sont décevants avec
plus de 33 % de récidives (recul 6 mois-3 ans).
De façon plus surprenante, cette prothèse bio-
logique ne met pas à l’abri de la rétraction
(4 patients sur 15), du retard de cicatrisation
Prolapsus récidivés
Figure 3. Matériel prothétique par voie vaginale : une
solution en cas de cystocèle récidivée ?
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Hendrix SL, Clark A, Nygaard I,
Aragaki A, Barnabei V, McTiernan A.
Pelvic organ prolapse in the Women’s
Health Initiative: gravity and gravidity.
Am J Obstet Gynecol 2002;186:1160-6.
2. Fatton B. Anatomie du fascia de
Halban et anatomie pathologique des
cystocèles. Réalités en Gynécologie-
Obstétrique 2003;79:48-55.
3. Lahodny J. Ventral plasty of the
levators a neglected method for the ope-
rative treatment of stress incontinence.
Geburtshilfe Frauenheildkd 1981;41:
769-76.
4. Fatton B, Grunberg P, Ohana M,
Manssor A, Descamps C, Jacquetin B.
Cure de prolapsus chez la femme jeune :
la voie abdominale n’a pas d’avantage
sur la voie vaginale ; à propos d’une
étude prospective randomisée. 1 –
Résultats anatomiques et sexuels.
Jobgyn 1993;1:66-72.
5. Morley GW, Delancey JO. Sacro-
spinous ligament fixation for eversion
of the vagina. Am J Obstet Gynecol 1988;
158:872-81.
6. Holley RL, Varner RE, Gleason BP,
Apffel LA, Scott S. Recurrent pelvic sup-
port defects after sacrospinous ligament
fixation for vaginal vault prolapse.
J Am Coll Surg 1995;180:444-8.
7. Sze EHM, Karram MM. Transvagi-
nal repair of vault prolapse: a review.
Obstet Gynecol 1997;89:466-75.
8. Colombo M, Vitobello D, Proietti F,
Milani R. Randomised comparison of
Burch colposuspension versus ante-
rior colporraphy in women with
stress urinary incontinence and ante-
rior vaginal wall prolapse. Br J Obstet
Gynaecol 2000;107:544-51.
9. Kohli N, Sze EHM, Roat TW, Kar-
ram MM. Incidence of recurrent cysto-
cele after anterior colporrhaphy with
and without concomitant transvaginal
needle suspension. Am J Obstet Gynecol
1996;175:1476-82.
10. Reiffenstuhl G, Platzer W, Knap-
stein PG. La colporraphie antérieure.
In : Les opérations vaginales, Cachan :
éd. Médicales Internationales;1996:
132-7.
11. Raz S, Klutke CG, Golomb J. Four-
corner bladder and urethral suspension
for moderate cystocele. J Urol 1989;142:
712-5.

28
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004
(4 patients sur 15) et même du rejet prothétique
(5 patients sur 15 !).
Cependant, le matériel prothétique synthétique
reste largement utilisé et de nombreuses tech-
niques ont été décrites (21-25) avec des résultats
encourageants (mais pas toujours optimaux) qu’il
faudra reconsidérer à moyen et long termes.
Ces variantes techniques peuvent être séparées
en trois groupes pour en faciliter l’exposé et la
compréhension par le non-spécialiste :
– les renforcements “simples” par la mise en
place d’une prothèse de petite taille derrière une
colpotomie, le risque principal étant la rétraction
et la récidive ;
– les prothèses “moyennes” souvent plus larges
de quelques centimètres avec un bras latéral mis
en place dans l’espace de Retzius ou les espaces
paravésicaux ou pararectaux. De Tayrac et al. (23),
par exemple, après la mise en place d’une pro-
thèse non fixée de Gynemesh
®
dont les branches
antérieures sont “perdues” dans l’espace de Ret-
zius rapportent, avec un recul de 8 à 32 mois sur
une série de 48 patientes, un taux de succès de
97,9 % au prix d’un taux d’érosion vaginale de
8,3 % (figure 4).
– enfin, les prothèses “larges” avec, souvent, un
passage transobturateur antérieur et/ou une
fixation postérieure au ligament sacroépineux, soit
par abord direct, soit par passage transglutéal
(et alors dérivé de la technique de l’IVS
®
posté-
rieure de von Theobald et al. [26]).
Eglin et al. (25) optent pour l’utilisation d’une
prothèse passée en tension free à travers la mem-
brane obturatrice et publient un taux de récidive
de 3 % sur un collectif de 103 cas dont le suivi
moyen est de 18 mois. La modification technique
qui consiste à faire “l’impasse” sur l’incision sagit-
tale du vagin antérieur réduit sensiblement le taux
d’érosions vaginales qui n’excède pas 4,5 %.
Chaque auteur rivalise d’ingéniosité technique et
la grande variété des interventions décrites rend
difficile, voire impossible, les comparaisons de
séries mais témoigne aussi de la difficulté à con-
cevoir la technique et la prothèse idéales.
L’expérience du service sur l’utilisation des pro-
thèses par voie vaginale date de plus de 10 ans
avec des fortunes diverses : l’évolution des tech-
niques, le recours à des matériaux différents, les
indications le plus souvent ciblées sur des patientes
complexes multiopérées rendent difficile l’éva-
luation des résultats. Une première série de 106 pa-
tientes opérées de juin 2000 à juin 2002 avec
mise en place d’un renfort prothétique de Vypro
®
(la prothèse est antérieure dans 86 % des cas,
postérieure dans 32 % des cas, 18 % des patientes
ayant eu une réparation prothétique complète
antérieure et postérieure ; par ailleurs, concer-
nant le matériel prothétique, il s’agit d’un treillis
de Vypro
®
dans 81 % des cas, de Vypro II
®
dans
19% sans différence statistiquement significative
sur les résultats en fonction de la génération de
matériau concernée) a été récemment contrôlée
avec les résultats suivants pour un recul moyen
de 9 mois (23) :
– un taux global d’érosion chiffré à 17,1 % et un
taux d’érosions nécessitant un parage chirurgical
de 10,4 % ;
– un taux de vraies récidives de cystocèle de
6,6%;
– un taux de décompensations antérieures secon-
daires de 11,4 % reposant la délicate question
du déséquilibre induit par nos réparations chirur-
gicales.
La difficulté à confronter nos résultats avec ceux
d’autres séries de la littérature en raison de la
grande variabilité des techniques et des maté-
riaux, et notre déception sur les résultats obte-
nus en matière de tolérance nous ont conduits à
envisager une étude multicentrique, permettant
de tirer profit de l’expérience de plusieurs
équipes fortement impliquées dans cette chi-
rurgie.
L’idée est donc née d’essayer de valider un concept
anatomo-physio-pathologique en testant une
intervention standardisée (TVM) (figures 5 et 6)
au sein d’un groupe de 9 experts. Le matériel est
un treillis de Gynemesh Prolène Soft
®
. Sommai-
rement, cette prothèse antérieure sous-vésicale
(figure 7), qui peut éventuellement se prolonger
par une partie postérieure prérectale (prothèse
totale), respecte le col vésical et est arrimée par
deux bras positionnés aux extrémités de l’arc ten-
dineux du fascia pelvien et sortant par le fora-
men obturé. Une évaluation prospective multi-
centrique est en cours, qui permettra d’établir des
résultats rigoureux et de légitimer éventuellement
le concept technique. Si, en cas de réparation glo-
bale (antérieure et postérieure), la technique ini-
tiale imposait l’hystérectomie, la conservation
utérine s’avère tout à fait possible moyennant
quelques aménagements techniques et fait l’objet
actuellement d’une validation. De l’aveu même
de l’ensemble des promoteurs de la technique, le
concept est séduisant, techniquement reproduc-
tible, mais les résultats préliminaires sur 322 cas
font apparaître quelques insuffisances et imposent
dossier
Figure 4. Principe de l’intervention de
De Tayrac (23). Bras prothétiques
libres dans le Retzius.
12. Miyasaki FS, Miyasaki DW. Raz
four-corner suspension for severe cysto-
cele: poor results. Int J Urol 1994;5:94-7.
13. Collinet P, Cosson M, Crépin G. The
vaginal plastron for cure of cystocele.
J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris)
2000;29:197-201.
14. Richardson AC, Edmonds PB,
Williams NL. Treatment of stress uri-
nary incontinence due to paravaginal
fascial defect. Obstet Gynecol 1981;57:
357-62.
15. Zacharin RF. Fre full-thickness
vaginal epithelium graft in correction
of recurrent genital prolapse. Aust N Z
J Obstet Gynecol 1992;32:146-8.
16. Iglesia CB, Fenner DE, Brubaker L.
The use of mesh in gynecologic surgery.
Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct
1997;8:105-15.
17. Debodinance P, Cosson M, Burlet G.
Tolerance of synthetic tissues in touch
with vaginal scars: review to the point
of 287 cases. Eur J Obstet Gynecol
Reprod Biol 1999;87:23-30.
18. Debodinance P, Delporte P,
Engrand JB, Boulogne M. Development
of better tolerated prosthetic materials:
applications in gynaecological surgery.
J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris)
2002;31: 527-40.
19. Benson JT. Female pelvic floor dis-
orders. New-York : WW Norton and Com-
pagny, 1992;280-94.
20. Salomon LJ, Detchev R, Barran-
ger E, Cortez A, Callard P, Daraï E. Treat-
ment of anterior vaginal wall prolapse
with porcine skin collagen implant by
the transoburator route: preliminary
results. Eur Urol 2004;45:219-25.
21. Mage P. Interposition of a synthetic
mesh by vaginal approach in the cure
of genital prolapse. J Gynecol Obstet
Biol Reprod (Paris) 1999;28:825-9.

29
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004
plusieurs commentaires et recommandations :
– en analogie avec les constatations faites au
décours de la chirurgie par voie abdominale,
l’hystérectomie réalisée dans le même temps opé-
ratoire grève à la hausse le taux d’exposition de
la prothèse : ainsi le taux d’érosion global passe
de 16,6 % à 4,5 % si l’on renonce à l’hystérecto-
mie ou si celle-ci a été antérieurement réalisée ;
– le taux d’érosions imposant la résection chirur-
gicale est de 10 % et reste excessif, notablement
supérieur encore à celui constaté après promon-
tofixation. Il semble raisonnable d’espérer, qu’en
l’absence d’hystérectomie, ce chiffre puisse des-
cendre à une valeur moyenne n’excédant pas
3 % ce qui devient alors tout à fait acceptable et
comparable aux chiffres publiés après chirurgie
par voie abdominale ou cœlioscopique ;
– de manière significative, l’exposition prothé-
tique est plus fréquente au niveau du vagin anté-
rieur (8,7 %), le fond vaginal et le vagin postérieur
n’étant que plus rarement concernés (respective-
ment 4,7 % et 2,8 %)
;
– l’absence de colpotomie en Tsemble réduire le
risque d’érosion vaginale et de mise à nu du maté-
riel prothétique et justifie donc de conseiller la
dissection rétrograde (sans colpotomie sagittale
médiane). Ainsi, le taux d’érosion constaté est
de 18,2 % après colpotomie en T, de 14 % après
incision péricervicale, et de 4,5 % en l’absence
d’hystérectomie ;
– si les phénomènes d’érosion peuvent a priori
être réduits par certaines précautions peropéra-
toires, la rétraction prothétique, source de distor-
sion vaginale et potentiellement dyspareuniante,
paraît plus imprévisible et, de ce fait, peu sus-
ceptible d’être influencée par d’éventuels choix
techniques ;
– le recul est encore insuffisant pour pouvoir ana-
lyser la fiabilité de la technique sur le long terme
ce qui nous prive, actuellement, de l’argument
fort selon lequel le bénéfice anatomique à distance
pourrait compenser un taux de morbidité plus
élevé que celui constaté après chirurgie utilisant
les tissus naturels.
En conclusion, il faut retenir, qu’à ce jour, des
techniques d’utilisation des prothèses synthé-
tiques par voie vaginale sont en cours de valida-
tion et que la preuve du bénéfice patent pour nos
patientes n’est pas établie. Le recours à la pro-
thèse ne sera justifié que si nous pouvons amé-
liorer ainsi nos taux de succès, en réduisant à la
fois les récidives et les complications : les taux
Prolapsus récidivés
Figure 5. Réparation prothétique par voie vaginale (groupe TVM) : vue schématique avant mise en
place des 2 prothèses antérieure et postérieure.
Figure 6. Réparation prothétique par voie vaginale (groupe TVM) : prothèses en place. Figure 7. Prothèse antérieure.
SS = sacrospinous ligament
ATFP = arcus tendineous fascia pelvis
US = utero-sacral ligament
SS = sacrospinous ligament
anterior TVM
posterior TVM
anterior TVM
posterior TVM
22. Montete P, Gilbon F, Borgogno C,
Coloby P. Treatment of genitor-urinary
prolapses by spinous fixation with a
polypropylene prosthesis. Prog Urol
2002; 12:517-20.
23. De Tayrac R, Gervaise A, Fernan-
dez H. Cystocele repair by the vaginal
route with a tension free sub-bladder
prosthesis. J Gynecol Obstet Biol Reprod
(Paris) 2002;31:597-9.
24. Sergent F, Marpeau L. Prosthetic
restoration of the pelvic diaphragm in
genital urinary prolapse surgery: trans-
obturator and infracoccygeal hammock
technique. J Gynecol Obstet Biol Reprod
(Paris) 2003;32:120-6.
 6
6
1
/
6
100%