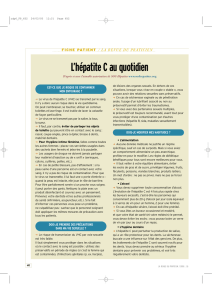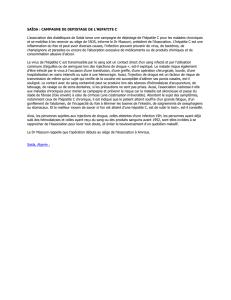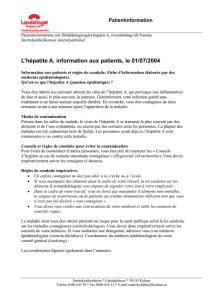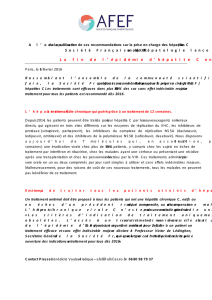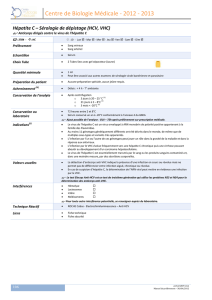? Q Pourquoi est-il si rare de découvrir une cryoglobu-

37
QUESTIONS/RÉPONSES
?
?
?
?
Pourquoi est-il si rare de découvrir une cryoglobu-
linémie en pratique rhumatologique de ville, même
dans les rhumatismes inflammatoires ?
L’identification d’une cryoglobulinémie nécessite des condi-
tions techniques très rigoureuses. Le prélèvement doit être
effectué et conservé à chaud (37 °C), par exemple dans un
bain-marie ou dans une Thermos. Si ces conditions ne sont
pas respectées, il y a cryoprécipitation dans le tube, à des tem-
pératures variables selon les caractéristiques physico-chi-
miques de la cryoglobulinémie (certaines cryoglobulinémies
précipitent dès 25 °C), avant l’arrivée au laboratoire.
Quoi qu’il en soit, les cryoglobulinémies symptomatiques ne
sont pas fréquentes. Néanmoins, avec des techniques sensibles
et dans de bonnes conditions, il est possible d’en identifier
(par exemple, dans 20 à 30 % des infections chroniques par
le virus de l’hépatite C et dans 10 à 15 % des syndromes de
Gougerot-Sjögren primitifs).
J. Sibilia
Quelles sont les possibilités thérapeutiques devant
une forme réfractaire de spondylarthropathie à
prédominance axiale ?
Les formes réfractaires de spondylarthropathie sont habi-
tuellement définies par la non-réponse à des doses suffisantes
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Il faut tout d’abord s’assurer que la symptomatologie dou-
loureuse est bien en rapport avec l’inflammation rhumatolo-
gique axiale (diagnostic différentiel, fracture de contrainte sur
rachis ankylosé, tassement vertébral, processus expansif intra-
canalaire, pathologie tumorale...).
Les traitements d’action lente peuvent être proposés, notam-
ment la Salazopyrine®,qui a démontré une certaine efficacité
dans les études contrôlées, mais surtout sur les atteintes arti-
culaires périphériques. Il en est de même du méthotrexate.
Les bolus de corticoïdes ont parfois un effet bref sur la symp-
tomatologie axiale.
À titre adjuvant, les myorelaxants, voire les tricycliques, ont
été proposés avec un certain succès. En cas de diminution
significative du contenu minéral osseux, les bisphosphonates
en étude ouverte ont fait preuve d’une certaine efficacité sur
les paramètres cliniques de la spondylarthrite (toutes ces pro-
positions sont cependant hors AMM).
Les antalgiques majeurs paraissent souvent décevants, comme
pour l’ensemble des rhumatismes inflammatoires.
D. Wendling
Quand et comment prévenir l’ostéoporose chez les
patients traités par corticoïdes au long cours ?
L’étidronate peut désormais être prescrit pour prévenir la
perte osseuse induite par la corticothérapie. L’AMM autorise
sa prescription chez les adultes qui nécessitent une cortico-
thérapie supérieure à trois mois, par voie générale et à des
doses supérieures à 7,5 mg/j d’équivalent-prednisone. Le
schéma thérapeutique intermittent est le même que celui uti-
lisé dans l’ostéoporose postménopausique. Il semblerait
cependant que ce traitement préventif soit plus efficace chez
la femme que chez l’homme.
I. Chary-Valckenaere
Faut-il faire une sérologie de l’hépatite B et de l’hé-
patite C systématique avant la mise sous métho-
trexate ?
Le méthotrexate a un potentiel hépatotoxique bien connu. Il
est logique, avant de débuter ce traitement, de s’assurer de
l’absence de maladie hépatique par la recherche d’une cyto-
lyse (transaminases) et d’une cholestase (phosphatases alca-
lines et gamma-GT). En l’absence de perturbations hépatiques
“standards”, il n’y a pas de règle consensuelle concernant la
prescription d’une sérologie systématique de l’hépatite B ou
de l’hépatite C (VHB et VHC).
Quels sont les arguments qui pourraient inciter à effectuer une
sérologie systématique ?
–Toutes les infections chroniques actives par le VHB et le
VHC ne s’accompagnent pas forcément d’une cytolyse per-
La Lettre du Rhumatologue - n° 253 - juin 1999
ous souhaitons que cette nouvelle rubrique favorise les échanges.
Faites-nous parvenir vos critiques, vos idées, vos questions,
y compris sur les articles déjà publiés.
Les auteurs et/ou le comité de rédaction y répondront.

38
QUESTIONS/RÉPONSES
?
?
La Lettre du Rhumatologue - n° 253 - juin 1999
.../...
?
manente. Ainsi, un bilan hépatique standard normal ne per-
met pas d’éliminer formellement une infection.
–L’utilisation d’un traitement par méthotrexate au long cours
peut interférer avec la réplication virale, en particulier du
virus de l’hépatite B. Un traitement immuno-suppresseur,
éventuellement associé à une corticothérapie, peut aggraver
une hépatite B chronique active tout en masquant initialement
la cytolyse, puisque celle-ci est liée à la cytotoxicité des lym-
phocytes T du sujet contre les hépatocytes infectés par le virus
de l’hépatite B. En revanche, les
choses sont moins bien
connues pour le virus de l’hépatite C.
En pratique, il paraît donc justifié d’effectuer au moins une
fois, lors du bilan initial, une sérologie de l’hépatite B et de
l’hépatite C avant la mise sous méthotrexate. En fait, ce bilan
devrait être réalisé lors du bilan diagnostique initial de la
polyarthrite, ce qui peut permettre de faire “d’une pierre deux
coups”.
J. Sibilia
Devant une douleur de la région cubitale du poignet
évocatrice d’arthrose piso-triquétrale, quelle(s) inci-
dence(s) radiographique(s) doit-on pratiquer ?
La meilleure incidence radiographique est le cliché de poi-
gnet de profil à 30 degrés de supination. La radiographie de
face ne montre qu’inconstamment une ostéophytose du pisi-
forme, et est surtout utile pour la recherche de lésions asso-
ciées. Si la présentation clinique est typique, il n’y a pas lieu
de demander d’imagerie plus complexe.
A. Saraux
Y a-t-il des indications à prescrire du calcium à la
ménopause ? Si oui, dans quel cas ?
Il peut être utile de prescrire une supplémentation calcique
chez une femme récemment ménopausée. Cette prescription
doit au mieux reposer sur une évaluation simple des apports
calciques alimentaires grâce à l’autoquestionnaire fréquen-
tiel de Fardellone. Si une insuffisance d’apport calcique est
mise en évidence (moins de 800 mg/jour), un ajustement est
nécessaire. Il peut se faire au mieux par des adaptations dié-
tétiques, qui sont à conseiller en première intention : penser
que les laitages allégés apportent autant de calcium et moins
de lipides, que certaines eaux minérales sont riches en cal-
cium et qu’un excès de fibres alimentaires diminue l’absorp-
tion intestinale du calcium. Si les conseils diététiques sont
impossibles ou inopérants, une supplémentation calcique
médicamenteuse peut être prescrite, là encore adaptée en fonc-
tion des apports alimentaires, soit 1 à 2 comprimés par jour.
Ph. Orcel
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l’article sur le syn-
drome d’insuffisance osseuse transitoire d’effort
publié dans La Lettre du Rhumatologue n° 249 de
février 1999. Dans cet article, vous citez les frac-
tures de contrainte pouvant survenir après la pose
de prothèses articulaires. J’ai eu l’occasion de
suivre un homme âgé de 40 ans chez qui avait été
mise en place une prothèse fémorale non scellée
(reprise d’un implant placé dix ans auparavant).
Dans les suites de cette intervention, mon patient
a présenté pendant 6 mois des douleurs fémorales
en regard de la queue de l’implant prothétique...
Un bilan scintigraphique objectivait une fixation
anormale dans la zone douloureuse pouvant évo-
quer une fracture de contrainte ou une FIOTE.
Très curieusement, après plusieurs mois d’évolu-
tion péjorative, j’ai prescrit en désespoir de cause
du kétoprofène. En quelques jours, la douleur dis-
paraissait, comme si l’effet antalgique lui avait
permis de pendre un appui puissant sur l’implant
prothétique et de le réencastrer...
Les douleurs après pose d’une prothèse de hanche non scel-
lée en remplacement d’une prothèse cimentée descellée, en
regard de la queue de la prothèse, avec intense hyperfixation
osseuse isotopique localisée, pouvaient en effet faire suspec-
ter le diagnostic de fracture de contrainte (fracture sur sque-
lette modifié par la prothèse), mais non celui de FIOTE, qui
est, par définition, une fracture par insuffisance osseuse tran-
sitoire d’effort (survenant sur un squelette normal après une
activité physique intense, inhabituelle et répétée, sans trau-
matisme unique et important).
Mais la guérison spectaculaire des douleurs après quelques
jours de kétoprofène dans le cas de votre patient n’est pas très
en faveur de ce diagnostic de fracture de contrainte. Il serait
néanmoins très intéressant de revoir les clichés pris immé-
diatement après la pose de la prothèse et de les comparer avec

La Lettre du Rhumatologue - n° 252 - mai 1999
41
QUESTIONS/RÉPONSES
RÉUNIONS
&
CONGRÈS
XeJournée de Menucourt, samedi 25 sep-
tembre 1999, La Châtaigneraie -
Menucourt
Stratégie devant une pathologie dégénéra-
tive de la coiffe des rotateurs de l’épaule.
Renseignements : secrétariat de J.N. Heuleu,
CRRF La Châtaigneraie.
Tél. : 01 34 46 64 22. Fax : 01 34 66 72 67.
Journée montpelliéraine de rhumatologie,
samedi 2 octobre 1999, palais des Congrès,
Le Corum, Montpellier
Journée de formation médicale continue en
rhumatologie, portant sur des thèmes
divers : lombalgies, arthrites infectieuses,
virus de l’hépatite C et maladies articu-
laires, arthrites chroniques juvéniles, patho-
logie du phosphore, TNFαet polyarthrite
rhumatoïde – perspectives thérapeutiques,
anti-COX-2, pathologie tendineuse du pied,
myofasciites à macrophages, prescriptions
hors AMM en rhumatologie..., organisée
par J. Sany, B. Combe, F. Blotman et
J.L. Leroux.
Renseignements : J. Sany, service d’immuno-
rhumatologie, hôpital Lapeyronie, 34295
Montpellier Cedex 5.
Tél. : 04 67 33 77 92/04 67 33 72 31.
Fax : 04 67 61 97 31.
18es Journées de médecine du sport de
l’hôpital St-Jan, 7-9 octobre 1999,
Bruges
Renseignements : Revalidatiecentrum A.Z.
St-Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge,
Belgique.
Tél. : (32) (050) 45 29 00 - (32) (050) 45 22
30. Fax : (32) (050) 45 22 31.
E-mail : [email protected]
http://uc2.unicall.be/brucosport/index.htm
17eJournée de traumatologie du sport de
la Pitié-Salpêtrière, 13 novembre 1999,
Maison de la Chimie, Paris
Microtraumatismes et traumatismes du sport
chez l’enfant.
Renseignements : J. Rodineau, service de
rééducation, hôpital de la Salpêtrière, 47, bd
de l’Hôpital, 75013 Paris.
Fax : 01 42 16 11 48.
DIPLÔMES
Diplôme interuniversitaire de pathologie
locomotrice liée à la pratique du sport
Regroupant les facultés de Paris-VII,
Grenoble, Lyon, Marseille et Nice.
Directeur d’enseignement à l’Université
Paris-VII, UFR Xavier-Bichat : Dr Thierry
Boyer.
Renseignements et inscriptions : voir ci-
dessous.
Diplôme universitaire de pathologie
rachidienne
Sous la direction des Drs M. Benoist et
P. Béraud, des Prs A. Deburge, P. Guigui et
D. Huten et du Dr Ph. Stora, Université
Paris-VII, UFR Xavier-Bichat.
Renseignements et inscriptions : voir ci-
dessous.
Diplôme interuniversitaire d’arthroscopie
Universités de Paris-V et VII, Nancy I,
Strasbourg-I, Caen, Lyon-I, Nice Sophia-
Antipolis, Aix-Marseille-II, Bordeaux,
Grenoble.
Directeur d’enseignement à l’Université
Paris-VII, UFR Xavier-Bichat : Dr Thierry
Boyer.
Pour ces trois diplômes : renseignements et
inscriptions auprès de Corine Bensimon, servi-
ce du Pr Meyer, hôpital Bichat, 46, rue Henri-
Huchard, 75018 Paris.
Tél. : 01 40 25 74 01.
e-mail : [email protected]
des clichés pris plusieurs mois après, afin de déceler d’éven-
tuelles appositions périostées, voire une fissure osseuse qui
pourrait alors faire porter ce diagnostic de fracture de
contrainte.
En l’absence de tels signes radiologiques ou scanographiques
tardifs (appositions périostées, condensation avec ou sans fis-
sure), l’hypothèse que vous proposez (douleurs mécaniques
liées à la queue de la prothèse non scellée qui se serait réen-
castrée par un appui puissant qu’aurait permis la sédation
des douleurs grâce au kétoprofène) paraît davantage corres-
pondre au diagnostic exact.
En cas de fracture de contrainte, comme d’ailleurs en cas de
FIOTE ou de fracture ostéoporotique, il est difficile d’imagi-
ner un effet favorable aussi spectaculaire du kétoprofène sur
les douleurs.
P. Doury
BLOC-NOTES
Reportez-vous à la page 39
pour découvrir
la nouvelle formule
des petites annonces
professionnelles
.../...
1
/
3
100%