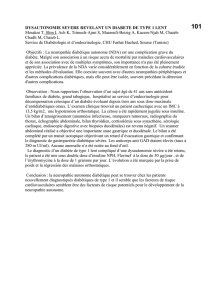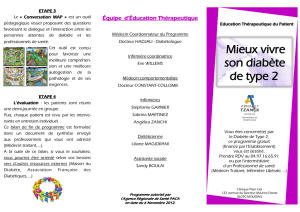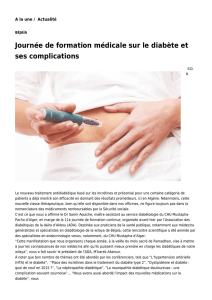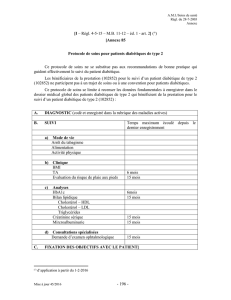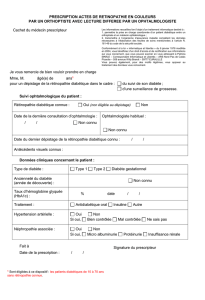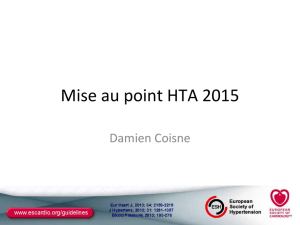Cœur et diabète : quoi de neuf ? CONGRÈS RÉUNION

28 | La Lettre du Cardiologue • n° 474 - avril 2014
CONGRÈS
RÉUNION
Cœur et diabète :
quoi de neuf ?
Paris, les 13 et 14 février 2014
D. Desposito*
Tabac, métabolisme
et maladies cardio vasculaires
(D’après la communication de D. Thomas)
Il est bien connu désormais que le tabac est un
important facteur de risque vasculaire et cardiovas-
culaire. Chez le diabétique, il multiplie de 3,5 à 4 fois
la mortalité et constitue un surrisque important
de maladie cardiovasculaire. De plus, la pose d’un
stent chez le fumeur diabétique implique un risque
important de resténose coronarienne.
Le tabac joue aussi un rôle important dans le méta-
bolisme et l’évolution de l’équilibre glycémique. En
effet, il stimule le système sympathique, ce qui peut
favoriser le développement d’une obésité abdo-
minale et un syndrome métabolique. En fait, les
fumeurs ont une mauvaise répartition des graisses,
si bien que leur tour de taille et leur rapport taille/
hanches sont plus élevés. Le tabac joue également
un rôle sur l’insulino résistance et l’intolérance au
glucose, fortement augmentées chez le fumeur actif
mais aussi chez le fumeur passif. De plus, il existe un
effet direct de la nicotine, du monoxyde de carbone
ou d’autres composants chimiques du tabac sur les
cellules β sécrétrices d’insuline du pancréas. Il faut
noter aussi que le tabac influence la répartition des
* INSERM UMRS 1138, centre de
recherche des Cordeliers, Paris.
lipides : diminution du taux de HDL-cholestérol et
augmentation du taux de LDL-cholestérol. Une
importante méta-analyse publiée début 2014 et
regroupant 51 études apporte de solides arguments
en faveur d’un rôle majeur du tabac dans le dévelop-
pement du diabète de type 2
(1)
. Ainsi, le risque de
développer un diabète est augmenté de 30 à 40 %
chez le fumeur actif par rapport au non-fumeur. On
observe enfin une relation dose-réponse positive
entre le nombre de cigarettes fumées et le risque
de développer un diabète.
L’arrêt du tabac avant l’âge de 30 ans permet d’éli-
miner à 100 % le risque de maladie cardiovasculaire.
Mais, chez les diabétiques, le phénomène inflam-
matoire est pérennisé et le bénéfice est plus tardif :
dans les 5 à 10 ans après le sevrage. Dans le sevrage
tabagique, la principale crainte du patient diabétique
est la prise de poids à la suite du sevrage et, donc,
le déséquilibre du contrôle glycémique. Cependant,
le sevrage tabagique, malgré la prise de poids, a un
bénéfice significatif sur le risque cardiovasculaire.
L’avantage reste donc en faveur du sevrage chez
les patients fumeurs et diabétiques. Compte tenu
des difficultés à arrêter de fumer, le médecin se
doit d’être proactif dans le sevrage du diabétique
(personnel paramédical, intervention personnalisée,
outils de sevrage et suivi régulier). Le concept de
“glucose equivalent of smoking”
, qui explique que le
risque de décès d’un fumeur est équivalent au risque
d’une personne ayant une glycémie à jeun d’environ
0,68 g/l, peut aussi motiver l’arrêt du tabac chez le
diabétique
(2)
.
Au final, le tabagisme intervient de façon majeure
dans les complications cardiovasculaires du diabé-
tique et a un rôle certain, dose-dépendant, dans
l’incidence du diabète de type 2. Les bénéfices de
l’arrêt du tabac sont déterminants dans le devenir
cardiovasculaire du diabétique et seront d’autant
plus importants que cet arrêt aura été précoce. La
prise en charge médicalisée active du sevrage taba-
gique doit être systématiquement incluse dans la
prise en charge des patients diabétiques.
Le congrès CoDia, organisé par les Prs Michel Komajda et Bernard Charbonnel, qui s’est
déroulé les 13 et 14 février derniers à Paris, a encore connu un grand succès ! Ce forum est
l’occasion de réunir cardiologues et diabétologues afin d’échanger sur les complications
cardiovasculaires du patient diabétique, les nouvelles avancées dans le domaine et leurs
implications cliniques au quotidien. Cette 9
e
édition est d’autant plus importante que
l’année 2013 a été riche en matière de recherche clinique sur le diabète et les complica-
tions cardio vasculaires (nouvelles recommandations, grandes études de morbi-mortalité
et nouveaux antidiabétiques). De prestigieux orateurs ont ainsi pu faire le point sur les
différentes analyses, décrire les principaux facteurs de risque associés et aborder les
nouvelles classes thérapeutiques.

La Lettre du Cardiologue • n° 474 - avril 2014 | 29
CONGRÈS
RÉUNION
Qu’apporte la génétique
au clinicien ?
(D’après les communications de P. Froguel,
P. Amouyel et P. Charron)
La génétique – plus précisément la génomique –
vise à rechercher des associations entre les variants
génétiques et le risque de maladie, pour apporter de
nouvelles hypothèses de recherche, mesurer le risque
et le prévenir, mettre en place une recherche trans-
lationnelle et pratiquer une médecine de précision
personnalisée. L’avenir de la génétique est dans l’étude
des associations entre variants fréquents ou rares et
environnement, pour identifier le risque de développer
une maladie et appréhender la complexité de cette
maladie ou la susceptibilité de réponse au traitement.
L’étude de E.A. Ashley et al., parue en 2010, en constitue
un très bon exemple
(3)
. En effet, elle a poussé l’inter-
prétation du génome humain au maximum. Stephen,
un individu atteint de nombreuses anomalies familiales
dont les bilans biologique, métabolique et cardiaque
sont bons, a séquencé l’ensemble de son génome et a
identifié tous les risques possibles (maladies et modi-
fication de la sensibilité aux traitements). Il a ensuite
établi les interactions entre gènes et environnement,
dans le but de comprendre comment la santé de l’indi-
vidu peut être conservée le plus longtemps possible en
repérant ce qui doit être corrigé dans son mode de vie.
La cardiologie recense une cinquantaine de gènes de
susceptibilité ; la génétique va informer sur l’origine
des maladies et identifier des cibles thérapeutiques.
Un bilan cardiaque familial et un test génétique
permettent de surveiller le patient à risque ou de
prédire et traiter la maladie de façon adaptée. La
pharmacogénétique est importante aussi en cardio-
logie pour expliquer les différences de réponse entre
les individus et anticiper les moins bons répondeurs
de manière à adapter le traitement à l’aide de produits
de remplacement. En ce qui concerne le diabète de
type 2, quelque 2 % des cas sont monogéniques
contre 95 % de formes polygéniques. Le diagnostic
génétique des diabètes monogéniques est désor-
mais facile, rapide et peu onéreux. Un questionnaire
clinique simple permet de rechercher la probabilité
de détecter une anomalie génétique de diabète. La
génomique va ensuite permettre de connaître les
causes du diabète et, de ce fait, d’instaurer un traite-
ment adapté et efficace. La connaissance des diabètes
monogéniques a également permis de construire des
cellules β artificielles pour une médecine régénéra-
trice et pour la thérapie génique. Le diabète de type 2
d’origine polygénique est dû à la combinaison gènes-
environnement. La génomique va alors rechercher
le rôle de ces gènes dans la toxicité pancréatique,
dans la réponse aux différents traitements, dans les
complications du diabète et dans le risque de diabète.
Les nouvelles méthodologies génétiques permettent
aussi une caractérisation génétique des diabètes
familiaux et l’amélioration de leur prise en charge.
Dans les maladies monogéniques, le test génétique
est devenu un outil de routine qui peut aider le clini-
cien dans le diagnostic, le pronostic, la prédiction
ou le traitement de la maladie. Dans les maladies
multifactorielles, le test génétique reste un outil
de recherche. Grâce à l’évolution des technologies,
l’analyse du génome est aujourd’hui rapide et de
moins en moins onéreuse. Le séquençage de haut ou
de moyen débit permet depuis peu de cibler des gènes
de susceptibilité de diabète ou de cardiomyopathie.
L’ischémie myocardique
du diabétique
(D’après les communications de P. Henry
et C. Spaulding)
Les recommandations du dépistage de l’ischémie
myocardique silencieuse chez le diabétique ont connu
de nombreux changements. Malgré des recomman-
dations européennes peu favorables au dépistage, la
recherche d’ischémie myocardique est souvent prati-
quée en France. Cependant, le dépistage ne modifie
pas le pronostic du patient : il identifie les lésions
coronaires stables et ne sait pas prédire les lésions
instables, à plus haut risque. L’utilisation d’une échelle
spécifique au dépistage est utile mais peu définie.
Depuis peu, la Société francophone du diabète (SFD)
recommande de réaliser un doppler carotidien et des
membres inférieurs afin de rechercher la présence de
plaques athéromateuses pouvant être prédictives
d’une maladie coronarienne associée. Le score de
calcification, peu onéreux, constitue également un
moyen rapide de détecter les diabétiques à haut risque.
Chez le diabétique, un diagnostic complémentaire
d’insuffisance rénale, qui aggrave le pronostic, sera
intéressant pour optimiser la prise en charge.
L’ischémie myocardique silencieuse sera donc recher-
chée chez les diabétiques à risque, c’est-à-dire ceux
présentant une dysfonction rénale, un score de calci-
fication élevé, une autre atteinte athéromateuse et/
ou un diabète ancien. Une fois la maladie corona-
rienne dépistée, la priorité sera d’optimiser le traite-
ment médical, sachant que ces patients présentent un
risque d’événement ultérieur. La revascularisation n’est
pas forcément l’objectif systématique. En effet, selon
l’étude FREEDOM, la revascularisation chirurgicale par

CONGRÈS
RÉUNION
pontage coronarien chez le diabétique est plus favorable
que la revascularisation par angio plastie coronaire, et ce
malgré l’augmentation du risque d’accident vasculaire
cérébral à 5 ans. Cela s’explique par l’augmentation
importante du risque de resténose intrastent et du
risque de thrombose chez le patient diabétique.
Le dépistage systématique de l’ischémie myocar-
dique du diabétique ne fait donc pas l’unanimité
et reste encore discuté. Cependant, lorsqu’elle est
dépistée, la prise en charge de la coronaropathie doit
être discutée et l’avis du patient, pris en compte.
Hypertension artérielle
résistante : les stratégies
interventionnelles
(D’après la communication de X. Girerd)
L’hypertension artérielle (HTA) résistante, dont la défini-
tion dépend des données épidémiologiques, est difficile
à évaluer. Le plus souvent, le traitement est inadapté.
Il faut savoir que 10 % des hypertendus ont une HTA
résistante et que seuls 5 % d’entre eux ont un traitement
adapté à leur HTA. En France, afin de lutter contre l’HTA
résistante, des recommandations pragmatiques ont été
mises en place par la SFHTA (Société française d’HTA).
La dénervation rénale par radiofréquence ou par
ultrasons est une technique simple et sans risque
pour traiter l’HTA résistante. Elle consiste à inter-
rompre l’activité électrique des nerfs du système
nerveux sympathique à destinée rénale, par applica-
tion locale d’un courant électrique de faible inten-
sité contre la paroi des artères rénales. Elle pourrait
concerner près de 30 % des patients hypertendus.
Cette technique permet une diminution impor-
tante de la pression artérielle, qui reste pérenne
dans le temps. Cependant, cette diminution varie
d’un patient à un autre. Des études évaluant la
dénervation rénale, son efficacité et ses causes
d’échec sont actuellement menées en France ; il
est important de faire progresser cette technique
prometteuse en trouvant des marqueurs de réussite
du chauffage endovasculaire, et/ou en étendant les
zones de chauffage afin d’augmenter les chances de
réussite de la procédure. Aucune étude n’a encore
été réalisée chez le diabétique hypertendu. ■
1. National Center for Chronic
Disease Prevention and Health
Promotion (US) Office on
Smoking and Health. The Health
Consequences of Smoking—50
Years of Progress: A Report of the
Surgeon General. Atlanta (GA):
Centers for Disease Control and
Prevention (US); 2014.
2. Wen CP, Cheng TY, Tsai SP et
al.Exploring the relationships
between diabetes and smoking:
with the development of glucose
equivalent concept for diabetes
management. Diabetes Res Clin
Pract 2006;73(1):70-6.
3. Ashley EA, Butte AJ, Wheeler MT
et al. Clinical assessment incorpo-
rating a personal genome. Lancet
2010;375(9725):1525-35.
Références
bibliographiques
L’auteur déclare ne pas avoir
deliens d’intérêts.
1
/
3
100%