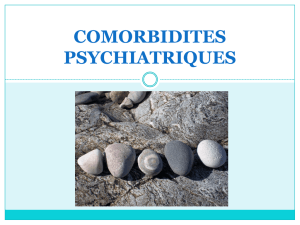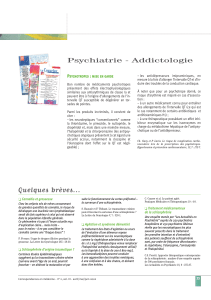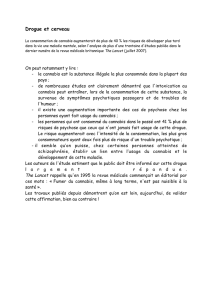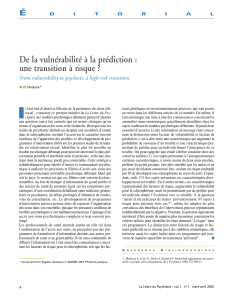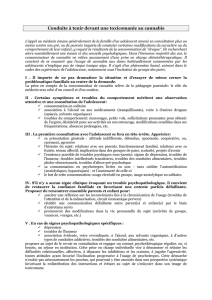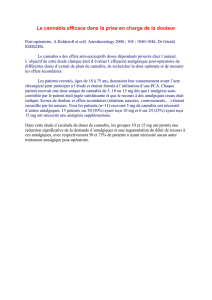Avancées et recherches REVUE DE PRESSE Le tabac pendant

L’Encéphale (2009) 6, 515-520
REVUE DE PRESSE
Chefs de rubrique : D. Gourion
Ph. Gorwood
Avancées et recherches
Ph. Gorwood (1)
Le tabac pendant
la grossesse constitue un
facteur de risque de psychose
Maternal tobacco, cannabis and alcohol
use during pregnancy and risk of adoles-
cent psychotic symptoms in offspring.
Br J Psychiatry. 2009 Oct ; 195 (4) : 294-
300.
Zammit S, Thomas K, Thompson A,
Horwood J, Menezes P, Gunnell D, Hollis
C, Wolke D, Lewis G, Harrison G.
CONTEXTE
On a de moins en moins de doute que
le cannabis puisse avoir un rôle inducteur
d’épisodes psychotiques, voire de déclen-
chement de schizophrénie, au moins chez
les sujets vulnérables. Les liens entre schi-
zophrénie et tabac sont plus complexes, les
études épidémiologiques étant peu con-
cordantes. En règle générale, on considère
que l’exposition, précoce et importante, au
tabac pourrait être un marqueur de vulné-
rabilité à la schizophrénie. Quelques hypo-
thèses sont données sur un rôle direct du
tabac sur le développement de trouble psy-
chotique. Si ces conclusions sont pour le
moins prudentes, c’est que détecter un rôle
direct de facteurs de risque requière des
études considérables, en temps (de suivi)
et en taille (recrutement). Zammit et ses col-
lègues ont proposé une idée originale pour
contourner ce problème.
MÉTHODE
La schizophrénie touchant autour de
1 % de la population générale, pourquoi ne
pas s’intéresser à un trouble en amont, cer-
tes moins spécifique, mais bien plus
répandu, la présence de symptômes psy-
chotiques à l’adolescence ? L’autre avan-
tage de cette approche (quand on se fixe,
comme ici, sur des enfants de 12 ans),
c’est que l’information sur le tabagisme des
mères est plus proche, donc a priori moins
biaisé. 6 300 jeunes adolescents d’une
cohorte existante (donc les informations sur
la grossesse étaient bien collectées en
temps réel) ont été étudiés pour les symp-
tômes psychotiques à l’aide de l’échelle
PLIKSi, entretien semi-structuré réalisé en
face-à-face. Les consommations d’alcool
et de cannabis ont aussi été notées.
RÉSULTATS
Les Britanniques sont d’excellents épi-
démiologistes, les auteurs ont donc tout de
suite commencé par évaluer en quoi le
tabagisme maternel témoignait d’autres
facteurs de risque potentiels tels la pau-
vreté, l’isolement, le niveau socio-économi-
que ou le fait de vivre en ville. C’est bien sûr
le cas systématiquement pour le tabac
mais en bonne partie aussi pour le cannabis
et l’alcool.
L’étude montre que la consommation
de tabac pendant la grossesse est asso-
ciée à un risque accru de symptômes psy-
chotiques à 12 ans, avec un effet dose,
c’est-à-dire que plus cette consommation
est importante, plus le risque est élevé (de
15 % d’augmentation du risque pour un
demi paquet par jour à 230 % pour plus
d’un paquet par jour). Ce lien n’était pas
retrouvé (de manière presque étonnante…)
pour le cannabis, mais les effets de l’alcool
semblent aussi avoir la même tendance,
quoique uniquement pour les doses éle-
vées (plus de 3 verres par jour pendant la
grossesse…). Pour prendre en compte le
fait que ces consommations (alcool, tabac
et cannabis) ont tendance à s’accumuler
(addiction), l’impact des comorbidités a été
contrôlé, ce qui ne change pas l’effet réel
du tabac.
CONCLUSIONS
Le tabac pendant la grossesse aug-
mente le risque de symptômes psychoti-
ques à l’adolescence, ce d’autant que cette
consommation est importante, et surtout
pendant le troisième trimestre. Ce résultat
ne semble pas vrai pour le cannabis, et
n’est retrouvé pour l’alcool qu’à des doses
très fortes.
COMMENTAIRE
Que le tabac pendant la grossesse constitue
un facteur de risque pour la présence de
symptômes psychotiques chez l’adolescent
est une surprise… Que cela ne soit par contre
pas le cas pour le cannabis en est une autre.
L’imputabilité de la substance tabac est bien
sûr atténuée par le fait que fumer pendant la
grossesse est avant tout un marqueur de plu-
sieurs autres facteurs de risque. En effet, le
poids du tabagisme maternel sur le risque de
symptômes psychotiques à l’adolescence est
diminué de 40 % si toutes les variables con-
fondantes sont contrôlées. Le tabagisme
paternel a aussi été analysé (par ses effets
passifs in utero), avec des effets moins frap-
pants mais allant dans la même direction, ce
qui renforce le résultat global. Il manque clai-
rement d’études chez l’animal donnant un
rationnel biologique à ce résultat. Les données
actuelles à propos de l’impact du tabac sur la
neurogenèse, la potentialisation à long terme
(LTP) et l’hypersensibilisation des récepteurs
cholinergiques sont essentiellement basées
sur des analyses directes.
(1) Hôpital Louis Mourier, Colombes.

516 Ph. Gorwood
Descriptive summary of contounders in relation to maternal substance use during pregnancya
n (%)
Low
social
class
Income
support
Council
housing
Single
status
(mother)
Rural
birth
Low
maternal
education
Low
paternal
education
Mother’s
age > 30
Medication
pregnancy
Maternal
depression
(EPDS ≥ 15)
Paternal
tobacco
use
Tobacco use
Non-smokers 3 462
(39,9)
561
(6,3)
7 787
(81,6)
749
(7,7)
623
(6,3)
1 408
(15,3)
1 328
(17,9)
3 371
(33,7)
5 882
(62,2)
453
(4,8)
1 890
(23,6)
Smokers 1 722
(60,2)
585
(18,9)
1 815
(51,2)
734
(19,8)
139
(3,7)
1 101
(13,9)
808
(33,9)
803
(20,9)
2 557
(73,1)
413
(11,6)
1 829
(68,6)
Cannabis use
Never used 4 849
(44,3)
1 000
(8,8)
9 153
(75,3)
1 296
(10,4)
723
(5,8)
2 255
(19,3)
1 967
(21,1)
3 913
(30,8)
7 894
(64,7)
740
(6,1)
3 348
(33,9)
Ever used 162
(53,8)
102
(30,3)
152
(39,7)
105
(26,8)
8
(2,0)
84
(24,0)
76
(29,7)
87
(21,4)
272
(71,0)
64
(16,9)
214
(73,8)
Alcohol use
< 1 glass/week 4 052
(47,2)
864
(9,6)
7 098
(73,2)
1 058
(10,6)
535
(5,3)
1 931
(20,9)
1 713
(23,1)
2 756
(27,0)
6 164
(63,6)
627
(6,4)
2 809
(34,6)
≥ 1 glass/week 1 000
(36,7)
254
(9,1)
2 279
(76,3)
376
(12,3)
212
(6,9)
490
(16,8)
381
(16,9)
1 308
(42,3)
2 093
(69,4)
199
(6,6)
852
(35,1)
EPDS, Edinburgh Posnatal Depression Scale.
a. For tobacco use, all P < 0.001 ; for cannabis use, all P < 0.05 ; for alcohol use, all P > 0.01 except income support (P = 0,43), paternal smoking (P = 0,63) and maternal
depression (P = 0,70). Note that confounding variables dichotomised only for the purpose of this table and not for analystes ; data in table in on whole cohort and not just those
with PLIKS data.
Crude and adjusteda odds ratios (OR) and 95 % CI for psychosis like symptoms (PLIKS) by maternal substance use during pregnancy
n
Suspected
or definite PLIKS
Crude OR (95 % CI)
Suspected
or definite PLIKS
Crude OR (95 % CI)
Definite PLIKS
Crude OR (95 % CI)
Definite PLIKS
Adjusted OR (95 % CI)
Tobacco
None 3 579 1111
1-9 cigarettes/day 295 1,15 (0,79-1,66) 0,92 (0,63-1,36) 1,53 (0,92-2,53) 1,25 (0,73-2,14)
10-19 cigarettes/day 266 1,88 (1,35-2,61) 1,47 (1,02-2,12) 2,33 (1,48-3,66) 1,65 (0,99-2,75)
≥ 20 cigarettes/day 113 2,30 (1,45-3,65) 1,84 (1,12-3,03) 2,03 (1,01-4,10) 1,54 (0,73-3,25)
Linear trend 4 253 1,33 (1,18-1,49),
P < 0,001
1,20 (1,05-1,37),
P = 0,007
1,39 (1,18-1,63)
P < 0,001
1,21 (1,01-1,47),
P = 0,047
Cannabis
None 4 175 1111
< 1/week 37 0,95 (0,34-2,70) 0,58 (0,20-1,70) 0,57 (0,08-4,20) 0,34 (0,04-2,56)
≥ 1/week 41 1,62 (0,71-3,66) 1,04 (0,45-2,43) 1,63 (0,50-5,32) 1,12 (0,33-3,84)
Linear trend 4 253 1,22 (0,83-1,79),
P = 0,317
0,94 (0,62-1,41),
P = 0,755
1,16 (0,65-2,09,
P = 0,616
0,91 (0,49-1,71),
P = 0,776
Alcohol
None 2 522 1111
≤ 7 units/week 1 293 0,92 (0,74-1,14) 0,92 (0,74-1,15) 0,67 (0,48-0,94) 0,68 (0,48-0,96)
8-21 units/week 410 1,05 (0,77-1,48) 1,00 (0,71-1,39) 0,58 (0,33-1,04) 0,56 (0,31-1,02)
≥ 22 units/week 28 2,58 (1,09-6,11) 2,40 (0,99-5,83) 2,14 (0,64-7,17) 1,86 (0,54-6,42)
Linear (per 10 units)b4 253 0,80 (0,51-1,25) 0,75 (0,47-1,19) 0,77 (0,48-1,25) 0,73 (0,45-1,18)
Quadratic (linear2)b4 253 1,21 (1,00-1,47) 1,22 (1,00-1,49) 1,04 (0,97-1,12) 1,04 (0,97-1,12)
Likelihood ratio
(for overall alcohol)b4 253 χ2 = 9,8, d.f. = 2,
P = 0,008
χ2 = 8,3, d.f. = 2,
P = 0,016
χ2 = 1,3, d.f. = 2,
P = 0,522
χ2 = 1,8, d.f. = 2,
P = 0,415
a. Adjusted for other substances used, and all variables in Table 1 ; data-set with no missing data for confounders 4 253.
b. Results for linear and quadratic terms for alcohol use are with both included in same model.

Revue de presse 517
Major depression or schizoaffective depression
Mania, hypomania, or schizoaffective mania
All episodes
0
10
20
30
40
123456
Baseline global Anxiety Rating
Percent Time in Episodes
L’anxiété chez les bipolaires
constitue un facteur de mauvais
pronostic
Anxiety and outcome in bipolar disorder.
Am J Psychiatry. 2009 Nov ; 166 (11) :
1238-43.
Coryell W, Solomon DA, Fiedorowicz JG,
Endicott J, Schettler PJ, Judd LL.
CONTEXTE
L’anxiété constitue un facteur de risque
de mauvaise réponse thérapeutique chez
les sujets souffrant d’un épisode dépressif
majeur. Il s’agit même de l’un des critères
ayant la plus forte prédictivité pour la
réponse thérapeutique comme cela a été
montré récemment dans l’étude STAR*D.
Les sujets avec un haut niveau d’anxiété ou
souffrant d’une comorbidité anxieuse ont
de même plus de risque de virage, de ten-
tative de suicide, et un délai plus long avant
d’atteindre la rémission. Ces études sont
néanmoins assez courtes, et portent sur-
tout sur des unipolaires. L’équipe de San
Diego a donc analysé une nouvelle fois leur
bien belle cohorte de 430 bipolaires con-
sultants, avec un suivi allant jusqu’à 20 ans
pour certains.
MÉTHODE
Ici, seule la sévérité de l’anxiété à l’inclu-
sion des patients a été analysée. Ce niveau
d’anxiété a ensuite été regroupé en 6 types
de cotation. Le temps passé en dépression
et en phase maniaque sur les années sui-
vantes a par la suite été comparé dans ces
6 groupes. Le niveau d’anxiété étant plus
élevé dans la dépression que dans l’accès
maniaque (ce n’est pas une surprise), ce
niveau d’anxiété indiquait tout d’abord
l’existence d’une dépression, facteur de
risque en soi de plus d’épisodes ultérieurs.
Quelques analyses contrôlant ce biais ont
donc aussi été proposées.
RÉSULTATS
Plus le niveau d’anxiété initial est élevé,
plus le patient passera de temps en dépres-
sion, alors que c’est l’inverse pour les épi-
sodes maniaques. En dehors de la polarité,
le temps passé dans les épisodes thymi-
ques est corrélé à la sévérité initiale de
l’anxiété. Une anxiété quasiment nulle dans
le premier épisode est associée au fait de
ne passer que 15 % des années suivantes
en dépression ou en manie, pour 40 % si
cette anxiété est majeure.
Cet effet prédictif est décroissant dans
le temps, mais reste significatif jusqu’à
20 ans après, ce qui témoigne d’un rôle réel
et solide, quels que soient les facteurs en
jeu. Les effets de la polarité initiale (com-
mencer par une dépression est de plus
mauvais pronostic…) semblent quant à eux
moins solides dans le temps, venant ren-
forcer l’idée que les symptômes anxieux
constituent un facteur de risque relative-
ment autonome.
Enfin, les analyses plus précises des
manifestations anxieuses impliquées sont
plutôt en faveur d’un rôle prédictif de
l’anxiété au niveau dimensionnel, puisque
la comorbidité anxieuse, pour le trouble
panique comme pour tout trouble anxieux
syndromique, n’avait pas de lien avec le
temps passé en phase thymique dans les
années suivantes.
CONCLUSIONS
Un niveau d’anxiété plus élevé au cours
de l’épisode index (le premier traité) est un
facteur de mauvais pronostic. Plus les
sujets sont anxieux initialement, plus ils
passeront de temps dans des épisodes
thymiques les années à venir. Cette anxiété
signe la présence d’un épisode dépressif
plutôt que maniaque dans l’épisode index,
mais cette contamination ne suffit pas à
expliquer le rôle de marqueur négatif du
niveau d’anxiété initial.
C’est l’augmentation récente
de la consommation du
cannabis qui est associée à
l’émergence de prodromes et
d’épisodes schizophréniques
Association of pre-onset cannabis, alcohol,
and tobacco use with age at onset of pro-
drome and age at onset of psychosis in first-
episode patients.
Am J Psychiatry. 2009 Nov ; 166 (11) : 1251-7.
Compton MT, Kelley ME, Ramsay CE, Pringle
M, Goulding SM, Esterberg ML, Stewart T,
Walker EF.
COMMENTAIRE
Une hypothèse séduisante (mais bien peu
étayée par leur travail) serait que les sujets qui
ont souffert de maltraitance infantile ont une
dépression initiale marquée par plus d’anxiété,
et ont donc en général un temps passé en
dépression plus long que les autres bipolaires.
On voit poindre alors le problème de la comor-
bidité avec la pathologie borderline (fortement
comorbide avec le trouble bipolaire). Mais les
auteurs ne s’y avancent pas puisque leur
cohorte ne comprenait pas d’évaluation des
troubles de la personnalité. La conclusion
pragmatique peut être la plus importante, mais
là aussi bien indirecte, est la nécessité de repé-
rer précocement cette anxiété initiale, et peut
être de privilégier des thymorégulateurs ayant
une composante anxiolytique…
Relationship of percent time in depressive episodes to baseline global anxiety level and index
episode polarity in 427 patients with bipolar disorder, by follow-up perioda
Follow-up period
1-5 years
(N = 356)
6-10 years
(N = 311)
11-15 years
(N = 271)
16-20 years
(N = 230)
Measure FpFpFpFp
Global anxiety levelb5,3 0,021 1,1 0,285 4,7 0,031 3,4 0,065
Episode polarityc22,0 < 0,001 9,2 0,003 3,6 0,059 2,1 0,151
a. General linear model analyses for participants who completed each 5-year period.
b. Sum of the somatic and psychic anxiety scores on the schedule for affective disorders and schisophrenia.
c. Pure mania versus pure depression or cycling.

518 D. Gourion
CONTEXTE
Les patients qui souffrent de schizoph-
rénie ont une forte comorbidité addictive,
pour le tabac, l’alcool et le cannabis, leurs
fréquences étant deux fois plus importan-
tes que celle de la population générale. Les
données sur le cannabis comme facteur de
risque de la schizophrénie sont nombreu-
ses, néanmoins l’impact du cannabis sur
les prodromes est moins bien étudié. Cette
approche en amont peut être particulière-
ment intéressante pour mieux percevoir à
quel niveau le cannabis peut faciliter les
décompensations psychotiques.
MÉTHODE
L’étude proposée ici ne brille certaine-
ment pas par la force de l’approche épidé-
miologique. Avec 100 sujets en tout et pour
tout, une analyse rétrospective ; on est tout
d’abord surpris qu’un tel travail puisse être
publié dans une revue si prestigieuse. En
réalité, la force de cet article, réside dans
la richesse clinique de ses analyses, avec
une concentration sur de jeunes patients
évalués au cours du premier épisode psy-
chotique (moins de 3 mois d’ancienneté),
et recrutés dans 3 centres socialement pré-
caires, favorisant ainsi le risque d’exposi-
tion au cannabis. Les évaluations sont donc
très approfondies sur les symptômes schi-
zophréniques et tous les prodromes, avec
à chaque fois le moment de leur apparition,
ainsi que les modalités de consommations
en fréquence comme en dose.
RÉSULTATS
La consommation de cannabis journa-
lière est retrouvée deux fois plus fréquem-
ment dans les quelques semaines qui pré-
cèdent le premier épisode psychotique que
dans les autres périodes analysées. Cette
fréquence quotidienne est la seule retrou-
vée comme facteur de risque. Elle est dif-
férente pour la consommation d’alcool –
pas d’augmentation du facteur – en revan-
che, elle se rapproche de celle du tabac.
Étant donné que le niveau de consomma-
tion est assez instable dans cette popula-
tion jeune, l’étude a ensuite porté sur les
modifications dans le temps de ces diffé-
rentes consommations. Les résultats sont
alors beaucoup plus tangibles.
Hazard ratios for onset of symptoms, using
frequency of use as a time-dependent
covariate to test the effects of pregression
of usea
Si l’on ne s’intéresse qu’aux consom-
mations qui augmentent dans le temps, les
passages d’une consommation nulle à
occasionnelle, d’occasionnelle à hebdo-
madaire et d’hebdomadaire à quotidienne,
sont toutes des facteurs de risque pour
l’épisode psychotique. Plus exactement,
elles sont retrouvées bien plus que ne le
voudrait le hasard, dans les semaines qui
précédent l’émergence psychotique.
Cet effet dose de l’augmentation de fré-
quence n’est peu ou pas observé ni pour
l’alcool ni pour le tabac.
Enfin, last but not least, si l’on incorpore
dans les analyses l’émergence de signes
prodromiques, la prédictivité augmente.
C’est dire que la consommation de canna-
bis possède des effets sans doute assez
directs sur l’ensemble du trouble. De ces
toutes premières manifestations (prodro-
miques), à son expression la plus bruyante
(l’épisode psychotique).
CONCLUSIONS
Nouvel épisode dans les liens entre le can-
nabis et la schizophrénie, pointant du doigt
cette fois la fréquence récemment accrue de
sa consommation comme facteur de risque
réel, pour le trouble constitué comme pour ses
manifestations prodromiques.
Clinique et thérapeutique
D. Gourion (1)
Un marqueur biologique
pour l’aide au choix
de l’antidépresseur ?
Effectiveness of a quantitative electroence-
phalographic biomarker for predicting dif-
ferential response or remission with escita-
lopram and bupropion in major depressive
disorder. Andrew F. Leuchte et al., Psy-
chiatry Research
Volume 169, Issue 2, 30 ; 2009, Pages 132-
138 Et
Comparative effectiveness of biomarkers and cli-
nical indicators for predicting outcomes of SSRI
treatment in Major Depressive Disorder : Results
of the BRITE-MD study. Andrew F. Leuchter
Predicted survival curves of cannabis use
and age at onset of psychosis
Frequency
of use Cannabis Alcohol Tobacco
None 1,000 1,000 1,000
Ever 1,749b1,690 1,570
Weekly 2,415b2,043b1,632
Daily 2,065b1,763 1,825b
a. Symptoms represented prodromal symptoms in
69,7 % of patients.
b. Significant difference compared to the “none” refe-
rence category.
COMMENTAIRE
Il paraît plus important de s’intéresser aux
changements récents de la consommation de
cannabis chez les sujets souffrant d’un pre-
mier épisode psychotique, plutôt qu’à la
quantité moyenne préalable, ni même à l’exis-
tence d’un abus ou d’une dépendance. La
question de l’imputabilité reste irrésolue, en
grande partie du fait qu’il s’agit d’une étude
rétrospective, à savoir pourquoi cette con-
sommation augmente de manière si proche
des troubles psychotiques (cause ou effet).
Néanmoins, cette étude apporte une nouvelle
pierre à l’édifice du cannabis comme subs-
tance pro-schizophrénique…
(1) CH Sainte-Anne, Paris.

Revue de presse 519
et al., Psychiatry Research Volume 169, Issue 2,
30 September 2009, Pages 124-131.
BACKGROUND
Environ deux tiers des patients déprimés
traités par antidépresseurs n’atteignent pas le
seuil de la rémission complète après trois
mois de traitement. Pour ces patients, un trai-
tement antidépresseur d’une autre classe
pharmacologique doit alors être instauré,
impliquant un nouveau délai d’attente de plu-
sieurs semaines. Un marqueur biologique
permettant d’orienter le choix de la molécule
pour chaque patient représenterait une avan-
cée thérapeutique majeure. L’étude BRITE-
MD (Leuchter et al., 2009) avait montré qu’il
est possible de déterminer un index électro-
physiologique « ATR » (antidépressant treat-
ment response, ou index de réponse au trai-
tement antidépresseur) grâce à une mesure
frontale en EEG quantitative (QEEG). Cet
indice ATR avait montré une bonne prédiction
de la réponse à 7 semaines un sérotoniner-
gique, l’escitalopram. Dans l’étude actuelle,
les mêmes auteurs ont tenté de montrer dans
quelle mesure cet index permettrait de discri-
miner correctement le groupe des patients
répondant mieux à l’escitalopram et le groupe
des patients répondant mieux à un antidé-
presseur agoniste dopaminergique et nora-
drénergique, le bupropion.
MÉTHODE
375 sujets ont été explorés en QEEG à
la baseline, puis traités durant une semaine
par 10 mg d’escitalopram à l’issue de
laquelle un nouvel examen QEEG était réa-
lisé permettant le calcul de l’index ATR. Les
sujets étaient ensuite randomisés en trois
groupes, escitalopram, bupropion et esci-
talopram + bupropion. Une Hamilton était
réalisée après 49 jours de traitement. Les
taux de réponse et de rémission étaient
comparables entre les trois groupes.
RÉSULTATS
Les sujets ayant un ATR élevé répon-
daient 2,4 fois mieux à l’escitalopram que
les sujets ayant un ATR bas (68 % versus
28 %). À l’inverse, les sujets ayant un ATR
bas répondaient 1,9 fois mieux au bupro-
pion que ceux sous escitalopram.
Dans la seconde étude, les auteurs ont
comparé l’ATR à un autre type de marqueur
génétique. Ils ont caractérisé différents
polymorphismes dans la région du promo-
teur du gène codant le transporteur de la
sérotonine (5HTTLPR) ainsi que dans le
gène codant le récepteur post-synaptique
5HT2a. Parmi les 73 sujets traités par esci-
talopram durant 49 jours, les taux de
réponse et de rémission furent respective-
ment de 52,1 et 38,4 %. L’index ATR pré-
disait la réponse et la rémission avec 74 %
d’adéquation. Par contre, ni le polymor-
phisme 5HTTLPR, ni celui du 5HT2a ne
permettaient de prédire la réponse ou la
rémission.
Schizophrénie : la présence
d’antécédents génétiques
rend-elle plus vulnérable face
aux effets d’une exposition
prénatale infectieuse ?
Evidence for an Interaction Between Fami-
lial Liability and Prenatal Exposure to Infec-
tion in the Causation of Schizophrenia.
Mary C. Clarke et al., Am J Psychiatry
2009 ; 166 : 1025-1030.
CONTEXTE
La recherche de facteurs de risque de
schizophrénie a permis de mettre en évi-
dence pour la première fois par Mednick
l’effet d’une exposition virale prénatale
durant la pandémie grippale de 1957 à Hel-
sinki. Les premières études pointaient le
second trimestre de la grossesse comme
COMMENTAIRE
La longue quête d’un marqueur biologique de
dépression n’a pas encore permis d’aboutir à
une découverte décisive. Par contre, des tech-
niques sophistiquées électrophysiologiques ou
d’imagerie cérébrale fonctionnelle semblent
ouvrir la voie vers l’identification de marqueurs
permettant d’orienter la stratégie thérapeuti-
que. C’est incontestablement une voie de
recherche très prometteuse, même si ces mar-
queurs demeurent encore difficilement réalisa-
bles en pratique clinique du fait de la complexité
des technologies sur lesquelles ils reposent et
de l’imprécision relative de la prédiction. Leur
optimisation, et leur couplage éventuel avec des
méthodes de pharmacogénétique automati-
sées en plein essor pourrait déboucher, dans
un avenir proche, vers l’avènement de théra-
peutiques ciblées en psychiatrie biologique.
 6
6
1
/
6
100%