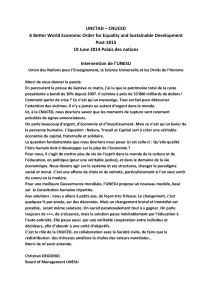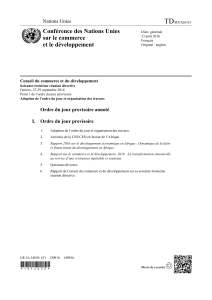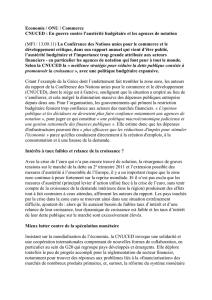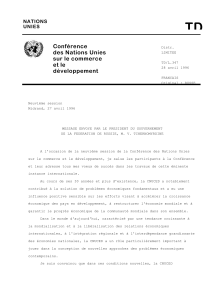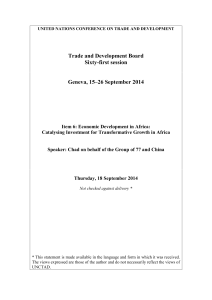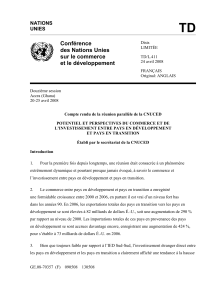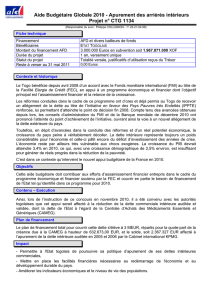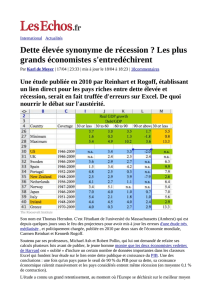TD Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

GE.16-17865 (F) 101116 101116
Conseil du commerce et du développement
Soixante-troisième réunion directive
Genève, 27-29 septembre et 11 octobre 2016
Rapport du Conseil du commerce et du
développement sur sa soixante-troisième
réunion directive
Tenue au Palais des Nations, à Genève, du 27 au 29 septembre et le 11 octobre 2016
Nations Unies
TD/B/EX(63)/4
Conférence des Nations Unies
sur le commerce
et le développement
Distr. générale
14 octobre 2016
Français
Original : anglais

TD/B/EX(63)/4
2 GE.16-17865
Introduction
Le Conseil du commerce et du développement a tenu sa soixante-troisième réunion
directive au Palais des Nations, à Genève (Suisse), du 27 au 29 septembre et le 11 octobre
2016. Il a tenu quatre séances plénières au cours de la réunion.
I. Décisions du Conseil du commerce et du développement
A. Rapport 2016 sur le développement économique en Afrique : Dynamique
de la dette et financement du développement en Afrique
Conclusions concertées 528 (EX-LXIII)
Le Conseil du commerce et du développement,
1. Accueille avec satisfaction le Rapport 2016 sur le développement économique
en Afrique : Dynamique de la dette et financement du développement en Afrique ;
2. Réaffirme que la CNUCED est résolue à apporter son appui à l’Afrique,
conformément au Maafikiano de Nairobi, afin de contribuer à la réalisation du Programme
2030 et des objectifs de développement durable ;
3. Demande à la CNUCED de continuer de répondre aux préoccupations et aux
besoins particuliers de l’Afrique en matière de commerce et de développement, notamment en
assurant des services de conseil et d’analyse des politiques et en menant des activités de
renforcement des capacités ;
4. Souligne que la réalisation des objectifs de développement de l’Afrique passe
par la transformation structurelle et la diversification économique, et donc par la mobilisation
de ressources suffisantes pour financer le développement, auprès de sources intérieures et
extérieures ;
5. Considère que l’économie de l’information est importante pour le
développement de l’Afrique ;
6. Note que selon différentes sources, le montant des investissements nécessaires
à la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique serait compris entre
600 milliards et 1 200 milliards de dollars par an ;
7. Prend note avec préoccupation de l’augmentation de l’encours de la dette
extérieure des pays africains, ainsi que de la baisse de la part de la dette concessionnelle, de la
hausse des taux d’intérêts et de la réduction des échéances, qui auront très probablement pour
effet d’alourdir le fardeau de la dette de ces pays, que ceux-ci soient pauvres et très endettés
ou peu endettés ;
8. Souligne l’importance d’une gestion efficace de la dette, et demande à
la CNUCED de poursuivre ses activités visant à renforcer les capacités de suivi et de gestion
de la dette, notamment dans le cadre du Système de gestion et d’analyse de la dette ;
9. Prend acte des recommandations selon lesquelles il est nécessaire, pour
atteindre les objectifs de développement et mener à bien la transformation structurelle
en Afrique, de mobiliser des ressources suffisantes pour financer le développement, auprès de
sources intérieures et extérieures ;

TD/B/EX(63)/4
GE.16-17865 3
10. Estime que l’aide publique au développement joue un rôle décisif dans le
financement du développement, et souligne qu’il importe de respecter les engagements pris au
niveau international en la matière ;
11. Prend acte des recommandations préconisant le recours à des mécanismes de
financement innovants, qui peuvent aider les pays africains à mobiliser des ressources
supplémentaires pour financer le développement de façon stable et durable ;
12. Note que les partenariats public-privé sont également un moyen de financement
possible, particulièrement dans le domaine du développement des infrastructures ; une
certaine prudence est cependant de mise sur le plan de la gestion de la dette, les contributions
à ces partenariats étant souvent considérées comme des transactions hors budget ; un cadre
général est donc nécessaire pour bien évaluer et surveiller les partenariats public-privé ;
13. Constate que les envois de fonds représentent une part importante des flux
extérieurs à destination de l’Afrique, et invite la CNUCED à poursuivre, dans le cadre de son
mandat, les travaux de recherche et d’analyse sur les moyens d’accroître la contribution des
envois de fonds des migrants au développement, notamment en en renforçant les retombées
économiques et sociales bénéfiques, de réduire les frais de transaction et d’élargir l’accès aux
services financiers, tout en respectant le caractère privé de ces fonds ;
14. Constate avec inquiétude que les flux financiers illicites en provenance de
l’Afrique nuisent au développement de la région, estime que ce problème appelle des mesures
nationales et internationales et demande aux pays africains et à la communauté internationale
de redoubler d’efforts pour s’y attaquer ;
15. Invite les partenaires de développement à aider davantage les pays africains à
garantir des investissements publics et privés suffisants dans les secteurs productifs et les
secteurs d’infrastructure, afin qu’ils soient en mesure d’atteindre les objectifs de
développement durable d’ici à 2030 et de réaliser les objectifs de développement de l’Afrique
énoncés dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine ;
16. Prend note avec préoccupation de l’insuffisance des données dans plusieurs
domaines économiques, financiers et sociaux, et demande instamment à la CNUCED de
chercher à résoudre les problèmes qui restreignent la disponibilité des données, dans le cadre
de son mandat, estimant qu’il est nécessaire de remédier à cette insuffisance et de renforcer
les capacités d’analyse en matière de suivi et de gestion de la dette ;
17. Prend également note avec préoccupation de l’insuffisance des analyses
concernant l’autonomisation des femmes, et demande donc à la CNUCED d’intensifier ses
travaux sur la contribution de l’autonomisation des femmes à la réduction de la pauvreté, en
particulier, sachant que seulement 20 % des femmes en Afrique ont accès à des services
financiers formels ;
18. Encourage la CNUCED à poursuivre ses travaux de recherche et d’analyse sur
les politiques propres à mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des aspirations de
l’Afrique en matière de développement et à garantir la viabilité de la dette.
Séance plénière de clôture
Le 11 octobre 2016

TD/B/EX(63)/4
4 GE.16-17865
B. Activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique
(Point 2 de l’ordre du jour)
1. Le Conseil du commerce et du développement a pris note du rapport du secrétariat
sur les activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique, publié sous la cote TD/B/EX(63)/2.
C. Rapport sur le commerce et le développement, 2016 : La transformation
structurelle au service d’une croissance équitable et soutenue
(Point 4 de l’ordre du jour)
2. Le Conseil du commerce et du développement a pris note du Rapport sur le commerce
et le développement, 2016, publié sous la cote UNCTAD/TDR/2016.
II. Résumé du Président
A. Ouverture de la plénière
Introduction
3. Dans ses observations liminaires, le Secrétaire général de la CNUCED a indiqué que
le Nairobi Maafikiano adopté à la quatorzième session de la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement, en juillet 2016, promouvait la revitalisation du
mécanisme intergouvernemental, et a rappelé que deux nouveaux groupes
intergouvernementaux d’experts avaient été créés, consacrés respectivement au financement
du développement et au commerce électronique. Il a réaffirmé que la CNUCED était résolue à
apporter son soutien à l’Afrique, notamment en fournissant un appui technique aux
négociations sur la création d’une zone de libre-échange continentale ; en soutenant les
organisations économiques régionales et en organisant des réunions d’information à
l’intention de responsables gouvernementaux africains ; en promouvant la prise en compte
systématique de la problématique hommes-femmes en son sein et dans le cadre de son
programme sur le commerce et les questions de genre ; en créant un bureau régional à
Addis-Abeba. Il a indiqué, en outre, que la CNUCED avait nommé un conseiller spécial pour
l’entreprenariat des jeunes et les petites entreprises.
4. Le Secrétaire général a dit que le thème du Rapport 2016 sur le développement
économique en Afrique (la dynamique de la dette et le financement du développement
en Afrique) permettait de se pencher sur les vulnérabilités caractérisant aujourd’hui le
continent africain. Le rapport mettait en lumière certains moyens de réduire le déficit de
ressources en Afrique, à savoir la mobilisation de ressources complémentaires, la création de
partenariats public-privé et la lutte contre les flux financiers illicites. Le Rapport sur le
commerce et le développement, 2016 : La transformation structurelle au service d’une
croissance équitable et soutenue, publié le 21 septembre 2016, avait déjà retenu l’attention de
plusieurs médias, dont le Wall Street Journal et Bloomberg News.
Rapport 2016 sur le développement économique en Afrique : Dynamique de la dette
et financement du développement en Afrique
(Point 3 de l’ordre du jour)
5. Le secrétariat de la CNUCED a présenté le Rapport 2016 sur le développement
économique en Afrique et souligné que la réalisation des objectifs de développement durable
dépendrait en grande partie de l’évolution de la situation en Afrique et de la capacité des pays
africains à mobiliser suffisamment de ressources pour financer le développement. Financer la

TD/B/EX(63)/4
GE.16-17865 5
réalisation de ces objectifs sans compromettre la viabilité de la dette représentait un immense
défi pour les pays africains, une grande quantité de ressources étant nécessaires à cette fin.
Des sources de financement complémentaires comme les partenariats public-privé, les envois
de fonds et les apports des diasporas et la réduction des flux financiers illicites pouvaient
contribuer à la mobilisation de ressources intérieures et permettre aux pays africains
d’atteindre leurs objectifs de développement.
6. Les représentants des groupes régionaux et délégations ci-après ont fait des
déclarations : l’Argentine, au nom du Groupe des 77 et de la Chine ; la Namibie, au nom
du Groupe africain ; les Bahamas, au nom du Groupe des pays d’Amérique latine et
des Caraïbes ; l’Union européenne, au nom de ses États membres et en son nom propre ;
le Japon, au nom du groupe JUSSCANNZ ; le Bangladesh, au nom des pays les moins
avancés ; l’Égypte, au nom du Groupe arabe ; la Chine ; le Zimbabwe ; le Kenya ; l’Algérie ;
le Maroc ; la Tunisie ; Djibouti ; la République-Unie de Tanzanie ; le Soudan.
7. Les délégations s’accordaient en général à juger opportun le thème du Rapport 2016
sur le développement économique en Afrique (la dynamique de la dette et le financement du
développement), dans le contexte de l’adoption récente des objectifs de développement
durable. De nombreux représentants ont souligné que les pays africains auraient à résoudre un
dilemme redoutable pour réussir à mobiliser des ressources suffisantes par rapport à leurs
besoins de financement tout en garantissant la viabilité de leur dette. L’Afrique restait
vulnérable à l’augmentation de l’endettement, problème dont devraient se soucier aussi bien
les pays africains que la communauté internationale. La croissance de la dette extérieure de
l’Afrique posait également problème et risquait d’aboutir à une crise de la dette.
8. Plusieurs délégations ont appelé l’attention sur l’évolution de la situation du
financement du développement, l’aide publique au développement ayant diminué tandis
qu’une plus grande importance était accordée à la mobilisation de ressources intérieures.
Divers représentants ont réaffirmé que l’aide publique au développement était une source de
financement essentielle pour les pays en développement, précisant qu’il fallait respecter les
engagements pris dans ce domaine pour contribuer concrètement à la réalisation des objectifs
de développement durable. Le représentant d’un groupe régional a estimé qu’il fallait faire
preuve de prudence à l’égard de la recommandation formulée dans le rapport au sujet des
envois de fonds de la diaspora. Un représentant a dit que les envois de fonds avaient certes
gagné en importance et que les pays prenaient des mesures pour accroître ces envois et
l’épargne de la diaspora, mais que ces flux de capitaux privés, qui étaient souvent
imprévisibles, ne sauraient remplacer l’aide publique au développement ou le financement du
développement.
9. Selon de nombreuses délégations, la baisse des prix des produits de base, le
ralentissement du commerce de ces produits et la dévaluation de la monnaie risquaient de
compromettre la possibilité d’atteindre les objectifs de développement durable en Afrique.
La diversification de l’économie et l’investissement dans les infrastructures étaient
indispensables au développement durable.
10. Plusieurs représentants ont fait observer que le reclassement de pays à faible revenu
dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire s’accompagnait de difficultés pour les pays
concernés, qui perdaient les avantages accordés aux pays à faible revenu, notamment l’accès
aux guichets de prêts concessionnels.
11. Le Rapport 2016 sur le développement économique en Afrique fournissait de bonnes
raisons de réexaminer la question de la viabilité de la dette et de revoir le cadre applicable en
la matière. Les délégations ont salué la qualité des recherches présentées dans le rapport et
l’utilité de l’analyse directive de la gestion de la dette qui y était exposée.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%