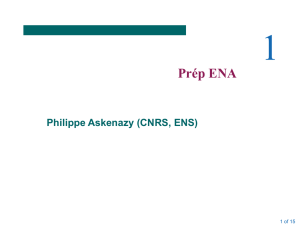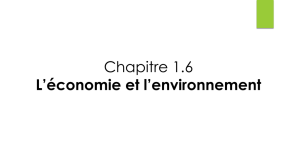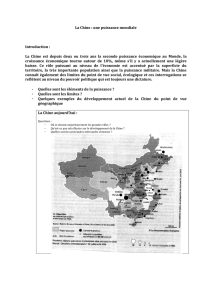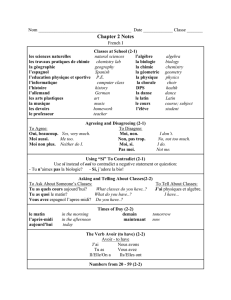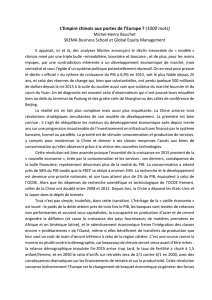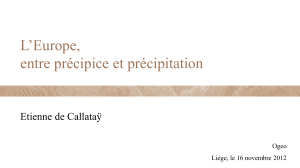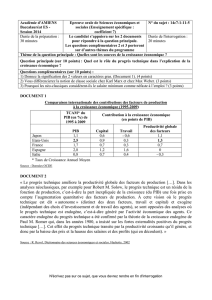GDP Fetishism Josep h E. Stiglitz - Knowledge

1
MACROECONOMIE
Cours de Jean-Luc Gaffard
Dossier 1 : Enjeux et débats de la macroéconomie contemporaine
Questions
Quels sont les principaux épisodes qui ont marqué l’évolution économique depuis l’entre deux guerres
en termes des principales grandeurs économiques et quelles ont été les lignes directrices dans le
renouvellement de l’analyse économique à chacun de ces épisodes ?
Textes
1. Le temps des conséquences. Perspectives 2009-2010 pour l’économie mondiale. Lettre de l’OFCE 309
2. Deux ou trois choses que je connais de la crise, Jean-Paul Fitoussi Le Monde 24-09-2009
3. Quand la Chine consommera, Martin Wolf, Le Monde 29-09-2009
4. GDP Fetichism, J. Stiglitz
Questions
Texte 1
Quels sont les comportements d’épargne et leurs conséquences prévisibles ?
Quelle est l’ampleur de l’impulsion budgétaire ? A préparer pour la séance 3
Texte 2
Quel lien peut-on établir entre l’endettement des ménages et la hausse du prix des actifs ?
Pourquoi les pays émergents ont-ils accumulé des réserves ? A préparer pour la séance 3
Texte 3
Pourquoi les réserves de changes qu'a accumulé la Chine sont-elles problématiques ? A préparer pour
la séance 3
Dans quelle mesure une relance de la consommation interne serait bénéfique à la Chine ?
Pourquoi l'appréciation du Yuan apparaît-elle comme "inévitable et souhaitable" ? A préparer pour la
séance 3

2
Texte 4
Pourquoi mesurer le revenu médian est aussi important que de mesurer le revenu moyen?
Les prix de marché mesurent-ils la richesse ?
Deux ou trois choses que je sais de la
crise, par Jean-Paul Fitoussi
LE MONDE | 24.09.09 | 14h05 •
L
a croissance du PIB est redevenue positive, les Bourses reprennent
leur ascension, les banques renouent avec les profits et l'on
commence à affirmer, de façon de plus en plus pressante, l'exigence
du retour au monde d'avant. Il faudrait au plus vite mettre en
œuvre une exit strategy. L'expression ne signifie pas, comme on
pourrait le croire, stratégie de sortie de crise, mais stratégie de sortie
de l'Etat des affaires économiques.
L'accumulation de dette publique comme celle de liquidités font
renaître la crainte même qui a présidé à l'organisation du monde
d'avant, celle du retour de l'inflation. Que ces accumulations soient
conséquences de l'errance des marchés ne change rien à l'analyse
tant on a tôt fait, dans un monde déserté par la mémoire, de rendre
les effets coupables des causes.
Prendre au sérieux cette exigence conduirait en réalité à cultiver les
germes de reproduction de la crise. Car, de fait, cette crise ne trouve
son origine ni dans la dette publique ni dans l'inflation. C'est une
crise financière reflétant un dysfonctionnement majeur des marchés
financiers. Pour autant, elle n'est que partiellement imputable à la
myopie de ces derniers et au comportement tantôt prédateur tantôt
moutonnier de leurs acteurs. J'ai la conviction que des causes plus
profondes sont elles-mêmes à l'origine de l'implosion du système
financier.
Le dernier quart de siècle ne fut pas, dans les pays riches, favorable
au monde du travail, dans sa très grande majorité. Les inégalités se
sont creusées presque partout, comme il ressort des études des
grandes organisations économiques internationales. La crise n'est elle
pas née au cœur du système capitaliste contemporain, les Etats-
Unis, là où les inégalités ont le plus augmenté ? Le corollaire de la
montée des inégalités de revenu est une faiblesse structurelle de la
demande globale, puisque ceux qui dépensent tout ont moins à
dépenser, tandis que ceux dont la dépense n'est qu'une faible
fraction de leur revenu voient celui-ci augmenter encore.

3
Dans ce contexte, la politique monétaire, instrument privilégié de
régulation de la demande globale, se doit d'être expansionniste. Elle
devient endogène à l'état des inégalités. La baisse des taux d'intérêt
facilite l'accès au crédit et la croissance de l'endettement privé.
L'autre face du phénomène est qu'une fraction très faible de la
population (moins de 1 pour cent, si ce n'est 1 pour mille) voit ses
revenus croître dans des proportions considérables. Elle recherche
alors des occasions d'investissement et, soit directement, soit par la
médiation du système financier qui lui promet monts et merveilles,
contribue à la formation de bulles spéculatives - des prix d'actifs
(immobiliers, financiers) qui enflent bien au-delà de leur valeur
réelle.
La beauté de la chose est qu'alors tout semble pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Le système apparaît équilibré, puisque à la
montée de l'endettement privé correspond une augmentation de la
valeur des actifs, ce qui donne l'impression que la richesse nette des
ménages ne s'est pas réduite, voire a augmenté. Lorsque le marché
corrige brutalement ses excès, le système s'effondre, la plupart des
débiteurs devenant insolvables.
La mécanique de crise est implacable. La montée des inégalités ne
peut que conduire à un relâchement de la politique monétaire et,
dans un marché financier peu régulé, à un envol du prix des actifs.
Mais un second élément a contribué à la fois à déprimer la demande
globale et à alimenter les marchés en liquidités : l'accumulation de
réserves par les pays émergents. La crise asiatique de 1997 leur a
enseigné qu'il valait mieux éviter la tutelle des institutions
internationales. Les pays contraints d'avoir recours au Fonds
monétaire international (FMI) avaient alors payé un lourd tribut en
termes de croissance économique, de souffrance sociale et de perte
de souveraineté. Echaudés par cet épisode, ils ont choisi de
s'autoassurer contre l'instabilité macroéconomique du monde, en
accumulant des réserves en dollars. C'était autant de soustrait à la
demande mondiale, et c'était autant de liquidités nouvelles
alimentant la déraison des marchés financiers.
Ces deux causes structurelles sont, hélas, appelées à perdurer. Le
retour de la croissance est une bonne nouvelle. Elle signifie que la
chute de la demande globale a été interrompue grâce à l'action des
Etats. Il reste que le PIB mondial est aujourd'hui 4 à 5 points plus
bas que ce qu'il était avant la crise. Il faudra plusieurs années de
croissance pour rattraper ce niveau. En attendant, le chômage - vrai
marqueur de la crise - continuera d'augmenter.
Aussi, une exit strategy permettrait peut-être le retour au monde
"d'avant", mais sans avoir aucunement remédié à ce qui l'a fait
s'effondrer. La croissance des inégalités n'est pas le fruit du hasard,
mais celui d'une conception particulière de la "vertu économique"
qui place au cœur des politiques publiques la concurrence fiscale et

4
sociale. De même, l'accumulation de réserves en guise d'assurance
dans les pays émergents est le reflet des carences dans l'organisation
de la gouvernance du monde, et notamment l'absence d'une
monnaie de réserve réellement internationale. Nous ne sortirons de
la crise qu'à condition de vouloir la comprendre : le G20 le voudra-t-il
?
Courriel : [email protected].
Jean-Paul Fitoussi (Editorialiste associé)

5
L'éclairage
Quand la Chine consommera, par Martin
Wolf
LE MONDE ECONOMIE | 28.09.09 | 16h25 • Mis à jour le 28.09.09 | 16h25
L
a crise a réussi à la Chine. C'était évident lors du "Davos d'été", le
Forum économique mondial qui s'est tenu à Dalian (Chine) début
septembre. La confiance des Chinois était palpable. Mais aussi leur
anxiété.
Celui qui a le mieux exprimé cette ambivalence est le premier
ministre Wen Jiabao. Il a déclaré à son auditoire que "cette crise
financière mondiale sans précédent a coûté cher à l'économie
chinoise. Pourtant nous avons su relever les défis et surmonter en
toute confiance les difficultés". Mais il a également reconnu que "la
stabilisation et le redressement de l'économie chinoise ne sont
encore ni stables, ni solides, ni équilibrés".
Les données en provenance de Chine laissent à penser qu'en effet un
vigoureux redressement est en cours. Au cours de la première moitié
de cette année, a souligné le premier ministre, le produit intérieur
brut (PIB) a augmenté de 7,1 %. Les prévisions consensuelles
publiées en septembre indiquent pour l'économie chinoise une
croissance de 8,3 % en 2009 et de 9,4 % en 2010. Le géant asiatique
devrait devenir la deuxième économie du monde en 2010, même
aux prix du marché.
Selon l'Economist Intelligence Unit, la demande intérieure pourrait
connaître cette année une augmentation de 11,5 % en termes réels.
Une telle hausse était nécessaire. La consommation des ménages
chinois devrait également croître de 9,3 %.
Pourtant, comme toujours, la véritable locomotive, c'est
l'investissement fixe réel. Or, d'après les prévisions, celui-ci devrait
augmenter de 14,8 % cette année, plus vite que le PIB au cours de
neuf des dix dernières années.
Or, cette augmentation du taux d'investissement par rapport au PIB,
qui était déjà à un niveau élevé, n'est pas une force mais une
faiblesse. Il indique une baisse des retours sur investissement et
risque d'entraîner une capacité excédentaire toujours plus grande.
De surcroît, lorsque les taux de croissance finiront par retomber,
l'effondrement de l'investissement creusera un énorme trou dans la
demande.
La forte dépendance à l'égard de l'investissement n'est pas le seul
écueil en vue. La hausse prononcée du crédit et de la masse
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%