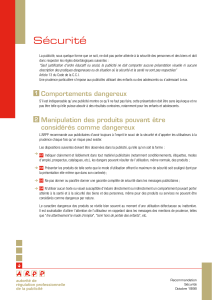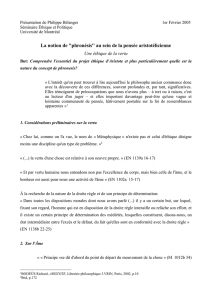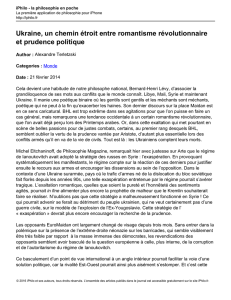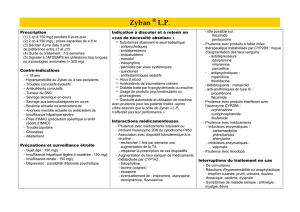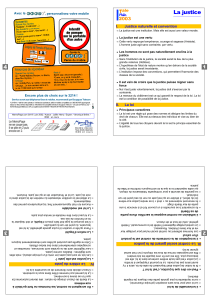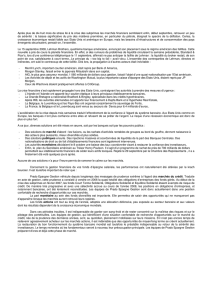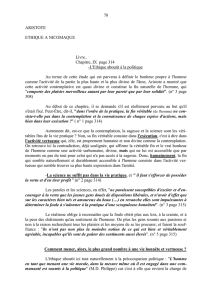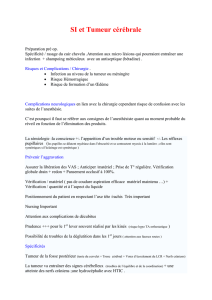Cahill_Karina_2015_memoire - Papyrus

Université de Montréal
Phronèsis
et
prudence
Esquisse de la
science pratique
dans les textes de la tradition classique
Karina Cahill
Département des littératures de langue française, Faculté des arts et des sciences
Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de maîtrise en littératures de langue française
Août 2015
©Karina Cahill, 2015


i
Résumé
Ce mémoire porte sur les transformations du concept de prudence, de l’Antiquité grecque au
XVIIe siècle. Il souligne notamment le lien qui unit les manières d’être et l’art, tant chez les Grecs
qu’au début de la modernité. La phronèsis se définissait tout d’abord en relation aux autres
manières de faire, dont la technè fait partie. Si Platon et Aristote les distinguent, les auteurs de la
modernité assimileront ces deux manières de faire. De plus, on peut voir dans la forme du
langage employé pour écrire sur la prudence un reflet de la vertu antique. Il s’agit de donner, tant
par le style que par le propos, un exemple de prudence. Cette vertu, qui est d’ailleurs la première
des vertus cardinales, est donc fondamentale pour comprendre le rapport entre l’éthique et l’art,
de l’Antiquité au début de la modernité. Elle annonce aussi les débuts de l’esthétique moderne, en
ce qu’elle donne des règles à suivre pour arriver à ses fins, qu’il s’agisse de n’importe quelle
manière de faire.
Mots-clés : phronèsis, technè, praxis, prudence, art, Antiquité, modernité.
Abstract
This thesis traces back the history of the concept of prudence from Antiquity to the XVIIth
century. It underlines the link between “ways of being” and art in Greek thought and during early
modernity. Phronèsis first defined itself in contrast to other “ways of doing” of which techne takes
part. This distinction, common to both Plato and Aristotle, is not present in the writings of early
modern thinkers which assimilate the two “ways of doing”. We can also see, in the way language
is used to describe prudence, a reflection of that virtue. An example of prudence is therefore at
work both in the style and the object it describes. This virtue, which is the first of the cardinal
virtues, is hence fundamental to understanding the relation between art and ethics during early
modernity. It is also a precursor to early modern esthetics, in that it gives rules to arrive at one’s
ends concerning any type of “ways of doing”.
Key words: phronèsis, techne, praxis, prudence, art, Antiquity, early modernity.

ii
Table des matières
!
RÉSUMÉ&..........................................................................................................................................................&I!
ABSTRACT&.......................................................................................................................................................&I!
TABLE&DES&MATIÈRES&.....................................................................................................................................&II!
REMERCIEMENTS&..........................................................................................................................................&III!
INTRODUCTION&..............................................................................................................................................&1!
L'IMPORTANCE!DE!LA!PHRONÈSIS!ET!DES!TEXTES!GRECS!....................................................................................................!3!
MÉTHODOLOGIE!ET!ORIENTATION!................................................................................................................................!7!
CHAPITRE&I&...................................................................................................................................................&10!
LA&PHRONÈSIS&DANS&LES&TEXTES&DE&LA&TRADITION&GRECQUE&ANTIQUE&.......................................................&10!
1.!ANALYSE!DES!FRAGMENTS!ATTRIBUÉS!À!HÉRACLITE,!EMPÉDOCLE!ET!DÉMOCRITE.!............................................................!11!
2.!TECHNÈ!ET!PHRONÈSIS!DANS!LES!DIALOGUES!PLATONICIENS.!.......................................................................................!22!
3.!TECHNÈ1ET!PHRONÈSIS!CHEZ!ARISTOTE.!..................................................................................................................!34!
CHAPITRE&II&..................................................................................................................................................&59!
L’ART&ET&LA&PRUDENCE&AU&DÉBUT&DE&LA&MODERNITÉ&..................................................................................&59!
1.!LA!PRUDENCE!DANS!LA1SOMME1THÉOLOGIQUE!.........................................................................................................!59!
2.!LE1COURTISAN!...................................................................................................................................................!66!
3.!LE1PRINCE!.........................................................................................................................................................!74!
4.!LES1ESSAIS!.........................................................................................................................................................!80!
5.!LES!ÉTHOPÉES!DE!BALTHASAR!GRACIÀN!..................................................................................................................!87!
CONCLUSION&................................................................................................................................................&98!
BIBLIOGRAPHIE&..........................................................................................................................................&102!

iii
Remerciements
J’aimerais remercier ici ceux qui ont contribué à mon développement tant académique
qu’intellectuel durant les dix dernières années. En premier lieu, ma reconnaissance va à Éric
Méchoulan dont le travail a été pour moi une grande source d’inspiration. Je dois le remercier
pour ses conseils, ses commentaires et ses corrections. Sans lui, ce mémoire n’eut jamais été
possible. Un remerciement spécial va à Jeanne Bovet qui m’a souvent aidée, et ce de plusieurs
manières. Son appui fut important pour moi tout au long de mon parcours en littérature.
J’aimerais aussi remercier Gilles Declercq, dont le travail a été une source d’inspiration et qui m’a
souvent appuyée académiquement.
Le travail intellectuel est, invariablement, un travail collectif. Aussi, celui-ci fut partagé par des
collègues et amis, lecteurs et correcteurs, que je me dois de remercier. Ce parcours, qui a
commencé en une thèse de doctorat, a aussi été le lieu de plusieurs amitiés qui ont contribué à
mon développement intellectuel. J’aimerais donc remercier ici Judith Sribnai, Jean-Alexandre
Perras, Iain Macdonald, Philippe Viroly et Philippe Gervais pour leurs commentaires qui m’ont
permis d’enrichir mon travail.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
1
/
110
100%