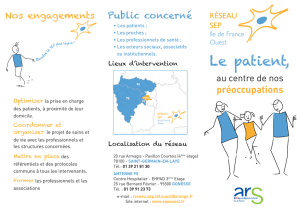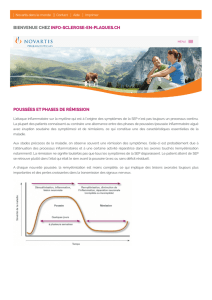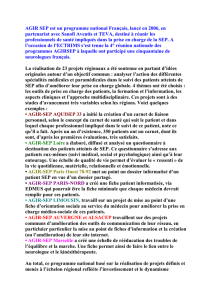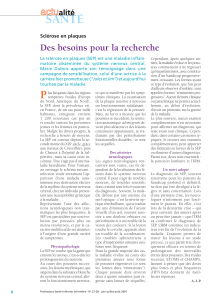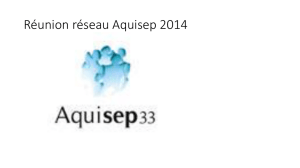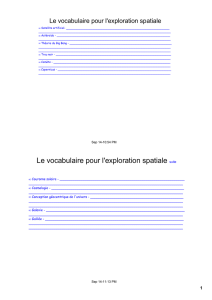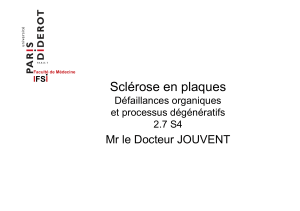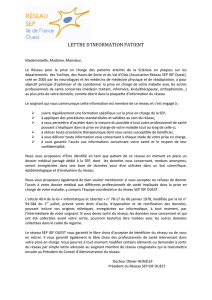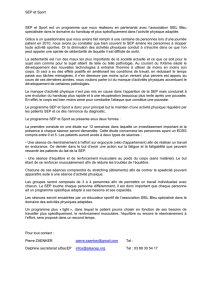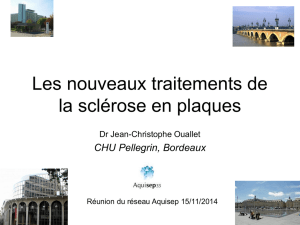Neurologie: De nouveaux médicaments pour le traitement de la

981
HIGHLIGHTS 2014
Neurologie:
De nouveaux médicaments pour le traitement de la
sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP RR)
×
×
β
κ
β
Christian P. Kamm
Les auteurs ont
reçu, au cours des
années passées,
le soutien nancier
des entreprises
et fondations
suivantes, actives
dans le domaine
de la sclérose en
plaques, pour
leurs formations,
exposés,
consulta tions et
projets de
recherches:
Bayer, Biogen
Idec, Genzyme,
Merck-Serono,
Novartis, Roche,
Teva ainsi que la
Société suisse
de la sclérose en
plaques. Departement Neurologie, Inselspital, Universitätsspital
und Universität, Bern

HIGHLIGHTS 2014
982
Correspondance:
Christian.Kamm[at]insel.ch
Référence
Traitement de
premièreinten�on Traitement de
deuxièmeinten�on Traitement de troisième
inten�on
SEP hautement ac�ve
Natalizumab
Diméthyl
fumarate
Fingolimod
Traitement non mis sur le
marché(CH)
Alemtuzumab
Rituximab
Daclizumab notamment
Transplanta�on autogène de
cellulessouches
Interféronβ
Acétate de
gla�ramère
Natalizumab
(Mitoxantron)
Natalizumab
(Mitoxantron)
Tériflunomide
Diméthylfumarate
Fingolimod
Effet secondaire
Effet secondaire/
Ac�vité de la
maladie
Effet secondaire
Ac�vité
Ac�vité Ac�vité
Ac�vité
Effet secondaire/
Ac�vité de la
maladie
Ac�vité
de la
maladie
Ac�vité/effets secondaires/virus JV posi�f
Figure 1
Schéma thérapeutique de la sclérose en plaques récurrente-rémittente.
1
/
2
100%