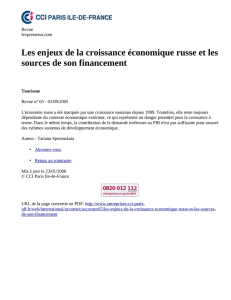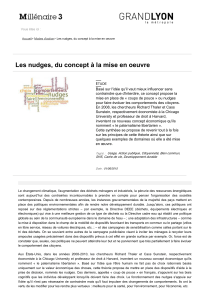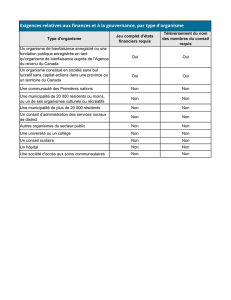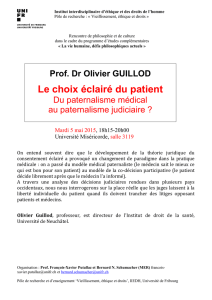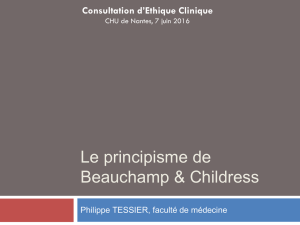Paternalisme, autonomie et respect de la personne : un dilemme ?

Le Courrier de colo-proctologie (II) - n° 1 - mars 2001
30
Science et conscience
I
l est d’expérience immédiate que la rela-
tion médecin-malade, telle qu’elle se vit
aujourd’hui, diffère profondément de ce
qu’elle était pour nos aînés. En quelques
décennies, l’attente des patients s’est trans-
formée : les exigences ne sont plus les mêmes,
avec des conséquences sur le rôle et la place
du médecin dans la société. S’agit-il d’un
changement de degré ou de nature, d’une
simple modification relationnelle ou d’une
révolution structurelle ? Quelles sont les
causes d’une telle évolution et ses consé-
quences sur le questionnement éthique qui
fonde cette relation si particulière à l’autre
qu’est l’exercice de la médecine ?
L’ensemble de la problématique tient ici à ce
que nous passons du modèle paternaliste à
celui de l’autonomie, transformation com-
plexe et non sans risque, car elle sous-tend des
approches culturelles fort différentes. Qu’en
est-il précisément ? Jusqu’à ces dernières
années, la relation médecin-malade était, en
France, de type paternaliste et fondée sur le
principe de bienfaisance. Le malade n’avait
d’autre possibilité que d’être réduit au statut
d’enfant de par l’ignorance dans laquelle il
était maintenu de la nature et des causes de son
mal ainsi que des moyens d’y remédier. “Tout
patient est et doit être pour [le médecin]
comme un enfant à apprivoiser, (...) à sauver,
(...), à guérir ”, déclarait L. Portes (1), prési-
dent de l’Ordre national des médecins, il y a
quelque cinquante années. Dans cette analyse,
la relation médecin-patient est fondamentale-
ment inégalitaire, le patient s’en remettant à
la décision du médecin, qui sait et qui agira –
principe de bienfaisance oblige – pour son bien
à lui, malade qui ne sait pas. Mais là se pose
une question de fond : qu’est-ce que le bien
du malade ? Au nom de quoi et de qui
appartient-il au médecin de s’approprier le
droit de le définir ? De fait, comme le signale,
B. Baertschi (2), “la maladie n’est pas le seul
mal, ni la santé le seul bien, et parmi les biens
que poursuit un individu, il y en a beaucoup
d’autres” ; et – sauf à se substituer au choix
de l’autre (mais comment le justifier ?) – le
médecin est-il fondé à hiérarchiser ce qui est
bien pour son patient ? Finalement, peut-il –
même au nom de la bienfaisance – décider à
la place de l’autre1, le priver de sa faculté de
choisir et, partant, porter atteinte à son inté-
grité en tant que personne ?
À tout cela les partisans de l’autonomie vont
répondre par la négative. Si le paternalisme
“affirme savoir mieux qu’un autre ce qui est
bon, bénéfique pour lui” (2) et s’autorise à lui
imposer une conduite, le principe d’auto-
nomie inscrit la relation médecin-malade dans
un rapport d’égalité, la consultation n’étant
qu’une prestation de services qui permet au
malade de recueillir le maximum d’informa-
tions afin qu’il puisse se déterminer. “La
valeur première, ici, n’est pas [pour le méde-
cin] de faire le bien du patient mais de res-
pecter sa liberté, sa dignité d’être qui prend
lui-même les décisions qui le concernent sous
couvert d’une négociation contractuelle.” (3)
Finalement, respecter l’autonomie du patient,
“c’est respecter sa conception de la vie heu-
reuse et l’histoire personnelle qui la sous-
tend” (2).
Ainsi sommes-nous en présence de deux pro-
jets relationnels radicalement opposés et,
comme toujours en de telles situations, il
convient de s’interroger sur les fondements de
l’un et de l’autre. En d’autres termes, qui du
paternalisme ou de l’autodétermination prime
l’autre ? Faire le bien de l’autre au nom de ce
Paternalisme, autonomie et respect de la personne :
un dilemme ?
●
Th. du Puy-Montbrun*
* Service de colo-proctologie,
hôpital Léopold-Bellan, Paris.
1. Le cas des enfants sort du champ de cette réflexion.

que je pense être son bien – parce que j’ai la
connaissance et lui non – ou respecter la per-
sonne qu’il est, sa liberté de choix, c’est-à-dire
sa dignité ? Pour résoudre ce dilemme, on peut
se référer au principe selon lequel la proposi-
tion qui a le plus de valeur doit être préférée,
“puisqu’un bien plus élevé est un bien plus
désirable, c’est-à-dire préférable” (2). Dans
cette hypothèse, on peut admettre que la seule
personne qui soit à même de décider pour le
patient est le patient lui-même – sauf à nier sa
liberté – et qu’il n’est pas dans les préroga-
tives du médecin d’imposer sa propre échelle
de valeurs. Dès lors, l’autodétermination
prime, non qu’elle soit hiérarchiquement
supérieure, mais, comme le dit très justement
B. Baertschi, “parce qu’elle est au fondement
de tout choix” (2). En termes kantiens, cela
rappelle que la personne doit être prise comme
une fin et non comme un moyen. Du point de
vue de l’exercice médical, cette primauté de
l’autonomie signifie donc que savoir mieux
que le sujet n’implique pas l’existence d’un
droit d’autorité du médecin sur le patient.
Est-ce pour autant que le dilemme est résolu ?
Non, car il reste à savoir quel sens recouvre le
terme d’autonomie. C’est là un point d’im-
portance, l’autonomie dans son acception
anglo-saxonne s’opposant, sur le fond, radi-
calement à notre cadre philosophique et cul-
turel. De fait, elle implique, par un médecin
“prestataire de soins neutre et indifférent” (3),
le respect du choix de chaque individu, quel
que soit ce choix, y compris s’il est irration-
nel ou dangereux pour le sujet. Or, et bien que
nous ayons souligné toute la nécessité de poser
le primat de l’autonomie, il semble qu’elle ne
puisse totalement “s’exercer contre le principe
de bienfaisance”(3). C’est, par exemple, ce
qu’a reconnu la Cour administrative d’appel
de Paris, à propos de patients transfusés contre
leur gré (Témoins de Jéhovah) : l’obligation
qu’a le médecin de toujours respecter la
volonté du malade trouve sa limite dans l’obli-
gation qu’il a aussi de protéger la vie même
de l’individu2.
Par conséquent, si le paternalisme ne peut fon-
der la relation soignant-soigné – il réifie le
sujet en lui ôtant sa liberté – l’autonomie ne
paraît pas non plus, bien que primant le pater-
nalisme, devoir s’imposer comme étant le
paradigme de cette relation, du moins dans sa
forte acception anglo-saxonne. L’autonomie,
pour avoir du sens, doit participer d’une
volonté d’universalisabilité de nos actes et
s’inscrire dans une référence constante à
l’autre, “lui et moi” étant liés dans la solida-
rité collective. Faute de quoi, elle risque de
n’être qu’un avatar de l’utilitarisme.
■
RÉFÉRENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
1. Portes L. Du consentement du malade à l’acte
médical. In : À la recherche d’une éthique médicale.
Paris, Masson, 1964, cité par S. Rameix, Fondements
philosophiques de l’éthique médicale, Paris, Ellipses,
1996.
2. Baertschi B. La valeur de la vie humaine et l’inté-
grité de la personne. Paris, PUF, coll. “philosophie
morale”, 1995.
3. Rameix S. Du paternalisme des soignants à l’au-
tonomie des patients ? In : Revue Laennec, Paris,
octobre 1997.
Le Courrier de colo-proctologie (II) - n° 1 - mars 2001
31
Science et conscience
2. Cours administrative d’appel de Paris, jugement du
9 juin 1998. Voir l’article 36 du code de déontologie.
Abonnez-vous
Abonnez-vous
Abonnez-vous
Abonnez-vous
Abonnez-vous
Abonnez-vous
Abonnez-vous
Abonnez-vous
http://www.edimark.fr
☞24 revues indexées avec moteur
de recherche
☞un e-mail offert
☞l’actualité des grands congrès
ABONNEZ-VOUS
ABONNEZ-VOUS
INSCRIVEZ-VOUS
1
/
2
100%