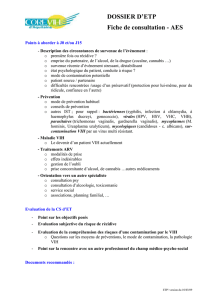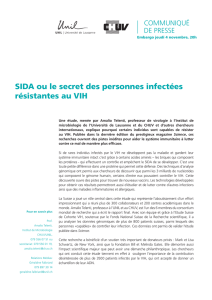plus de questions que

INT J TUBERC LUNG DIS 5 (3): 205-207
©2001 IUATLD
[Traduction de l'éditorial "Assessing health seeking behaviour among tuberculosis patients in rural South Africa" Int J
Tuberc Lung Dis 2001; 5 (3): 205-207.]
EDITORIAL
La signification clinique des interactions entre le VIH et le
bacille tuberculeux : plus de questions que de réponses
L'IMPACT POTENTIEL de la tuberculose (TB)
active sur le taux de progression de la maladie VIH
est réexaminé dans l'article de Badri et coll. dans
ce numéro du Journal.1 Les patients atteints de
tuberculose se présentant dans les polycliniques
pour VIH à Cape Town ont des taux ajustés de
mortalité et des taux d'incidence d'infection
opportunistes non-tuberculeuses (IOs) plus élevés
que les sujets fréquentant ces polycliniques mais
sans TB active. Les différences de résultat sont les
plus évidentes pour les patients qui ont des
décomptes initiaux de CD4 élevés (supérieurs à
200 x 106/L), comme cela a été trouvé également
dans une étude prospective similaire provenant
d'Ouganda.2 Que pouvons-nous attendre d'études
d'observation comme celles-ci au sujet de l'impact
de la TB sur l'histoire naturelle de l'infection VIH,
au sujet de l'importance de la TB relativement aux
autres pathogènes et en ce qui concerne les
priorités en matière d'interventions ou de
recherches ultérieures?
Le trait caractéristique de l'infection VIH non
traitée est une immunosuppression progressive qui
affecte de façon prédominante l'immunité à
médiation cellulaire et qui entraîne une
augmentation de sensibilité à l'égard des IOs. Il est
bien établi que la fréquence et la sévérité des IOs
augmentent au fur et à mesure de l'aggravation de
l'immunosuppression liée au VIH. Il n'est pas
étonnant que ceci soit associé à des taux accrus de
mortalité puisque chaque IO entraîne un risque qui
peut être substantiel de décès spécifique au
pathogène considéré. Toutefois, l'hypothèse
centrale de l'article de Badri et coll. est l'existence
d'un autre effet défavorable, en l'occurrence un
déclin irréversible et par étape de la fonction
immunitaire entraîné par une poussée de
réplication rapide du VIH qui serait induite par une
stimulation immunitaire intercurrente.3 Celle-ci a
été initialement attribuée à la tuberculose
puisqu'elle provoque une réponse immunitaire
caractéristiquement prolongée du type à médiation
cellulaire, mais cette hypothèse a été étendue
depuis lors à d'autres infections intercurrentes.3,4
Les conséquences potentielles sont une
augmentation subséquente du risque d'IOs et de
décès comme celle qui est illustrée par la flèche
rétrograde de la Figure. Le phénomène par lequel
un résultat de la prédisposition peut rétroagir pour
exacerber la maladie prédisposante n'est pas propre
au VIH ; par exemple les infections thoraciques
bactériennes peuvent simultanément compliquer et
aggraver des bronchectasies sous-jacentes.
La possibilité que les taux de progression du
VIH soient significativement propulsés par des IOs
intercurrentes a attiré un intérêt et des fonds de
recherche substantiels car, s'il en était ainsi, la
prévention des IOs serait une urgence
complémentaire. Toutefois, cette hypothèse n'est
toujours pas démontrée, en raison des difficultés
qu'il y a à distinguer les différentes composantes
qui interviennent dans le pronostic. Les études
d'observation, comme celle de ce numéro
investiguant l'impact de la tuberculose sur les
événements subséquents, ne peuvent pas distinguer
les relations à deux directions incluant une
rétroaction positive d'avec une relation plus simple
et à une direction dans laquelle la TB est
principalement la conséquence d'une déficience
fonctionnelle de l'immunité, mais ne contribue pas
à cette dernière. La limitation principale est que la
corrélation est imprécise entre état fonctionnel
immunitaire et marqueurs de laboratoire comme
les décomptes de CD4 ou charges virales ;5 il n'est
donc pas possible d'effectuer un ajustement précis
dans les analyses multivariées : ceci laisse la porte
ouverte à l'interprétation selon laquelle les piètres
pronostics ultérieurs dans le groupe TB reflètent
simplement des différences difficilement
quantifiables de la fonction immunitaire de début.
Dès lors, les études d'observation ne permettent
pas de conclure à une relation de causalité. Par
contre, elles fournissent des indications sur
l'ampleur du bénéfice individuel qu'on aurait pu
attendre si l'épisode de TB avait été prévenu et si la
prévention de la fonction immunitaire. Pour la TB,
à l'opposé de ce qui se passe dans d'autres IOs
associées au VIH, il existe une masse de données
pertinentes provenant d'essais contrôlés
randomisés (ECR) avec placebo sur le traitement

2 The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
Infection VIH Impact des IOs associées au VIH
• morbidité & mortalité
• spécifique au pathogène
Immunosuppression • ? impact indirect dû à
progressive et du taux de progression du VIH
charge virale • contagiosité & transmission du VIH
?• via une inflammation génitale par
les infections sexuellement transmissibles
fréquence et sévérité • ? via charge virale plasmatique par
des IOs les autres infections intercurrentes
• transmission des IOs contagieuses
Intensité et nature de l'exposition au pathogène
• facteurs socio-économiques
• variations géographiques
Figure Interactions potentielles entre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), les infections
opportunistes (IOs) et l'environnement dans lequel se trouvent les individus
des infections tuberculeuses latentes.6 Le
traitement d'une TB latente chez les sujets
séropositifs pour le VIH et dont les tests
tuberculiniques sont positifs réduit de manière
significative l'incidence subséquente de la TB mais
n'a pas d'impact significatif sur la survie selon la
méta-analyse la plus importante et la plus
récemment publiée.6 Comment ces résultats
peuvent-ils être réconciliés avec ceux de Badri et
coll. et avec d'autres études similaires ? Les deux
ne s'excluent pas mutuellement puisqu'il se
pourrait simplement que l'incidence de la TB
associée au VIH n'est pas suffisamment importante
pour l'emporter sur les taux de progression du VIH
et de sa mortalité au niveau de la population. Ceci
est particulièrement vraisemblable si l'impact sur la
progression était limité au sous-groupe de cas de
TB qui surviennent précocement dans le décours
de la maladie VIH, comme le suggèrent les
résultats de Badri et coll. et de Whalen et coll.
Néanmoins, quoiqu'un avantage individuel n'ait
pas été exclu, les résultats des ECR impliquent
qu'un traitement généralisé de l'infection TB
latente n'aura probablement pas un impact majeur
sur les taux de progression de la maladie VIH et
que la progression accélérée du VIH due à la TB,
si toutefois elle existe vraiment, n'a pas une
signification majeure an matière de santé publique.
En ce qui concerne les autres pathogènes, les
charges virales plasmatiques sont transitoirement
augmentées par la stimulation immunitaire
provenant de n'importe quelle cause, y compris les
infections par les protozoaires ou les helminthes
comme la malaria et la schistosomiase, d'autres IOs
associées au VIH et même les vaccinations.3,4 Il est
important de savoir que d'autres IOs associées au
VIH impliquent un pronostic défavorable en ce qui
concerne l'intervalle de survie sans maladie et la
survie globale quand on les compare avec d'autres
individus appariés mais sans événements
intercurrents, et que la TB associée au VIH
implique un pronostic moins grave que d'autres
IOs intervenant dans la définition du SIDA, dans
des groupes appariés de patients.7 Si l'hypothèse
selon laquelle une stimulation immunitaire
simultanée accélère la progression du VIH est
correcte, il est possible que des infections
courantes, qu'elles soient ou non associées au VIH,
puissent jouer collectivement un rôle majeur en
déterminant des taux de progression du VIH dans
des situations où l'exposition à des agents
infectieux et en particulier à des parasites est
marquée. Des différences régionales de l'état basal
d'activation immunitaire existent entre les résidents
de pays industrialisés et ceux des pays en
développement,8 mais il n'existe pas de consensus
clair au sujet du fait que ceci entraînerait des
différences dans le taux de progression du VIH.
3,4,9,10 La possibilité que des poussées de réplication
accrue du VIH associée aux IOs et aux co-
infections parasitaires pourraient contribuer aux
taux de transmission élevés du VIH observés en
Afrique sub-saharienne est peut être de
signification plus importante pour la santé publique
puisque les charges virales plasmatiques et celles
des sécrétions génitales sont corrélées l'une avec
l'autre ainsi qu'avec la contagiosité.11
La survie de personnes infectées par le VIH est

Editorial 3
3
certainement plus courte dans les pays en
développement que dans les pays industrialisés et
ces différences régionales vont en croissant. Le
facteur prédominant toutefois est l'accessibilité et
le standard des soins.12 La mise à disposition de
moyens de diagnostic de l'infection VIH et l'accès
à des interventions basales effectives et peu
coûteuses sont déjà des priorités majeures, le coût
et les barrières logistiques restant les défis-clé qui
doivent être surmontés.12 Pour l'isoniazide et le
cotrimoxazole, les bénéfices indirects
hypothétiques de préservation de la fonction
immunitaire n'ajoutent que peu de supplément aux
avantages directs de la prévention des IOs
spécifiques et ne représentent en rien une raison de
changer les recommandations en cours. Comme
secteurs de recherche qui pourraient effectivement
entraîner des modifications en matière de politique
à suivre, signalons l'investigation de l'impact des
infections intercurrentes qui ne bénéficient pas
encore d'une priorité d'intervention, comme les
helminthiases ou la malaria associée au VIH ainsi
que leur relation avec la contagiosité. Même si la
question de savoir si la TB a un impact quelconque
sur la progression de la maladie VIH peut rester
sans réponse, ceci ne diminue en rien la gravité de
l'épidémie de TB associée au VIH et ne réduit
nullement l'urgente nécessité d'un accroissement de
l'accessibilité aux soins dans les zones sévèrement
atteintes.
ELIZABETH L. CORBETT
KEVIN M. DE COCK
Department of Infectious and Tropical Diseases
London School of Hygiene and Tropical Medicine
Keppel Street WC1E 7HT, UK
Tel : (+44) 20 7927 2116
Fax : (+44) 20 7637 4314
e-mail : elizabeth.corbett@lshtm.ac.uk
Références
1 Badri M, Ehrlich R, Wood R, Pulerwitz T, Maartens G.
Association between tuberculosis and HIV disease
progression in a high tuberculosis prevalence area. Int J
Tuberc Lung Dis 2001; 5 (3): 000-000.
2 Whalen C C, Nsubuga P, Okwera A, et al. Impact of
pulmonary tuberculosis on survival of HIV-infected
adults: a prospective epidemiologic study in Uganda.
AIDS 2000; 14: 1219-1228.
3 Del Amo J, Malin A S, Pozniak A, De Cock K M. Does
tuberculosis accelerate the progression of HIV disease?
Evidence from basic science and epidemiology. AIDS
1999; 13: 1151-1158.
4 Bentwich Z, Maartens G, Torten D, Lal A A, Lal R B.
Concurrent infections and HIV pathogenesis. AIDS
2000; 14: 2071-2081.
5 Mellors J W, Rinaldo C R, Gupta P, White R M, Todd J
A, Kingsley L A. Prognosis in HIV-1 infection
predicted by the quantity of virus in plasma. Science
1996; 272: 1167-1170.
6 Bucher H C, Griffith L E, Guyatt G H, et al. Isoniazid
prophylaxis for tuberculosis in HIV infection: a meta-
analysis of randomized controlled trials. AIDS 1999;
13: 501-507.
7 Petruckevitch A, Del Amo J, Phillips A N, et al.
Disease progression and survival following specific
AIDS-defining conditions: a retrospective cohort study
of 2048 HIV-infected persons in London. AIDS 1998;
12: 1007-1013.
8 Clerici M, Butto S, Lukwiya M, et al. Immune
activation in Africa is environmentally-driven and is
associated with upregulation of CCR5. AIDS 2000; 14:
2515-2521.
9 French N, Mujugira A, Nayiyingi J, Mulder D, Janoff E
N, Gilks C F. Immunologic and clinical stages in HIV-
1-infected Ugandan adults are comparable and provide
no evidence of rapid progression but poor survival with
advanced disease. J Acquir Immune Defic Syndr 1999;
22: 509-516.
10 Deschamps M M, Fitzgerald D W, Pape J W, Johnson Jr
W D. HIV infection in Haiti: natural history and disease
progression. AIDS 2000; 14: 2515-2521.
11 Quinn T C, Wawer M J, Sewankambo N, et al. Viral
load and heterosexual transmission of human
immunodeficiency virus type 1. N Engl J Med 2000;
342: 921-929.
12 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Report
on the global HIV/AIDS epidemic. UNAIDS/00.13E.
Geneva: UNAIDS, 2000.
1
/
3
100%