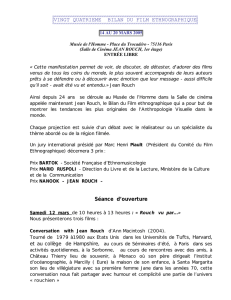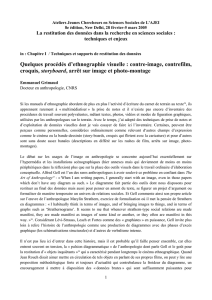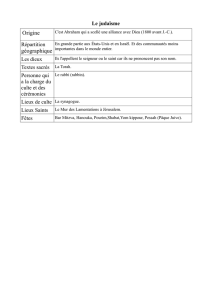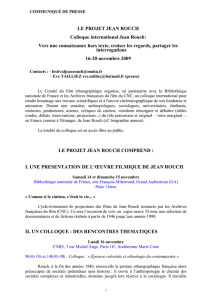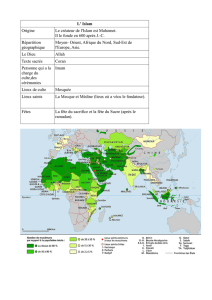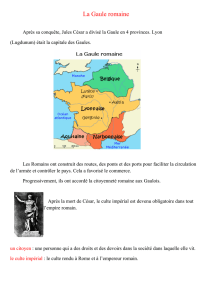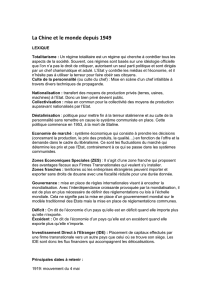Petit à petit - Antoine Chech

1
Dr. Roger Canals i Vilageliu
Universitat de Barcelona
Partage des espaces - espaces de partage
Sur les traces de « Petit à petit »
En 1971 Jean Rouch achevait Petit à petit, un film inclassable et provocateur,
construit sur le voyage de deux Nigériens à Paris et de deux Parisiennes au Niger. À
travers une trame explicitement « fictionnalisée », résultat d’un jeu constant
d’improvisation et d’autoreprésentation, Rouch aborde dans ce chef d’œuvre, avec un
humour aussi fin que tranchant, quelques-uns des thèmes majeurs de l’anthropologie
(l’identité, le rapport à l’autre, l’opposition Ville-Nature) tout en développant une
critique sévère sur les fondements colonialistes et sur une notion occidentale de
« progrès » définie uniquement comme croissance technico-industrielle.
Petit à petit apporte un ensemble de questionnements théoriques et
d’innovations filmiques qui nous concernent et nous surprennent encore. Si l’on
confronte ce film au monde contemporain et aux défis conceptuels et méthodologiques
qui sont les nôtres, on perçoit l’actualité de l’œuvre de Rouch ainsi que les portes qu’il a
permis d’ouvrir pour filmer, interpréter, voire transformer la réalité sociale qui nous
entoure. Mon but dans cet article est de mettre en évidence cette actualité du projet
rouchien en montrant comment certaines des idées surgissant de Petit à petit peuvent
être appliquées à l’étude de l’expansion et de la transformation des cultes afro-
américains et, plus concrètement, du culte à María Lionza (Venezuela), sur lequel je
travaille depuis près de 6 ans.
Les jeux de la différence
Petit à petit se présente comme un jeu de miroirs complexe qui tourne autour de
la question de la « distance culturelle » et de la possibilité de « devenir autre ». Ces
thèmes sont évoqués à partir d’une trame basée sur une série d’allers-retours entre
l’Afrique et l’Europe. Le film commence dans un village au Niger, où la compagnie
« Petit à petit » envisage de construire un immeuble à étages plus haut que celui qu’une
compagnie de la concurrence compte édifier à Niamey. Face à ce défi, M. Damouré,
chef de la compagnie, décide de partir à Paris afin de voir de ses propres yeux comment

2
on construit des « maisons à étages » et pour engager des architectes capables de
réaliser ce projet. Dans la capitale française, M. Damouré découvre un mode de vie qui
lui est étranger : les fleuves et les arbres sont « emprisonnés » derrière des murs ou des
clôtures, les filles, vêtues de mini-jupes, montrent leur jambes, les poulets sont vendus
puis mangés sans avoir été égorgés. Les cartes postales qu’il envoie en Afrique épatent
ses collègues nigériens qui, finissant par le croire fou, décident d’envoyer Lam, un des
employés de la boîte, pour le ramener de Paris. Or, dès son arrivée en Europe, Lam
s’aperçoit que les descriptions de son patron sur la capitale française n’étaient pas
fausses, et que le mode de vie des Parisiens est opposé à celui qu’il connaît. Damouré et
Lam retournent ensuite au Niger, le plan de l’immeuble en main, accompagnés de trois
personnages : une jeune Parisienne, une femme d’origine africaine résidant depuis
longtemps en France et un Québécois rencontré par Lam sur les quais de la Seine. C’est
de retour en Afrique que les choses vont se compliquer : les trois occidentaux ne
s’adaptent pas à la vie nigérienne et décident de quitter l’Afrique. Lam et Damouré,
quant à eux, décident de laisser tomber la construction du bâtiment pour retourner vivre
près du fleuve dans une simple case.
A travers l’histoire des rencontres et des séparations entre ces cinq personnages,
Rouch évoque la question de la confrontation à l’altérité et des possibles passages entre
des contextes culturellement différents. Au début du film, les membres de la société
« Petit à petit » laissent transparaître, par leur projet du « bâtiment à étages », leur
souhait de devenir comme « les autres », c’est-à-dire comme les habitants de la ville ou,
plus généralement, comme ceux du monde occidental. Dans cette volonté de
dépassement des limites et dans cet esprit de concurrence, c’est une philosophie de
progrès comprise comme développement technique qui aurait été incorporée par les
Africains. Une fois à Paris, confrontés à un mode de vie qui n’est pas le leur et dont ils
voient maintenant les vertus et les défauts, Damouré et, surtout, Lam, font l’expérience
de l’altérité, une situation qui se répète, mais à l’inverse, lorsque les trois francophones
vont au Niger. Le cas de la femme originaire d’Afrique habitant à Paris constitue un cas
particulier dans ce mouvement d’échanges et de contacts avec l’étranger. Elle
représente le summum du passage d’une culture vers l’autre. Un passage montré ici
comme douloureux puisqu’elle restera une Africaine en France (où elle doit se
prostituer pour vivre) et une Française en Afrique (un continent dont elle ne comprend
plus les traditions ni la façon de vivre). Grâce à ce personnage, Rouch montre combien
l’identité personnelle est variable voire multiple et, sans oublier la composante politique

3
et raciale du phénomène, donne des pistes pour une étude anthropologique de
l’émigration.
Cette situation de « passage » entre un contexte familier et un contexte étranger
à laquelle tous les personnages du film doivent se confronter est en partie assimilable à
l’expérience que vit l’anthropologue pendant l’enquête de terrain. Rouch suggère cette
analogie notamment lorsque Damouré rend visite à son associé à Paris et que celui-ci lui
dit que, pour vivre à Paris, il doit apprendre « les coutumes et les habitudes » des gens
qui y habitent. Autrement dit, pour comprendre le nouveau contexte où il se trouve, il
faut que Damouré devienne lui aussi anthropologue. Petit à petit incorpore ainsi une
dimension réflexive que l’on voit par ailleurs dans toute l’œuvre de Rouch et qui est
devenue l’un des points capitaux de l’anthropologie contemporaine. Dans ce travail, la
méthode et l’expérience ethnographique deviennent des thèmes inhérents au film ou,
mieux encore, le film finit par être une réflexion sur le projet anthropologique lui-
même.
Or, de quelle genre d’anthropologie s’agit-il ? Rouch oppose ici deux
orientations différentes. La première est celle inspirée des principes coloniaux : lorsque
Damouré réalise des examens anthropométriques auprès des Parisiens sous prétexte de
faire un travail scolaire d’anthropologie, Rouch met en évidence, avec cynisme, la
stupidité d’une étude de l’être humain construite uniquement sur les bases des sciences
naturelles. L’anthropologie devient ainsi ridicule, aussi méprisante que pathétique. Par
cette « mise-en-situation » dans les rues de Paris, Rouch montre la nécessité d’un projet
anthropologique fondé sur la reconnaissance de l’autre comme sujet, comme
interlocuteur, comme être historique. Cette seconde orientation proposée et choisie par
Rouch implique, d’un point de vue méthodologique, de cesser de concevoir la recherche
ethnographique comme une simple analyse faite de l’extérieur pour la comprendre
comme une expérience partagée, une relation sociale donnant lieu à des situations
inédites et visant à une connaissance mutuelle. C’est cette anthropologie-là qui permet
d’en finir avec les préjugés, qu’ils soient sur l’Afrique ou sur l’Europe.
A travers ce jeu d’allers-retours et cette réflexion sur l’anthropologie elle-même,
Rouch élabore une réflexion sur les rapports à l’autre et sur la possibilité de comprendre
un mode de vie étranger grâce à une insertion participante. Par une critique sévère du
colonialisme et de toute idée d’une supériorité culturelle, l’auteur semble suggérer que
si l’étude de l’autre est possible (et donc, si le projet anthropologique a un sens) c’est
parce que l’autre, tout en restant étranger, ne constitue pas une altérité insaisissable.

4
Chez Rouch, la reconnaissance de l’autre comme sujet implique aussi bien la
reconnaissance de sa différence que celle de la possibilité de la franchir. De même,
l’auteur nous indique que s’il y a culture -et donc identité- c’est parce qu’il y de
l’histoire, c’est-à-dire du changement, de l’emprunt et du partage d’éléments entre des
individus et des collectifs divers. Or, comment s’approcher de l’autre ? Comment saisir
ce qui est constamment en transformation ? Rouch nous propose à cette fin un outil et
une méthode privilégiés : le cinéma.
Rouch conçoit le cinéma comme un élément relationnel, un agent de création de
liens sociaux, une technique permettant de déclencher une expérience ethnographique
partagée. D’où la technique dramatique utilisée consistant en une improvisation
incessante et en une interprétation explicitement distancée et antinaturaliste. Avec les
regards à la caméra ou les références des acteurs à leur propre rôle, Rouch rappelle au
spectateur que ce qu’il est en train de voir sur l’écran n’est ni une simple fiction ni une
capture « objective » de la réalité elle-même mais un jeu, un essai, une découverte.
Cette ouverture à l’autre et à l’imprévu caractérisant les films de Rouch met en
évidence la nature très contradictoire du rôle du réalisateur dans le cinéma de recherche.
Il a, d’une part, un rôle créatif et créateur : c’est, en effet, l’anthropologue qui, dans la
plupart des cas, « arrange » la réalité en donnant lieu à des situations
anthropologiquement significatives qu’il filme ensuite. Cela dit, le réalisateur acquiert,
d’autre part, un rôle, disons, passif : il se situe, face aux événements qu’il filme, dans
une position d’attente, laissant les choses se passer devant la caméra, bref, il découvre
« la » réalité en même temps qu’il la tourne. Le film en résultant n’appartient donc ni
entièrement au réalisateur ni entièrement aux participants : l’image du cinéma, et du
cinéma ethnographique en particulier, est toujours la trace d’une rencontre.
Ce caractère dialogique et relationnel du cinéma est porté à ses limites dans Petit
à petit. Rouch y joue en effet sur l’idée de l’échange et de l’interrelation en mettant en
place un double partage : d’une part, un partage du projet cinématographique et donc de
la connaissance anthropologique qui s’ensuit. D’autre part, et c’est là la spécificité de ce
chef d’œuvre, Rouch établit un partage d’espaces géographiques et culturels entre les
protagonistes, donnant lieu à un échange de regards, à un ensemble de situations où
chaque personnage joue autant le rôle d’observateur que d’observé. Par ce jeu de
miroirs, Rouch nous parle du rapport à l’altérité, un rapport construit sur la
reconnaissance d’une différence et à la fois sur l’horizon d’une entente possible.

5
Pour un cinéma des mondes contemporains
Les pistes ouvertes par Rouch dans Petit à petit me semblent être
particulièrement indiquées pour mener des recherches en anthropologie visuelle sur la
transformation et l’expansion des cultes afro-américains aujourd’hui. Ceci est dû
essentiellement à deux facteurs liés à la globalisation et aux enjeux identitaires qui en
dérivent.
Avec l’immigration, le contact culturel et le développement des nouvelles
technologies, les cultes afro-américains -comme la Santería Cubaine, l’Umbanda ou le
Vaudou- sont devenus des cultes globaux constituant une sorte de réseau planétaire en
pleine transformation. Prenons, par exemple, le culte à María Lionza1. Né au Venezuela,
devenu même « la religion » autochtone et représentative de la nation, on le retrouve
aujourd’hui presque partout dans les Caraïbes, au Brésil, aux Etats-Unis et en Europe.
Les pages Internet consacrées à María Lionza et aux pratiques religieuses lui étant
associées sont innombrables. De part leur nature globale et décentralisée, l’étude des
cultes afro-américains dans toute leur complexité n’est possible qu’en adoptant une
approche comparative en réalisant une ethnographie multi-située. Ce n’est qu’en
mettant en relation les différentes pratiques de ces cultes et les discours qui sont générés
autour d’eux que l’on pourra saisir le rôle qu’ils jouent dans la société contemporaine.
Une approche que l’on trouve déjà, du moins potentiellement, dans Petit à petit, avec le
souci que l’auteur y exprime de partager des espaces et de créer ainsi des espaces de
partage, donc de connaissance. Cette perspective comparative ne doit pas concerner
uniquement l’opposition de différentes expressions d’un même culte, mais aussi la mise
en relation de différentes manifestations religieuses, désormais interconnectées. Par
exemple : le culte à María Lionza apparaît intimement lié à la Santería cubaine, au
Palerismo (culte aux morts) ou au Vaudou. Dans ce vaste réseau que constituent les
cultes afro-américains aujourd’hui, l’approche des « regards croisés » proposée par
Rouch s’avère indispensable puisqu’elle est la seule capable d’en saisir toute la
complexité.
Par ailleurs, dans Petit à petit Rouch conçoit l’identité comme quelque chose d’à
la fois structurant et de perméable, unique et multiple. Cette vision dynamique et
plurielle l’identité de l’identité et de l’attachement aux contextes culturels apparait tout
particulièrement apte à permettre la compréhension des relations que les croyants
établissent avec les divinités du culte à María Lionza. Cette religion est basée sur une
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%