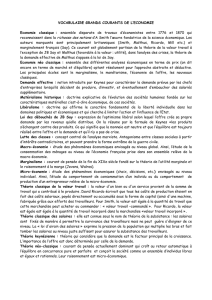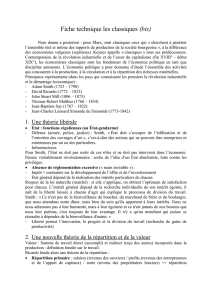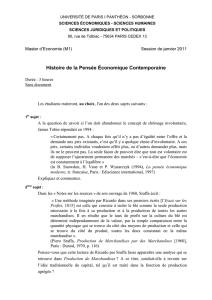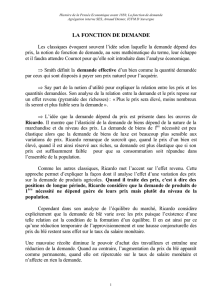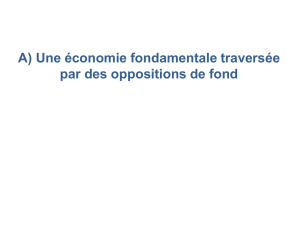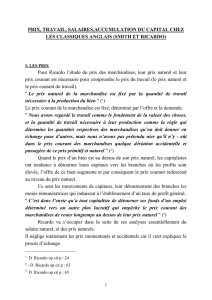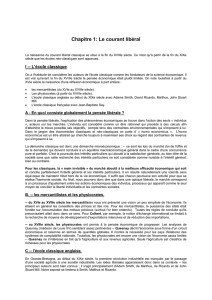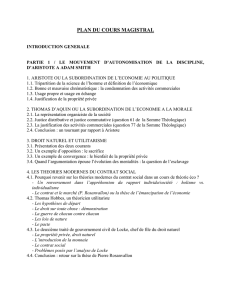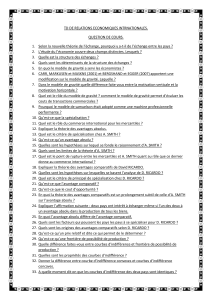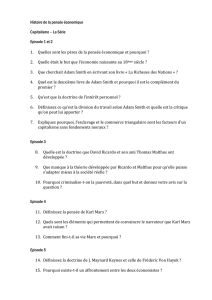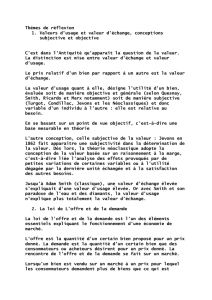Chapitre 2 - fonds pour la recherche en ethique economique

1
Chapitre 2. La pensée classique : de l’agrarianisme à l’analyse systématique
de la production
1. La pensée agrarienne.
1.1. Les physiocrates.
1.2. Adam Smith (1723 - 1790)
2. La pensée systématique ou Le matérialisme de David Ricardo à Piero Sraffa. ??
2.1. David Ricardo
2.2. Piero Sraffa
Introduction ?
L'économie politique classique aurait pu naître en France avec des précurseurs tels que
Vauban ou Boisguilbert, mais elle a trouvé un climat plus favorable en Angleterre avec le
puritanisme. Elle s'ordonne autour de la production et de la séquence :
valeur---> répartition---> prix
1) On peut faire remonter la pensée classique à Vauban ( dont notre collège s'honore
de porter le nom...). Sébastien le Prestre, Seigneur de Vauban ( 1633- 1707), Maréchal de
France, écrivit une foule d'écrits sur les fortifications, la guerre, la marine, les finances
publiques, la religion, la monnaie, l'agriculture et la colonisation. En 1698, il met en place un
recensement de la population et surtout élabore en 1707 un projet d'impôt dit de "dîme royale"
et son "testament politique": afin de simplifier les impôts ( nombreux, compliqués et
inefficaces), il propose un impôt unique sur le revenu, pouvant être de différents taux mais
dont le maximum serait de 10 %.... proposition qui compromettra sa position de favori au près
de Louis XIV. Il est conscient que l'impôt touche l'organisme économique au coeur.
Afin de justifier ce projet ( que l'on retrouvera chez Mirabeau et plus tard
chez....Allais), Vauban argumente avec tous les faits possibles, usant, à la manière de Petty,
de faits, poids et mesures. Non seulement il sera réputé comme créateur de la statistique mais
comme utilisateur de celle- ci aux fins de son argumentation.
" C'est ce qui fait de lui un économiste classique, au sens apologétique du mot, et un
précurseur des tendances modernes, bien qu'il n'ait pas contribué à l'appareil théorique
moderne de la science économique" ( Schumpeter, HEA, pp.203 passim).
La pensée de Vauban et celles de nombreux intellectuels français se retrouve tiraillée
entre la volonté de réformes et une résistance conservatrice très forte. La résolution de cette
tension n'interviendra qu'un siècle plus tard. De ce fait, la pensée classique trouvera plutôt son
inspiration dans l'extraordinaire révolution anglaise.
- 2- L'éthique protestante (Cf. le débat de Max Weber à Tawney) ne constitue pas une
entité globale. Il existe dans l'Angleterre du XVII° siècle une multitude de formes d'esprit
issues de la Réforme. Celle ci liée à l'origine au problème matrimonial de Henri VIII fait de
l'église une institution dont le pouvoir économique et politique sera considérablement réduit;
avec en particulier la dissolution des monastères et la disparition des abbés de la chambre des
Lords. La Réforme a eu en Angleterre un caractère irréversible. Jamais la religion de Rome ne
pourra rétablir son autorité. Tous les souverains qui se compromettront avec Rome y

2
trouveront leur perte, en particulier Charles I° et Charles II. Elle fournit une approche du
monde adaptée à la nouvelle idéologie. En insistant sur la différence entre la connaissance
surnaturelle et la connaissance naturelle, elle donne à cette dernière les moyens de son
émancipation. Cette idée se trouvait déjà chez Calvin dans sa doctrine de la foi active, avec la
dissociation entre la hiérarchie céleste et la hiérarchie terrestre, entre causes principales et
causes secondaires. Mais l'idéologie de Calvin renferme aussi l'idée du contrôle direct de Dieu
sur ses créatures. Aussi, le rôle de Calvin deviendra de plus en plus diffus dans la religion
réformée anglaise Celle- ci minimise le domaine où intervient la puissance divine pour
proclamer le rôle de la nature. A la façon de John Preston, célèbre prédicateur puritain (Cf. Ch
Hill,1958): "Dieu n'altère pas la loi de la nature". Les sermons de John Preston ,comme
d'autres, ont lieu dans des centres contestataires. Chassés de Cambridge avant la révolution,
ils prêchent à Lincoln's Inn ou Gray's Inn où se retrouvent des puritains éclairés. La doctrine
prêchée est celle de la convention : Dieu est omnipotent mais il peut passer une convention
avec son serviteur pour limiter son pouvoir et dès lors ses actions deviennent prévisibles et
compréhensibles. Les "lecturers" , payés par les marchands, seront persécutés par
l'archevêque Laud jusqu'à la révolution; payés par leurs ouailles, ils peuvent proclamer l'après
midi, l'exact opposé de ce qu'a pu dire le matin le clergé officiel.
La tolérance des pays protestants est souvent opposée à l'intolérance qui régnait au
XVI/XVII° siècle dans les pays catholiques. Ainsi la tolérance anglaise pouvait être opposée à
l'intolérance qui régnait en France. Néanmoins, la tolérance en Angleterre n'atteignait pas le
niveau de celle qui régnait en Hollande ; un centre tel que celui de Leydes accueillera de
nombreux jeunes anglais épris de nouvelles techniques et de discussions théologiques.
Jacques II se préoccupera des mauvaises influences acquises par la jeunesse anglaise dans "un
endroit aussi infect que l'université de Leydes.." (cité dans Hill, 1972). La révolution de 1640
fera aboutir, sur la tolérance, les conceptions de Hobbes, Harrington avec de multiples
conséquences idéologiques. La religion perd définitivement l'importance qu'elle avait
auparavant. La pensée devient autonome. La réflexion économique peut s'affranchir de la
morale et s' appuyer sur le seul calcul des avantages et désavantages pour la richesse de
l'individu et de la nation. Le nouvel esprit intellectuel et le nouvel esprit religieux peuvent
coïncider. La nouvelle religion fondée sur l'individualisme permet la méthode expérimentale.
La religion elle- même, représente un terrain d'expérimentation où l'usage de l' autorité
diminue au profit des "soul experiments". Enfin la tolérance religieuse favorise la
productivité: on connaît les calculs de Petty dans ce domaine, montrant comment la tolérance
accroît la productivité de 50% ...
- 3- Plus généralement la pensée classique, sur les fondements socio- politiques du
XVII° siècle, analyse la production, les causes et l'évolution de la richesse. Elle pose de
l'équation pono- physiocratique en partant de l'agriculture ( Physiocrates- Smith- Malthus) et
en terminant par le travail ( Ricardo- Marx).
Elle ne reste pas à la superficie ou aux évidences, en développant des lois contre-
intuitives telle l'analyse ricardienne de la rente, ou les analyses (Smith, Ricardo) de la valeur.
D'où l'idée ( Marx) qu'elle est susceptible d'une critique logique. Elle se différencie ainsi du
sensualisme de Condillac (1776, Le commerce et le gouvernement considérés relativement
l'un à l'autre) et de ce qui sera plus tard le positivisme de Comte ( 1852, le Catéchisme...). Elle
est centrée sur la production, l'offre mais aussi les contradictions sociales. Certes la demande
peut intervenir, résultant de l' expansion démographique ou de l'évolution du pouvoir d'achat
ou encore du comportement des classes dépensières. Mais, elle prend ainsi un aspect
secondaire ou exogène.

3
L' équation ponophysiocratique caractérise la pensée des premiers classiques ( Petty,
1660; et Cantillon, 1755 ). Prenons l'expression qu'en donne Cantillon dans les premières
phrases de son " Essai sur la nature du commerce en général":
" La terre est la source ou la matière d'où l'on tire la richesse; le travail est la forme qui
la produit.."
Cette expression aura de nombreuses versions ( terre mère/travail père) dans l'analyse
de la richesse classique. Une partie des classiques ( physiocrates, Smith, Malthus) insistera
plutôt sur la terre, la seule à même de produire plus qu'elle ne coûte. Une autre considérera
plutôt le travail et le capital ( Ricardo, Marx, Sraffa). Dans ce dernier cas intervient un
problème systématique qui correspond à la séquence de pensée valeur/répartition/prix.
Ainsi on peut poser cette subdivision entre classiques; en distinguant les agrariens d'un
côté et la pensée systématique de l'autre.
1. La pensée agrarienne.
Cette pensée privilégie la terre comme facteur exclusif ( les physiocrates) ou
prioritaire ( Smith et Malthus). Cette pensée est largement répandue en Europe au XVIII° .
1.1. Les physiocrates.
1.1.1. Généralités
a. Les troupes: en grande partie des intendants et contrôleurs généraux des
finances,
Les précurseurs: Boisguilbert ( Le Détail de la France, 1697 ;le Factum de la France),
Cantillon ( cf. supra) , Gournay ( père de la formule laissez faire/ laissez passer) mais ces
précurseurs ne situent pas uniquement en France compte tenu de l'influence de l'agrarianisme
anglais.
Les principaux membres :
Dupont de Nemours ( 1735- 1817), il prépare avec Turgot l'édit sur la liberté du
commerce des grains de 1764; inventeur de l'étiquette "physiocrate", il sera amené à s'exiler
aux États Unis à la fin de sa vie...
Le Mercier de la Rivière, théoricien politique; il est séduit, comme Diderot, par
l'expérience de Catherine II en Russie et expose sa conception du despotisme éclairé dans
l'"ordre naturel et essentiel des sociétés politiques"
Victor de Riqueti, marquis de Mirabeau ( père de..), (1715- 1783), écrit "l'ami des
hommes ou traité de la population" (1759) où il défend l'idée que la richesse dépend de la
population qui dépend des subsistances lesquelles dépendent de la terre...c'est donc la terre qui
est à l'origine de toute richesse.Il rédige l'essentiel, avec Quesnay, de la "philosophie rurale" (
1763).
François Quesnay ( 1694- 1774).
D'origine modeste ( son père issu de la terre est petit avocat au Parlement), il réalise
des études de médecin chirurgien et devient médecin personnel de la Pompadour puis du roi.
Il s'installe à Versailles qui devient le lieu de l'école.

4
Il écrit deux articles de l'encyclopédie ( 1751): "fermiers" et "grains",le tableau
économique ( 1758) et aussi " Le Droit naturel " (1765) qu'il publie dans le "Journal de
l'agriculture, du commerce et des finances", journal dirigé par Dupont de Nemours; il y publie
plusieurs commentaires sur le Tableau. Citons encore " ses maximes générales du
gouvernement d'un royaume agricole "(1758) et encore des propos ayant trait au despotisme
de la chine ou encore au gouvernement des incas du Pérou.
Les sympathisants: de nombreux contrôleurs généraux ( Bertin,1715-1788, grand
protecteur de l'agriculture, Callone, et intendants des finances ( Truden, 1709-1769 et surtout
Turgot..).
Le sympathisant le plus connu est Turgot (1727- 1791), renonçant à la prêtrise et à
l'enseignement, il devient intendant à Limoges où il effectue des recensements. Les idées
physiocrates classiques sont très améliorées avec des théories nouvelles: minimum
physiologique, loi des rendements non proportionnels. I
Les adversaires
Les derniers mercantilistes: Forbonnet, l'abbé Galiani, l'abbé Terray et surtout Necker
qui fera l'éloge de Colbert.
Les classiques: Graslin ( 1727- 1790) selon lequel l'industrie peut être également
productrice nette, ce que l'on retrouve chez l' abbé de Condillac ( 1714- 1780) avec son
ouvrage économique en 1776: du commerce et du gouvernement considérés relativement l'un
à l' autre.
Les pré- socialistes ( Rousseau dont la philosophie sur l'ordre naturel diverge du
conservatisme des physiocrates et surtout ses idées politiques sur la propriété et les inégalités;
l'abbé Mably, Morelly).
Voltaire dont le conte sur l' "homme aux quarante écus" attaque la physiocratie...
b. Généralités sur la pensée des physiocrates
La pensée des physiocrates a toujours été source d'interrogations tant elle repose sur
des dilemmes, sinon apparaît contradictoire:
- dilemme pensée réactionnaire/ moderne. réactionnaire quand elle fait appel à l'ordre
naturel, à la propriété au royaume.
- dilemme "secte française" ou mouvement international
- dilemme entre pensée sociale "macro"( avec des catégories représentatives) et
réflexion sur l'homme. Ainsi Louis Dumont y voit la naissance d'un "tout ordonné", sinon du
holisme
Elle commence ainsi par une réflexion sur la philosophie de l'homme.. puis des classes
et finit par une réflexion sur les agrégats eux mêmes. Cette pensée peut être résumée par trois
ordres:
- l'ordre naturel: une certaine conception de la nature, l'homme et de la société.
Il existe des lois naturelles: "..la législation positive consiste donc dans la déclaration
des lois naturelles, constitutives de l'ordre évidemment le plus avantageux possible aux
homme réunis " en société. ( Droit Naturel). Les transgressions du droit naturel sont la source
de tous les maux. D'où une négation de l'histoire et une immuabilité de l'ordre des choses. La
meilleure critique contemporaine est celle de Rousseau.
L'homme est soumis aux lois naturelles, mû par l'hédonisme ( il est dans la nature
humaine de maximiser son intérêt personnel) et une certaine sociabilité ( le XVIII° est le
siècle de la bienveillance).
La société, régie par le contrat social, met en harmonie les intérêts particuliers et la
société; "l"'intérêt particulier est le premier lien de la société; d'où il suit que la société est
d'autant plus assurée que l'intérêt particulier est le plus abri" ( Mirabeau). Les hommes sont

5
égaux , mais l'inégalité est le fruit des différences de milieu et de capacité dans le travail. D'où
l'idée que la liberté implique la liberté de sa personne et celle des choses acquises par le
travail.
Toute atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie est une atteinte aux droits de
l'homme; la liberté permet la concurrence et la diminution des coûts. Il faut donc condamner
les monopoles et privilèges.
- l'ordre économique: critiques du mercantilisme ( sur l'enrichissement, l'agriculture
productrice nette, libéralisme afin d'assurer un revenu élevé à l' agriculture), les rapports entre
les classes et le tableau économique).
- La richesse ne se confond pas avec le stock monétaire ( car tout dépend de la
consommation productive, i.e ce que , ce que l'on peut consommer sans s'appauvrir. Elle ne se
confond pas plus avec la population. L'expression de Mirabeau est restée célèbre: " Les
hommes se multiplient comme des rats dans un grenier s'ils ont les moyens de subsister"
- Seule l'agriculture est productrice nette:
" Les travaux de l'agriculture dédommagent des frais, payent la main d'oeuvre de la
culture , procurent des gains aux laboureurs et de plus, ils produisent les revenus des biens
fonds( la rente foncière). Ceux qui achètent les ouvrages d'industrie, payent les frais, la main
d'oeuvre et le gain des marchands, mais ces ouvrages ne paient aucun revenu au delà.
L'industrie et le commerce sont stériles, et on ferait double emploi si, dans le but de
calculer la valeur du produit national, l'on additionnait la valeur des biens agricoles et celle
des biens industriels.
- Seule la liberté peut assurer un revenu élevé à l'agriculture. Elle réduit les coûts et
abolit les monopoles. Elle permet d' obtenir de bons prix et d'élever la productivité:
" Abondance et non valeur n'est point richesse. Disette et cherté est misère. Abondance
et cherté est opulence". ( Quesnay). ( cf. editn GF. p. 111)
La liberté intérieure et extérieure est la condition de la richesse:
Turgot: " Quiconque n'oubliera pas qu' il y a des frontières entre les nations, ne traitera
jamais bien d'aucune question d'économie politique".
- L'ordre économique règle les rapports entre les trois classes fondamentales: classe
productive, classe des propriétaires et classe stérile.
* La classe productive ( voir def . in GF p. 209): "celle qui fait renaître par la culture
du territoire, les richesses annuelles de la Nation" Il s'agit en fait des fermiers qui font des
avances:
- avances primitives: dépense en capital fixe ( machines etc....).
- avances annuelles: capital circulant ( semences et salaires).
* "La classe des propriétaires comprend le souverain, les possesseurs de terre et les
décimateurs".(ibid p. 210).Elle subsiste par le revenu ou produit net qui lui est payé
annuellement par la classe productive. Cette classe par sa distribution (naturelle) conditionne
le développement harmonieux du pays ( cf; Malthus plus tard avec le rôle des dépense de
luxe), il est donc nécessaire de protéger la "propriété foncière qui est le prolongement de la
liberté individuelle...". Ces propriétaires font aussi des avances, les avances foncières : fonds
de terre ou infrastructures ( de la part du souverain).
* La classe stérile.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
1
/
64
100%