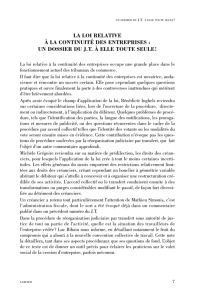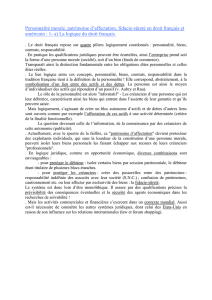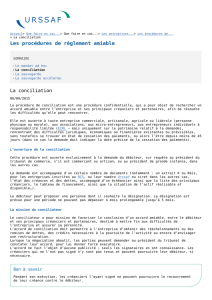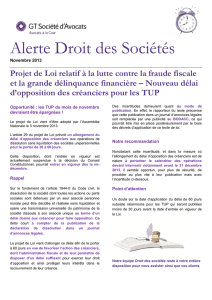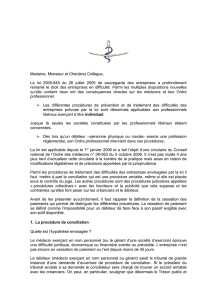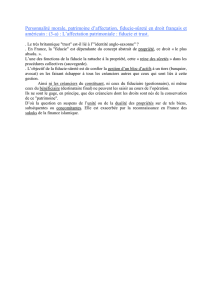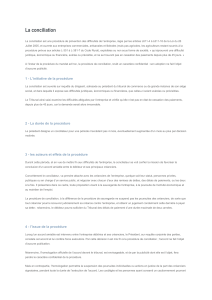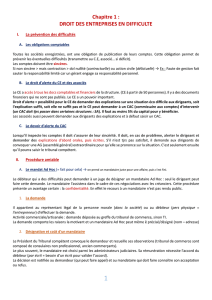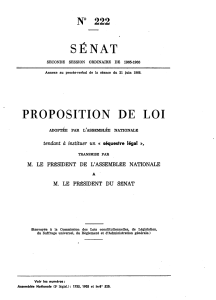FORUM FINANCIER BELGE comité de Verviers Eupen

1
FORUM FINANCIER BELGE
comité de Verviers Eupen
Séminaire du 24 novembre 2010
LA LOI SUR LA CONTINUITE DES ENTREPRISES :
PREMIERS ENSEIGNEMENTS
LE CREANCIER FACE A LA PROCEDURE DE REORGANISATION JUDICIAIRE
BERNARD LEROY,
avocat au Barreau de Verviers.
Frederick, Leroy, Henry et Masset
INTRODUCTION
La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises connaît, depuis son entrée en
vigueur, un incontestable succès. Elle remplace l'ancienne loi sur le concordat judiciaire qui s'était
avérée trop lourde et trop coûteuse et avait suscité une grande méfiance aussi bien dans le chef des
débiteurs qui perdaient le contrôle de leur entreprise que dans le chef des partenaires commerciaux
et des créanciers en raison notamment de l'ambiguïté du rôle du commissaire au sursis.
La législation actuelle donne résolument la priorité à la prévention et à l'aide aux entreprises.
Le débiteur garde le contrôle de ses affaires, bénéficie d'un éventail de possibilités et est ainsi
encouragé à recourir plus tôt à l'aide qui lui est offerte par la loi, ce qui permet d'espérer de
meilleurs chances de redressement.
L'objectif de la loi est de permettre aux entreprises de surmonter leurs difficultés, voire de corriger
leurs erreurs tout en maintenant l'activité économique et en sauvegardant un maximum d'emplois.
La loi envisage même la possibilité de sauver l'entreprise en difficulté malgré elle, toujours dans un
but de continuité et de maintien de l'emploi.
La protection que l'on offre à l'entreprise en difficulté est perçue de façon radicalement différente si
l'on se place du point de vue des créanciers. Il existe et existera toujours un conflit inévitable entre
d'une part, la protection et le sauvetage d'une entreprise en difficulté et d'autre part, les droits de ses
créanciers.
Ceux-ci, de façon compréhensible, restent réservés, sinon carrément méfiants à l'égard des
« faveurs » accordées à leur débiteur par la loi actuelle.

2
La principale crainte des créanciers est évidemment de voir leur situation se dégrader : ils n'ont plus
entière confiance dans leur débiteur alors que celui-ci, qui bénéficie d'un sursis, est laissé à la tête
de son entreprise; ils considèrent que le Tribunal de Commerce ne dispose que de pouvoirs limités
tant à l'ouverture de la procédure qu'au long de celle-ci et lors de l'homologation du plan de
réorganisation .
D'autre part, les créanciers qui bénéficient de garanties craignent de les voir se détériorer au cours
du sursis sans qu'ils aient de réelles possibilités d'intervenir.
« Les créanciers d'une entreprise en difficulté sont d'autres entreprises en recherche de stabilité, des
travailleurs ou des institutions publiques ou d'intérêt public, pour qui la sécurité des échanges
constitue le socle indispensable à leur survie ou à l'efficacité des politiques collectives ou de
solidarité » (Michèle GREGOIRE « Le point de vue des créanciers face à la réorganisation de
l'entreprise de leur débiteur » CUP vol. 120, p. 208).
Il ne faut évidemment pas que la continuité des entreprises en difficulté se fasse au détriment des
entreprises saines ; le but de la loi n'est évidemment pas de permettre à des « canards boiteux » de
prolonger leur existence de façon artificielle et injustifiée dans le cadre de « soins intensifs »
susceptibles de créer une concurrence déloyale ou de mettre d'autres entreprises en difficulté.
C'est dans cet esprit qu'il a paru intéressant d'examiner la loi sous l'angle des droits des créanciers et
des moyens d'action dont ils disposent.
L'exposé sera divisé en trois parties envisageant le point de vue des créanciers, dans le cadre de la
loi relative à la continuité des entreprises, selon qu'on se situe avant ou en dehors de toute procédure
collective, pendant la procédure de réorganisation judiciaire et à l'issue de celle-ci.
* * * *
I. LE CREANCIER AVANT UNE PROCEDURE COLLECTIVE.
1. La prévention
L'article 12 §1er de la L.C.E. prévoit que les chambres d'enquêtes commerciales « suivent la
situation des débiteurs en difficulté en vue de favoriser la continuité de leur entreprise ou de leurs
activités et d'assurer la protection des droits des créanciers ».
C'est donc dans ce double but que la loi donne de réels pouvoirs au juge enquêteur et prévoit des
mesures conservatoires.
Le sujet de la prévention sera abordé de façon approfondie par Madame le Juge Nathalie
BONHOMME et nous faisons donc ici référence à son exposé.
2. Les moyens d'action du créancier.
En dehors de toute procédure collective, le créancier a naturellement la possibilité d'agir
librement en récupération de sa créance par toutes les voies normales lui permettant de prendre des

3
mesures conservatoires, d'obtenir un titre et de le mettre à exécution. L'article 584, 3° du code
judiciaire autorise toutes les mesures provisoires et urgentes de même que la désignation en référé
d'un administrateur provisoire (de droit commun) lequel peut être compétent pour déposer une
requête en réorganisation judiciaire (comm.Verviers, 10/11/2010, inédit aff. DELOS France).
La loi sur la continuité des entreprises donne une autre possibilité intéressante : son article 14
permet en effet à « tout intéressé » de saisir - selon les formes du référé - le Président du Tribunal de
commerce, en cas de manquements graves et caractérisés du débiteur, aux fins de voir désigner un
ou plusieurs mandataires de justice. Il faut préciser que les « manquements graves » dont il est
question ne sont pas nécessairement des « fautes » au sens de l'article 28, ils peuvent être
simplement des évènements qui menacent la continuité de l'entreprise (divergences entre associés,
démissions d'administrateurs, ...).
D'autre part, l'initiative permise par l'article 14 n'est pas supprimée en cas de procédure de
réorganisation judiciaire, elle peut être exercée à tout moment (A. ZENNER, J.Ph .LEBEAU, C.
ALTER « la loi relative à la continuité des entreprises à l'épreuve de sa première pratique », n°65) .
Si cela devient nécessaire, le créancier, dispose également de l'article 8 de la loi sur les faillites qui
permet à « tout intéressé » de saisir le Président du Tribunal de Commerce s'il existe des indices
graves, précis et concordants de la réunion des conditions de la faillite et lorsqu'il y a (simplement)
« urgence » (et non plus comme précédemment « absolue nécessité »). Le Président peut ordonner
le désaisissement du débiteur et désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires chargés de
citer en faillite dans la quinzaine, s'il y a lieu. L'administrateur provisoire art.8 LF est compétent lui
aussi pour déposer s'il y a lieu une requête en réorganisation judiciaire.
Rappelons enfin les dispositions de l'article 182 du code des sociétés (action en dissolution) et, bien
entendu, la possibilité de citer directement en faillite lorsque les conditions sont réunies.
3. L'accord amiable sans procédure
Une des originalités de la L.C.E. est de permettre, en dehors de toute procédure, la conclusion d'un
accord amiable entre le débiteur et deux ou plusieurs de ses créanciers.
Le contenu de cet accord est tout à fait libre, l'accord ne donne lieu à aucune publicité et n'est
exposé à aucun contrôle. Par le dépôt de l'accord au greffe du Tribunal de Commerce – dépôt qui
peut rester confidentiel – les créanciers concernés obtiennent la garantie qu'en cas de faillite
subséquente, les articles 17, 2° et 18 de la loi sur les faillites ne seront pas applicables.
L'article 17,2° de la L.F. prévoit l'inopposabilité à la masse de « tous paiements, soit en espèces, soit
par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues et pour dettes échues, tous
paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce ».
L'article 18 vise la possibilité pour le curateur de faire déclarer inopposables tous les autres
paiements faits par le débiteur avec connaissance dans le chef de celui qui le reçoit, de l'état de
cessation de paiement de son débiteur .
Avec Maître Pierre RAMQUET, on peut regretter que cette exemption ne soit pas étendue à l'article
17,3° de la L.F. (constitution d'hypothèques ou de garanties pour dettes antérieurement contractées),
ce qui aurait eu pour avantage de favoriser la négociation du débiteur avec son banquier (Pierre

4
RAMQUET « Un an d'application de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité de
l'entreprise. L'information, l'accord amiable et la réorganisation par accord amiable ou collectif des
créanciers » Commission Université Palais, vol. 120, p. 90).
La confidentialité de l'accord amiable laisse naturellement les autres créanciers dans l'ignorance
totale de cet accord, mais il ne faut pas oublier que ceux-ci conservent la plénitude de leurs droits.
* * * *
II. LE CREANCIER DANS LA PROCEDURE DE REORGANISATION JUDICIAIRE.
L'article 16 de la loi qui définit le but de la procédure de réorganisation judiciaire prévoit que celui-
ci est « de préserver, sous le contrôle du Juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en
difficulté ou de ses activités ».
L'intérêt et les droits des créanciers ne sont pas expressément visés, l'accent est mis sur la continuité
de l'entreprise et sur le triple choix qui lui est offert.
Nous verrons toutefois que tout au long des différentes procédures, les créanciers gardent des
possibilités significatives d'intervention ou de recours.
1. Les différentes sortes de créanciers.
L'article 2 de la loi définit les différentes sortes de créanciers en adoptant un nouveau vocabulaire
justifié par le fait que la procédure en réorganisation judiciaire ne crée pas de concours entre les
créanciers et afin de ne pas créer de confusion avec les autres situations de concours; cela modifie
assez sensiblement les catégories habituelles puisque, en l'espèce, les créanciers qui bénéficieraient
d'un privilège « général » ne peuvent logiquement l'exercer et sont mis sur le même pied que les
créanciers ordinaires. Cette seule question à fait l'effet d'une véritable révolution et provoqué une
abondante jurisprudence concernant notamment les droits du fisc et de l'ONSS.
Les créanciers sont définis en fonction du caractère de leurs créances, à savoir :
Créances sursitaires : il s'agit des créances nées avant le jugement d'ouverture de la
procédure, ou les créances nées du dépôt de la requête ou des décisions prises dans le cadre
de la procédure (cela vise notamment l'hypothèse de l'article 35 §2, cas où le débiteur décide
de ne plus exécuter un contrat en cours et s'expose à des dommages et intérêts, ou encore la
créance de la TVA en remboursement de taxes récupérées par les créanciers en cas
d'abattement prévu au plan )
Créances sursitaires extraordinaires : il s'agit des créances garanties par un privilège spécial
ou une hypothèque de même que les créances « créanciers propriétaires ».

5
Créanciers propriétaires : personne dans le chef de laquelle sont réunies simultanément les
qualités de titulaire d'une créance sursitaire et de propriétaire d'un bien meuble corporel qui
n'est pas en sa possession et qui fait office de garantie (c'est le cas par exemple de la vente
avec une clause de réserve de propriété, ou du leasing d'un bien meuble corporel, les
immeubles étant exclus).
Créances sursitaires ordinaires : toutes les créances sursitaires qui ne sont pas
extraordinaires .
En dehors de ces créanciers concernés par le sursis, il existe naturellement d'autres
créanciers « non sursitaires » qui seront confrontés à la procédure de réorganisation
judiciaire; il s'agit notamment des titulaires de créances nées postérieurement au jugement
d'ouverture de la procédure, c'est-à-dire durant le sursis ou après celui-ci.
2. L’information des créanciers
a) Dispositions générales
En dehors des créanciers concernés par l'article 22 de la loi (effets du dépôt de la requête) qui seront
nécessairement avertis, il n'est pas prévu de publicité particulière pour le dépôt de la requête
initiale; cela paraît normal car il s'agit d'une procédure sur requête unilatérale menée au départ avec
discrétion et ce, d'autant plus que la demande en réorganisation peut être rejetée si les conditions ne
sont pas réunies.
L'article 26 §1er prévoit la publication au Moniteur Belge du jugement d'ouverture de la procédure
de même que les différentes mentions obligatoires (il n’y a plus de publication dans les journaux) ;
le §2 du même article précise que le débiteur doit lui-même aviser individuellement ses créanciers
des mêmes données et ce, dans les 14 jours du prononcé du jugement.
Aucune publicité n'est prévue par l'article 38 dans le cas d'une prorogation du sursis.
L'article 39 qui prévoit la possibilité de modifier l'objectif de la procédure ne prévoit que la seule
publication au Moniteur. On remarquera dès lors que si le transfert d'entreprise n'est envisagé que
via une modification de l'objectif de la procédure, ce qui est fréquent, les créanciers ne doivent pas
en être avertis individuellement, contrairement à l'hypothèse où le transfert d'entreprise est envisagé
dès le début.
b) La réorganisation par accord collectif
L'article 45 exige du débiteur lui-même qu'il communique à chacun de ses créanciers sursitaires le
montant de sa créance dans les 14 jours du prononcé du jugement qui ouvre la procédure avec la
mention éventuelle du privilège spécial et de son assiette ou du bien dont le créancier est
propriétaire.
Lorsque le plan de réorganisation est déposé au greffe, les créanciers en sont individuellement
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%