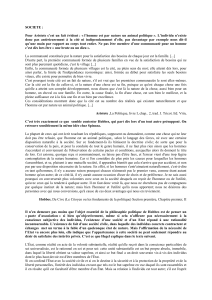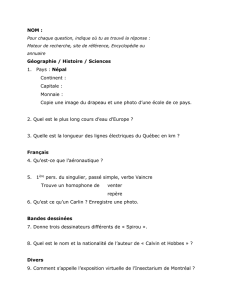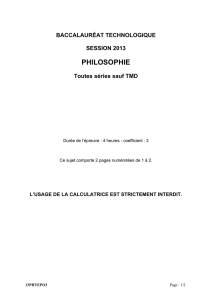Chapitre 2 Caractéristiques et limites de la question de la justice

183 / 520
II. Caractéristiques et limites de la question de la justice
dans les théories
La philosophie morale et politique n'a eu que peu à dire sur les relations internationales.
S.Hoffman in J. Rawls, Le droit des gens, Editions Esprit, Seuil, 1996.
Il est surprenant qu'en dehors de l'aire anglo-saxonne l'éthique des relations internationales ne
constitue pas un terrain d'exploration parmi les recherches effectuées en sciences humaines.
K.-G. Giesen, L'éthique des relations internationales, Bruxelles, Bruylant, p5.
S. Hoffman affirme que Rawls est le seul à essayer de fournir une théorie de la justice dans le système
international1. Or c'est faux, comme nous allons le voir dans ce chapitre, mais cela prouve à quel point le sujet
ne fait pas l'objet d'une grande attention, en tout cas dans les pays industrialisés.
La philosophie comme discipline s'est effectivement peu penchée sur la question de la justice internationale.
Traditionnellement, on se réfère à trois grands courants : l'anarchie de Hobbes, l'internationalisme de Grotius, et
le cosmopolitisme de Kant. Ces auteurs restent les références majeures dans le domaine, avec des travaux
vieux d'au moins deux cents ans ! Le seul courant réellement neuf dans ce domaine est le courant économiste,
incarné par J. Rawls et, dans une moindre mesure, R. Nozick. L'originalité de ce courant est l'accent mis sur le
mécanisme du marché pour réguler les relations entre les hommes, tandis que les trois autres se réfèrent aux
institutions en général, sans en privilégier une au premier abord. Cette approche est tout spécialement mobilisée
dans la problématique environnementale, aussi devrons-nous attacher une importance particulière à son analyse.
Le rapport du GIEC mentionne en effet trois auteurs ayant explicitement travaillé sur la question de la justice : J.
Rawls, R. Nozick, et H. Shue. R. Nozick est un défenseur du marché pur, et H. Shue un théoricien des besoins
fondamentaux : on peut donc considérer que Rawls est une bonne synthèse des deux, et c'est principalement à
lui que nous nous référerons.
La philosophie ayant finalement peu à dire sur le sujet, nous nous sommes intéressé à d'autres disciplines. On
constate par exemple qu'il existe une analyse de l'éthique des relations internationales, principalement en langue
anglaise. Il faut ici prendre « éthique » au sens le plus large, comme l'ensemble du champ axiologique et
normatif dans lequel l'être humain s'oriente. Davantage étudiée par les sciences politiques que par la philosophie,
l'éthique des relations internationale ne procède donc pas à une problématisation philosophique : il s'agit d'une
analyse des relations humaines qui admet l'existence des valeurs, et qui s'efforce de les ordonner dans une
description rigoureuse.
Il nous a semblé qu'il était possible de répartir les approches en éthique des relations internationales en trois
grandes catégories : le réalisme (l'anarchie des Etats), l'éthique du droit naturel (droit transnational, droit naturel,
droits de l'Homme), et le cosmopolitisme néo-libéral (« société de marché »). Le cosmopolitisme néo-libéral est
actuellement la théorie de la justice qui domine les analyses. Bien entendu, il s'agit là d'une typologie, et comme
telle elle serait contestable. Nous espérons toutefois avoir établi une grille de lecture pertinente, qui ne rompt pas
avec les approches traditionnelles en philosophie.
1 J. Rawls, Le droit des gens, Paris : Editions Esprit, 1996, p. 100.

184 / 520
Il reste la question du marxisme. Nous ne l'aborderons pas directement, pour plusieurs raisons. La première
est notre insuffisante connaissance du sujet, et le manque de temps nécessaire pour se plonger de manière
conséquente dans l'immense héritage marxiste. La seconde est que cette approche est très peu présente
actuellement dans les pratiques et dans les théories de l'éthique et de la justice à l'échelle internationale. La
troisième raison est la question de la séparabilité de la vision marxiste par rapport à sa philosophie de l'histoire,
indéniablement datée et invalidée par l'histoire elle-même. La dernière raison est que le marxisme est finalement
très proche du néo-libéralisme, comme nous l'avons vu plus haut, et que la différence essentielle réside dans le
statut de la propriété : privée et intouchable pour le néo-libéralisme, démocratisable pour le marxisme. La
propriété étant une institution, c'est finalement à une question d'institution que nous sommes ramenés, et cela les
autres approches en tiennent compte.
Que les internationalistes et les économistes ne s'offusquent pas. Nous allons recourir ici à des théories qui
appartiennent à leur domaine, sans pour autant avoir la maîtrise d'un spécialiste. L'objet étant transdisciplinaire, il
nous faut recourir à plusieurs disciplines. Mais comme chaque discipline demanderait en soi une thèse pour être
maîtrisée à l'égal des spécialistes, le risque de lacune est évidemment important. Il nous faut pourtant accepter
cette imprécision, sous peine de risquer d'en commettre de plus importantes encore en restant dans un cadre
purement disciplinaire. Nous avons préféré conserver une grande ouverture à notre sujet, en essayant de ne
commettre aucun oubli important, plutôt que de le réduire et de risquer de perdre des liens primordiaux.
Les courants de pensée que nous présentons ici ont un caractère idéal-typique. Les penseurs qui
représentent chaque courant stricto sensu, sans concessions pour les deux autres, sont rares. L'avantage de ce
type de présentation est avant tout analytique, et il importe de garder cela à l'esprit : il ne s'agit pas d'écoles
stabilisées et rigoureusement identifiées. Le courant néo-libéral présente dans ce domaine le plus de difficulté :
les auteurs qui s'en réclament peuvent adopter des positions proches d'un réalisme relativement strict, tandis que
d'autres sont beaucoup plus proches du cosmopolitisme. Tout dépend en grande partie de ce qu'on entend par
« marché » et des vertus qu'on lui prête. Il n'existe pas de définition précise du marché, ni de critères stricts pour
l’identifier dans le monde. D'une manière générale, on parle de « marché » dès qu'il y a des échanges
marchands, voire même dès qu'il y a des échanges.
Enfin, il faut être attentif à ne pas confondre le néo-libéralisme, ou libéralisme économiste et utilitariste, avec
le libéralisme politique, qui englobe un domaine plus large et en particulier un souci du social et du politique
qu'ignore le premier. Pour éviter la confusion, nous emploierons le terme « néo-libéral » pour le premier, pour
pouvoir réserver le qualificatif de « libéral » pour le second.
Nous allons essayer ici de montrer quels sont les apports et les limites de chaque approche, tout
particulièrement dans la problématique du changement climatique. Cette analyse nous servira de base et d'appui
pour élaborer, dans une troisième partie, les cadres d'une théorie de la justice qui tentera de dépasser certaines
de ces limites, et de mieux rendre compte de ce qui a lieu dans la crise environnementale en général et dans la
lutte contre les changements climatiques en particulier.
Nous aborderons donc successivement trois théories : l'anarchie des Etats, l'éthique du droit naturel et le
cosmopolitisme néolibéral.
Pourquoi ce choix ? S'il nous a semblé indifférent d'avoir commencé par l'anarchie des Etats ou par l'éthique
du droit naturel, il était par contre important de finir par le néo-libéralisme, pour plusieurs raisons. La première
est que c'est actuellement la théorie dominante en matière de théories de la justice, en ce qui concerne les
problématiques dans lesquelles la question de l'environnement intervient. Il était donc intéressant de bénéficier
des apports et des insuffisances des deux autres approches pour pouvoir l'aborder de la manière la plus
complète possible. Ensuite, parce qu'en un sens c'est la plus compliquée, car elle puise très largement dans la
science économique. C'est celle qui nous a demandé le plus de travail. Elle constitue donc le plus gros de

185 / 520
l'effort. Enfin, parce que c'est une théorie qui n'entretient plus de relations particulièrement claires avec la
philosophie, à la différence des deux autres. Là aussi, l'apport des deux autres s'est révélé très utile.
Pourquoi avoir abordé l'anarchie des Etats en premier ? Il n'y a pas de raison particulière. Nous aurions pu
inverser les deux premières parties sans dommage pour le raisonnement. Nous avons finalement choisi
l'anarchie des Etats parce que c'est le cadre d'analyse habituel des relations internationales : il constitue le
fondement de ce qu'on appelle le réalisme, et ne prend pas souvent la forme explicite d'une théorie de la justice,
nous verrons pourquoi. Mais pourquoi fait le choix de rebaptiser ce réalisme du nom d'anarchie des Etats ?
Parce que le concept de « réalisme » prête à un grand nombre d'ambiguïtés : le réalisme est-il plus « réaliste »
que les autres théories, et si oui en quoi ? Il nous a semblé que non, le caractère réaliste ou non ne permettait en
aucun sens de discriminer cette théorie par rapport aux autres. Cette dénomination est sans doute pertinente
dans d'autres contextes, mais elle ne semblait recouvrir rien de concret au regard de notre sujet, et nous avons
préféré marquer une certaine distance à cet endroit.

186 / 520
1. L'anarchie des Etats
1. Contours
i - Le Léviathan2
Thomas Hobbes (1588-1679) entend dégager la connaissance de la nature et des affaires humaines tant
de la métaphysique que de la religion. Impressionné par l'œuvre de Descartes, il voit dans le mécanisme un
moyen efficace d'y parvenir.
Il constate que partout les hommes se battent pour « la justice ». Par un argument nominaliste, Hobbes fait
alors remarquer que « justice » n'est qu'un mot, et que l'important est que les hommes arrivent à se mettre
d'accord sur ce qu'il désigne. Sans cela, « la doctrine du juste et de l'injuste est débattue en permanence à
la fois par la plume et par l'épée »3. Loin d'être absente des débats, c'est bel et bien la question de la justice
qui est source de conflit. La postérité a en général retenu du Léviathan le projet de reconstruction d'un Etat civil
qui serait avant tout artificiel, entendant par là qu'il s'agirait d'une autorité construite par la volonté humaine. Or
volontaire peut aussi signifier arbitraire, et cela Hobbes en est conscient au plus haut point. Sa réflexion va
donc beaucoup plus loin.
Hobbes assoit sa théorie sur une anthropologie, qu'il mène comme une étude empirique de la nature
humaine. Il établit alors que l'être humain est un être de désir, dont la passion la plus forte est la volonté de se
conserver. Cette passion prend son origine dans la peur de la mort, cette peur qui est aussi à la source de la
« religion » entendue comme discours sur « l'au-delà » de la vie. Les « biens » sont les objets des sens qui
provoquent l'attirance, le désir, tandis que les « maux » sont les objets qui provoquent la répulsion, l'aversion. Les
« biens » ne se réduisent pas aux biens matériels, et encore moins aux biens marchands : Hobbes tient aussi
compte de l'amitié, de la réputation etc. L'enquête sur la nature humaine permet d'ancrer le raisonnement hors
de la religion, dans les faits naturels. De fait, l'être humain dispose d'une certaine puissance, force. De fait, il est
animé par des passions. Chaque homme est pourvu d'une raison, dont il se sert pour tirer parti des choses et des
hommes pour maximiser ses « biens ». La raison est ici comprise comme la capacité à calculer les biens et les
maux issus des conséquences de différentes actions. La connaissance consiste en la mise en ordre de mots, de
manière à représenter adéquatement l'enchaînement des causes et conséquences matérielles. La science est
connaissance des conséquences.
Hobbes écrit pendant la révolution anglaise. Au cours de cette période troublée, les violences civiles
impliquaient non seulement les citoyens mais aussi les pouvoirs cléricaux et les puissances étrangères, dont la
France. Ceci n'est pas sans influence sur sa pensée. Il imagine un état de nature dans lequel les hommes étaient
en conflit permanent, la « guerre de tous contre tous », selon le mot célèbre, dans laquelle la vie de l'homme
était « solitaire, misérable, dangereuse, animale et brève »4. Hobbes en déduit que le premier droit naturel de
l'homme est le droit à l'auto conservation, et à la défense. Dans l'état de nature, dont par ailleurs Hobbes doute
qu'il ait réellement existé, ceci mène au conflit permanent : la nature a dissocié les humains, et les a faits si
égaux en puissance que chacun peut utiliser son pouvoir à son propre avantage et à sa conservation, cherchant à
prendre contrôle d'autrui pour ne pas être soi-même menacé. En l'absence d'autorité capable d'arbitrer entre les
différentes prétentions, il règne la défiance et la violence.
La solution vient de la création de l'Etat. Les hommes remettent leur pouvoir dans une autorité souveraine
unique, établie par le contrat de tous. La multitude devient alors « le peuple », unifiée par ce représentant des
volontés individuelles qu'est le souverain. Chacun remet à un tiers, le futur souverain, le droit de gouverner. Pour
que le souverain soit capable de gouverner, chacun renonce à exercer son pouvoir propre pour régler les
différends. Le souverain agit dans les limites imparties par le pacte social : les sujets sont les auteurs du rôle du
2 T. Hobbes, Léviathan, 1651.
3 T. Hobbes, ibid., p. 194.
4 T. Hobbes, ibid., p. 225.

187 / 520
souverain, lequel en est l'acteur. Le Léviathan est un dieu mortel qui, après et mieux que le dieu immortel, dont
le royaume n'est pas de ce monde, garantit la paix et la protection des citoyens. L'Eglise doit donc être
subordonnée à l'Etat, qui ne peut accepter de concurrence en matière d'autorité sans se voir aussitôt incapable
de réaliser ce pour quoi il a été construit. La foi est en passe d'être privatisée, c'est-à-dire renvoyée à chacun
comme une affaire privée, qui ne concerne pas l'organisation politique de la société.
L'Etat instaure la loi, qui est construite, conventionnelle, artificielle. Cette loi conventionnelle permet
d'atteindre ce que prescrit la « loi de nature », définie comme le « précepte ou règle générale trouvée par la
raison »5. Et que dit ce précepte ? Que « chacun a l'interdiction de faire ce qui détruit sa vie, ou qui le
prive des moyens de la préserver »6. La loi de nature prescrit la protection des personnes et le maintien de la
paix. La loi est donc conventionnelle, mais pas arbitraire : le critère qui permet de l'établir est cette loi naturelle
qu'on reconnaît par la raison naturelle, innée, ancrée dans la nature humaine, et donc universelle. La loi de
nature est une indication, mais non un déterminisme du type des lois physiques. Les hommes peuvent ignorer ses
commandements, les trahir ou simplement se tromper. Son respect doit donc être le fait d'une autorité, capable
de contraindre la volonté. L'institution d'un pouvoir capable de coordonner les volontés sur des lois qui sont les
mêmes pour tous est la solution qui empêche le conflit.
La souveraineté de l'autorité est absolue, illimitée, indivisible et inaliénable : Hobbes ne conçoit pas qu'on
puisse remettre un pouvoir limité au souverain. Tous les hommes consentent à renoncer à la force, et sont égaux
devant ce consentement. La seconde loi de nature énonce qu'on n'abandonne un droit que si on dispose d'autant
de liberté que les autres. Ce consentement leur garantit à tous la protection des mêmes droits contre les
violations de ces droits par autrui. Cette pensée de l'Etat ne se soucie donc pas de discriminer les régimes : peu
importe s'il s'agit d'un roi, démocratie, tyrannie etc. La souveraineté n'est limitée que par la loi naturelle des
individus, qui peuvent résister à l'Etat si celui-ci atteint à leur conservation7. Hobbes accorde donc le droit de
résistance à l'oppression et le droit de résister aux châtiments de l'Etat, seulement dans le cas où il y a tentative
d'atteinte à la conservation des individus. Aucune convention ne peut violer ce droit. Ce n’est pas exactement le
droit de résistance à l’Etat : on ne peut pas s’associer pour combattre l’Etat, mais seulement se défendre ou fuir
en cas de traitement abusif par les serviteurs de l’Etat.
Thomas Hobbes est l'auteur de deux ruptures importantes par rapport à la pensée politique scolastique.
La première est qu'il refuse de voir les hommes comme des êtres politiques par nature, à la différence
d'Aristote. Les relations interhumaines sont donc ici conçues comme essentiellement conflictuelles,
problématiques, et l'accord est rare et fragile, quoique d'une grande valeur. C'est cet aspect qui sera repris pour
comprendre les relations internationales comme anarchie des Etats, dans lesquelles il n'existe pas d'autorité
suprême reconnue. La seconde rupture est l'ancrage de sa théorie politique dans la nature humaine, et une
nature passionnelle avant d'être rationnelle : l'homme est un être de désir disposant d'une puissance par laquelle
il tend à rechercher ce qui contribue à la préservation de son être. Par suite, l'être humain recherche les êtres et
les choses qui peuvent l'y aider. La construction d'un monde civil, artificiel, vise à éliminer les choses qui
procurent de la douleur et multiplier les choses qui procurent du plaisir.
On a pu lire l'œuvre de Hobbes comme un hédonisme politique8, ancêtre de l'utilitarisme et des théories du
marché. C'est une lecture réductrice : Hobbes parle plutôt de droits, et bien peu de libertés commerciales. Le
bien commun en son sens le plus général est ce qui le préoccupe. Il affirme par exemple que la distribution des
matières premières et la constitution de la propriété revient à la puissance souveraine, sans cela il y a risque de
guerre. Pour lui, les lieux de commerce des matières comme de leur distribution doivent dépendre directement
du souverain, car le privé est un particulier qui peut être poussé par l'appât du gain à nourrir l'ennemi9. Hobbes
5 T. Hobbes, ibid., p. 230, Chap 14 : Des premières et deuxièmes lois naturelles, et des contrats.
6 T. Hobbes, ibid., p. 230, Chap 14.
7 T. Hobbes, ibid., p. 346-347, Chap 21 : De la liberté des sujets.
8 L. Strauss, Droit naturel et histoire, Paris : Flammarion, 1986, Ed. orig. 1954, p. 171.
9 T. Hobbes, ibid., p. 383, Chap 24 : De l'alimentation et de la procréation de l'Etat.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
1
/
86
100%