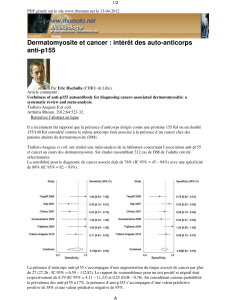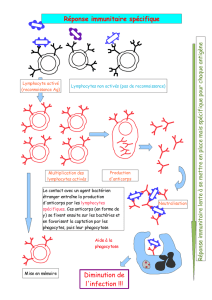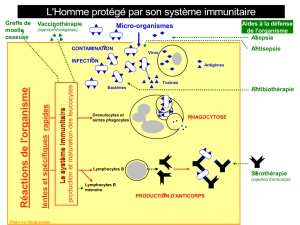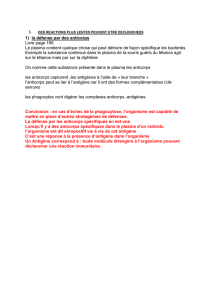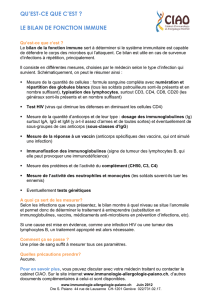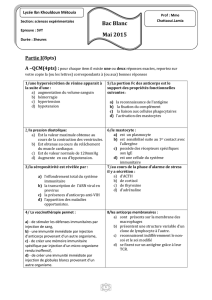biologie - Faculté de pharmacie de Paris

BIOLOGIE
RENE
DESCARTES
N°1
Septembre 2002
Edité par la faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Paris 5
(4 avenue de l’Observatoire, 75006 Paris)
avec le soutien FAIP de l’Université René Descartes.

JOURNAL JOURNAL SCIENTIFIQUESCIENTIFIQUE
BIOLOGIE BIOLOGIE RENE DESCARTESRENE DESCARTES
EDITORIALEDITORIAL
Par Véronique HANIN-PAULINO
Quel plaisir et quelle joie d'édi-
ter ce premier numéro de notre…
"Journal Scientifique
Biologie René Descartes"
Comment est né ce journal ?
C'est en cherchant un cadre
nouveau pour travailler avec les
étudiants de la filière scientifique
de notre université que l'idée de
l'écriture d'un journal scientifique a
germé. Elle s'est vite transformée
en un projet pédagogique initié au
cours des enseignements dirigés
d'immunologie en licence de biolo-
gie. Sur trois séances d'enseigne-
ments dirigés, les étudiants, divisés
en plusieurs groupes, ont eu à
écrire un article de synthèse sur un
sujet de forte actualité dans la litté-
rature spécialisée internationale.
Chaque groupe était chargé de la
rédaction d'un chapitre de l'article,
puis une séance finale en travail
commun était consacrée à l'assem-
blage des différents chapitres. De
ce travail, est née la revue de syn-
thèse que vous trouverez en page 3.
A l’issue de ces enseignements
dirigés et alors que l’enseignement
d’immunologie était terminé, cer-
tains étudiants ont accepté de pour-
suivre le travail engagé et de mener
à terme le projet, à savoir écrire un
journal complet.
Une demande de soutien dans le
cadre d'un appel d'offres de l'Uni-
versité René Descartes sur le Fonds
d'Aide à l'Innovation Pédagogique
nous a alors permis de formuler
concrètement deux objectifs par
rapport à ce journal. Un objectif
pédagogique : permettre aux étu-
diants de concrétiser sur un support
nouveau leurs capacités de curiosité
intellectuelle, d’analyse, de critique
et de synthèse, autour de sujets
d’actualité scientifique. Un objectif
technologique : utiliser, pour la
réalisation du journal, le contexte
interactif de travail sur l’Intranet
Share Object de l'université (expéri-
menté sur le site pilote de la Faculté
de Pharmacie) et se familiariser avec
à la fois les logiciels de traitement de
texte et d'outils graphiques et la navi-
gation sur le WEB. Les étudiants
utilisent ainsi un outil qui leur permet
d’être en relation permanente les uns
avec les autres et avec leurs ensei-
gnants, au sein d'un groupe
d’utilisateurs défini. Notre projet a été
sélectionné sur cet appel d'offres
FAIP et nous sommes très heureux de
ce soutien apporté par notre universi-
té.
Très rapidement, d'autres ensei-
gnants de la licence, attirés par l'expé-
rience pédagogique, s'y sont associés.
Nous avons donc constitué un Comité
Editorial, dont la liste des membres
est indiquée ci-contre. Ce journal est
la réalisation propre des étudiants. Ce
sont essentiellement eux qui en ont
proposé les sujets. Notre fonction, en
tant qu'enseignant a été principale-
ment un rôle de vérification scientifi-
que, de correction et de coordination.
Le comité éditorial a choisi de
diviser ce journal en plusieurs rubri-
ques à contenu majoritairement scien-
tifique mais aussi concernant leur vie
universitaire au sein de leur filière
scientifique. Vous pourrez donc lire
la revue de synthèse, les brèves, le
futur et le bloc-notes…
Une idée, un projet pédagogique,
son appropriation par les étudiants,
l'engagement de certains d'entre eux
et de collègues enseignants pour le
mener à son terme, voici les ingré-
dients d'une belle aventure où motiva-
tion et dynamisme ont côtoyé science
et formation…
Rendez-vous pour les deux pro-
chains numéros prévus pour
l’année universitaire 2002/2003 !
SOMMAIRESOMMAIRE
L'éditorial p. 2
La revue de synthèse p. 3
Les brèves p. 9
Le futur… p. 14
Le bloc-notes p. 16
La photo de promo p. 20
LE COMITE
EDITORIAL
Membres étudiants
Alexandra NABA,
Jamila ELBCHIRI,
Yalin EMRE,
Gabrielle VENTURA,
Omid AMIR-MOAZAMI,
Djamel HAMANI,
Sylvie REMAUD,
Sylvie DE SA,
Guillaume BAXTER,
Sabrina CHENOT,
Aurélie CHAMBRIER,
Marie-Laure MICHEL,
Thierry DUCHEMANN,
Alexandre BLANC,
Khaoussou SYLLA,
Yann TOIRON,
Vincent PAUPE,
Armelle BOSQUILLON.
Membres enseignants
Véronique HANIN-PAULINO,
Virginie LASSERRE,
Dominique MARTIN,
Anne-Judith WALIGORA,
Christophe MOINARD,
Thierry NOËL,
Jean-Louis BEAUDEUX,
Jean-Pierre CLOT,
Philippe MANIVET,
Hélène ROUACH.
Membre d'honneur
Pr Dominique DURAND, Doyen de la
faculté des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques

REVUE DE SYNTHESEREVUE DE SYNTHESE
PAGE 3
LE LE RENOUVEAU RENOUVEAU DES ANTICORPS DES ANTICORPS MONOCLONAUXMONOCLONAUX
Par les étudiants du Comité Editorial
HISTORIQUEHISTORIQUE
Les premières générations
d’anticorps monoclonaux (Acm) sont
réalisées en 1975 par Kohler et Mils-
tein (prix Nobel 1980), à partir de
cellules murines. Ces Acm dérivent
d’hybridomes provenant de la fusion
d'une cellule normale de souris et
d’une cellule cancéreuse. A partir de
1980, des essais cliniques
d’utilisation thérapeutique des Acm
aboutissent dès 1982 à un premier
succès: l'application d'un anticorps
anti-idiotype dans le traitement du
lymphome. Ce succès suscite alors un
vif intérêt économique et commercial
pour l'utilisation des Acm. En 1986,
la FDA (US Food and Drugs Admi-
nistration) approuve l'anticorps mo-
noclonal OKT3 (anti-CD3) dans le
traitement des rejets des allogreffes.
Puis dès 1987, démarrent les premiers
essais cliniques avec des Acm chimé-
riques souris/humains (voir chapitre
suivant). Cependant, à l'orée des
années 90, on observe une baisse
d’enthousiasme pour l’utilisation
thérapeutique des Acm. A cela plu-
sieurs raisons: leur toxicité
(essentiellement due à leur origine
murine), leur manque d’efficacité et
leur coût élevé. Des essais avec des
Acm produits cette fois par fusion de
cellules d'origine humaine com-
mencent alors à être réalisés mais les
problèmes d’instabilité posés par ces
cellules humaines ne permettent de
produire qu’un petit nombre de ce
type d'anticorps.
Entre 1980 et 1992, la principale
production d’Acm testés en essais
cliniques correspond à des anticorps
murins, avec huit produits pour la
seule année 1991. Par contre, seule-
ment deux à quatre Acm chimériques
sont développés chaque année de
1988 à 1994. En 1994 de graves ef-
fets secondaires sont observés lors de
l’utilisation aux Etats-Unis de l'anti-
corps chimérique Campath 1H (déve-
loppé pour le traitement de l’arthrite
rhumatoïde). Cet échec thérapeutique
va entraîner alors un ralentissement
important dans la production de ce
type d'Acm.
Malgré tout, entre 1980 et 2001,
dix Acm ont été approuvés et mis sur
le marché : 1 murin, 5 chimériques et
4 humains/humanisés (voir tableau
domaines d'application et traite-
ments)… Et plus de 200 produits,
toutes formes et pathologies confon-
dues, ont été introduits par des com-
pagnies dans des études cliniques.
Depuis 1995, ce nombre a surtout
augmenté grâce aux progrès du génie
génétique, qui ont permis le dévelop-
pement d’Acm chimériques humani-
sés et d’Acm humains produits par la
transgénèse. Les premières phases
d'essai de ce type d'Acm ont montré
une demi-vie longue, de faibles capa-
cités à induire une réponse anti-
anticorps, et une interaction efficace
avec des effecteurs naturels.
TROIS GENERATIONS D’TROIS GENERATIONS D’ANTICORPSANTICORPS ::
DE L’ANTICORPS DE DE L’ANTICORPS DE SOURISSOURIS
A A L’ANTICORPSL’ANTICORPS HUMANISE HUMANISE
L'utilisation des premières généra-
tions d’Acm de souris (obtenus par
hybridation lymphocytaire après
immunisation de cet animal) ne fut
pas à la hauteur des espérances en
matière de thérapeutique chez
l’homme. En effet, l’injection d’Acm
de souris à l’homme entraîne chez lui
une réponse contre ces protéines
étrangères. Cette réponse est appelée
HAMA : réponse humaine contre les
Acm murins. Cet effet conduit à limi-
ter le nombre d’injections, et entraîne
une perte de l’efficacité au cours de
l’administration de ces Acm.
Les limites des Acm murins ont
ainsi motivé la recherche pour les
rendre mieux utilisables chez
l’homme.
Des tentatives d’« humanisation »
de ces Acm ont été réalisées sur la
base des meilleures connaissances de
la structure des Immunoglobulines.
Cela aboutît à la création de la se-
conde génération d’Acm, grâce aux
techniques d’ingénierie des protéines,
à savoir la réalisation d’Acm chimé-
riques où 33% de la molécule
(correspondant aux domaines dits
variables) restent d’origine murine,
les domaines dits constants étant
d’origine humaine. Cette transforma-
tion permet de lever l’obstacle lié à la
réponse HAMA. Toutefois, on a
observé que l’affinité des Acm chi-
mériques pour l’antigène, n’atteint
pas celle des Acm murins parentaux.
Cela est dû en grande partie à une
région intermédiaire de l’Acm (dite
charpente) qui n’intervient pas direc-
tement dans l’interaction Antigène -
Anticorps mais semble jouer un rôle
de premier plan quant au positionne-
ment optimal de la zone de reconnais-
sance de l'antigène. L'étape ultime de
cet ingénierie des Acm est l'obtention
d'Acm humanisés, où seul 10 % de la
molécule est d'origine murine,
correspondant à la zone stricte de
reconnaissance de l'antigène, combi-
née au hasard (technique de "shuf-
fling").

REVUE DE SYNTHESEREVUE DE SYNTHESE
PAGE 4
La résolution du problème
d’humanisation des Acm pourrait
provenir d’une troisième génération
d'anticorps obtenus par réalisation de
souris transgéniques. Ces souris sont
capables de produire directement des
Acm humains par transfection de
gènes humains et inactivation des
gènes murins. L'inconvénient actuel
de cette méthode est que la quantité
d’ADN transfectable reste encore trop
limitée pour permettre d’assurer une
production large du répertoire des
anticorps. Cette technique présente
cependant deux avantages. D’une
part, la souris transgénique est en
mesure de produire des Acm humains
dirigés contre les antigènes humains,
et d’autre part, différentes lignées de
souris peuvent être développées de
manière à obtenir de façon sûre un
Acm de domaines constants désirés,
en fonction de l’application thérapeu-
tique envisagée.
Outre l’humanisation, la structure
en domaines de l’outil anticorps, a
favorisé le développement et
l’utilisation de fragments d’anticorps.
L’idée étant l’obtention de la plus
petite molécule capable de se lier à
l’antigène. Cela a permis la produc-
tion de différents formats de frag-
ments d’anticorps avec l’obtention,
dans un premier temps, de fragments
par digestion enzymatique (les
F(ab’)2 et F(ab)). Puis l’ingénierie
génétique a permis de se limiter aux
seuls domaines variables VH et VL
pour la production de fragments dont
la forme à chaîne unique, ScFv, est
obtenue grâce à un peptide de jonc-
tion entre VH et VL. A partir de cette
chaîne unique peuvent être créées des
formes multimériques : Diabody,
Triabody et Tétrabody.
type d’Ac schéma pourcentage
murin avantages inconvénients
Acm murin
100 % pouvoir thérapeutique sur
les lymphomes
efficacité faible
forte toxicité
réponse HAMA
coût
Acm sans région
Fc (=Fab)
¢origine murine
100 % Réponse
HAMA diminuée pas ou peu d’effet
Ac chimères
33 % bonne affinité
réponse HACA
(réponse humaine
contre
les Acm chimères)
Ac humanisé
10 % durée de vie augmentée affinité aléatoire
Ac humains
(souris transgéni-
que)
0 %
durée de vie augmentée
capable de déclencher
l’apoptose des cellules ci-
bles
peu d’effet sur les
tumeurs avancées
anticorps
monoclonal
Fab’2
Fab scFv Fv VH
anticorps
monoclonal
bispécifique
Fab’2
bispécifique
Diabody
bispécifique
biscFv
diabody bivalent
triabody
anticorps chimérique
anticorps
«humanisé »
«souris »
«homme »
anticorps
monoclonal
Fab’2
Fab scFv Fv VH
anticorps
monoclonal
bispécifique
Fab’2
bispécifique
Diabody
bispécifique
biscFv
diabody bivalent
triabody
anticorps chimérique
anticorps
«humanisé »
«souris »
«homme »

REVUE DE SYNTHESEREVUE DE SYNTHESE
PAGE 5
LES MECANISMES D’ACTLES MECANISMES D’ACTION DES ANTICORPSION DES ANTICORPS
MONOCLONAUXMONOCLONAUX EN EN THERAPEUTIQUETHERAPEUTIQUE
Les anticorps sont des glycopro-
téines qui protègent l’organisme
contre l’invasion d’agents pathogè-
nes, dans le cadre d’une réponse
immunitaire spécifique. Il existe un
grand nombre d’Acm répertoriés à ce
jour mais dans une perspective d'utili-
sation thérapeutique, il est important
de connaître les mécanismes qui
peuvent être mis en jeu par ces anti-
corps in vivo. Deux grands types
d’Acm sont décrits: les Acm nus,
dont l’action est liée à leurs propriétés
propres et les Acm armés, dont
l’action est due à une substance cou-
plée à l’anticorps.
Les Acm nus
Différentes expériences ont per-
mis de mettre en évidence trois prin-
cipaux mécanismes d’action pour ce
type d’anticorps : des fonctions de
neutralisation, de signalisation et de
ciblage.
La neutralisation est une première
voie d’action directe. Les Acm vont
empêcher l’action de facteurs de
croissance, de cytokines ou d’autres
médiateurs solubles en se liant direc-
tement au facteur soluble lui même
ou à son récepteur. De cette façon, ils
peuvent prévenir l’entrée et la propa-
gation du pathogène en bloquant
l’interaction récepteur-ligand.
Le ciblage est une deuxième voie
d’action directe. En cas d’invasion
microbienne, les anticorps sont capa-
bles de reconnaître des structures
antigéniques de l’agent pathogène et
cette reconnaissance induit directe-
ment l'élimination de ce pathogène
par deux mécanismes principaux : le
premier de ces mécanismes est le
CDC pour « complement dependent
cytotoxicity » : la fixation de l'anti-
corps sur l'antigène active le système
du complément. Cette activation
entraîne la destruction de la cible à la
fois par opsonisation de l'agent pa-
thogène qui va favoriser le recrute-
ment de phagocytes et par la constitu-
tion d’un complexe de lyse cellulaire
directe, le CAM (complexe d'attaque
membranaire) au niveau de la mem-
brane du pathogène.
Le deuxième mécanisme est l'ADCC
pour antibody dependent cellular
cytotoxicity : les anticorps, fixés
spécifiquement sur une structure
antigénique par leur région variable,
sont reconnus au niveau de leur ré-
gion constante (fragment Fc) par
différentes cellules effectrices,
comme les macrophages ou les cellu-
les NK (natural killer…). Cette re-
connaissance se fait par l'intermé-
diaire de récepteurs particuliers pour
ce fragment Fc. Cette interaction Fc-
RFc déclenche l' activité cytotoxique
de ces cellules sur la cible antigéni-
que.
La signalisation est une voie
d’action indirecte qui recrute d’autres
effecteurs. L’anticorps, par l'effet de
sa plurivalence antigénique, permet
de regrouper au niveau de la mem-
brane de la cellule cible les mar-
queurs antigéniques reconnus. On
parle d'agrégation. Ce phénomène
peut alors induire au niveau intracel-
lulaire l’activation des voies de signa-
lisation de l’apoptose, via des casca-
des de phosphorylations aboutissant à
l’arrêt du cycle cellulaire et donc à la
mort de la cellule cible.
Les Acm armés
Ils ne font pas appel à une action
directe de l’anticorps ou à d’autres
éléments effecteurs, c’est un élément
conjugué à l’anticorps qui détruit la
cellule cible. Des isotopes radioactifs,
des enzymes ou des toxines peuvent
être conjugués aux anticorps et ainsi
leur conférer une forte toxicité contre
l’agent pathogène. Des résultats pro-
metteurs ont pu par exemple être mis
en évidence via différents types
d’anticorps monoclonaux radio-
marqués utilisant différents mécanis-
mes d’action décrits pour les Acm
nus.
Cellule cible
Antigène cible pour
le facteur soluble
Facteur
soluble
Inhibition de la
croissance et de la
prolifération
Apoptose
Opsonisation et
mise en place du
complexe de lyse
Cellule
effectrice
SIGNALISATION
CIBLAGE
NEUTRALISATION
ADCC
CDC
Activité
cytotoxique
Cellule cible
Antigène cible pour
le facteur soluble
Facteur
soluble
Inhibition de la
croissance et de la
prolifération
Apoptose
Opsonisation et
mise en place du
complexe de lyse
Cellule
effectrice
SIGNALISATION
CIBLAGE
NEUTRALISATION
ADCC
CDC
Activité
cytotoxique
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%