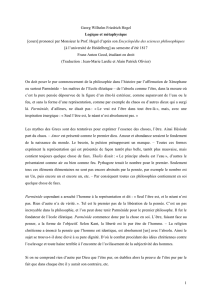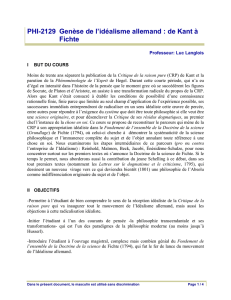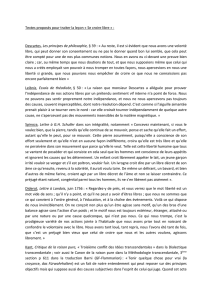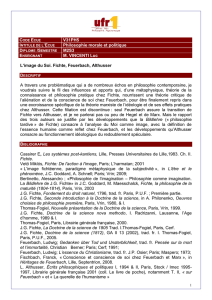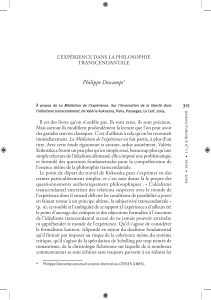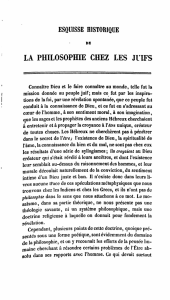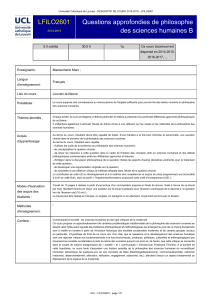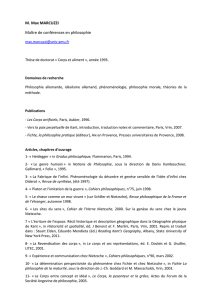Position de thèse - Université Paris

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
ÉCOLE DOCTORALE CONCEPTS ET LANGAGES
Équipe d’accueil 3553 Métaphysique : histoires, transformations, actualité
T H È S E
pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
Discipline : HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
Présentée et soutenue par
Maxime CHÉDIN
le 25 février 2012
L’idéalisme de Fichte et la question de la
philosophie comme science
Sous la direction de M. Jean-François COURTINE (Professeur, Université de Paris-
Sorbonne)
JURY:
M. Jean-François COURTINE (Professeur, Université de Paris-Sorbonne)
M. Jean-Christophe GODDARD (Professeur, Université de Toulouse Le Mirail)
M. Jean-Marie LARDIC (Professeur, Université de Nantes)
M. Alexander SCHNELL (Maître de conférences HDR, Université de Paris-
Sorbonne)

1
Position de thèse
« Ce que l’on choisit comme philosophie dépend
de l’homme que l’on est ; un système
philosophique n’est pas, en effet, un instrument
mort, que l’on pourrait prendre ou rejeter selon son
bon plaisir ; mais il est animé par l’esprit de
l’homme qui le possède »
Ce travail se propose d’interroger le lien entre l’idée de science et l’idéalisme. L’entreprise
peut paraître étrange : quel sens y a-t-il à associer deux concepts si éloignés ? Pour l’opinion,
l’« idéaliste » est celui qui nie les contraintes du monde effectif, un rêveur qui prend ses désirs pour
des réalités. Réciproquement, le sens commun tient pour évident que la connaissance scientifique,
étant essentiellement objective et utilisable, est par définition « réaliste ».
Au point de vue philosophique pourtant, il en va autrement, et le lien entre ces deux concepts
s’avère essentiel. Voyons pourquoi. Que la connaissance scientifique soit objective n’est pas nié par la
philosophie, mais sous son regard, cette objectivité devient problématique. En effet, celui qui réfléchit
à la transformation d’une opinion en science, trouvera qu’elle ne peut avoir lieu que par la production
soit d’une démonstration logique, qui rend raison du contenu et de la forme de la proposition (qui rend
nécessaire, donc objectif, un contenu d’abord appréhendé comme contingent), soit d’une preuve de sa
correspondance avec la norme de ce qui est effectivement réel, l’expérience sensible. Le premier cas
est celui d’une science que l’on pourrait qualifier d’axiomatique, connaissance qui ne se préoccupe
que de la correction formelle et de la cohérence interne de ses déductions, sans se soucier d’un accord
avec l’expérience sensible ; le second, celui des sciences dites expérimentales. Or concernant la
science démonstrative (essentiellement logique et mathématique), la philosophie s’avise assez tôt du
fait qu’il ne peut exister de démonstrations sans des principes qui demeurent en leur sein
indémontrables, et en conséquence, que toute connaissance démonstrative doit finalement reposer sur
des principes qu’elle ne peut objectiver à partir d’elle-même et qui demeurent pour elle injustifiables.
Au commencement de chaque science, il y a donc quelque chose de subjectif, d’arbitraire, à savoir la
décision de postuler certaines propositions et de les tenir pour des axiomes non interrogeables,
évidents. De là naît la question de savoir si ces principes, qui ne peuvent être fondés ni justifiés à
l’intérieur des sciences particulières, peuvent l’être dans une autre science, qui aurait spécialement
pour tâche de reproduire leur genèse à partir d’un principe supérieur et réellement absolu, et ainsi de
conférer à ces postulats la nécessité et l’objectivité qui leur font défaut tant qu’ils demeurent des
principes, c’est-à-dire des postulats arbitraires et subjectifs. Ce qui ne signifie pas que la philosophie
soit une simple « épistémologie », qui n’aurait pour fonction que de justifier après-coup les principes
des sciences particulières. Le projet a un sens plus radical : retrouver la source première de l’évidence,
du savoir certain, déjà voilée et recouverte quand débute l’enquête des sciences particulières. Cette
science possible, Platon la nomme « dialectique » et l’oppose qualitativement aux autres sciences : elle
est la seule à être anhypothétique, c’est-à-dire à partir non pas d’une évidence donnée – comme c’est
le cas des sciences particulières –, mais de la source vivante de toute évidence donnée. Au contraire,
on appelle science particulière un savoir qui ne peut commencer à démontrer sans admettre au moins
un principe dont l’évidence n’est pour lui que factuelle, c’est-à-dire obscure, et au fond
incompréhensible. Ainsi, lorsque je trouve que quelque chose est à l’évidence ainsi, sans qu’il me soit

2
possible de comprendre pourquoi, ni de garantir que cela ne pourra être autrement (par exemple
lorsque je trouve que l’espace que j’intuitionne et dans lequel je me meus a évidemment trois
dimensions et seulement trois dimensions). Autrement dit, les sciences particulières – ce que l’on
nomme aujourd’hui simplement « la science » – ne sont pas auto-fondatrices, elles ne sont pas en
mesure de justifier pleinement leur prétention à une validité objective, car les principes dont elles
partent ne produisent pas une évidence absolue ou, comme le dit Fichte, génétique, mais seulement
une évidence « factuelle », c’est-à-dire reçue de l’extérieur par un « hiatus irrationnel », donc
contingente.
Jusqu’ici, nous n’énonçons rien que l’on ne puisse tirer d’une tradition dont Fichte, sans la
connaître directement, hérite par l’intermédiaire de Jacobi – celle du livre VII de la République et des
Seconds Analytiques. Mais il faut aller plus loin. Car ce défaut d’objectivité intrinsèque (ou d’auto-
objectivation) ne concerne pas seulement les sciences démonstratives formelles, il frappe aussi bien les
sciences expérimentales ou empiriques, c’est-à-dire les sciences modernes, qui prétendent non
seulement à une objectivité interne (cohérence hypothético-déductive), mais encore à une validité
objective externe, et qui l’établissent en exhibant la coïncidence de leur théorie avec l’expérience
sensible. Une théorie scientifique est si l’on veut une théorie qui peut être falsifiée par l’expérience. Or
en même temps que prend naissance avec Galilée la science expérimentale moderne, qui prétend
découvrir les lois de la nature, la philosophie s’avise avec Descartes de ce que l’expérience sensible
n’est pas objective en soi, mais seulement pour le Moi. Cette intuition, qui ouvre l’époque de la
philosophie moderne et se développe jusqu’à Fichte, pose un problème majeur, qui préoccupe la
réflexion philosophique jusqu’à Nietzsche et la phénoménologie : celui du subjectivisme. En effet la
philosophie adresse à la science aussi bien qu’à elle-même la question suivante : s’il n’y a d’être,
d’objet, de monde, ou de nature, que pour le Moi, n’est-ce pas parce que rien n’existe que par le Moi,
autrement dit, qu’à travers les objets et toute la nature, je n’ai jamais affaire qu’à moi-même et ne
connais jamais rien d’autre que moi-même, sans atteindre l’être tel qu’il est en lui-même ? « En toute
perception [d’une chose extérieure], tu ne perçois jamais que ton propre état » ; ou encore : « le
monde n’est rien de plus que le Moi intuitionné dans ses limites originaires », résume Fichte de façon
lapidaire.
Encore faut-il s’entendre sur le contenu de ce que nous avons appelé « Moi ». En l’expliquant,
nous serons conduit à clarifier l’autre concept central de notre travail, celui de l’idéalisme. Pour
appréhender l’unité de la pensée moderne, il faut entendre le mot « Moi » en un sens d’abord
indéterminé, nom commun de toute activité informatrice, de toute instance productrice de sens et de
représentation. Et remarquer que l’éventualité que cette instance puisse coïncider avec le moi
individuel ou subjectif de chacun n’a en réalité jamais retenu l’attention d’un seul philosophe, encore
moins celle des sciences humaines, tant elle est spéculativement pauvre. En revanche, comprise
comme une subjectivité au sens large, cette instance a pu être identifiée, en philosophie, à la Raison, à
une volonté de puissance, à un sujet transcendantal, à un Dasein, à un champ transcendantal
impersonnel, etc. Dans les sciences humaines, à une structure collective (la société comme contrainte
extérieure), à un inconscient psychique structuré, etc. Le point commun de ces démarches, c’est
d’admettre que l’être objectif du « monde » (par exemple celui de la structure sociale pour le
sociologue, du « caractère » psychique de l’individu pour le psychanalyste), qui apparaît à la
conscience commune comme indépendant d’elle et subsistant par soi, est en réalité constitué et
produit, ou du moins conditionné, par une instance que l’on peut qualifier de subjective, non pas au
sens où elle serait identifiable à l’activité consciente et volontaire des individus particuliers, mais au
sens où elle est une activité productrice de sens et de représentation. Par suite, même si elle est pensée
comme une structure ou comme un champ impersonnel, cette activité ou cette instance, une fois

3
admise comme principe (et quelle que soit la façon dont on détermine son contenu), pose la question
de savoir si l’homme peut accéder à une autre sphère de réalité que celle des représentations et des
interprétations qui émanent d’elle. Une telle impossibilité définirait alors le subjectivisme, non pas au
sens solipsiste où chaque individu particulier, enfermé dans son monde, serait « la mesure de toutes
choses », mais au sens d’un subjectivisme de la forme ou de la structure, d’un subjectivisme
« transcendantal » en quelque sorte. Radicalisant l’hypothèse de Nietzsche, qui affirmait dans le §374
du Gai savoir que l’existence est un acte continu d’interprétation, Foucault ira par exemple jusqu’à
dire que si connaître c’est interpréter, et si l’interprétation est devenue pour nous, modernes, une tâche
infinie, impossible à achever (c’est-à-dire s’il n’y a pas de savoir absolu), c’est au fond parce que nous
reconnaissons qu’il n’y a rien à interpréter : « Il n’y a rien d’absolument premier à interpréter, car au
fond, tout est déjà interprétation, chaque signe est en lui-même non pas la chose qui s’offre à
l’interprétation, mais déjà interprétation d’autres signes. »
C’est ici que s’opère la jonction qui nous intéresse entre l’interrogation sur l’objectivité du
savoir scientifique et la signification philosophique moderne de l’idéalisme, qui s’élabore de Descartes
à Kant, et que Fichte va porter à son achèvement. Car ce que nous avons appelé « subjectivisme » – de
façon impropre, puisque l’instance productrice de sens, d’interprétation ou de représentation, n’a
jamais été identifiée par les philosophes au sujet individuel – c’est en fait ce que la philosophie a
proprement appelé, à partir de Kant et de Fichte, idéalisme. Pour ce dernier, l’idéalisme est
l’affirmation selon laquelle le réel est idéel (plus tard : représentation, interprétation, langage, sens,
etc.). Cette affirmation, selon laquelle idéalité et réalité sont une seule et même chose considérée à
deux points de vue différents, ne signifie pas que la « matière » est une illusion ni que le monde qui
nous entoure ne serait qu’un songe creux, « irréel » – malentendu d’où provient l’opposition politique
triviale de « l’idéaliste » qui ignore les contraintes du réel et du « réaliste » qui sait s’accorder avec
elles pour les modifier. La thèse selon laquelle le réel est idéel cherche seulement à traduire
conceptuellement l’intuition selon laquelle nous ne saisissons comme réel que ce que nous pouvons
penser, nous représenter. Ou si l’on préfère, que nous ne saisissons comme effectivement réel que ce
dont nous pouvons parler, ce qui a une forme. Dans l’idéalisme de Fichte, cette forme, la seule
possible, c’est celle de la conscience ou du savoir, ou encore, mais cela est indissociable, celle de la
parole, du dire (Istsagen). L’idéalisme est l’affirmation que la forme de l’être (i.e. la forme du est qui
me permet de dire que « ce mur est » et ce qu’il est, la forme de toute parole qui parle de quelque
chose, quel que soit son mode d’être) est la forme de la conscience, ou plutôt est la conscience elle-
même. La conscience elle-même : non pas au sens subjectif du mot, par où j’oppose ma conscience
individuelle à celle de mes semblables (ma personne aux autres personnes), mais au sens de la
conscience générale de soi, par laquelle je me distingue et me sépare, non pas d’autres « moi », mais
de la « chose » sans forme et sans nom que « je » serais moi-même sans cela, cet « être en soi »
insaisissable qui pour le savoir est égal au néant. Cette conscience est ce que Fichte nomme au début
de son œuvre l’« égoïté » (Ichheit) ou le « Moi absolu » (das absolute Ich, par opposition au moi
« empirique », qui est celui de ma personnalité ou de mon individualité).
Pour comprendre ce que désigne ce mot « moi », pris au sens absolu, Fichte demande, de
façon paradoxale, que l’on « produise l’abstraction de son propre moi [personnel] ». Dans la suite de
son œuvre, découragé par les malentendus incessants générés par cet emploi il est vrai contre-nature
du mot « moi », Fichte désignera plus volontiers son principe par les termes de savoir (Wissen), de
raison (Vernunft), ou encore d’Idée (Idee), au sens grec. Il n’y a pas d’être absolument « en soi » :
l’être n’est, ou si l’on préfère, n’apparaît (n’existe), que dans et pour le Moi (que dans et pour un
savoir). « La conscience de l’être, c’est-à-dire le est par rapport à l’être, est immédiatement l’existence
de l’être (Dasein des Seins) », c’est-à-dire la révélation ou manifestation de l’être en lui-même sans

4
nom et insaisissable. Mais la conscience n’est pas qu’un des modes possibles par lesquels l’être se
donne ou apparaît : elle est « la seule forme et le seul mode possible de l’existence de l’être, si bien
qu’elle est en fait elle-même, de façon immédiate et absolue, l’existence de l’être », écrit Fichte en
1806. La conscience ou l’Idée (ou encore la parole, logos), est l’existence de l’être, ce qui fait que
l’être est là pour nous (Da-sein), c’est-à-dire ce qui fait qu’il peut être interprété, représenté, recevoir
un sens. Ainsi défini, l’idéalisme est donc sans rapport avec ce que vise le sens commun : ce n’est pas
une attitude psychologique consistant à refuser de voir le réel, à rêver d’un avenir impossible. C’est
une position ontologique, c’est-à-dire une compréhension et une détermination de l’essence du réel.
Tout ce qui est, est nécessairement pour le Moi (au sens défini). Nous ne pouvons rien dire, ni rien
savoir, d’une chose « en soi » ; l’existence de l’être, et la seule qui soit possible, est la conscience ou le
savoir de l’être. Voilà pour ce qui concerne la forme générale du principe de l’idéalisme moderne – ce
qui n’est encore rien dire du contenu spécifique de l’idéalisme fichtéen.
Résumons. La connaissance scientifique est une connaissance objective ou elle n’est rien.
Mais cette quête d’objectivité se heurte à deux obstacles, invincibles pour la science : le statut de ses
principes d’abord, qui ne seraient pas principes si elle pouvait les objectiver ; la possibilité et le sens
d’un accord ou d’une correspondance de nos représentations avec la réalité extérieure (l’expérience
sensible), ensuite. La connaissance scientifique ne peut pas prouver théoriquement son objectivité, elle
ne peut progresser sans tenir pour évidents, non seulement ses propres principes, mais encore
l’existence d’un accord général de notre représentation avec ce qui est hors de notre représentation. Or,
au regard d’une conception conséquente de l’évidence rationnelle, ces deux présupposés sont tout sauf
évidents, puisqu’ils ne sont que factuellement évidents. La connaissance scientifique est ainsi
constamment menacée de se voir ravalée à n’être qu’une simple interprétation, une vision du monde
sans valeur de vérité, une « interprétation d’interprétation », qui n’a au fond rien de réel ni d’objectif à
interpréter.
Or c’est précisément la considération de ces deux obstacles qui introduit la connexion entre
l’idéalisme philosophique et la science. Poussée par la logique idéaliste, la philosophie tente avec
Fichte de résoudre cette double difficulté en se constituant à son tour comme science : une science qui
aurait pour objet précisément ce qui ne peut jamais devenir l’objet des sciences particulières. C’est à
cette hypothèse que Fichte donne le nom de « science de la science » ou « Doctrine de la science »
(Wissenschaftslehre). La philosophie idéaliste moderne exige de résoudre en son sein, de façon
autonome, cette double aporie dont les sciences particulières ne pourraient se charger sans renoncer à
leur objet propre et à leur fécondité. Kant formule la première face du problème en demandant
comment il est possible que l’entendement forme tout à fait a priori des concepts des objets, avec
lesquels les objets de l’expérience doivent pourtant nécessairement s’accorder. L’autre face trouve
chez Fichte et chez Hegel une expression tranchée : si la philosophie doit être la Science (i.e. la
science qui a pour objet la source de toute science, donc le développement du savoir, de la
conscience), son objet ne peut pas être un objet immédiat, autrement dit un objet donné par
l’expérience, qui pourrait être observé et contrôlé par la représentation ; il est bien plutôt « opposé à la
manière de connaître procédant de la représentation ». En conséquence, pour dégager le fondement
ultime du savoir, la philosophie doit paradoxalement commencer par renoncer à présenter un
« fondement », c’est-à-dire un principe que l’on pourrait se représenter et qui appartiendrait au genre
de ceux que la science reconnaît comme seuls scientifiques. La philosophie ne peut commencer (c’est-
à-dire se procurer un objet) sans susciter de la part de la conscience représentative le soupçon qu’elle
n’est pas une science, mais plutôt une pseudo-science, une considération subjective et arbitraire. Ce
qui en un sens est vrai, car la philosophie ne pourrait pas être la science qu’elle vise à être, si elle était
une science à la manière des sciences particulières.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%